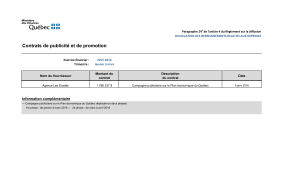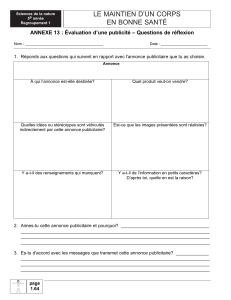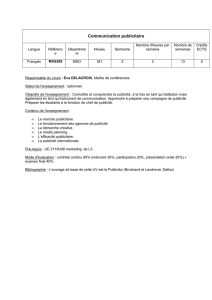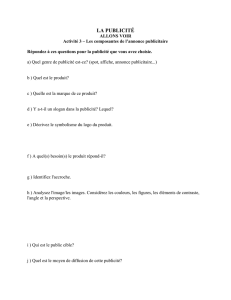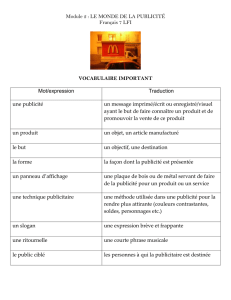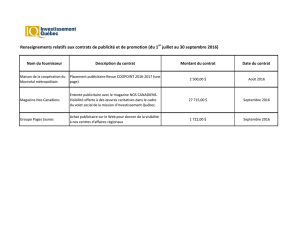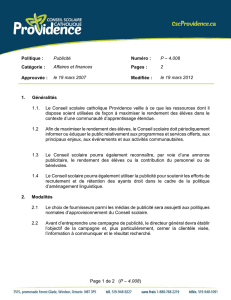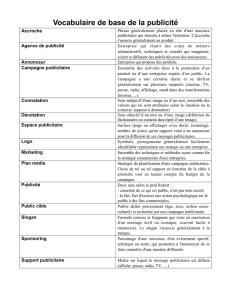le cadre communicationnel particulier de la langue publicitaire

УДК 811.133.1
М. Ю. Шевченко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
LE CADRE COMMUNICATIONNEL PARTICULIER
DE LA LANGUE PUBLICITAIRE
Присвячено проблемі комунікативних особливостей мови реклами; зроблено спробу
визначити специфіку ситуації рекламної комунікації, її прагматичних аспектів та семантики
рекламного повідомлення.
Ключові слова: мова реклами, семантика висловлювання, прагматичний аспект, перло-
кутивний ефект, рекламна комунікація, ситуація комунікації.
Посвящена проблеме коммуникативных особенностей языка рекламы; сделана попыт-
ка определить специфику ситуации рекламной коммуникации, ее прагматических аспектов и
семантики рекламного сообщения.
Ключевые слова: язык рекламы, семантика высказывания, прагматический аспект, пер-
локутивный эффект, рекламная коммуникация, ситуация коммуникации.
The article deals with the problem of communicative peculiarities of the advertising slogans.
The author tries to define the specific situation of advertising communication, its pragmatic aspects
and semantics of the advertising message.
Keywords: advertising language, semantics of the utterance, pragmatic aspect, perlocutive effect,
advertising communication, situation of communication.
Les tâches du présent article consistent en établissement du caractère spécifique
de la situation de communication publicitaire, de ses aspects pragmatiques et du sens du
message publicitaire; en mise en relief du critère du comportement de l’émétteur du
message.
Étant le genre rhétorique étudié dans le cadre de la stylistique, le discours
publicitaire présente un genre intéressant par sa dimension langagière et discursive: les
règles de l’agencement du texte publicitaire, son orientation argumentative et
énonciative, son caractère illustratif par rapport aux images etc. deviennent l’objet
d’étude dans les théories de l’énonciation, de la communication, dans la pragmatique et
la linguistique textuelle. La théorie de la communication prête beaucoup d’attention à
l’étude de la langue publicitaire et dans son cadre on distingue quelques traits
particuliers de la communication publicitaire.
Dans la mesure où elle met en rapport des sujets en vue de transactions
économiques, la publicité a été traditionnellement étudiée en termes de théorie de la
communication ce qui a permis de mettre en évidence la spécificité de la situation de
communication de cette transaction. Cette situation se présente comme une situation de
communication-interaction écrite très particulière. Cette particularité a été remarquée
par plusieurs linguistes qui étudiaient la langue publicitaire: J.-M. Adam,
M. Bonhomme, R. Kochmann, J. Baudrillard, L. Spitzer.
Selon J.-M. Adam et M. Bonhomme, la particularité de la situation de
communication publicitaire consiste en ce qu’en première lieu, la prise de parole de
l’instance émettrice étant payante, la moindre annonce nécessite un investissement
élevé. En second lieu, il s’agit d’une communication médiatisée et distanciée par ses
supports – journaux et autres, avec des délais parfois longs entre la conception de
l’annonce et sa lecture. De plus, il s’agit d’une communication sollicitative et aléatoire,
Шевченко М. Ю., 2012

en ce qu’elle s’adresse à un destinataire qui ne l’attend pas et qui n’est pas
obligatoirement disposé à la récevoir. Ce destinataire doit donc être interpellé et
convaincu instantanément de lire le message qu’on lui propose. De ce jeu de contraintes
spécifiques découle le fait que cette structure communicative, axée d’abord sur la
recherche de l’établissement d’un contact, est un système avant tout phatique et
impersonnel. L’instance émettrice est un contacteur en quête du plus grand nombre de
contactés possibles, qu’elle ne connaît pas et dont le seul point commun est d’être
occasionnellement – avec tous les risques d’échec que cela comporte – exposés au
même message [1, p. 23].
La dimension socio-économique de l’achat est gommé soigneusement au profit
de valeurs comme la santé ou la nature. C’est le mécanisme que Leo Spitzer met
parfaitement en évidence dans son analyse de la publicité américaine Sunkist des années
1940:
«Sur notre réalité de tous les jours, il y a surimposition d’une autre réalité,
comme un rêve. Tout se passe comme si le but essentiel, qui est de vendre et de faire un
profit, était nié; comme si le monde des affaires n’avait d’autre souci que de moissonner
les dons de la nature et de les apporter à chaque amateur individuel – dans une vie
idyllique en pleine harmonie avec la nature» [6, p. 155].
Il est impossible de comprendre la rhétorique de la publicité si l’on néglige
d’«inscrire le pouvoir de l’argent dans la problématique même de ce type particulier de
communication qu’est la communication publicitaire» [5, p. 19].
Une telle constitution de la communication publicitaire a des conséquences
directes sur sa structure pragmatique. En s’inspirant de la terminologie classique
d’Austin, J.-M. Adam et M. Bonhomme proposent de considérer trois dimensions des
actes de discours. Les deux premières se révèlent au niveau de la communication
langagière. C’est la dimension proprement locutoire c’est-à-dire la production écrite
textuelle et iconique d’un discours publicitaire et la dimension illocutoire qui présente la
force de persuasion inscrite dans l’énoncé. La troisième dimension s’ouvre sur la
communication commerciale: la dimension perlocutoire a trait à la réussite de l’acte
illocutoire, aux réactions du lecteur persuadé ou non d’acheter le produit.
Considérons la structure pragmatique du message publicitaire.
Au plan locutoire, le discours est, à la fois, texte et image.
Au plan illocutoire, on peut parler de deux visées plus complémentaires que
réellement contradictoires: une visée descriptive, informative, qui a la forme d’un acte
constatif, et une visée argumentative. En cela, la communication publicitaire est info-
persuasive. Mais il faut considérer le caractère globalement indirect d’une
communication publicitaire dominée par un acte illocutoire directif généralement
implicite (Je vous conseille d’acheter ce produit). Cet acte directif est dissimulé sous un
acte constatif que l’on peut, avec Nicole Everaert-Desmedt, ainsi décrire: «La publicité
fait une série de constations à propos du produit et du consommateur (elle constate que
le produit existe, qu’il est nouveau, qu’il a telles qualités, que le consommateur qui
l’utilise en est comblé, que celui qui ne l’utilise pas encore se trouve dans un état de
manque...)» [4, p. 126]. L’acte illocutoire dominant de la plupart des publicités est
explicitement constatif et implicitement directif.
Au plan perlocutoire, l’acte d’achat n’est qu’un effet ultime. Il est précédé par
une stratégie dans laquelle se concentre toute la persuasion publicitaire. L’acte
illocutoire constatif est associé à une intention perlocutoire de type «faire croire»
quelque chose au destinataire, et l’acte illocutoire directif à une intention perlocutoire de
type «faire faire» quelque chose. Le passage du «croire» au «faire» ne peut être assuré

que si le sujet-consommateur potentiel apprend quelque chose qu’il ne considère pas
comme faux.
Le discours publicitaire doit être assez crédible pour susciter une telle croyance
et, en même temps, l’absence de toute réfutation de ce qu’il asserte. La croyance est
rendue possible par la manipulation des désirs profonds des sujets. Plus précisément,
comment le «savoir» sur le produit se transforme-t-il en «vouloir»? Cela est rendu
possible par le fait que les énoncés constatifs suscitent une valorisation du produit
constitué ainsi en «objet de valeur» et un désir de l’obtenir ou qui s’accompagne d’un
désir d’identification reposant sur une valorisation du sujet lui-même, totalement
dépendante de l’acquisition de l’Objet. Ce désir d’identification part de la valorisation
de l’Objet et s’accompagne d’une valorisation liée de tous ceux qui le possèdent
représentés dans le discours et éprouvant toujours une euphorie visible et d’une
dévalorisation de tous ceux qui ne le possèdent pas.
Selon J.-M. Adam et M. Bonhomme, le passage au «faire» (l’achat par le
consommateur) est conditionné par une phase cognitive («savoir» et «croire» que
l’Objet possède les valeurs qui motivent le désir de le posséder) et par une phase
mimétique («vouloir» posséder l’Objet et s’identifier ainsi à ses détenteurs) [1, p. 26].
Derrière l’opération de constitution du produit en Objet de valeur, c’est la
question de la valorisation symbolique des objets qui se pose. Entre la vente et l’achat
du produit, le discours publicitaire opère une sémantisation qui transforme le simple
objet (robot de cuisine, climatiseur, fer à repasser) en Objet de valeur. On passe d’un
rapport objectif au monde (cuisiner, soutenir une atmosphère constante, faire le
repassage) à un rapport symbolique. L’objet de consommation est, par définition, cet
objet symbolique qui a, comme Jean Baudrillard l’a montré, perdu son statut de nom
commun et d’ustensile pour acquérir un statut de nom propre que la marque garantit.
L’Objet se charge ainsi de valeurs différentielles de statut ou de prestige qui le vident de
sa substance, comme l’explique Jean Baudrillard:
«Les signes publicitaires nous parlent des objets, mais sans les expliquer en vue
d’une praxis (ou très peu): en fait, ils renvoient aux objets réels comme à un monde
absent. Ils sont littéralement «légende», c’est-à-dire qu’ils sont d’abord là pour être lus.
S’ils véhiculaient une information, il y aurait lecture pleine et transition vers le champ
pratique. Mais ils jouent un autre rôle, celui de visée d’absence de ce qu’ils désignent»
[2, p. 208].
L’Objet valorisé, intégré dans le système de la mode et du standing, relie le sujet
aux autres consommateurs: un système de standing déterminé par la possession des
objets est un système de signes de reconnaissance où tout sujet est qualifié par les objets
qu’il a ou n’a pas.
On comprend mieux également pourquoi le discours publicitaire limite le contenu
descriptif des annonces à deux énoncés axiologisés:
1. Le produit, pour lequel la publicité est faite, est valorisé, «positivé»; les autres
produits pour le même usage, mais portant d’autres marques, sont «négativés».
2. Le sujet-consommateur en relation avec le produit est «positivé»; le sujet qui
n’est pas en relation avec ce produit est «négativé» [4, p. 127].
Selon J.-M. Adam, il est intéressant d’appliquer à la publicité le célèbre schéma
de Jakobson, puisque son exploitation publicitaire acquiert de nouvelles valeurs. Le
schéma de Roman Jakobson n’a pas manqué d’intéresser les analystes de la publicité
qui se sont efforcés d’en cerner les fonctions. Ce schéma rend compte des composantes
de la communication publicitaire et il en dégage les dominantes. En examinant les
annonces diverses, outre la communication-émetteur centrée sur la compétence du

fabricant, la communication-récepteur axée sur la force de persuasion du message et la
communication-référent qui glorifie le produit et son univers, on pourrait distinguer
d’autres orientations de la communication.
La communication-contact a pour but d’attirer l’attention du lecteur à tout prix.
Sans rapport avec la transaction commerciale en jeu, le but de la campagne est souvent
de faire parler d’elle, mais l’effet voulu est de renforcer la mémorisation de la marque
par l’accroche de l’attention.
La communication-code concerne les cas où l’annonceur déstructure et rend
conscient le système de signes qu’il utilise. Caractérisant le goût actuel des médias pour
le ludique, elle est particulièrement développée dans une publicité Go-Voyages où les
évocations des proposés sont autant d’occasions de jeux de mots paronymiques. Voila
l’exemple de publicité singulière à propos de l’Espagne: «Ces prix sont valables pour
l’olé et le retour» (le jeu de mots olé=aller).
Néanmoins, d’après J.-M. Adam et M. Bonhomme, bien que séduisant par son
caractère descriptif, le modèle de Jakobson souffre de limites certaines. Il fige la
description de la complexité du discours. Ce schéma ne sort pas d’un cadre discursif
unidimensionnel allant d’un émetteur vers un récepteur 1, p. 30.
L’acte de langage publicitaire est un acte inter-énonciatif entre 4 sujets, lieu de
rencontre imaginaire de deux univers de discours qui ne sont pas identiques: le sujet
énonçant, le sujet communiquant, le sujet destinataire, et le sujet interprétant. Il est
nécessaire que dans la communication publicitaire l’image du sujet destinataire et de
sujet interprétant coïncide, sinon la publicité peut échouer: le publiciste crée une image
de son destinataire idéal auquel les consommateurs sont supposés s’identifier, mais eux,
ils interprètent cette image d’une manière différente et peuvent ne pas s’associer avec le
produit présenté.
Comme toute acte de langage, celui publicitaire peut être asymétrique: celui qui
interprète l’acte de langage reconstruit son sens à partir d’indications données dans
l’énoncé produit, mais rien ne garantit que ce qu’il reconstruit coïncide avec les
représentations de l’énonciateur. Comprendre un énoncé, ce n’est pas seulement se
reporter à une grammaire et à un dictionnaire, c’est mobiliser des savoirs très divers,
faire des hypothèses, raisonner, en construisant un contexte qui n’est pas une donnée
préétablie et stable.
Le circuit général d’échanges de biens de production comporte trois sujets: un
Publiciste en tant qu’une instance communiquante, un Consommateur comme une
instance agissante et en même temps interprétante et le Produit comme objet d’échange.
Le Publiciste doit toujours tenir compte de trois facteurs suivants pendant l’élaboration
de la conception publicitaire: l’existence d’une concurrence sur le marché, l’existence
des règles professionnelles qui empêchent toute comparaison explicite avec le produit
d’une autre marque, et l’existence de certaines tendances sociales.
Selon P.Charaudeau, d’après la présence de l’émetteur dans le texte de publicité
et d’après les distances qu’il prend envers le destinataire on peut relever trois types du
comportement de l’émetteur pendant la communication. Considérons en détail chacun
d’eux.
1. Le comportement délocutif
Les modalités délocutives sont déliées du locuteur et de l’interlocuteur. Le propos
émis existe en soi, et s’impose aux interlocuteurs dans son mode de dire [3, p. 619].
L’annonceur est effacé. Il n’est présent que comme un présentateur qui annonce
un spectacle.

Le destinataire n’est pas sollicité explicitement, il est également effacé. Il n’est
présent que comme un spectateur-témoin. Ce comportement a pour effet d’inciter le
sujet interprétant à s’identifier à l’image idéale d’un tiers qui serait acquis à la Quête
présentée par le texte.
Exemple: «104 PEUGEOT. Des qualités confirmées et le prix d’une 5 CV».
Image idéale du «tiers cherchant le meilleur rapport qualité/prix».
2. Le comportement élocutif
Les modalités élocutives n’impliquent pas l’interlocuteur dans l’acte locutif. Elles
précisent la manière dont le locuteur révèle sa position vis-à-vis du Propos qu’il énonce
[3, p. 599].
L’annonceur s’énonce par une prise de position appréciative. Il est présent
comme un présentateur de music-hall qui aurait déjà pu apprécier le spectacle et
manifesterait son enthousiasme.
Le destinataire n’est pas explicitement sollicité comme dans un comportement
allocutif; il est donc encore en position de spectateur-témoin, mais il est appelé à
partager l’euphorie de l’annonceur.
Le comportement a pour effet d’inciter le sujet interprétant à s’identifier à
l’image d’un tiers qui est, cette fois, fabriquée sur l’exemple: «Vigoureux. Savoureux.
Étonnant! COINTREAU».
Mais il y a à l’intérieur de ce même comportement un autre cas de figure. Celui
où l’annonceur s’énonce explicitement sous la nomination de la Société ou de la
marque; il se révèle alors responsable de son discours et Agent du Faire décrit. Dans ce
cas, il se donne le statut de Bienfaiteur, ce qui doit inciter le destinataire, même si celui-
ci n’est pas sollicité explicitement, à se considérer comme un Bénéficiaire.
Exemple: «ANTAR. NOUS essayons de rendre la route plus sûre»
3. Le comportement allocutif
Les modalités allocutives impliquent locuteur et interlocuteur, et précisent la
manière avec laquelle le locuteur impose un Propos à l’Interlocuteur [3, p. 579].
L’annonceur s’énonce dans le même instant qu’il sollicite le savoir du
destinataire («Saviez-vous que...? Eh bien, voilà...»). Il se présente alors comme un
informateur qui fait découvrir au destinataire son Manque ou sa Quête. Exemple: «Do
you speak, English? Non. Alors. BERLITZ»; également: «Vous tricotez? Il vous faut le
livre-tricots BERGÈRE DE FRANCE».
L’annonceur s’énonce dans le même instant qu’il adresse au destinataire une
injonction incitatrice («Faites...»). Il se présente alors comme un Conseilleur qui
propose au destinataire un contrat de confiance.
Exemple: «Si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, venez nous voir,
B.N.P.».
Ce comportement a pour effet d’inciter le sujet interprétant à s’identifier à une
image idéale de destinataire qui doit être l’acteur d’un Faire dont il sera en même temps
le bénéficiaire, ayant l’annonceur pour Allié.
Or, du point de vue communicatif on peut distinguer les différents types de
slogans publicitaires selon le critère du comportement de l’émetteur du message. Le
premier type des slogans publicitaires reflète le comportement délocutif et présente un
énoncé qui existe en soi en cachant les marques de présence de l’émetteur et ne révélant
point le destinataire. Le deuxième type présente le comportement élocutif qui révèle
l’attitude de l’annonceur envers ce qu’il dit, mais n’implique toujours pas le destinataire
dans l’acte locutif. Et le dernier type de slogans présente le comportement allocutif
 6
6
 7
7
1
/
7
100%