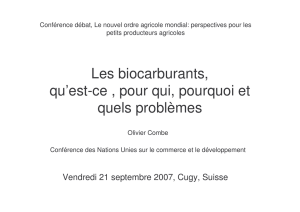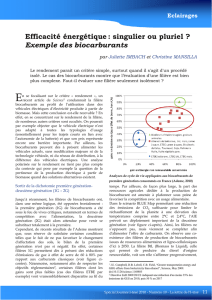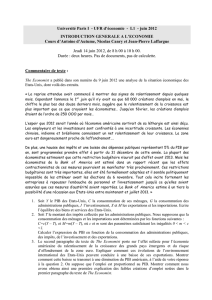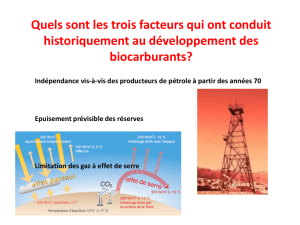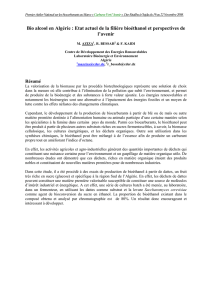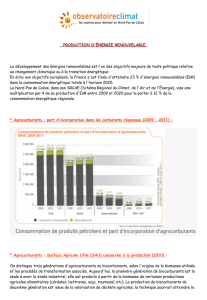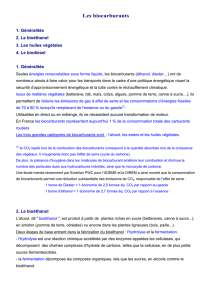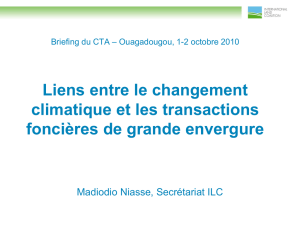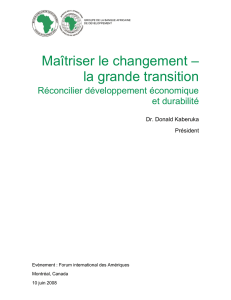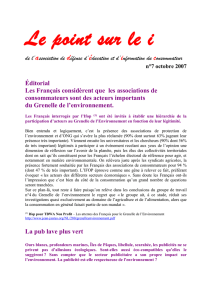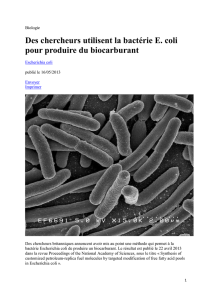Carrefour. de l`économie

Les biocarburants
Carrefour.
de l’économie
2007/1-2A ∙ année 11
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré
du marché des biens et services en Belgique. »
Publication mensuelle du Service
public fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie
http://economie.fgov.be
fax: 02 277 55 07
e-mail: carrefour@economie.fgov.be
Un numéro d’essai peut
être demandé par écrit à:
Carrefour de l’économie
City Atrium, Bloc C,
7e étage
rue du Progrès 50
B-1210 Bruxelles
La reproduction de données
afi n de les uti li ser dans d’autres
étu des est autorisée à con di tion
de men tion ner clairement et
pré ci sé ment la source.
Les articles - même non-
signés - n’en ga gent que leur(s)
auteur(s).
Editeur responsable:
Lambert Verjus,
rue du Progrès 50,
B-1210 Bruxelles.
Numéro d'entreprise:
0314.595.348
ISSN 1370 - 7213
0187-07

Carrefour de l’économie.2007/1-2A
2
LES BIOCARBURANTS
Par : Anne-Florence TAMINIAUX, Attachée, Direction générale Energie - Service Pétrole
Les autres émissions des moteurs utilisant les
biocarburants sont assez variables.
Le biodiesel réduit les émissions d’oxyde de car-
bone et de soufre, d’hydrocarbures ainsi que des
suies. Par contre, les émissions d’oxyde d’azote et
d’aldéhyde sont moins favorables.
L’éthanol quant à lui permet de réduire les émis-
sions d’oxyde de carbone, d’hydrocarbure et de
benzène mais est également moins performant
en ce qui concerne l’oxyde d’azote.
Un inconvénient commun à ces deux produits est
leur pouvoir énergétique moindre en comparaison
aux carburants fossiles. L’ETBE est 0,83% moins
énergétique que l’essence et le FAME est 0,83%
moins énergétique que le diesel routier (2).
BIOCARBURANTS DE PREMIÈRE GÉNÉRATION
Les biocarburants de la première génération tels
que le biodiesel, le bioéthanol, l’huile végétale
pure, peuvent être mélangés en faible quantité
aux carburants classiques dans la plupart des vé-
hicules et peuvent être distribués par l’infrastruc-
ture existante.
Les coûts de production des biocarburants dans
les pays en développement sont comparativement
plus faibles qu’en Europe. Le bioéthanol produit à
partir de la canne à sucre au Brésil est compétitif
par rapport aux combustibles fossiles car l’apport
d’énergie fossile pour le produire est plus faible
que pour l’éthanol produit en Europe. D’un point
de vue environnemental, les réductions corres-
pondantes des émissions sont donc plus impor-
tantes. Pour le biodiesel, par contre, l’UE est ac-
tuellement le premier producteur mondial (3).
Le problème qui se pose pour la production de
biocarburant de première génération est la com-
pétition qui s’instaure entre les productions ali-
mentaires et les productions non-alimentaires.
Les terres mobilisables pour la culture de colza
ou de betteraves sont limitées (4).
Pour prendre une part signifi cative dans le bilan
énergétique, il est nécessaire d’accroître le nom-
bre et le volume de végétaux à utiliser comme ma-
tière première pour produire des biocarburants :
plantes entières, forêt, fraction biologique des
déchets urbains. La ressource la plus largement
INTRODUCTION
La promotion des biocarburants en UE est motivée
par deux grandes priorités : réduire d’une part les
émissions de gaz à effet de serre et d’autre part
la dépendance de l’Europe à l’égard des importa-
tions de pétrole et de gaz.
Transformés à partir de la biomasse, les biocar-
burants constituent un substitut direct aux com-
bustibles fossiles dans le secteur des transports
et peuvent aisément être intégrés dans les circuits
d’approvisionnement en carburants.
GÉNÉRALITÉS SUR LES BIOCARBURANTS
Le terme biocarburant recouvre des combustibles
liquides ou gazeux utilisés pour le transport et fa-
briqués à partir de la fraction biodégradable des
produits, déchets et résidus provenant de l’agri-
culture ou encore de la sylviculture.
Parmi les biocarburants qui sont techniquement
au point, on distingue trois grandes fi lières (1).
La première est celle de l’éthanol : il s’agit d’un al-
cool obtenu par la fermentation des plantes riches
en sucre (betteraves, canne à sucre) ou en amidon
(blé, maïs). Le bioéthanol peut-être transformé
en ETBE (éthyl tertio butyl éther) ce qui augmente
l’indice d’octane.
La seconde est celle du biodiesel : il s’agit d’une
huile extraite de graines oléagineuses (colza,
tournesol) qui subit une réaction chimique pour
former l’ester méthylique (FAME).
La troisième fi lière est celle de l’huile végétale
pure qui peut être utilisée dans des moteurs die-
sel modifi és.
En ce qui concerne le CO2, principal gaz à effet de
serre, on peut considérer la quantité émise lors de
la combustion des biocarburants dans les moteurs
comme compensée par la quantité absorbée par
la plante durant sa croissance. Toutefois, des gaz
à effet de serre sont émis lors de la production du
biocarburant (culture, transformation, transport,
etc). Le bilan global en CO2 de l’ensemble de la
fi lière des biocarburants devrait faire l’objet d’une
analyse précise afi n de pouvoir défi nir les bénéfi -
ces réels en terme de CO2.

Carrefour de l’économie.2007/1-2A
3
disponible et qui n’entre pas en compétition avec
les productions alimentaires est la lignocellulose
contenue dans les plantes, arbres, pailles,etc.(5)
BIOCARBURANTS DE SECONDE GÉNÉRATION
Alors que les biocarburants de première généra-
tion sont fabriqués avec une fraction relativement
faible des cultures, ceux de deuxième génération
sont élaborés à partir de la totalité de la plante.
Les recherches ont commencé en France et en
Allemagne où une installation pilote devrait être
construite pour 2010 (4).
Les biocarburants de seconde génération utilise-
ront des ressources plus diversifi ées, provenant
de plantes ou d’animaux.
Lors de la fabrication des biocarburants de pre-
mière génération, toute la plante n’est pas exploi-
tée. Pourtant, les tiges et les troncs possèdent
leurs propres ressources énergétiques : la bio-
masse lignocellulosique constituée de la cellulo-
se, d’hémicellulose et de lignine. La diffi culté est
d’extraire la cellulose qui est emprisonnée dans
une matrice de lignine. De plus, les sucres obte-
nus ne sont pas tous faciles à transformer en al-
cool. Des chercheurs se penchent sur la manière
de transformer les tiges et les troncs tendres des
végétaux (2).
Plusieurs projets de recherche sont développés
à l’Institut National de Recherche Agronomique
(France).
A Marseille, une équipe a choisi d’utiliser les enzy-
mes de champignons fi lamenteux pour s’attaquer
aux tiges des plantes et libérer les sucres de leur
matrice. Ces enzymes découpent ensuite la cellu-
lose et l’hémicellulose en petits fragments pour
obtenir au fi nal des sucres simples, similaires à
ceux des betteraves, qui peuvent directement être
transformés en alcool. Ce procédé a été testé avec
succès sur la paille de blé mais n’est pas encore
suffi samment effi cace que pour être rentable. Les
chercheurs étudient de plus près l’enzyme char-
gée d’extraire les sucres de la tige. Il est prévu de
tester le procédé sur des véhicules d’ici 2009 (2).
Un autre projet de recherche est un système de
culture dédiée à la production de bois : taillis
à courte rotation (TCR) ou à très courte rotation
(TTCR). Il s’agit de plantation très dense de jeunes
peupliers que l’on coupe entre 6 et 8 ans (TCR) ou
entre 2 et 4 ans (TTCR). Après la coupe, de nouvel-
les tiges repoussent sur les souches et l’on peut
ainsi effectuer plusieurs cycles de production - ré-
colte (6).
Si la technologie la plus prometteuse en matière
de biocarburants de deuxième génération est le
traitement ligno-cellulosique, d’autres techni-
ques se développent en parallèle. Parmi celles-ci
fi gurent le biodiesel Fischer-Tropsch ainsi que le
gaz naturel synthétique (GNS) (3).
ASPECT LÉGISLATIF EUROPÉEN
La Commission a promu l’utilisation des biocarbu-
rants dans la directive 2003/30/CE du 8 mai 2003
(7). Cette directive fi xe les valeurs de référence
d’une part de marché de 2% pour les biocarbu-
rants en 2005 et de 5,75% en 2010. Pratiquement,
l’objectif ciblé de 2% n’a pas été atteint. La part
des biocarburants aurait atteint tout au plus 1,4%
(3).
Le coût de production de biocarburants étant plus
élevé, les Etats Membres comptent sur les exoné-
rations fi scales en faveur des biocarburants, faci-
litées par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27
octobre 2003 (8) sur la taxation de l’énergie.
Une révision de la directive 2003/30/CE est at-
tendue. Cette révision tiendra compte du rapport
coût-effi cacité, du niveau d’ambition après 2010
ainsi que du contrôle de toutes les incidences des
biocarburants sur l’environnement. La Commis-
sion veillera à garantir le caractère durable des
cultures en matières premières destinées à la fa-
brication des biocarburants dans l’UE et les pays
tiers.
La directive 2003/17/CE du 3 mars 2003 (9) con-
cernant la qualité de l’essence et du diesel limite
le contenu en composés oxygénés de l’essence, la
pression de vapeur de l’essence et prévoit que le
diesel ne peut contenir plus de 5% de biodiesel en
volume.
La norme EN590 permet une adjonction maximale
de 5% v/v (volume/volume) pour le biodiesel. La
norme EN 228 permet une adjonction maximale
de 2,7% m/m (masse/masse) en O2 sous forme
d’oxygénats.
Ces limites imposent des contraintes à une uti-
lisation accrue des biocarburants. Ces limites
quantitatives devront être revues.
ASPECT LÉGISLATIF EN BELGIQUE
En Belgique, l’Arrêté royal (AR) du 4 mars 2005
(10) jette les bases de l’existence juridique des
biocarburants et transpose la directive 2003/30/
CE. Cet AR fi xe une incorporation progressive des
biocarburants sur le marché belge pour atteindre
les 5,75% en 2010. Il autorise également la mise
sur le marché de biocarburants en l’absence de
normes CEN grâce à une décision de dérogation
des autorités compétentes (Energie et Environne-
ment).

Carrefour de l’économie.2007/1-2A
4
Cet AR est complété par l’AR du 22/11/2006 (11)
qui défi nit les règles de mise sur le marché des
biocarburants non normés. Ces règles sont vala-
bles pour le diesel qui contient plus de 5% de bio-
diesel, l’essence qui contient plus de 5% d’éthanol
et l’huile de colza pure (12). Il indique que la dé-
cision de dérogation peut être octroyée pour des
biocarburants non-normés quand ils sont vendus
entre un nombre limité de parties dans le cadre
d’un projet spécifi que ou encore pour la vente au
consommateur fi nal d’huile de colza.
Depuis le 3 avril 2006, la législation fi scale belge
(AR du 10 mars 2006 (13)) permet aux agriculteurs
ainsi qu’aux associations d’agriculteurs de triturer
du colza de leur culture afi n d’en tirer une huile
pure pouvant être directement vendue à l’utilisa-
teur fi nal possédant un véhicule adapté ou encore
lorsqu’elle est destinée à être utilisée comme car-
burant par les véhicules des sociétés de transport
en commun régionales.
La loi concernant les biocarburants du 10/06/2006
(14) prévoit une diminution du taux d’accise pour
l’essence contenant au moins 7%vol d’éthanol et
pour le diesel contenant 3,37% de biodiesel en 2006
(des pourcentages supérieurs sont autorisés pour
les sociétés de transport en commun régionales).
Ces taux d’accise seront appliqués si les biocarbu-
rants proviennent d’unités de production agréées.
La loi prévoit qu’un appel à candidature destiné aux
opérateurs potentiels soit publié au Journal Offi ciel
de l’Union Européenne. La loi défi nit également les
volumes maximaux pour lesquels l’agrément sera
accordé. Les biocarburants sont défi scalisés pour
des quotas de production exigés par l’Europe.
Les mesures de défi scalisation en faveur de l’in-
corporation des biocarburants dans les carbu-
rants fossiles (AR du 27/10/2006 (15)) sont entrées
en vigueur au 1er novembre 2006. Les pétroliers
peuvent donc procéder aux mélanges à condition
de s’approvisionner chez l’un des producteurs
agréés par l’état belge (4 fi rmes pour le biodiesel
et 3 fi rmes pour le bioéthanol).
Le bioéthanol incorporé à l’essence ne fera, quant
à lui, pas son apparition avant l’automne 2007.
Références
(1) Les biocarburants, Valbiom, information en ligne, www.valbiom.be
(2) Les « carburants verts » font bonne route, information en ligne, www.planete-énergies.com
(3)
Communication de la Commission : Stratégie de l’UE en faveur des biocarburants. (COM (2006) 34 fi nal)
(4) « Les biocarburants de deuxième génération : un potentiel de production considérable », Philippe
Girard (CIRAD), 02/11/2005, information en ligne, www.terre-net.fr
(5) Chimie verte, INRA, dossier de presse 14/02/2006, information en ligne, www.inra.fr
(6) Des mini-forêts pour produire du « bois-énergie », dossier de presse 14/02/2006, information en ligne,
www.inra.fr
(7) Bulletin de l’Union européenne L 123 du 17.5.2003
(8) Bulletin de l’Union européenne L 283 du 31.10.2003
(9) Bulletin de l’Union européenne L 8 du 14.1.2003
(10) Moniteur belge du 8 mars 2005, 3eme édition
(11) Moniteur belge du 7 décembre 2006, 2e édition
(12) Actualités 07/12/2006, Valbiom, information en ligne, www.valbiom.be
(13) Moniteur belge du 20 mars 2006, 2ème édition
(14) Moniteur belge du 16 juin 2006
(15) Moniteur belge du 31 octobre 2006, 3ème edition

Carrefour de l’économie.2007/1-2A
5
PANORAMA BELGE DE L’ÉCONOMIE 2006 : SOMMAIRE
Contrairement aux années 1970, la moindre dé-
pendance énergétique, couplée à la faiblesse des
anticipations infl ationnistes, à la recomposition
du tissu productif au profi t des services et à la vi-
gueur de la concurrence internationale ont permis
de contenir la hausse du niveau général des prix.
2. ÉVALUATION MACRO-ÉCONOMIQUE
STRUCTURELLE ET SECTORIELLE
La croissance et l’emploi sont les deux composan-
tes centrales de la nouvelle stratégie de Lisbonne
qui doit faire de l’Union européenne l’économie de
la connaissance la plus compétitive au monde.
La compétitivité d’un pays est infl uencée par des
facteurs quantitatifs tels que les coûts et la struc-
ture de production et par des facteurs qualitatifs
tels que le capital humain disponible (le marché
du travail), les investissements, la recherche et le
développement, l’innovation et le fonctionnement
effi cace des marchés fi nanciers ainsi que du mar-
ché des biens et des services.
En ce qui concerne le PIB par habitant, la Belgi-
que a maintenu en 2005 et en 2006 sa place parmi
les pays les plus prospères de la planète.
La hausse du PIB par habitant s’est légèrement
affaiblie en 2005, après une croissance substan-
tielle en 2004, pour atteindre +0,7%. On s’attend
en 2006 à un net redressement (+2,5%). Depuis
2004, cette hausse subit l’infl uence positive et si-
multanée de la croissance du taux d’emploi et de
la productivité du travail.
Bien que la Belgique bénéfi cie encore d’un des
meilleurs niveaux de productivité par travailleur,
la productivité connaît un certain tassement ces
dernières années. Ceci est dû notamment à l’im-
portance économique accrue du secteur tertiaire
dont la croissance de productivité est en moyenne
inférieure à celle de l’industrie.
Sur le marché du travail, le taux de l’emploi (me-
suré d’après l’enquête sur les forces du travail)
est passé de 60,5% en 2004 à 61,1% en 2005 mais
1. ÉVOLUTION CONJONCTURELLE DE LA
BELGIQUE EN 2005-2006
L’activité économique mondiale a montré en
2005 une grande résilience face à l’envolée des
prix des produits pétroliers. Après des années
de forte croissance, tant en termes d’activité que
d’échanges commerciaux, l’économie mondiale
a toutefois montré des signes de faiblesse depuis
le deuxième trimestre 2006, surtout perceptibles
outre-Atlantique. Ce fl échissement du PIB améri-
cain résulte en partie d’un ralentissement des dé-
penses de consommation des ménages suite au
tassement du secteur immobilier. Dès lors, l’éco-
nomie américaine devrait enregistrer une crois-
sance proche, voire légèrement en deçà, de son
potentiel au cours de la seconde partie de 2006 et
en 2007.
En revanche, le PIB de la zone euro a connu une
progression substantielle au deuxième trimestre
2006 (un plus haut depuis 5 ans). Cette vitalité tra-
duit une croissance plus équilibrée, dictée par le
rebond de la demande intérieure, le dynamisme
du commerce mondial et les effets différés de la
dépréciation de l’euro.
Après avoir crû de manière signifi cative en 2004
(3%1 de hausse), la croissance du PIB belge s’est
fortement repliée en 2005 (+1,1%), soit un pour-
centage nettement en dessous de son potentiel.
Ce taux cache toutefois une activité économique
en pleine reprise même si le nouveau cycle sem-
ble déjà avoir atteint son sommet.
A l’instar de la zone euro, le redressement du
PIB au premier semestre 2006 marque le retour
vers une croissance plus équilibrée. Ainsi, tant la
demande intérieure que la demande extérieure
devraient soutenir la croissance en 2006, princi-
palement sous l’effet d’une évolution favorable du
revenu disponible, de conditions fi nancières tou-
jours attractives, d’un bon climat de confi ance et
d’une demande européenne vigoureuse.
Pour sa part, l’infl ation a été largement dictée
par l’évolution des prix des produits énergétiques.
1 Attention, il s’agit des données brutes (estimations en euros chaînés) qui révèlent un taux de croissance du PIB de
3% pour 2004 et de 1,1% pour 2005. Pour les données corrigées des variations saisonnières et des effets calendai-
res, ces taux s’élèvent respectivement à 2,7% et 1,5%.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%