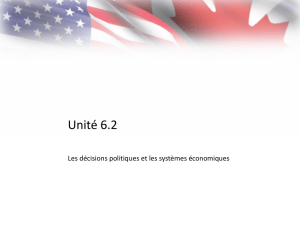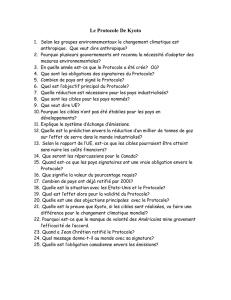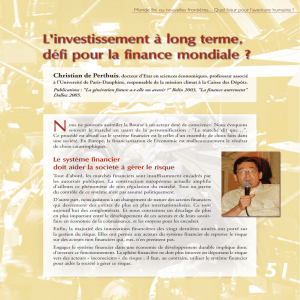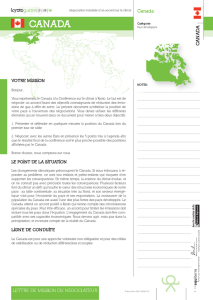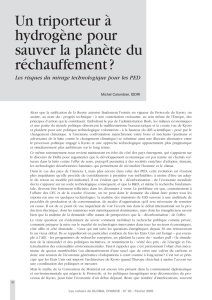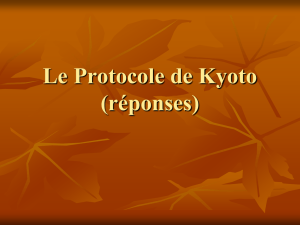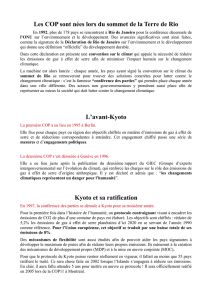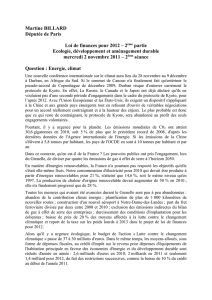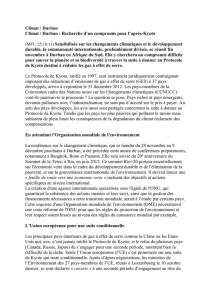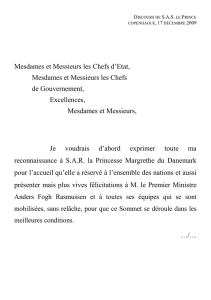Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives

Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives
Réseau Action Climat France
1

Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives
Réseau Action Climat France
2
www.rac-f.org
Publié le 22 novembre 2012
Rédaction
Célia Gautier, RAC-F, Chargée des Politiques européennes,
Chargée du volet « atténuation des émissions » dans le suivi des négociations
internationales sur le climat
celia@rac-f.org
+33 1 48 58 89 76
+33 6 72 34 00 27
Mise en page
Célia Gautier, Marc Mossalgue, RAC-F

Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives
Réseau Action Climat France
3
Sommaire
Abréviations et acronymes 4
Partie 1 Enjeux et contexte 5
La planète parle aux gouvernements 5
Le climat en mal d’ambition 6
Définition du régime climatique international 7
2012, année charnière 8
Un accord mondial à partir de 2020 ? 10
Présentation de la publication 11
Partie 2. Le protocole de Kyoto : Charpente du régime climatique actuel 13
Le protocole de Kyoto : Quèsaco ? 13
Les grands acquis du protocole de Kyoto 14
L’approche réglementaire descendante et les objectifs quantifiés pour 2012 14
Le caractère juridiquement contraignant 16
La différentiation claire entre pays développés et pays en développement 17
Les mécanismes de flexibilité du Protocole 18
Un système de transparence 18
Des objectifs chiffrés pour 2012, et ensuite ? 20
La 2e période du protocole de Kyoto : une transition entre deux régimes climatiques (2012-2020) 21
Les pays ont-ils respecté leurs engagements de réduction d’émissions sous Kyoto ? 22
Le Protocole à l’origine de politiques publiques climat-énergie 25
Partie 3. Vers un nouveau régime climatique 31
Un bilan GES mitigé… 31
Le problème de l’excédent de quotas d’émission 33
Un défaut de niveau de participation 33
La réalité de la contrainte juridique sous Kyoto 34
Un partage des émissions pas si « top down » que ça 35
Un mode de différenciation des pays devenu anachronique 36
Transparence : une comptabilisation partielle des émissions mondiales 37
Les éléments du futur régime climatique international 41
La question cruciale de la contrainte juridique dans le futur régime climatique - Revue
bibliographique 41
Les discussions entre pays sur la forme juridique de l’accord 2020 44
Une participation large des pays 46
Une différenciation plus subtile et plus équitable entre les pays 46
Privilégier une approche réglementaire (vraiment) descendante 48
Se questionner sur le caractère dynamique du futur régime climatique 49
Comptabiliser nos émissions liées à la consommation 50
Conclusion 51

Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives
Réseau Action Climat France
4
Abréviations et acronymes
AME Accords multilatéraux sur l’environnement
AWG-KP Groupe de travail spécial sur les engagements des pays sous le protocole
de Kyoto
AWG-LCA Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme sous la
Convention
CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
CO2 Dioxyde de carbone
COP Conférence des Parties (« Conference of the Parties »)
EU ETS Système européen d’échange de quotas d’émissions de CO2
GES Gaz à effet de serre
Giec Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat
LULUCF Usage des sols, changement d’usage des sols et foresterie (« Land Use, Land
Use Change and Forestry »)
MDP Mécanisme de développement propre
Moc Mise en œuvre conjointe
OMC Organisation mondiale du commerce
ONG Organisations non gouvernementales
Onu Organisation des Nations unies
PIB Produit intérieur brut
Pnue Programme des Nations unies sur l’environnement
UE Union européenne

Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives
Réseau Action Climat France
5
Partie 1.
Enjeux et contexte
Cette partie introductive effectue un panorama des enjeux alors que l’année 2012 se termine et
que la Conférence annuelle des Nations unies sur le climat s’ouvre au Qatar (26 novembre-8
décembre 2012).
La Conférence de Doha sur le changement
climatique, ou 18e Conférence des Parties
(COP) à la Convention cadre des Nations
unies sur le climat (CCNUCC, également
appelée « Convention Climat »), intervient au
terme d’une année particulièrement
chaotique pour le climat. Une année émaillée
de désastres climatiques et de catastrophes
naturelles.
Les pays développés ne sont pas épargnés.
Entre 1980 et 2011, les dégâts causés en
Amérique du Nord par des aléas climatiques
extrêmes et des catastrophes naturelles ont
été évalués à 1600 milliards de dollars entre
1980 et 20111. Ils se sont multipliés par cinq
sur la période.
Les Etats-Unis, deuxième plus gros émetteur
de gaz à effet de serre (GES) et acteur très
1 Munich Re, « Severe Weather in North America »,
17 octobre 2012 :
http://www.munichre.com/en/media_relations/pres
s_releases/2012/2012_10_17_press_release.aspx
bloquant des négociations internationales sur
le climat, ont particulièrement souffert. A
l’été 2012, la plus grave sécheresse depuis
plus d’un demi-siècle a frappé près de 40% de
la zone continentale du pays, détruisant 88%
de la récolte nationale de maïs. Des incendies
de forêt, liés à cette sécheresse, ont ravagé le
Colorado. Les conséquences de cet
événement climatique extrême intervenu aux
Etats-Unis ont été mondiales : les cours
internationaux des denrées alimentaires ont
flambé, notamment pour les produits de
première nécessité comme le blé, le maïs ou
le manioc, menaçant la sécurité alimentaire
de centaines de milliers de personnes.
Toujours à l’été 2012, la calotte glaciaire a
connu sa plus forte fonte depuis le début des
relevés exacts, soit 1958. Et en fin d’année,
tel un symbole, c’est la côte Est des Etats-
Unis et New York qui ont été frappées par
l’ouragan Sandy. Cette méga-tempête a causé
des centaines de morts dans plusieurs pays
(notamment en Haïti) et plusieurs milliards de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
1
/
51
100%