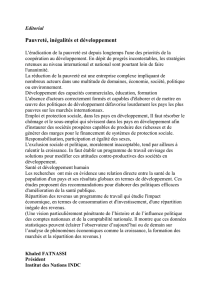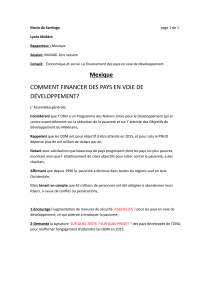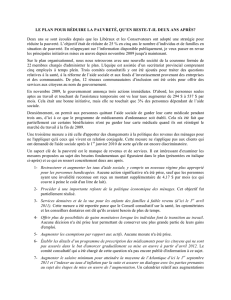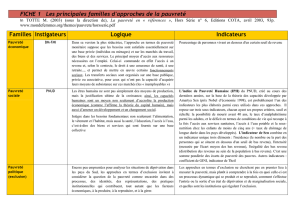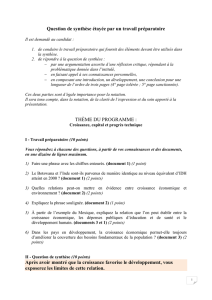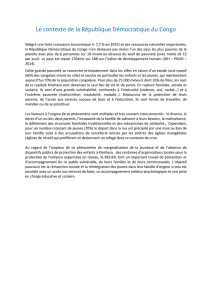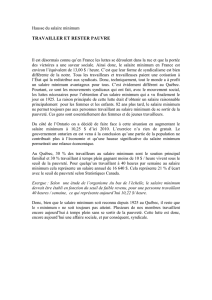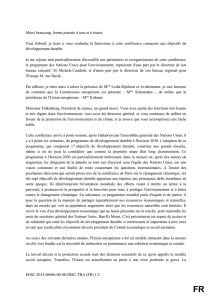image

1
8èmeConférenceAFD/EUDN
SYNTHESE DES DEBATS
MESURE POUR MESURE
Sait-on vraiment mesurer le développement ?
1erDécembre2010
CentredeconférencePierreMendès‐France,
Ministèredel’Economie,del’Industrieetdel’Emploi,Paris
Ouverture
DovZERAH,Directeurgénéral,AgenceFrançaisedeDéveloppement(AFD)
FrançoisBOURGUIGNON,présidentd’EUDN,Ecoled’EconomiedeParis
DovZERAHouvrelaconférenceensaluantleniveauexceptionneldelaparticipationcette
année.Elledémontrequecet événement annuel constitue désormais un rendez-vous
important pour les chercheurs et les acteurs du développement. La conférence AFD-EUDN
fournit en effet un lieu de dialogue en rassemblant une communauté très variée - en termes
géographiques (30 pays représentés) mais aussi en termes d’institutions et d’horizons
professionnels (institutions publiques, entreprises, société civile, recherche).
Le thème de cette année « Mesure pour mesure : sait-on vraiment mesurer le
développement ? » devrait permettre d’offrir un aperçu du chemin parcouru en cette matière
depuis le premier rapport du Club de Rome qui, il y a 40 ans, proposait une approche
purement économique. Même s’il est évident que l’acte de mesure ne pourra englober
l’ensemble des paramètres du développement et restera insuffisant, il n’en demeurera pas
moins indispensable pour estimer les avancées, pour défendre l’aide au développement et
améliorer l’efficacité de ses actions. Si le développement se caractérise par un mouvement
vers le haut de tout le système social, encore faut-il en effet pour le suivre connaitre la
situation de départ, caractériser l’objectif et avoir les instruments adéquats d’évaluation.
Le président Sarkozy a confié en 2008 à une commission menée par Joseph Stieglitz une
réflexion sur les limites de la mesure du PIB. Il en ressort que le bien-être va bien au-delà de
la notion de PIB par habitant. D’une part le PIB ne reflète que partiellement la perception de
la richesse qui repose aussi sur la répartition des niveaux de revenu, le niveau de
consommation ou encore le patrimoine. D’autre part, outre le niveau de richesse, le bien-être
est aussi lié à l’accès au travail, à l’éducation, à la santé ou encore au sentiment de sécurité,
autant de domaines souvent oubliés et parfois difficiles à caractériser. Enfin, pour suivre le
développement, doit-on rechercher un indicateur global capable de refléter l’ensemble de ces
facteurs ou reste-t-il plus pertinent de maintenir une batterie d’indicateurs parfois peu
comparables ? Cette conférence est l’occasion de poser cette question.

2
FrançoisBOURGUIGNONrappellequela commission menée par Joseph Stiglitz a en effet
souligné les limites de la mesure par le PIB et la nécessité de combiner les approches de
mesure économique et celles des autres dimensions du développement. A cela deux
difficultés. La première est conceptuelle : comment s’articulent et fonctionnent les différents
facteurs du développement – par exemple les liens entre évolution des économies et évolution
des institutions ? Comment prendre en compte la complexité croissante des situations en lien
avec la globalisation et la multiplication des interactions ? Comment inclure dans la démarche
les notions nouvelles telles que les biens publics, les préoccupations environnementales, le
changement climatique ?
La deuxième difficulté est fonctionnelle : bien que la disponibilité en données se soit
fortement améliorée (il y a trente ans, bien peu de pays disposaient d’enquêtes ménages
complètes), on arrive rarement à pondérer les différentes informations et données. A titre
d’exemple : comment relier état nutritionnel, revenus, richesse, état de santé et bien-être ou
état de satisfaction ? Ces deux enjeux seront abordés lors de la conférence.
Mesurer le développement : autres données, autres conclusions ?
Intervenant:AngusDEATON,UniversitédePrinceton
Président:FrançoisBOURGUIGNON,PSE
Angus DEATON, en introduction de son exposé, a rappelé que la mesure du développement
faisait l’objet d’une attention politique et académique très poussée et que cette attention était
utile et justifiée. L’idée même de développement économique s’est complexifiée depuis 20
ans, avec le dépassement progressif d’une vision économiciste fondée sur le seul revenu par
tête, pour atteindre une conception plus large, multidimensionnelle, de la pauvreté. Ce
changement de paradigme doit évidemment beaucoup aux travaux d’Amartya Sen
(Development as Freedom). Les travaux de la commission Sen-Stiglitz-Fitoussi (2009) ont
également permis de mettre en lumière la nécessité d’étendre les indicateurs de mesure de la
richesse, de la performance économique et du bien-être.
Les données sur la richesse des Nations sont en effet encore insatisfaisantes. Ainsi, en 2008,
le nombre de « pauvres » au niveau mondial a bondi de 500 millions selon les statistiques
produites dans le cadre de l’International Comparison Program et publiées par la Banque
mondiale. La révision du niveau des prix, notamment en Asie, a en effet conduit à corriger de
manière massive les estimations antérieures de pauvreté et à déplacer une partie de la pauvreté
recensée dans le monde de l’Afrique vers l’Asie. L’existence d’une ligne de pauvreté unique,
mondiale, même exprimée en parité de pouvoir d’achat, peut conduire à de tels réajustements
compte tenu du nombre important de personnes vivant près du seuil de pauvreté.
Devant la difficulté à estimer le revenu monétaire dans les pays en développement, et surtout
à comparer le coût de la vie dans des contextes socio-économiques, voire culturels, différents,
il est tentant de se tourner vers des indicateurs plus directs et concrets que le revenu, à l’image
des variables de nutrition ou des données anthropométriques. On constate alors des
différences importantes entre régions, l’Asie du Sud semblant souffrir de davantage de
problèmes de malnutrition que l’Afrique, en dépit d’indicateurs de revenus plus favorables.
En Inde, la hausse rapide du revenu moyen s’accompagne en effet, de manière surprenante,
d’une baisse de la consommation moyenne de calories par tête.
Enfin, les mesures déclaratives de bien-être peuvent, au plan théorique, permettre de résoudre
certains de ces paradoxes, en laissant à chaque individu la responsabilité de la définition et de
l’agrégation de ses préférences, alors que les indices de pauvreté « imposent » typiquement un
panier de consommation de biens ou de services aux ménages. Les indicateurs de bien-être

3
fondés sur des auto-évaluations des conditions de vie, plutôt que sur des ressentis
émotionnels, semblent toutefois plus fiables et moins sensibles aux phénomènes
« d’adaptation », qui font que des personnes, même pauvres, peuvent déclarer des niveaux
relativement élevé de satisfaction en dépit de conditions de vie objectivement difficiles. De ce
point de vue, le paradoxe d’Easterlin, qui affirme que la croissance économique ne
s’accompagne pas d’améliorations en termes de bien-être, reste un sujet entièrement
d’actualité.
Echanges avec la salle
La discussion porte tout d’abord sur les implications pour l’aide publique au développement
de la multidimensionnalité de la pauvreté. L’aide doit-elle être dirigée vers la réduction de la
pauvreté et de la faim ou vers une hausse des revenus dans les pays en développement ?
Angus DEATON souligne que l’aide a connu une évolution ces dernières années, avec
notamment une attention plus grande portée aux questions de santé. Pour autant il n’attribue
pas ce changement aux difficultés de mesure des revenus mais aux impératifs humanitaires
plus pressants dans le domaine de la santé et à la relative facilité avec laquelle l’efficacité de
l’aide dans ce domaine peut être rendue visible (campagnes de vaccination etc.).
Une participante s’interroge sur les enseignements en termes de politiques à tirer de
l’intervention d’Angus DEATON et celui-ci rappelle que la mortalité dans les pays en
développement est essentiellement une mortalité infantile, due à des causes aisément
traitables (diarrhée, etc.). Il ne sert à rien selon lui de parachuter des innovations techniques
mais il s’agit de renforcer les systèmes de santé de manière à améliorer la santé infantile.
Un participant suggère que les différences de taille entre populations présentées par Angus
DEATON comme le signe de leur malnutrition n’est peut-être en fait que le reflet de
privations passées génétiquement transmises d’une génération à une autre et dont l’effet prend
du temps à s’estomper. Angus DEATON souligne qu’on a longtemps pensé que la taille avait
tout à voir avec la génétique mais que ce n’est plus le cas à l’heure actuelle. Il a été montré
que les populations grandissent dès lors que leurs contraintes nutritionnelles sont levées. C’est
ce qu’on a observé dans la deuxième moitié du vingtième siècle, du fait de l’amélioration des
conditions de vie au dix-neuvième siècle. Il a suffi d’une à deux générations pour que les
femmes commencent à porter des enfants plus grands, ce laps de temps étant trop court pour
que cela soit le seul effet de la génétique. En réponse à une autre question concernant le lien
entre obésité et mortalité dans les pays en développement, Angus DEATON explique qu’il
s’agit là d’un lien assez controversé (on peut voir l’obésité comme une maladie chronique qui
finit par avoir le dessus) et qu’il s’agit plus d’une projection des pays développés sur les pays
en développement. Même si certains suggèrent que l’obésité commence à être un problème en
Inde par exemple, c’est sans doute le cas pour une minorité d’individus fortunés tandis que la
sous-nutrition est bien plus largement répandue dans le pays.
Plusieurs participants font part de leurs réserves quant à la méthodologie employée dans les
comparaisons internationales de prix et de pouvoir d’achat. Angus DEATON indique que les
pratiques en termes de mesure s’améliorent constamment. La vraie difficulté de ces exercices
de comparaison est bien plus d’ordre conceptuel : comment comparer le prix de biens
communément consommés dans tous les pays et qui soient comparables ? La comparaison du
niveau de prix moyen entre le Japon et le Sénégal relève du défi dès lors que les biens qui
composent leur panier de consommation moyen sont très différents. Les indices de prix
permettent de faire cela par capillarité (on compare le Japon avec les Etats-Unis, les Etats-
Unis avec le Maroc, le Maroc avec le Sénégal etc.) mais ce n’est pas totalement satisfaisant.

4
Au-delà de la pauvreté monétaire :
les mesures multidimensionnelles et leurs limites
Intervenant:SabinaALKIRE,Universitéd’Oxford
Président:PierreJACQUET,Cheféconomiste,AFD
Discutant:AlemayehuSEYOUMTAFFESSE,IFPRIAddisAbeba
Sabina ALKIRE ouvre sa présentation en soulignant que la feuille de route pour la mise en
œuvre des Objectifs de Millénaire pour le Développement (OMD) publiée en 2001 par les
Nations-Unies mettait en évidence l’interconnexion des composantes de la pauvreté. Amartya
Sen a milité en faveur d’une approche multidimensionnelle de la pauvreté. Outre le revenu, il
convient également de considérer d’autres éléments (santé, éducation, violence, etc.) ce qui, in
fine, est susceptible de révéler des relations entre les différents indicateurs de privation. La
question est donc bien de savoir si une mesure de la pauvreté multidimensionnelle apporte un
plus relativement à une batterie d’indicateurs unidimensionnels. Comme le rappelle Sen : « la
passion de l’agrégation est tout à fait justifiée dans de nombreux contextes, mais elle peut
devenir futile ou inutile dans d’autres ». Dans l’article « Multidimensional poverty and its
discontents », Sabina Alkire se demande dans quelle mesure l’indice de pauvreté
multidimensionnelle IPM (ou MPI, Multi-Dimensional Poverty Index) présente un intérêt
supplémentaire par rapport aux indices unidimensionnels.
Depuis une quinzaine d’années, des projets de recherche ont œuvré pour l’émergence de
différentes approches de la pauvreté multidimensionnelle. La demande pour des indicateurs
en mesure de mieux comprendre et cibler la pauvreté s’est en effet accrue. En 2010, le PNUD
et l’OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative) lancent le MPI en tant
qu’indice expérimental couvrant 104 pays, voué à remplacer l’indice composite de pauvreté
humaine. Il est construit à partir de 10 indicateurs également pondérés recouvrant 3
dimensions (santé, éducation et niveau de vie). En premier lieu, il s’agit d’identifier les
personnes souffrant de privations dans chacun des indicateurs. Ensuite, une personne est
identifiée multi-dimensionnellement pauvre si elle souffre d’une privation pour au moins 30%
des indicateurs pondérés. L’IPM (ou Mo) est construit comme le produit de l’incidence de la
pauvreté H (à savoir, le pourcentage de personnes multi-dimensionnellement pauvres) et de
l’intensité de la pauvreté A (la proportion moyenne de privations pondérées qu’une personne
pauvre subit).
Au regard de cette méthodologie, 1,7 Mds de personnes sur une population mondiale de 5,2
Mds de personnes sont considérées comme pauvres (soit 32% de la population mondiale).
Une comparaison de l’incidence de la pauvreté calculée par l’IPM à l’incidence de la pauvreté
monétaire (entre 1,25 USD et 2 USD par jour) dans les pays disposant de cette mesure (92 des
104 pays couverts) montre qu’il existe une relation entre le revenu et la pauvreté
multidimensionnelle. Pour autant, des différences notables existent pour certains pays. Dans
quelques cas, ce décalage s’explique par la datation différente des enquêtes et les erreurs de
mesure résultant de l’inexactitude des données. En termes de distribution régionale, la
pauvreté multidimensionnelle se concentre en Asie du sud (51% des pauvres dans le monde)
puis en Afrique subsaharienne (28%). En outre, les décompositions de l’IPM mettent en
évidence des divergences entre les zones et les ethnies des pays (cas de l’Inde par exemple).
De plus, on observe que l’intensité de la pauvreté tend à s’accroître avec l’incidence de
pauvreté. Des analyses sont en cours pour étudier l’évolution de l’IPM dans le temps pour un
certain nombre de pays. D’ores et déjà, on observe qu’au Bengladesh, en Ethiopie et au
Ghana, la pauvreté a reculé entre 2004 et 2007.

5
Sabina ALKIRE identifie les forces et les limites de l’IPM. La mesure reste assez
rudimentaire mais elle a l’avantage d’être opérationnelle ; de plus, il en découle un indice
agrégé susceptible d’être ventilé par indicateurs et par sous-groupe révélant ainsi la structure
de la pauvreté chez différentes populations. L’importance d’un tableau de bord des indicateurs
(dashboard) n’est pas remise en cause ; la construction d’une mesure de la pauvreté
multidimensionnelle apporterait une valeur ajoutée. Ces deux outils ne s’évincent pas, ils se
complètent en cela qu’une mesure agrégée permet une estimation globale de la pauvreté. En
revanche, l’IPM reste fortement contraint par les données issues des enquêtes ménages
(nécessité de disposer d’indicateurs internationalement comparables ; les cadres
d’échantillonnage, la périodicité et la qualité des enquêtes auprès des ménages diffèrent entre
les pays ; la profondeur de la privation pour chaque dimension n’est pas exprimée ; les
données qualitatives ne sont pas prise en considération, telles que la violence). Les méthodes
de combinaison des données individuelles et des données au niveau des ménages sont à
approfondir puisqu’elles introduisent des biais. Outre l’information disponible au niveau des
ménages, il y a la nécessité de disposer de données sur différentes dimensions au niveau
individuel. Des interrogations liées à l’agrégation, aux pondérations et aux seuils émergent.
Même si des recherches ont été effectuées en amont permettant de conclure que les
pondérations pour chaque dimension de l’IPM et que la détermination des seuils de privation
sont robustes, il convient de poursuivre les travaux sur les méthodologies et leur mise en
œuvre pratique. De même, il s’agit de mieux comprendre la relation qu’entretiennent les
mesures de la pauvreté multidimensionnelle avec les mesures de pauvreté monétaire. Les
mesures de la pauvreté multidimensionnelle doivent inciter à étudier plus avant les
interconnexions entre les dimensions. Une meilleure compréhension des phénomènes peut
contribuer à créer des instruments de politique publique utiles.
Alemayehu SEYOUM TAFFESSE, le discutant de la séance, souhaite d’abord remercier les
auteurs pour la qualité de leur article. Ces derniers y proposent non seulement un nouvel
indicateur, le MPI, mais ont également pour ambition d’alimenter une réflexion plus générale
sur l’utilisation des indicateurs multidimensionnels. Les auteurs ont déjà eux-mêmes relevé un
certain nombre des limites du MPI, qui mériteraient d’être approfondies dans des travaux
ultérieurs. Ainsi, après avoir brièvement rappelé le contenu de l’article, M. Taffesse propose
de concentrer ses commentaires sur la valeur ajoutée des indicateurs multidimensionnels.
L’article ne paraît pas à vrai dire pas complètement convaincant sur ce sujet. Les auteurs
défendent en effet l’idée que les indicateurs multidimensionnels sont nécessaires pour
appréhender le niveau de pauvreté dans un pays. Ils n’apportent cependant pas de réponses
claires à la question « clé » : l’utilisation d’un seul indicateur multidimensionnel est-il
préférable à une batterie d’indicateurs unidimensionnels ? Une discussion autour de trois
justifications du recours aux indicateurs multidimensionnels aurait pu contribuer à alimenter
efficacement ce débat :
1. les indicateurs unidimensionnels sont limités. Les auteurs identifient des écarts importants
entre différents indicateurs de pauvreté unidimensionnels et considèrent ce résultat comme
une justification de leur propre indicateur. Cet aspect n’est toutefois pas précisément
détaillé. Il aurait ainsi été utile de préciser la taille de ces écarts, et à quels risques
d’erreurs de politique économique les indicateurs unidimensionnels pouvaient conduire. A
l’inverse, les bénéfices du MPI doivent être mis en balance avec le coût et les défis
associés à sa construction, plus importants que dans le cas d’indicateurs unidimensionnels.
2. les indicateurs multidimensionnels sont utiles pour recentrer l’action sur des dimensions
de la pauvreté souvent négligés. On pourrait penser qu’un des principaux apports des
indicateurs multidimensionnels, davantage que leur fiabilité, est de déplacer les termes du
débat politique sur la lutte contre la pauvreté, du revenu vers les questions d’éducation et
de santé. Mais, grâce à l’IDH notamment, cet objectif paraît déjà atteint. De ce point de
vue, le MPI ne constitue pas un apport additionnel.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%