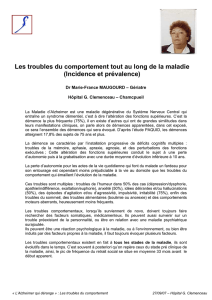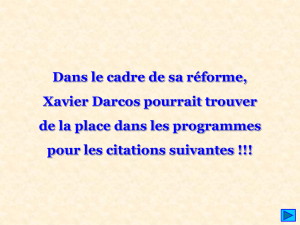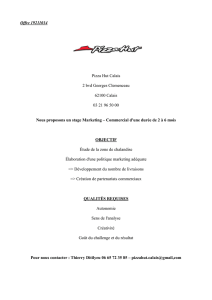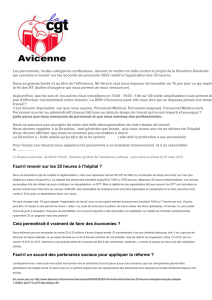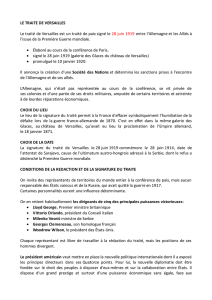telecharger en format word

1
Déposé à la SACD
CLEMENCEAU OU L'ANNEE DU TIGRE
***
MIchel Fustier
(toutes les pièces de M.F. sur : http://theatre.enfant.free.fr )
PERSONNAGES
L'historien de service, Clemenceau, Poincaré, le sergent,
le soldat Hirsch, le soldat Vauthier,
les généraux Hindenburg, Ludendorff, Foch, Pétain et Mordach
1 - Clemenceau est nommé président du Conseil
L'HISTORIEN DE SERVICE - En 1914, toutes les nations européennes ont, les unes et les autres,
peur de la guerre. Elles sont aussi fascinées par la même guerre, considérée comme le creuset dans
lequel elles se retremperont pour s'y purifier et retrouver leur énergie… La guerre éclate en effet dans
les premiers jours d'Août. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie d'un côté, l'Angleterre, la France et la
Russie de l'autre. La population de l'Allemagne est de 67 millions d'habitants alors que la France n'en
compte que 39! La guerre s'est déjà indéfiniment prolongée lorsque, en 1917, sur le front est, la
Russie, devenue révolutionnaire, se retire du combat. Pendant ce temps sur le front ouest, les armées
française et anglaise, enterrées dans leurs tranchées, réussissent à grand peine à faire face aux
Allemands également enterrés dans leurs propres tranchées. Situation bloquée! Quant au
gouvernement français, où se disputent des partis très divisés, il n'a pas, et c'est peu dire, démontré son
efficacité. Aussi, en novembre 1917, le président de la République Poincaré est-il sur le point de
désigner Clemenceau comme nouveau président du Conseil… Ils ne sont pas en très bons termes…
POINCARE - Merci d'être venu.
CLEMENCEAU - J'espère que vous ne m'avez pas dérangé pour rien!
POINCARE - Clemenceau, je n'irai pas par quatre chemins… Vous êtes le dernier auquel, dans les
circonstances dramatiques que nous vivons, je songerais à faire appel pour occuper la fonction de
président du Conseil….
CLEMENCEAU - Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir?
POINCARE - Laissez-moi au moins finir mes phrases… Le dernier, parce que vous avez un
caractère épouvantable, parce que les articles que vous avez si généreusement pondus dans votre petit
journal vous ont brouillé avec la moitié de la classe politique, parce que vous êtes terriblement
vindicatif, très superbe et assez bordélique, et enfin parce que vous avez toujours raison et que vous ne
changez jamais d'avis, ce qui revient à peu près au même…
CLEMENCEAU - Ajoutez si vous voulez que j'ai été traité par vos journaux de naufrageur et de
vieillard sanguinaire! Et n'oubliez pas non plus que je suis anticlérical en diable, et que par
conséquent, je ne crois ni en Dieu ni en la providence.
POINCARE - Je n'aurais pas osé vous en faire le reproche, mais en effet, dans un pays chrétien, cela
choque… Et aussi que vous avez une très large culture, ce qui ne choque pas moins que votre
athéisme, que vous avez défendu Dreyfus, que vous parlez l'anglais et l'allemand, ce qui est encore
pire… L'espagnol aussi, je crois…
CLEMENCEAU - Mal.
POINCARE - Je ne vous en ferai pas grief… De plus, je ne peux pas vous encadrer!
CLEMENCEAU - Je vous le rends bien.

2
POINCARE - Je sais, je sais!… Cependant nous sommes d'accord pour que cette guerre, nous la
fassions jusqu'au bout!
CLEMENCEAU - En effet, c'est peut-être notre seul point d'accord, mais oui, c'en est un.
POINCARE - Merci… Donc, vous êtes donc le dernier, mais le seul. Le seul parmi tous vos
collègues…
CLEMENCEAU - Ça me gène que vous parliez de "collègues"!
POINCARE - Vous avez raison, vous êtes d'une autre nature! Pour parler clair, je sais que vous êtes
un monstre d'énergie et c'est cela seul qui compte. Et nul n'a jamais douté de votre patriotisme…
Donc, vous êtes le seul parmi les… hommes politiques du jour auquel je puisse demander de conduire
la politique de la France et d'accepter pour cela la charge de président du Conseil.
CLEMENCEAU - Vous m'étonnez… Il y en a d'autres…
POINCARE - Mais vous, je le dis, c'est comme si d'impossible, vous étiez devenu indispensable.
CLEMENCEAU - Vraiment? Vous ne penseriez pas plutôt à Caillaux, par exemple.
POINCARE - Pas confiance, c'est un pacifiste!
CLEMENCEAU - Ou à Malvy…?
POINCARE - Pas fiable, pas du tout…!
CLEMENCEAU - Ou à Briand?
POINCARE - Un beau parleur, un amateur, très suspect!
CLEMENCEAU - Et Viviani, et Laval, et Delcassé, et Franklin-Bouillon, et Ribot, et Deschanel, et
Thomas, et Combes, et Picquart, et Tardieu…? Il y en a une bonne brouettée… Je parle sans la
moindre ironie.
POINCARE - Et moi, je vous écoute, vous l'incomparable, avec un extrême amusement! En tout cas,
ils ont tous amplement démontré qu'ils étaient incapables de maîtriser la situation. Ils ont peut-être des
qualités, mais jusqu'à présent nos députés et nos ministres n'ont fait que s'agiter dans le désordre. Une
vraie crapaudière, cette Chambre… Vous me comprenez? Et je me mets dans le même sac, j'ai fait
beaucoup d'erreurs! Nous n'avons été jusque-là ni gouvernés, ni défendus. Ce que je veux à la fin, c'est
ce qui est exceptionnel en vous, c'est votre entêtement. Nous sommes plongés dans un épouvantable
merdier. Les Allemands nous ont envahis en 14 et nous les avons arrêtés sur la Marne, mais depuis,
rien! Le nord de la France occupé, six cents kilomètres de tranchées à garder… Trois ans de guerre, les
pieds dans la boue sous les obus! Ils nous ont vidés, nous sommes épuisés. Eux aussi, je pense… Et
nous allons bientôt voir déferler sur notre front les quarante divisions dont les Allemands n'ont plus
besoin sur le front de Russie… Heureusement que les Anglais sont là! Quant aux Américains, ils se
font attendre… Il nous faut un gouvernement d'acier, avec un président de marbre, capable de serrer
les dents! Et qui fasse la guerre. Et qui ne fasse que ça… Alors, votre réponse? J'espère que vous
comprenez que je joue à quitte ou double…
CLEMENCEAU - En effet. Vous êtes-vous souvenu que j'ai soixante-seize ans et que ma santé n'est
pas bonne… J'ai des ennuis avec ma prostate.
POINCARE - Je n'ai parlé ni de votre âge ni de votre santé, ils m'indiffèrent. Vous tiendrez bien
encore deux ou trois ans, cela nous suffit. Le temps d'une victoire. Après, si vous insistez, nous vous
ferons des funérailles nationales! Alors, votre réponse?
CLEMENCEAU - La situation est très difficile… Vous me laisseriez faire comme je veux?
POINCARE - Pourvu que vous m'en parliez, oui.
CLEMENCEAU - Et si j'oubliais de vous en parler?
POINCARE - Je ferais comme si j'avais quand même entendu.
CLEMENCEAU - Si j'accepte, je ne veux personne dans mes jambes. Surtout pas les partis… Et
encore moins les syndicats! Il n'y a que l'homme seul qui puisse être un homme fort.
POINCARE - Monsieur Clemenceau, ne vous répétez pas, je crois avoir compris…
CLEMENCEAU - Dans ces conditions il se pourrait que j'accepte… Naturellement, je nommerais
moi-même mes ministres?
POINCARE - Naturellement…
CLEMENCEAU - Mais sachez bien que, si j'accepte, le pays s'apercevra tout à coup qu'il est
commandé. Il ne s'y attend pas!
POINCARE - Pourquoi insistez-vous… Je ne vous demande pas autre chose.
CLEMENCEAU - La situation est pourrie… J'aurais tout donné pour échapper à ce que vous me
proposez… Donc, j'accepte. Mais donnez-moi acte que je n'ai rien demandé.

3
POINCARE - Rien n'est plus vrai… Merci!
CLEMENCEAU - Monsieur le Président, mes respects….
2 - Discours à la Chambre
L'HISTORIEN DE SERVICE - Quelques jours après, alors que la situation militaire se révélait en
effet très difficile, Clemenceau prend la parole devant la Chambre…
CLEMENCEAU - Messieurs les députés, j'ai l'honneur de me présenter devant vous en tant que
nouveau président du Conseil. Comme c'est une fonction que je n'ai en aucune façon sollicitée, mais
que j'ai été prié d'accepter, j'ai obtenu de l'exercer avec la plus grande liberté. Le pouvoir que l'on m'a
donné, c'est "le Pouvoir", le vrai, dans tout son sens. Et vous savez en effet qu'en ce qui me concerne,
il faut me prendre non en détail, mais en bloc, exactement comme je suis! Quant à mon programme, il
est simple: je me présente devant vous avec l'unique pensée de faire la guerre, et une guerre intégrale.
Rien d'autre!
J'ai été choqué d'entendre votre collègue M. Forgeal nous parler tout à l'heure de l'organisation de la
paix future. Ce n'est pas le moment de parler de la paix. Avant de parler de la paix, il nous faut gagner
la guerre. Croyez-vous que ce soit une bonne chose pour les poilus que de sentir plus ou moins
consciemment que, pendant qu'ils se battent, il y a des gens qui pérorent dans leur dos? Je sais qu'on a
aussi évoqué, dans le pays et même dans cette assemblée, des pourparlers pour une paix immédiate,
qui eut été une paix honteuse. Nous ne renoncerons jamais au retour de l'Alsace et de la Lorraine… Il
ne faut pas laisser le pays et l'armée sous l'impression démoralisante qu'on leur demande des sacrifices
inutiles et que c'est sans objet qu'on a versé le sang des Français. S'arrêter en chemin serait la pire des
trahisons. Encore une fois, nous devons faire la guerre, et nous devons la gagner, cela ne se discute
pas. Et quand la guerre aura été gagnée, la paix alors sera immédiate et nous en dicterons chaque
article. Mais pas de paix sans victoire!
Maintenant donc est venu, non le temps de la parole, mais celui de l'action. Je serai tellement occupé
par l'action que vous me pardonnerez, je l'espère, de ne pas venir plus souvent vous voir pour en parler
en détail. Mais soyez rassurés, pendant ce temps, j'agirai. J'agirai et les décisions seront prises. Et
rapidement prises… Tout à l'heure, M. Constant me reprochait mon silence en matière de politique
extérieure… Voici ce que je réponds: ma politique extérieur et ma politique intérieure ne font qu'un.
Politique intérieure, je fais la guerre, politique extérieure, je fais toujours la guerre… La Russie nous
trahit, je fais la guerre. La malheureuse Roumanie est obligée de capituler, je continue à faire la guerre
et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure.
Nous avons de grands soldats, héritiers d'une grande Histoire, obéissant à des chefs trempés dans les
épreuves. Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous.
Nous devons les faire victorieux. Un jour, de Paris au plus humble village, des rafales d'acclamations
accueilleront nos étendards vainqueurs, tordus dans le sang, dans les larmes, déchirés par les obus,
magnifique apparition de nos grands morts. Ce jour, le plus beau de notre vie, il est en notre pouvoir
de le faire advenir.
3 - Visite au front.
L'HISTORIEN DE SERVICE - Ce que veut Clemenceau, on l'aura compris, c'est gouverner seul,
sans s'embarrasser d'institutions ou de procédures compliquées. Et pour cela, il nommera des ministres
qui seront plus des experts que des hommes politiques et s'appuiera pour prendre ses décisions sur
deux très proches collaborateurs, le général Mordacq pour les affaires militaires et Georges Mandel
pour les affaires civiles. Quant au commandement de l'armée, il était alors aux mains du général
Pétain, le général Foch étant dans son état-major… Clemenceau travaillait vite et prenait des décisions
rapides, ce qui fit sa force. Pour les décisions les plus graves, il consultait tout de même le ministre
concerné et se donnait vingt-quatre heures de réflexion. Mais il aimait aussi voir de ses yeux ce qui se
passait sur le terrain, c'est-à-dire au front…
CLEMENCEAU - Sergent, j'ai lâché mon escorte… J'aime bien fouiner tout seul, pour voir les
choses comme elles sont, de mes propres yeux… Sans être surveillé.
LE SERGENT - Vous allez vous salir, il y a deux pieds de boue.
CLEMENCEAU - Et alors? La boue des tranchées n'est pas celle que je crains. Présentez-moi donc
ces deux poilus… Bonjour!

4
LE SERGENT - Chut, monsieur le Président, ne parlez pas si fort, nous sommes en première ligne,
les Boches ne sont pas loin…
CLEMENCEAU - Pardon… Vous avez raison, j'ai naturellement la voix qui porte... Bonjour!
VAUTHIER - Bonjour… Mais c'est le Président? …Avec son calot sur la tête… Dans cette tranchée!
CLEMENCEAU - Oui, c'est moi… Bonjour!
VAUTHIER - Soldat Vauthier… Mes respects, monsieur le Président
HIRSCH - Soldat Hirsch… Pas possible! C'est… Mes respects, monsieur le Président.
LE SERGENT - Prenez garde, monsieur le Président, ils ne sont pas loin… Une balle perdue…
CLEMENCEAU - Laissez, laissez, je ne cours pas plus de risques que vous. Dites-moi, Vauthier,
d'où venez-vous?
VAUTHIER - De Saint-Genest-Malifaux, monsieur le Président…
CLEMENCEAU - Laissez tomber les "monsieur le Président"… Nous n'en sortirions pas! Saint-
Genest-Malifaux, beau village, très prometteur… Et vous avez quel âge?
VAUTHIER - Vingt-sept… Marié, deux enfants, deux blessures…
CLEMENCEAU - Graves, vos blessures?
VAUTHIER - C'est selon… une balle dans le mollet et une autre fois le pied droit gelé.
CLEMENCEAU - Aie! Et maintenant, tout marche bien?
VAUTHIER - Pas aussi bien qu'avant. Mais on fait aller. Je serre les dents.
CLEMENCEAU - Nous serrons tous les dents. Merci de bien les serrer. Tout ce qu'il nous faut, c'est
tenir, tenir, tenir jusqu'à ce que les Américains soient là. Après ça ira tout seul. Et vous, Hirsch?
HIRSCH - Moi… eh bien, trente-cinq ans… Pas marié… et pas de blessures…
CLEMENCEAU - Vous en avez de la chance! Et vous avez l'intention de continuer comme ça?
HIRSCH - Vous voulez dire… célibataire?
CLEMENCEAU - Non. Je veux dire sans blessures… Vous devez faire des jaloux.
HIRSCH - Oui, nous ne sommes pas très nombreux au club… Dans le bataillon, pas plus de trois. On
a passé à travers!
CLEMENCEAU - Je n'ai pas besoin de vous dire: continuez comme ça…
HIRSCH - Je ne demande pas mieux.
CLEMENCEAU - Nous en verrons la fin bientôt… Prêtez-moi un peu votre casque…
HIRSCH - Mon casque…? Tenez…
CLEMENCEAU - Merci… Le casque d'un chanceux! Je voudrais voir comment c'est, le no man's
land. Sergent, à quelle distance sommes-nous des Boches?
LE SERGENT - Vous n'allez pas…
CLEMENCEAU - Si, si, précisément, je vais… Donc, à quelle distance?
LE SERGENT - Enfin… Le Génie est venu mesurer hier, rapport à la mine qu'il est question de
creuser pour faire sauter leur cagna… Entre soixante-six et soixante-sept mètres… Monsieur le
Président… vous ne devriez pas…
CLEMENCEAU - Qu'est-ce que je ne devrais pas? Je suis assez grand pour prendre mes
responsabilités... Et je monte sur ce petit marchepied?
LE SERGENT - Oui… Faites attention… Prenez au moins un périscope!
CLEMENCEAU - Merci… Je ne suis pas très grand, il me faut la seconde marche… Là… Je vois…
Il fallait que je voie ça une fois… A force de parler de choses qu'on n'a jamais vues… Dieu sait si j'en
ai dit sur la guerre! Comme ça j'aurai vu. C'est terrifiant! (il regarde longuement) Cette mer de
cratères! Oui, c'est terrifiant… Oui, j'ai bien fait de venir… Vauthier, donnez-moi votre mousqueton…
(il prend le mousqueton) Que j'aie au moins tiré une fois, symboliquement! (il charge et tire dans la
direction des Allemands)
LE SERGENT - Vous feriez mieux d'arrêter, maintenant. Ils pourraient nous répondre… (on entend
quelques sifflements)… Vous entendez?
CLEMENCEAU - Vous avez raison, sergent… Hirsch, je vous rends votre casque et voilà votre
mousqueton, Vauthier… Dites-moi, il y a quelque chose qui me tracasse… et vous trois, justement,
vous pourriez… J'ai besoin d'un avis… Pétain me dit que ce serait mieux, dorénavant, que ce ne soit
plus la première ligne qui soit la mieux fortifiée, mais la seconde. Parce qu'il dit que maintenant,
quand la première ligne est enfoncée, souvent la seconde ligne n'est pas capable de tenir. Alors que
dans son idée, la première ligne, qui serait allégée, servirait au moins à retarder les choses sérieuses. Et
ensuite, une fois son élan brisé, l'ennemi, deux ou trois kilomètres plus loin, viendrait définitivement

5
s'éteindre devant une puissante seconde ligne… Vous qui savez ce que c'est que d'être dans les
tranchées, qu'en pensez-vous? Pour ainsi dire, l'ennemi, on lui casse la patte à la première ligne et, à la
seconde, on l'achève… Qu'est-ce que vous en dites, vous, Vauthier, de cette idée?
VAUTHIER - Qu'est-ce que j'en dis… J'en dis que ça fait toujours mal au cœur que d'abandonner un
petit bout de France aux Boches, mais que ce serait peut-être mieux, en fin de compte, parce qu'on
l'aurait bien vite récupéré.
CLEMENCEAU - Et vous, Hirsch, qu'en pensez-vous?
HIRSCH - J'en pense… que je n'aimerais pas trop être en première ligne. Sacrifié pour ainsi dire!
CLEMENCEAU - C'est bien ce qui me tracasse. Et vous, sergent?
LE SERGENT - Si Pétain… pardon, si le général Pétain le dit, c'est que… c'est bon.
CLEMENCEAU - Je vois, Sergent, vous êtes pour l'autorité… Et c'est vrai qu'il en faut de l'autorité
pour maintenir au combat quarante millions de Français… Sans toujours mesurer les conséquences de
ce qu'on décide, avec toute cette autorité! C'est ça, ma guerre à moi, décider, et ne pas arrêter de
décider, et la plupart du temps de décider dans le brouillard, sans bien savoir ce que…. Allons,
allons… Il y a des jours où je me demande si je ne préférerais être en première ligne, les pieds dans la
boue, à me geler les couilles… Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide… Allons, j'y vais.
Merci, merci, vous trois, de faire ce que vous faites… (il fait le salut militaire) Maintenant, sergent,
ramenez-moi dans le droit chemin. Je vous suis.
4 - Les Allemands changent de tactique.
L'HISTORIEN DE SERVICE - Pendant les cinq ou six mois qui suivirent son arrivée au pouvoir,
Clemenceau décida que la meilleure façon de faire la guerre, c'était, en attendant les Américains, de la
faire d'une façon purement défensive, de façon à économiser les troupes et les armes. Les armées
françaises et anglaises, allemandes aussi! étaient en effet épuisées par trois ans de combats
ininterrompus. Le front resta donc pendant de longs mois là où Clemenceau l'avait trouvé. Cependant
les Allemands, dont les effectifs se trouvaient au contraire renforcés par les troupes qui revenaient du
front russe, cherchaient à mettre au point de nouvelles stratégies. Le maréchal Hindenburg et le
général Ludendorff sont en pleine recherche…
HINDENBURG - Nous n'attendrons pas le Kronprinz … Il n'y comprend rien et il est toujours en
retard.
LUDENDORFF - Monsieur le Maréchal, il est le chef des armées et ce que nous avons à dire est trop
grave pour que…
HINDENBURG - Justement, général Ludendorff! Faisons d'abord le point de la situation.
LUDENDORFF - Bien… Ce sera simple… Après la paix de Brest-Litovsk, nous avons pratiquement
ramené du front russe la moitié des troupes dont nous disposions.
HINDENBURG - Donc, maintenant, sur le front français, où en sommes-nous?
LUDENDORFF - 192 divisions… 110 en ligne et 80 en réserve… Ce qui fait 2,5 millions
d'hommes.
HINDENBURG - Et l'ennemi?
LUDENDORFF - D'après mes renseignements… Mais on ne peut jamais être sûr… Français,
Anglais, Belges et quelques autres, environ 158 divisions… Mais je ne peux pas dire exactement ce
que cela représente de combattants, car les dites divisions ont été assez éprouvées et leurs effectifs sont
quasi-squelettiques. Pour certaines, je dirais presque qu'elles sont des divisions fantômes. Il y a aussi
25 divisions américaines, très bien fournies, elles, mais pas encore opérationnelles. Cependant les
Américains arrivent en France au rythme de… je n'ai que des informations contradictoires, mais ça
pourrait monter jusqu'à 100 ou 200 000 par mois. On nous parle aussi de troupes africaines… La force
nègre! Nous les évaluons à pas plus de 80 ou 90 000 hommes, qui craignent le froid!
HINDENBURG - Et c'est toujours Pétain qui…
LUDENDORFF - Oui, mais on parle de plus en plus de Foch, qui est quand même moins timoré que
Pétain… Il y a aussi Mangin qui piaffe dans la coulisse. Un fonceur! Et n'oublions pas qu'à la tête des
troupes anglaises il y a un général Haig très jaloux de son indépendance. Ah, si je pouvais enfoncer un
coin entre les Français et les Anglais, ça règlerait le problème! Et Clemenceau lui-même s'occupe
volontiers de stratégie, ce qui n'arrange rien. Quant aux Américains, je doute qu'ils acceptent de se
mettre sous commandement français.
HINDENBURG - Alors, avec tout ça, qu'allons-nous faire?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%