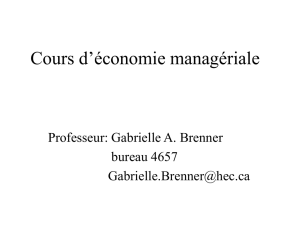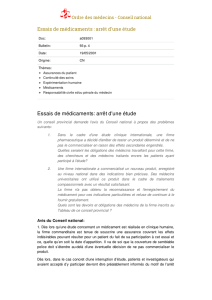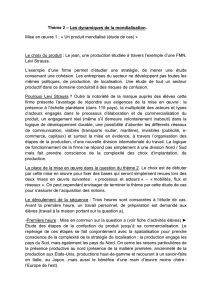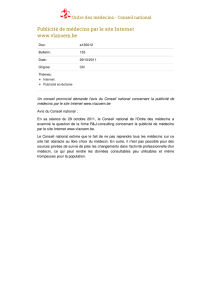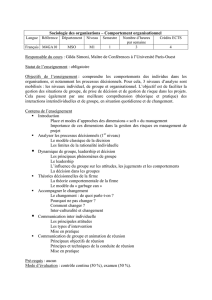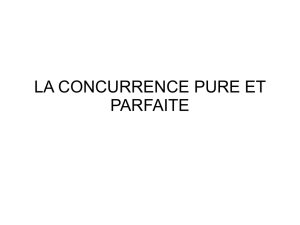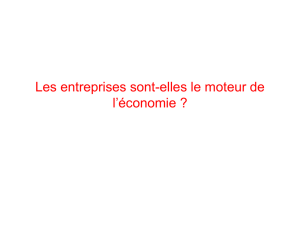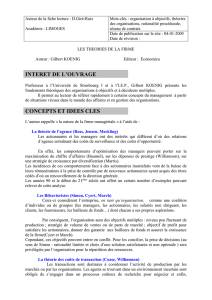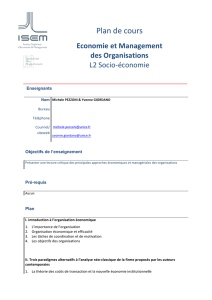les nouvelles theories de l`entreprise

1
LES NOUVELLES THEORIES DE L’ENTREPRISE
B. CORIAT ET O. WEINSTEIN
Chapitre premier
FIRME POINT, FIRME INSTITUTION, FIRME
ORGANISATION
1°) La firme néo-classique et ses paradoxes
Les hypothèses de base du modèle micro-économique standard réduisent la firme à une
simple fonction de production. Les contradictions qui en résultent, en particulier le
traitement du collectif comme un seul et même agent, contraire à l’individualisme
méthodologique (IM), ont amené dans les années 30 une remise en cause du modèle
(théories de la concurrence imparfaite). Une contestation plus radicale porte sur la conception
micro de la firme comme un agent individuel parfaitement passif, négligeant le rôle de
l’entrepreneur, auquel des économistes hétérodoxes attribuent trois fonctions essentielles :
une fonction d’innovation ou de création (l’entreprise cherche à agir sur son environnement
(Schumpeter)), une fonction d’acquisition et d’exploitation de l’information (Hayek) et une
fonction d’organisation et de coordination de la production (Liebenstein) ; ces trois
conceptions sont évidemment en contradiction avec les hypothèses néo-classiques de base.
2°) Dépassements et ruptures
Dès 1933 avait été mise en avant la scission au sein de l’entreprise entre propriétaires et
dirigeants, ces derniers contrôlant effectivement l’entreprise et ne cherchant pas
nécessairement à maximiser le profit de l’entreprise (fonction utilité des propriétaires), mais
leur propre fonction utilité (Berle et Means). Baumol formule en 59 une thèse selon laquelle
celle-ci les pousse à maximiser les ventes globales ou le taux de croissance de la firme plutôt
que son taux de profit. Une telle hypothèse permet d’expliquer le mouvement de
concentration des entreprises.
H. Simon met au point une nouvelle conception de la rationalité, en faisant des
comportements un objet d’étude en lui-même et non, comme chez Friedman, un simple
moyen de la théorie des marchés et des prix. Il prend en compte l’incertitude et
l’information imparfaite des agents, ainsi que les limites de leurs capacités de calcul, qui
ne leur permettent pas de passer en revue toutes les actions possibles, et enfin
l’interdépendance des agents, qui prennent leurs décisions en anticipant les actions des
autres (comportements stratégiques). Cette rationalité « procédurale » ou « limitée »
s’oppose à la rationalité substantive classique en ce qu’elle porte sur les procédures de
décision et non les résultats, et considère les objectifs et les moyens comme à déterminer et
non comme donnés. Il en résulte la recherche non d’une maximisation mais de la satisfaction
d’un niveau d’aspiration, qui se traduit par l’étude d’un certain nombre d’alternatives, le
processus cessant dès qu’est atteint le niveau de satisfaction attendu, niveau qui peut être
révisé en fonction de l’expérience du sujet. La théorie de Simon présente en fait la firme
comme un palliatif aux limites de l’individu, la division du travail au sein du processus de
décision permettant une meilleure gestion.
L’ouvrage de Cyert et March, A Behavoural Theory of the Firm (1963) va contribuer de
manière décisive à l’abandon de la représentation de la firme-point walrassienne ; en
effet, ces auteurs présentent la firme comme une coalition de groupes dont les intérêts
convergent mais dont chacun manœuvre pour son compte propre. Par conséquent, des buts
intermédiaires complètent les objectifs généraux de la firme, et sont l’objet de négociations

2
entre les différents groupes, ce qui entraîne un « relâchement organisationnel », les dirigeants
ayant besoin d’un « budget discrétionnaire », monétaire et non monétaire, pour faire accepter
par les différents groupes les objectifs fixés pour la firme.
Liebenstein de son côté part du constat que des entreprises disposant de ressources
équivalentes parviennent à des résultats très divers pour mettre en évidence un nouveau type
d’efficience, pas seulement « allocative » (consistant en l’allocation des ressources), mais qui
dépend de la qualité de l’organisation interne à la firme, « facteur X », qui détermine
l’intensité d’utilisation des facteurs de production (en particulier le travail) ; l’état normal de
l’entreprise est donc sous-optimal, contrairement à ce qu’affirme la théorie standard, en
conséquence d’une certaine « inefficience X », et les contrats et conventions, explicites ou
implicites (le contrat de travail en particulier étant nécessairement incomplet) jouent un rôle
essentiel ; la firme est dans cette perspective une organisation bien plus qu’une simple
combinaison de facteurs.
Chandler enfin effectue une mise en perspective historique de la firme moderne, que l’on
peut avec lui définir comme un ensemble intégré d’unités fonctionnelles et
opérationnelles, administré par une hiérarchie managériale à plusieurs niveaux. Sa
fonction principale est d’assurer la coordination des activités et des flux de ressources, ce qui
se traduit par le rôle croissant en son sein de l’appareil administratif. Elle se distingue du
marché en substituant la coordination administrative à la coordination marchande, et de la
fédération en reposant sur un système hiérarchique et un contrôle centralisé. Chandler
souligne l’influence sur la forme de la firme des conditions de production et de distribution
(passage à la consommation de masse) ; il distingue deux formes successives de firmes,
forme U (unitaire : centralisée, cloisonnée) et forme M (multidivisionnelle : divisions
autonomes spécialisées par produit ou par région, supervisées par une direction générale qui
assure la coordination), permettant intégration verticale (prise de contrôle des différents stades
de la production et de la distribution d’un produit) et diversification. Les formes de propriétés
et de contrôle, ainsi que les modes de relations inter et intra-firme jouent également d’après
lui un rôle essentiel. La firme moderne est donc dans ce cadre une institution complexe,
qui s’est imposée au fil du temps par son efficience dynamique, à travers les
métamorphoses de ses formes organisationnelles.
3°) Conclusion : quelques clés de lectures
[Pour ce qui est de la clé historique, je pense que le mieux est de se reporter directement au
bouquin.]
Deux problématiques sont transversales dans les débats théoriques actuels sur la firme. La
première est : pourquoi existe-t-il une firme, c’est-à-dire une forme d’organisation distincte
du marché ? Deux types de conceptions s’opposent, les uns voyant la firme comme destinée à
réduire les coûts de transactions qui existent sur le marché (Coase, Williamson,
néoclassiques), les autres la pensant comme un espace de production et de création de richesse
et d’innovation (Marx, Schumpeter, Chandler, régulationnistes).
La seconde est : comment caractériser la firme en tant qu’organisation et/ou
institution ? La firme entendue comme organisation est le lieu de coordination d’agents :
« les organisations sont des systèmes d’actions coordonnées entre individus et groupes dont
les préférences, l’information, les intérêts et les savoirs diffèrent. Les théories de
l’organisation décrivent la conversion du conflit en coopération, la mobilisation des
ressources et la coordination des efforts qui facilitent la survie simultanée d’une organisation
et de ses membres » (March et Simon). La conception de la firme comme institution prend en
compte ces dimensions, mais place également la firme dans un contexte social et une
perspective historique.

3
Chapitre second
DE COASE A WILLIAMSON : FIRME ET COUT DE
TRANSACTION
1°) Coase et l’établissement de nouveaux fondements
Dans les années 30, D. H. Robertson remarque qu’au milieu d’un « océan de coopération
inconsciente » (le marché, régi par la main invisible et donc le système des prix) existent des
« îlots de coopération consciente » (les firmes, régies par une hiérarchie et les décisions de
l’entrepreneur, et qui se caractérisent donc par la suppression de la régulation par les prix) ;
une fois établie cette distinction, il s’agit d’expliquer pourquoi il y a deux formes
économiques de coordination et comment s’effectue l’arbitrage entre l’une et l’autre. Coase
répond à la première question par la mise en évidence de coûts de marché (coût de la
découverte des prix adéquats + coût de négociation des contrats, d’autant plus élevé que les
contrats sont ponctuels et donc nombreux) ; à l’inverse, l’organisation des transactions
internes a aussi un coût, qui croît avec la taille de la firme. En mettant l’accent sur les
transactions, Coase réfute une conception technologique de la firme, qui met l’accent sur
la firme comme lieu de production. Il a en outre une conception hiérarchique de la firme
(où s’exerce une relation d’autorité), qui contribue à faire de l’existence de relations à long
terme un attribut essentiel de la firme.
2°) La constitution du nouveau corpus : Williamson
Williamson va pousser plus avant l’analyse de Coase en terme de coûts de transaction, en
reprenant des analyses développées par d’autres penseurs : le choix de la transaction comme
unité fondamentale de l’analyse économique (Commons) ; la théorie de la rationalité limitée
(Simon) ; l’importance primordiale de l’information (Arrow) ; et enfin l’importance des
innovations organisationnelles (Chandler), ainsi que des contrats. Il passe d’une vision
binaire (la firme opposée au marché) à une théorie des « arrangements institutionnels »
décrivant les diverses formes intermédiaires possibles entre firme et marché.
Williamson cherche à refonder la théorie de l’entreprise en partant de l’individu. Pour
cela, il définit tout d’abord des hypothèses de comportement jugées réalistes : la rationalité
limitée, d’une part, qui entraîne de manière nécessaire l’incomplétude des contrats ; et
consécutivement l’existence de comportements opportunistes (résultant de l’asymétrie
d’information, pouvant s’exercer ex ante ou ex post, et posant le problème de la sélection
adverse et du risque moral). Ensuite, il analyse les différentes formes de transactions,
caractérisées par le degré de spécificité des actifs (le fait qu’un investissement en vue d’une
production donnée soit plus ou moins facile à réutiliser dans le cadre d’un autre type de
production), le degré d’incertitude (qui résulte davantage des comportements stratégiques des
autres agents que de l’environnement naturel), et la fréquence des transactions.
Ceci posé, Williamson explique l’arbitrage entre les différentes formes institutionnelles
(de coopération) par le choix de celle qui minimise les coûts totaux (de production, qui sont
toujours plus faibles sur le marché, ET de transaction, qui varient en fonction des trois
facteurs évoqués ci-dessus). Il distingue trois types de contrats : classique (ponctuel, sans
incertitude), néo-classique (lorsqu’une relation à long terme soumise à une incertitude forte
impose le recours à un tiers pour arbitrer les conflits), et personnalisé (des liens durables et
complexes poussent à l’établissement de normes construites au fur et à mesure de la relation).
A un niveau d’incertitude donné (en l’absence d’incertitude, le marché est toujours
préférable), Williamson va donc, en considérant deux niveaux de fréquence et trois niveaux
de spécificité de l’investissement, établir les procédures d’arbitrage entre les différentes
formes institutionnelles : le contrat classique est préféré pour une faible spécificité, alors
qu’une forte spécificité entraîne soit un contrat de type néo-classique (faible fréquence) soit,

4
dans le cas de transactions fréquentes, une structure bilatérale (sous-traitance, partenariat),
voire l’intégration, qui permet une adaptation continue des relations entre les partenaires, sans
nécessiter la renégociation d’un contrat à chaque fois. [cf. tableau p. 61]
Pour Williamson, l’intégration verticale s’explique ainsi par le fait que dans certains cas
(investissements spécifiques) l’économie réalisée en termes de coûts de transactions grâce au
choix de la firme est supérieure à celle effectuée sur les coûts de production qu’aurait permise
le recours au marché. La limite de cette logique réside toutefois dans le fait que le choix de
l’organisation entraîne des coûts bureaucratiques mais surtout une perte de force incitative :
les agents intégrés sont moins incités à produire à un niveau optimal que les agents soumis à
la concurrence sur le marché.
Williamson reprend en outre l’analyse de Chandler en terme de forme U et forme M, à
laquelle il ajoute une forme H (holding) ; la supériorité de la forme M sur la forme U
s’expliquant par le fait qu’elle réduit les interactions et la circulation d’information entre les
divisions ; et sa supériorité sur la forme H (dont elle se distingue par l’existence d’une
direction générale) par le fait qu’elle permet de réduire les conséquences de l’opportunisme
des managers par la mise en place d’un système de contrôle et d’incitations global, faisant
converger les objectifs des différentes divisions (qui sinon tendent à poursuivre des sous-
objectifs propres).
3°) Une évaluation
C’est donc d’une approche en terme d’échanges qu’il s’agit, qui se veut institutionnaliste
mais réduit les institutions à des systèmes de contrats. Elle participe d’un courant qui vise
à rendre plus réaliste les hypothèses de base de l’économie, tout en conservant le principe
d’IM. On peut reprocher à Williamson l’hypothèse d’opportunisme, le développement actuel
des structures bilatérales prouvant qu’il peut aussi s’établir des relations de confiance entre
partenaires économiques, et surtout de ne pas prendre en compte toutes les conséquences de
l’hypothèse de rationalité limitée, puisque le choix de la forme d’organisation s’effectue pour
lui après un calcul de maximisation (qui nécessite donc une rationalité parfaite) ; enfin, on
peut critiquer le fait que dans la théorie des coûts de transaction, la technologie soit
considérée comme donnée, alors qu’elle interagit avec l’évolution des formes
institutionnelles (la mise en exergue de l’influence du choix de la forme institutionnelle sur
les coûts de transaction amène à négliger son influence sur les coûts de production).
Chapitre III
DROITS DE PROPRIETE ET RELATION D’AGENCE
LA NOUVELLE ORTHODOXIE NEO-CLASSIQUE
La théorie néo-classique qui se développe à partir des années 70 vise à prendre en compte
les critiques d’inspiration marxiste et institutionnaliste, notamment la réfutation de la « firme-
point » et la mise en évidence d’une information incomplète, tout en conservant les
hypothèses de base de la micro, à savoir la rationalité substantive, la stabilité des préférences
et une analyse basée sur la méthode de l’équilibre. Il s’agit alors d’expliciter la nature des
relations entre les membres de la firme et leurs positions respectives. Pour cela, deux
théories sont mises au point : la théorie des droits de propriété et la théorie de l’agence.
1°) La théorie des droits de propriété
La théorie standard considérait la structure des droits de propriété comme un donné ; il s’agit
pour les néo-classiques d’affiner l’analyse et de voir quels sont les différents systèmes de
droits de propriété et comment ils agissent sur le comportement des individus. Pour cela, un

5
droit de propriété est défini comme un droit socialement validé à choisir les usages d’un
bien économique. Un droit de propriété privé se caractérise en ce qu’il est attribué à un
individu et aliénable. L’intérêt économique des droits de propriété est qu’ils sont des facteurs
d’incitation à la création et à la valorisation d’actifs. Ainsi, l’établissement de droits de
propriété permet d’internaliser des externalités, et donc de restaurer l’efficacité du marché ; ils
sont cependant le plus souvent incomplets, toujours parce que les agents ne disposent que
d’une information incomplète.
Les trois grandes catégories de droit qu’un agent peut exercer sur un objet (usage,
exploitation, cession) permettent de définir plusieurs types de droits de propriété (privée,
communale, collective, mutuelle, publique) mais aussi de poser l’hypothèse de séparabilité
des droits de propriété (deux agents différents peuvent avoir l’un le droit d’usage et l’autre le
droit d’exploitation), dont on considère en outre qu’ils sont partitionnables (différents agents
peuvent exercer leur droit sur un actif) et aliénables (ils peuvent être échangés).
Une forme organisationnelle est alors considérée comme établissant une certaine structure de
droits de propriété, dont il s’agit d’expliquer le choix. Dans le cas de la firme, il s’agit de
combiner les avantages de la spécialisation et un système de contrôle et d’incitation. Tout
d’abord dans le cas de la firme capitaliste classique (Alchian et Demetz), qui repose sur un
travail en équipe dans lequel il est difficile d’évaluer l’apport marginal de chaque agent.
Il est alors tentant d’adopter une stratégie de free rider, ce qui ne peut être évité que grâce au
choix d’un moniteur qui contrôle le travail des agents. Pour cela, on lui donne droit de
contrôle sur le travail des agents, mais aussi droit exclusif à passer et à renégocier des contrats
avec les agents, ainsi que le droit de céder (vendre) sa place ; surtout, pour assurer que lui-
même n’est pas free rider, on en fait un « créancier résiduel », c’est-à-dire qu’il perçoit le
rendement résiduel (ce qui reste une fois que tous les facteurs de production ont été
rémunérés) ; il possède en outre un droit de contrôle résiduel (il prend les décisions
concernant les utilisations de l’actif qui ne sont pas explicitement spécifiées (ou interdites) par
le contrat), d’autant plus important que les contrats sont incomplets. Ce système permettrait
de répondre aux exigences du travail en équipe de manière efficiente, cette efficacité étant
bien sûr perdue dans le cas d’une entreprise publique ou autogérée…
L’existence de grandes sociétés par action, loin de remettre en cause les principes de la
propriété privée comme le prétendaient Berle et Means, permet pour les néo-classiques
d’exploiter au maximum la possibilité de partitionner et d’aliéner ces droits, et d’augmenter la
division du travail entre ceux qui exercent le droit de prendre des décisions et ceux qui
assument les conséquences ces décisions en terme de valeur d’échange.
2°) Un essai de reformulation générale : la théorie de l’agence
Le problème de la relation d’agence (définie en 76 par Jensen et Meckling : contrat par
lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engage une autre personne (l’agent)
pour exécuter en son nom une tâche qui implique la délégation d’un certain pouvoir de
décision) a été soulevé déjà par A. Smith. Ce problème apparaît dès lors que les intérêts du
principal et de l’agent divergent et que tous deux sont en situation d’asymétrie d’information,
et entraîne des coûts d’agence (pour le principal : coûts de surveillance et d’incitation + perte
résiduelle, i.e. écart entre le résultat obtenu et la maximisation effective de son utilité ; pour
l’agent : coûts d’obligation qu’il doit opérer pour garantir qu’il ne lésera pas le principal,
assurances par exemple) ; il s’agit donc de déterminer quelle structure contractuelle permet de
minimiser ces coûts.
La théorie de l’agence présente la firme comme un « nœud de contrats » bilatéraux
entre individus, « fiction légale. » Elle n’a donc pas d’existence véritable (contrairement à
la firme-point walrassienne) ; il est donc vain de chercher à déterminer ses objectifs, son
propriétaire, de définir un « intérieur » et un « extérieur » de la firme : il n’y a pas
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%