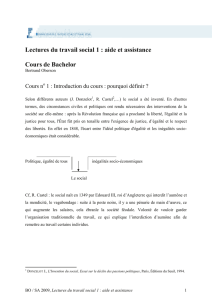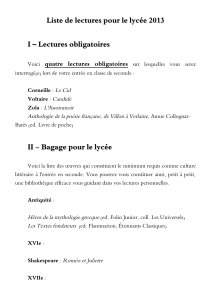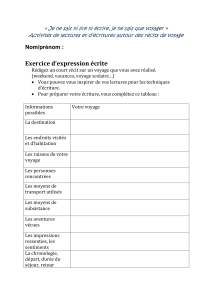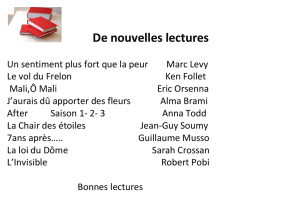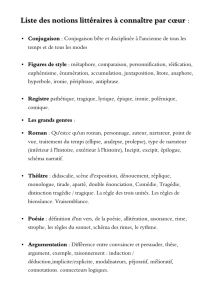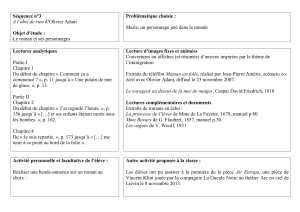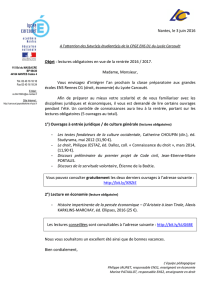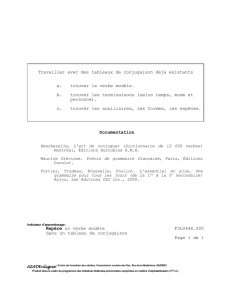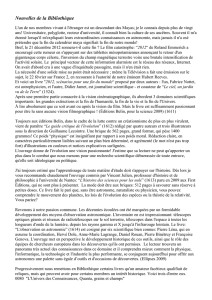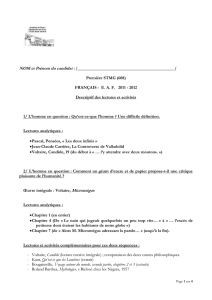école des hautes études hiver 1997

1
AUTOMNE 2008
NOUVELLES PERSPECTIVES EN MANAGEMENT
80-439-95
Bureau : 5.207
Tél : 340-6348
Secrétaire : Martine Lefebvre martine.lefebv[email protected]
Bureau : 5.249
Tél : 340-6325
OBJECTIFS DU COURS
En ce début de XXIe siècle, où foisonnent les interrogations profondes, sinon les remises en
question autour d'à peu près tous les systèmes économiques et managériaux, ce cours se veut un
tour d'horizon et une mise au point à propos des conceptions et fonctionnements de l'institution de
base des économies modernes : l'entreprise ou, d'une manière plus large, l'organisation, entendue
comme institution de production de biens ou de services destinés, en principe, à l'amélioration du
bien-être des collectivités.
Ce cours se veut une relecture radicale, non seulement du management occidental traditionnel
mais aussi de managements autres : germano-scandinave, est-asiatique...
L'organisation séquentielle de ce cours se construira d'abord sur une interrogation ethnohistorique
des bases et principaux jalons du management traditionnel dominant : le management occidental
anglo-américain. Ceci dans le but d'en rendre plus clairs les sous-bassements liés à certains
systèmes de croyances et de valeurs, s'étalant du XVe au XXe siècle et ayant accompagné l'entrée
de l'Occident dans dans l'industrialisation.
Puis, sous forme de différents blocs successifs, le cours canalisera la réflexion vers les leçons à
tirer, tant positives que négatives, de cette analyse des liens entre évolution des systèmes de
valeurs occidentales et construction de l'ossature théorique et doctrinale du management. C'est
ainsi que l'on débouchera sur les grands constats que tout un chacun, aujourd'hui, accepte et
partage : il n'y a pas «UN» mais plusieurs managements possibles et applicables, depuis le
«nippon» jusqu'au «rhénan», en passant par le «scandinave» ou encore, plus récemment, le
«latin»...
La question est alors, pour rendre la réflexion plus instructive et plus utile, de s'interroger sur les
raisons qui ont fait émerger, et même rendu parfois bien plus efficaces, ces managements
«autres».

2
C'est en quête de réponses à cette question, et aussi à celle de savoir quel(s) management(s) sera
(seront) le(s) réel(s) fondement(s) d'une qualité de vie à la hauteur des exigences et contextes du
XXIe siècle, que se construira la suite du cours avec, comme bases, ce qui est désigné ici par le
terme «perspectives». Chacune des perspectives proposées sera à considérer, non pas comme
une sorte d’avenue de pratiques managériales particulières, avec ses décalogues de recettes, mais
bien plus comme une voie de réflexion renouvelée, touchant chacune une ou plusieurs grandes
traditions intellectuelles, habituellement non mises à contribution dans les courants dominants,
traditionnellement positivistes, fonctionalistes et pragmatistes.
Ces «perspectives», iront de la critique philosophique-sociologique de la prétendue
cosubstantiabilité marché-libre-entreprise-démocratie, jusqu’à l’interrogation thermodynamique de la
logique de l’économie capitaliste, en passant par l’ethnohisroire critique et comparé, la relecture de
la logique et de la théorie de la comptabilité à partie double, de l’économisme néo-libéral, des liens
entre symbolismes organisationnels, pouvoir, vie intrapsychique, fantasmes des «leaders»...
En particulier et plus précisément, le cours s’attachera à :
_ L'étude des progrès, mais aussi des dysfonctionnements et contradictions «structurels»
provoqués par l'expansion des modèles-valeurs de l'entreprise occidentale du XIXe siècle ;
_ L'étude des conséquences de ces dysfonctionnements à la lumière de sciences et de
disciplines peu usitées dans le courant principal du management occidental : philosophie
sociale, sociolinguistique, métaphysique, socio-analyse, psychanalyse, anthropologie,
sémiologie, ethnohistoire, courants économiques en marge du main stream, (courants néo-
marxistes, régulationistes, classiques, tiers mondistes...) ;
_ L'étude des bases sociohistoriques comparées des différents autres managements :
japonais, germano-scandinave, sud-coréen, latino-catholique...
_ L'étude de quelques cas occidentaux atypiques et prometteurs, synthèses originales de
fondements apparemment universels de nouvelles perspectives managériales (et non
réductibles à quelques clichés folkloriques tels que les prétendues «discipline» des
Allemands, «soumission au groupe» des Japonais ou «abnégation-frugalité» des
Scandinaves...)
_ L'étude, enfin, des paradigmes les plus en mesure de rendre compte de ces nouvelles
perspectives, des raisons des succès et prouesses de managements «autres»... pour mieux
fonder une assise théorique et des orientations d'actions en mesure de répondre aux
exigences des connaissances d'aujourd'hui et des grands défis de demain.
D'une façon plus synthétique, à la fin de ce cours l'étudiant(e) devra avoir :
1. Resitué et compris les origines ethnohistoriques et les bases théoriques et idéologiques du
management occidental traditionnel ;
2. Dégagé et analysé les raisons de ses évidentes inadaptations actuelles, notamment face
aux dégâts de la mondialisation et aux percées des managements différents et d'origines
autres : Scandinavie, Japon, Corée, Allemagne, etc...
3. Recensé et compris les principaux grands dysfonctionnements désormais en voie de
devenir structurels dans l'économie-management de l'Occident anglo-américain ;

3
4. Étudié ces dysfonctionnements à la lumière de champs disciplinaires variés et plus en
mesure d'en éclairer la nature profonde : histoire des faits et des systèmes économiques,
philosophie sociale, économie politique...
5. Élaboré une compréhension globale des enjeux managériaux actuels à partir d'une
confrontation des paradigmes en jeu : celui de la raison économique traditionnelle basée sur
le fonctionnalisme et la vision newtonienne de l'univers, face à celui du radical-humanisme
et de la vision quantique-thermodynamique ;
7. Dégagé, enfin, un socle synthétique pouvant servir de fondements à une autre
compréhension du management et de ses applications face aux défis du siècle prochain,
aussi bien à l'échelle de l'entreprise que des sociétés et des nations.
MÉTHODE ET DYNAMIQUE PÉDAGOGIQUES
Propositions générales
Ce cours a ceci de particulier qu'il fait de l'implication et de l'engagement de chacun une nécessité
personnelle plutôt que l'enjeu d'une évaluation finale. L'implication et l'engagement visent une
dynamique collective qui n'aura de richesse que les qualités que chacun voudra bien apporter.
Toutefois, pour que ce séminaire soit pour chacun un apport pertinent, il est nécessaire que chaque
étudiant remplisse très exactement ses obligations : lire sérieusement les textes obligatoires,
contribuer aux débats autour des sujets précis de chaque session.
Les lectures doivent servir aussi à des réflexions approfondies sur les grands constats effectués par
les auteurs étudiés et conduire la classe à mettre en commun les principales leçons à en tirer. Dans
ce cadre, le but recherché est de permettre aux étudiants de bénéficier de la lecture et de l'analyse
du plus grand nombre de sujets et d'auteurs possibles, à travers différentes problématiques
fondamentales. Cela doit se faire sans alourdir outre mesure la charge de travail individuelle. Il est
proposé, pour cette raison, une dynamique et une logique de lecture qui se concrétisera par un
choix de lectures «complémentaires» st «suggérées». Les étudiants choisiront à leur gré les
thèmes, séances, lectures… pour réaliser leur travail de «fiche de lecture» et de «synthèse» écrites.
Les étudiants, en fin de session, remettront un travail final - synthèse où ils reprendront soit un
des enjeux du cours qu'ils approfondiront, soit un développement autour d'un sujet personnel
(idéalement dans le sens de leur domaine de mémoire ou de thèse) qu'ils traiteront selon les
différentes perspectives développées en cours.
Une «fiche de lecture» doit s’entendre comme un exercice de restitution de l’ensemble des idées
générales traitées par (tous) les textes obligatoires d’une séance donnée.
Une «synthèse» doit s’entendre comme une restitution-réflexion touchant les différentes lectures de
plusieurs séances, et si possible s’intégrant au domaine d’intérêt de recherche de
l’étudiant(e).

4
Séance-type de lecture
(1) Les lectures obligatoires :
_ Textes de base ou ensemble de textes commun à tous les étudiants, à lire impérativement
avant chaque séance.
(2) Les lectures suggérées
_ Recommandées mais facultatives à choisir selon les champs d’intérêt de chacun(e).
(3) Les lectures complémentaires
_ À l'usage des étudiants intéressés par l'approfondissement d'un aspect particulier.
`
LA DYNAMIQUE DU COURS
Les étudiants, dès le premier cours, présenteront durant dix minutes environ leur projet ou
simplement leur idée ou intérêt de recherche, afin que chacun puisse mettre en commun son
expérience, son ambition et aussi ses incertitudes. À la suite de cette présentation, les étudiants
devront s'efforcer de marquer leur participation par des liens entre leurs domaines respectifs de
recherche ou d'intérêt et le déroulement du cours. Cette dynamique collective marquera dès lors
tout le cours jusqu'à sa fin ; elle sera l'ossature du cheminement de tous.
Durant la plus grande partie du cours, le professeur proposera des exposés et des analyses
élargissant les perspectives tracées par les lectures et les discussions de la séance, mais
supposant toujours les lectures obligatoires correctement effectuées et assimilées par tous.
Une des particularutés pédagogiques de ce cours, est qu'il sera "construit" au fur et à
mesure, au gré de la dynamique des discussions en classe et des intérêts des participants,
et avec eux. D'où encore ube fois l'importance du sérieux à mettre dans l'effort personnel de lecture
de chacun (e).
EN CE QUI CONCERNE L'ÉVALUATION
Chaque étudiant(e) aura à réaliser :
(Il est à noter que les fiches et synthèses écrites s'entendent en format Times New Roman,
interligne et ½ et espaces et marges habituelles normales)
_ Une fiche de lecture par cours portant sur les lectures obligatoires de toutes les
séances du cours (3 pages)………………………………………………………… 30 %
_ Une synthèse individuelle - travail final, portant au choix sur une problématique
personnelle utilisant les lectures et débats du cours (thème de recherche, sujet

5
de thèse ou mémoire…) ou sur la restitution explicitation des lectures – fil
conducteur du cours en général. (10 pages maximum) ........................... 50 %
– Une note de participation sera également attribuée pour souligner l'assiduité, la
présence «active» au cours, la ponctualité, la qualité des interventions montrant une
correcte lecture des textes ……………………………………………………. … 20%
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%