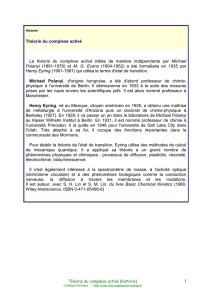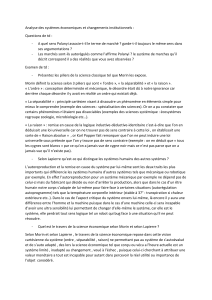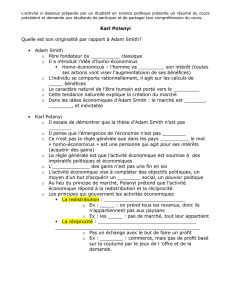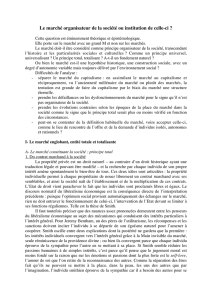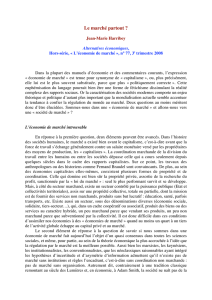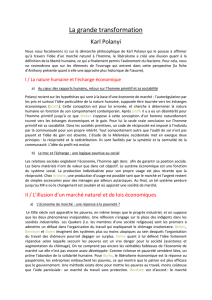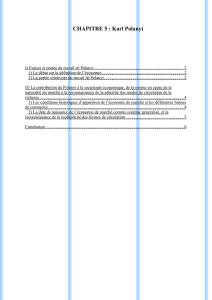La Grande transformation - prepa-bl

La Grande Transformation,
Karl Polanyi, 1944.
Nous nous attacherons ici à étudier la façon dont Polanyi explique l’apparition de l’économie de
marché et les raisons qui ont permis à celle-ci de devenir le principal moteur de l’histoire, tant lorsque
la société tenta de lutter contre elle que lorsqu’elle se soumit aux règles du marché, puis comment
celui-ci s’est effondré dans l’entre-deux-guerres, marquant de fait cette « Grande Transformation ».
I) Le marché au service des sociétés et de leur histoire jusqu’au
XVIIIe siècle.
1) L’échange et la sociabilité dans les sociétés primitives.
Pour Polanyi, l’histoire et l’ethnographie montrent que le rôle joué par les marchés a longtemps
été insignifiant dans les différentes nations et sociétés. Si la division du travail existe depuis les
premières sociétés, elle n’est pas due à une prétendue tendance au troc (Smith) mais à des différences
propres aux sexes, aux caractéristiques géographiques et aux dons individuels inégaux. L’histoire et
l’anthropologie montrent selon lui que l’homme agit pour garantir sa position sociale, ses droits et ses
avantages sociaux et n’accordent de valeur aux biens qu’en vertu de cette fin. Les intérêts sociaux
articulent donc le processus de production et de distribution des biens, même s’ils varient en fonction
de la taille de la société (société primitive tribale, antique, médiévale,…). Il prend l’exemple des
sociétés mélanésiennes pour montrer un système de troc (kula) qui échappe à tout mobile de gain et
n’est qu’un vecteur de cohésion sociale. Les relations sociales englobent les relations économiques.
2) Marchés locaux et marchés extérieurs : la remise en cause du modèle classique.
Polanyi renverse le point de vue classique : la localisation géographique différenciée des biens
suscite la division du travail et le commerce à long court, commerce qui appelle la création de marchés
où s’échangent les biens. Ces marchés permettent donc le troc et nécessite l’échange de monnaie de
transaction. C’est seulement alors que peut apparaître une propension au troc, mais elle n’est pas
nécessaire (alors qu’elle est première chez les classiques). Il n’y a longtemps que deux types de
marchés qui sont fonctions de la distance géographique des biens recherchés : un marché extérieur
pour ceux qui peuvent supporter le transport au long cours, et un marché local pour les autres biens
(périssables, volumineux, lourds,…). Ces marchés sont complémentaires et la concurrence n’y est pas
nécessaire. Si celle-ci y naît et tend à les désorganiser, il est tout à fait possible de l’éliminer. Le
commerce est donc municipal (exemple du commerce hanséatique), il s’effectue seulement entre
communes organisées qui l’assurent soit « sous forme de commerce de voisinage », soit au long court,
deux formes séparées qui ne pouvaient pénétrer au hasard dans les campagnes.
3) Civilisations, villes et bourgeoisie, protectrices et censeurs des marchés.
Dès le début, des protections ont entouré les marchés locaux contre l’ingérence de pratiques de
marché visant seulement le gain. Des rituels, des cérémonies et diverses pratiques culturelles marquent
les limites du marché tout en assurant son bon fonctionnement dans celles-ci. Des villes se créent aux
points de halte et de rencontre des marchands, donc sur les marchés, tout en empêchant que ceux-ci ne
s’étendent aux campagnes qui, productrices des ressources vitales, doivent échapper à ses règles. Les
marchés sont donc à l’origine d’une véritable civilisation urbaine qui les protège et les limite. Au
Moyen-Âge, Les villes sont une organisation des bourgeois, seuls à être citoyens, dont la position
dépend donc du type de commerce qu’ils pratiquent et de leur relation ou non avec les marchands
extérieurs, sur laquelle l’influence politique et militaire de la ville a peu de pouvoir coercitif (ils sont
donc exclus des marchés locaux par les réglementations car le capital mobile risque d’en désintégrer

les institutions). Ce clivage entre deux commerces est la « clé de l’histoire sociale de la vie urbaine »
pour Polanyi.
II) De la douloureuse naissance de l’économie de marché à son
triomphe sans partage.
1) La création de marchés nationaux par l’Etat centralisé mercantiliste et ses conséquences.
L’Etat centralisé nait aux XVe-XVIe siècles en raison de la Révolution commerciale. L’Etat
répond alors à deux principaux objectifs : mise de toutes les ressources nationales au service de la
puissance extérieure, grand problème de l’époque, et unification territoriale afin de centraliser les dites
ressources (le capital est donc un élément d’unification sur le plan économique). L’Etat cré aussi un
marché national, concurrentiel, afin d’instaurer la liberté commerciale entre les villes du pays et d’y
intégrer les campagnes. Il impose le système mercantiliste qui détruit les particularismes et les
protections dressés par les villes, mais en retour il impose une réglementation totale de la vie
économique pour lutter contre la concurrence et le risque de monopole, tous deux nuisibles. La
politique des enclosures dans l’Angleterre du XVIe siècle témoigne de ce marché national en marche
et d’un progrès économique (hausse de la productivité agricole) dont l’Etat doit rapidement contrôler
les effets sociaux désastreux (paupérisation des campagnes) en interdisant les nouvelles enclosures.
L’Etat contrôle ainsi le rythme du progrès afin que la société s’y adapte. Le social et le politique
contrôlent encore l’économique.
2) Les origines de l’économie et de la société de marché.
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la production industrielle n’est qu’un simple appendice du
commerce en Europe occidentale. Mais l’invention de machines et d’installations complexes, et donc
spécialisées, modifie la relation du marchand avec la production et appelle la mise en œuvre du
système de la fabrique tout en donnant plus d’importance à l’industrie par rapport au commerce. La
production industrielle nécessite dès lors des investissements à long terme par nature risqués, ce qui ne
peut être compensée que par la continuité de la production. La complexification de la production
industrielle suppose que la fourniture de ses éléments essentiels, travail, terre et monnaie, soit garantie,
donc que leur offre soit organisée pour pouvoir être achetée. Le système de fabrique dans de telles
sociétés commerciales conduit donc à l’extension du modèle de marché au travail, à la terre et à la
monnaie qui deviennent des marchandises (sans être produits pour la vente). Ce développement du
système de marché, en particulier avec la formation d’un marché du travail, nécessite une adaptation
de la société afin de garantir son bon fonctionnement et son autorégulation ; le mobile du gain devient
dominant; la société de marché est née. L’économique englobe dès lors le social qui lui est soumis.
3) Des résistances sociales et politiques au triomphe du libéralisme économique.
« La production mécanique, dans une société commerciale, écrit Polanyi, suppose tout bonnement
la transformation de la substance naturelle et humaine en marchandise ». Le rythme extrêmement
soutenu du bouleversement social suscité par la Révolution industrielle rend difficile l’adaptation
concomitante de la société qui en subit les conséquences désastreuses : paupérisation, désorganisation
sociale, etc. La société tente donc de s’en protéger. L’histoire sociale du XIXe siècle est ainsi marquée
par un double mouvement : extension des marchés pour les vraies marchandises et, en retour, mesures
et politiques mettant en place des institutions dont le but est d’enrayer l’action du marché sur le travail,
la terre et la monnaie. La loi de Speenhamland, active en Angleterre de 1795 à 1834, est un exemple
de ces protections et de leurs conséquences sociales. Jusqu’en 1795, les lois sur le domicile (restriction
de la mobilité physique) empêchaient la formation d’un marché du travail. Leur abrogation suscite la
mise en place de la loi de Speenhamland, « système des secours » accordant un complément de salaire
offrant un revenu minimum indépendant des gains. Mais il devient dès lors inintéressant d’offrir son
travail (car peu rémunéré), la productivité et les salaires diminuent, l’indigence se développe aux frais
de la paroisse. Le « droit de vivre » proclamé par la loi ruine la société qu’il devait protéger et

s’oppose aux lois de marché qui appellent un vrai marché du travail. Ce dernier est donc créé via
deux lois de 1832 et 1834 qui abrogent Speenhamland : c’est le début du capitalisme moderne.
III) Le système économique fondé sur l’étalon-or, moteur historique
du XIXe siècle et du premier XXe siècle.
1) Le pilier de la « paix de cent ans » de 1815 à 1914.
La civilisation du XIXe siècle, marquée par cent ans de paix sans précédent de 1815 à 1914
(seulement dix-huit mois de conflits entre grandes puissances), reposait selon Polanyi sur quatre
piliers : l’équilibre des puissances, l’étalon-or international, le marché autorégulateur et l’Etat libéral.
Cette situation est garantie par l’apparition d’un puissant parti de la paix qui incite les grandes
puissances à endiguer tout risque de conflit (pressions politiques ou/et économiques), d’abord dans le
cadre de la Sainte-Alliance, qui s’appuyait sur de forts liens féodaux et cléricaux (les aristocraties
européennes forment une « internationale de la parenté ») et sur la force armée, puis dans celui du
Concert européen. Ce dernier est dépourvu de ces atouts mais maintient pourtant la paix, ce qui n’est
permis selon Polanyi que par l’action de la haute finance mondiale, institution sui generis propre à la
période qui assure le lien entre l’institution politique et l’institution économique mondiales.
Indépendante de tout gouvernement et liée à chacun d’eux, la haute finance recherche son profit et
exerce de ce fait des pressions sur les gouvernements pour juguler tout risque de conflit ou pour les
provoquer si besoin, en particulier dans le domaine colonial. Le commerce est dès lors dépendant de la
paix car il repose sur un système monétaire international, l’étalon-or, qui ne peut fonctionner par
temps de guerre. La finance et le commerce, responsables de nombreuses guerres coloniales, évitent
donc un conflit général. Ce système économique suscite l’intérêt de paix et le sauvegarde.
2) De l’effondrement de l’étalon-or à la foi en son retour.
La formation de la Triple-Alliance puis de la Triple-Entente à la fin du XIXe et au début du XXe
siècle met fin à l’équilibre des puissances pendant que les rivalités coloniales et la concurrence pour
les marchés exotiques dissolvent le système économique, la haute-finance perdant de ce fait de sa
capacité à éviter les conflits. Des tensions politiques naissent alors et entrainent la Première guerre
mondiale. Les traités d’après-guerre empêchent toute reformation de l’équilibre des puissances en
affaiblissant les vaincus (rendant de ce fait caduque la S.D.N.). Le rétablissement d’un système
monétaire international apparaît alors comme un autre moyen d’assurer la paix (tout en étant en réalité
nécessaire à l’équilibre des puissances), en particulier aux yeux du président américain Wilson. Les
années vingt ne furent donc pas révolutionnaires mais bien conservatrices, avec cette volonté de
revenir au système économique antérieur fondé sur l’étalon-or. Rétablir la parité en or des monnaies
semble alors le seul moyen d’assainir la situation et la croyance en l’étalon-or devint « la foi de
l’époque ». La restauration de l’étalon-or devient le symbole de la solidarité mondiale pendant plus de
dix ans (voir les nombreuses conférences internationales tenues, de Londres à Locarno, dans ce but).
3) L’échec de ce projet à l’origine de la crise politique et sociale des années trente.
La crise des années trente est due à l’échec de ce projet de retour à un système économique que la
guerre et les Traités ont achevé de ruiner après sa déliquescence au début du siècle. Certaines
monnaies s’affaiblissent voire disparaissent dans les années vingt, entrainant la dislocation des
rapports entre Etats et la fuite des capitaux. Ces phénomènes monétaires orientent la vie politique
(notamment extérieure) et sociale de l’époque (développement des fascismes par exemple). Alors que
l’intention à long terme est le retour au libre-échange, la protection des monnaies, et en particulier de
leur valeur extérieure, suscite des politiques à tendance autarcique qui isolent les Etats les uns des
autres. La disparition définitive de l’étalon-or libère des « forces titanesques » qui brisent la S.D.N. et
la haute-finance et suscitent une transformation profonde et soudaine des institutions du XIXe siècle.
L’Etat libéral est remplacé dans de nombreux pays par des régimes autoritaires et de nouvelles formes
d’économies, fondées sur des blocs monétaires forts par exemple, supplantent le système des marchés

libres. Enfin, certains pays qui refusaient le statu quo, le retour en arrière tant recherché et qui ont de
ce fait perçu le bouleversement mondial, en profitent pour prendre de l’avance sur leurs rivaux dans
les transformations en cours : l’Allemagne nazie et l’U.R.S.S. communiste essentiellement. Le
protectionnisme interétatique débouche donc sur le totalitarisme et la guerre.
La civilisation du XIXe siècle était fondée sur le système du marché autorégulateur, ce qui
l’imbrique dans un cadre économique très artificiel, et même contre nature, dont l’effondrement
provoque sa propre transformation. Avec elle meure le libéralisme économique selon Polanyi.
IV) Critique interne de l’ouvrage sur les questions abordées.
Polanyi réalise dans La Grande Transformation un travail, mêlant l’économie et l’histoire, à l’issu
duquel il conclut que le libéralisme économique est mort à la suite de la crise politique et économique
qui toucha le monde entre 1929 et 1945. Sur ce point cependant, qui résume pourtant une part
importante de sa thèse, il se trouve que l’histoire a donné tort à Polanyi à la suite de la Seconde guerre
mondiale. L’un des premiers objectifs des grandes puissances mondiales d’après guerre fut ainsi de
restaurer le système économique sur des bases libérales dont l’O.N.U. et les Etats-Unis surtout se sont
fait les porte-drapeaux. Le système de Bretton-Woods, instauré dès 1944, soit l’année même de la
parution de l’ouvrage, cherche ainsi à restaurer le système financier mondial et à rétablir l’organisation
monétaire mondiale. Avec le Gold Exchange Standard, le dollar devient alors l’étalon monétaire
international et l’étalon-or lui-même ne disparaît vraiment qu’en mars 1973 avec l’effondrement des
taux de change fixes, qui fait suite à la suspension de la convertibilité de la monnaie américaine en
1971. Le libéralisme économique est en outre au cœur des débats et des conflits politiques qui
marquent tout le second vingtième siècle au cours de la Guerre froide. La guerre fut donc moins la
conclusion de la lente décomposition du libéralisme économique que le témoin de ses défauts. La
« Grande Transformation » n’est donc peut-être pas tant dans la cause des crises des années 1929-
1945, comme le pense Polanyi, que dans leurs conséquences sur l’économie libérale.
Sur le plan méthodologique, on peut remarquer que Polanyi étend sa théorie à l’ensemble des pays
développés, pris en un tout qui suivrait un seul et unique modèle dont l’Angleterre serait l’exemple
canonique. Mais une vision si totalisante de l’économie, si elle répond sans doute à un objectif de
simplification tout à fait louable, tend à passer sous silence les différences propres à chaque système
économique national. Le libéralisme lui-même ne s’y présente pas sous des formes identiques, en
particulier en ce qui concerne le rôle joué par l’Etat, les entreprises et les différentes formes de contre-
pouvoirs économiques et politiques, y compris au XIXe siècle. La prégnance des mécanismes de
marché sur la société et la virulence de la réaction en retour de celle-ci sont donc variables d’un pays à
l’autre, ce qui peut appeler à nuancer les propos de Polanyi. Ce dernier en effet nous décrit un long
processus économique (développement du capitalisme ; réponse protectionniste de la société pour
s’en protéger ; enfin émergence du fascisme et de l’autoritarisme qui en résulte) qui serait une forme
de loi d’airain ayant fatalement touché toutes les économies de façon identique. Il semble pourtant que
les évolutions économiques, sociales et politiques de l’Angleterre, de la France et de l’Allemagne par
exemple ont été bien différentes sur la période, en particulier en ce qui concerne les conséquences de
la crise sur les régimes en place : si l’Allemagne est peut-être l’exemple le plus convaincant de ce
processus, puisqu’il aboutit au triomphe du nazisme, l’Angleterre au contraire résiste à la tentation
fasciste et autoritaire, bien qu’elle connaissent elle aussi ses propres mouvements fascistes, dont le
B.U.F. d’Oswald MOSLEY est le principal représentant ; quant à la France, c’est sans doute moins des
éléments structurels liés à sa situation économique que sa déroute militaire et le chaos politique qui en
résulte qui la font se tourner vers un homme providentiel et le maréchalisme.
Polanyi oublie donc peut-être, à travers son souci de simplification, des éléments liés aux
différentes cultures et, finalement, aux différentes sociétés. Mais, ce faisant, il écarte également des
éléments d’explication parfois importants des évolutions historiques qu’il tente de comprendre. On
peut ainsi avancer des éléments culturels pour rendre en partie compte des conséquences politiques de
la « Grande Transformation » dans les trois pays que nous avons déjà pris en exemple, et en particulier
en évoquant l’attachement des populations concernées aux différents modèles politiques possibles :
notons ainsi, sans entrer dans le détail, que la tradition démocratique est relativement ancienne et

fortement ancrée en Angleterre (depuis 1689) et en France (même si la tradition colbertiste et surtout
bonapartiste est sans doute un des piliers du régime vichiste), alors que la société allemande, déçue par
la République de Weimar et l’humiliation subie à Versailles en 1919, n’est dans l’ensemble pas
défavorable à un retour à un modèle plus autoritaire qui lui est beaucoup plus familier. Polanyi semble
donc parfois faire exactement ce contre quoi il s’élève : inclure les phénomènes sociaux, culturels et
politiques dans des éléments et des processus économiques auxquels ils seraient simplement
subordonnés. En voulant réinsérer l’économique dans le social, il en vient peut-être à faire l’exact
inverse au risque de sombrer dans une forme d’ « économisme ».
V) Critique externe.
Le principal objectif de Polanyi est donc d’expliquer les processus historiques ayant conduits à la
chute du libéralisme économique par l’économie elle-même et les évolutions qu’elle a connues.
L’extension des mécanismes de marché à l’ensemble de la vie sociale et la réaction protectionniste de
la société, conduisant aux excès fascistes et totalitaires, sont selon lui à l’origine de la « Grande
Transformation » des années 1929-1945. Mais on peut également se demander comment le libéralisme
en général, et plus particulièrement le capitalisme, est lui-même progressivement apparu. C’est en
particulier ce que fait WEBER dans L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme de 1904-1905 ce
dernier considère ainsi que le capitalisme est liée à certaines conceptions du monde et à certaines
valeurs (« l’esprit de travail »), elles-mêmes très attachées à l’éthique protestante, mais aussi surtout
au long processus de rationalisation qui marque la société. Il résulterait par conséquent avant tout
d’une modification du rapport entre l’homme et le travail qui passerait d’un statut de labeur nécessaire
à la survie à celui de devoir envers l’homme (la division du travail permettant ainsi à chacun de
travailler pour tous les autres), voire envers Dieu (le travail pouvant permettre de gagner son salut). Le
capitalisme ne serait donc pas dans cette optique la simple conséquence des évolutions marchandes et
industrielles, mais bien plutôt celle des transformations profondes de la société qui à leur tour agiraient
sur l’économie. La création d’un marché du travail trouve peut-être ainsi une explication, tant en
termes de rationalité économique (en rendant plus visible et plus disponible l’offre de travail
notamment, donc rationalité en finalité) que d’un point de vue sociologique et culturel, puisque ce
souci rationnel répond aussi à des valeurs nouvelles, faisant du travail le cœur de la vie humaine, qu’il
faut satisfaire au mieux (rationalité en valeur). La crise sociale qui accompagne le développement des
mécanismes de marché est peut-être liée de ce fait au temps nécessaire pour faire correspondre les
évolutions parallèles de la société et de l’économie, et non plus à celui requis pour que la sphère
sociale s’adapte à une sphère économique dont le capitalisme aurait fait le moteur de la première.
On peut aussi considérer à travers deux autres processus sociaux, l’individuation et l’égalisation,
que l’intérêt individuel a tendu à prendre une place de plus en plus importante au sein des sociétés. Si
Polanyi, et surtout Marcel MAUSS, en particulier dès 1923-1924 avec son Essai sur le don, affirment
ainsi que l’échange dans les sociétés primitives est fondé sur l’obligation de faire des cadeaux et d’en
accepter (les 3 obligations selon Mauss : « donner, recevoir, rendre »), celui-ci se modifie
profondément avec l’individuation, puisqu’elle substitue progressivement l’intérêt individuel à
l’intérêt collectif (MAUSS voyant dans le don le fondement de la « socialité »). Robert BOYER en
particulier montre qu’alors le marché est une forme d’institution nécessaire pour coordonner et rendre
au mieux compatible les choix individuels, fondés sur des intérêts personnels, d’agents rationnels
considérés comme égaux dans la théorie (y compris dans les théories économiques classiques, puisque
tous, consommateurs comme producteurs, répondent au modèle de concurrence pure et parfait et à
l’atomicité des biens qui y est liée), bien qu’ils ne le soient pas dans les faits. Le marché ne serait donc
pas cette création artificielle prétendant pouvoir réguler l’ensemble de la société comme le pense
Polanyi, mais au contraire la conséquence logique des évolutions séculaires de cette même société.
Robert BOYER ajoute surtout que cette forme institutionnelle n’est pas la seule présente dans
l’économie face à un Etat qui tenterait d’en limiter les effets, comme semblent l’indiquer les réflexions
de Polanyi. Il relève au contraire six modèles principaux d’arrangements institutionnels (marché,
hiérarchie privée, communauté, réseau, associations, Etat) dont les associations variées et
complémentaires caractérisent et différencient chaque économie. La remise en cause du libéralisme
économique dans l’entre-deux-guerres est donc peut-être moins liée à la trop forte prégnance du
marché qu’aux disfonctionnements des autres formes d’institutions ou de leurs associations.
1
/
5
100%