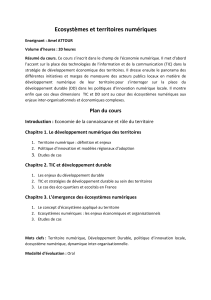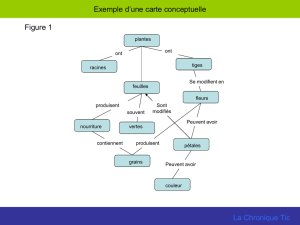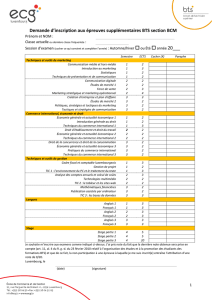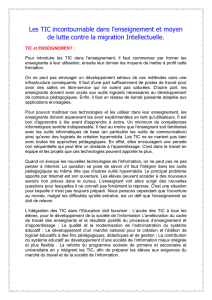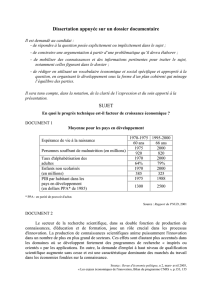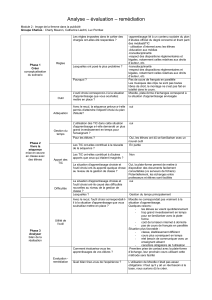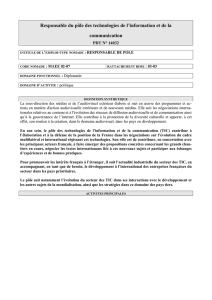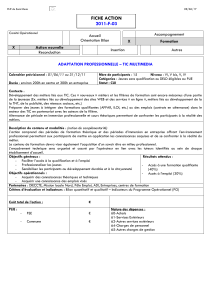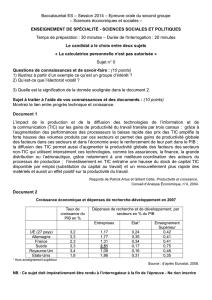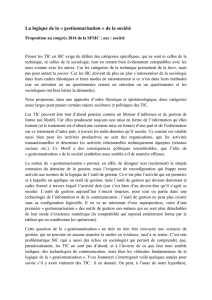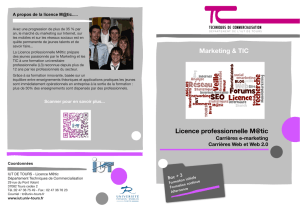La seconde vague : numérisation des échanges et

GROUPE THEMATIQUE "ENTREPRISES ET MARCHES"
SYNTHESE ET ORIENTATIONS POUR LA RECHERCHE
V5 – 15 OCTOBRE 2011
LES 3 VAGUES DE LA NUMÉRISATION DE L'ÉCONOMIE .............................................. 2
La première vague : l'informatisation des organisations ............................................. 2
La seconde vague : numérisation des échanges et des marchés .................................. 3
La troisième vague : équipement et pratiques numériques des individus ...................... 4
SIX GRANDS DOMAINES POUR LA RECHERCHE ......................................................... 7
1er domaine de recherche : Organisations, individus et réseaux .................................. 7
2e domaine de recherche : Innover et vendre dans un monde bruyant ...................... 10
3e domaine de recherche : croissance, équilibres et déséquilibres de marché .............. 15
4e domaine de recherche : Piloter le numérique, gouverner ses effets ........................ 18
5e domaine de recherche : Le numérique, levier des alternatives économiques ? ........ 20
6e domaine de recherche : Manager le numérique dans l'entreprise ........................... 24
ANNEXES ........................................................................................................... 27
Annexe 1- Tableau synthétique des tendances lourdes ............................................. 28
Annexe 2- Fiches "tensions fondatrices" ................................................................. 33
Annexe 3 – Micro-scénarios de rupture................................................................... 54

2
GROUPE THEMATIQUE "ENTREPRISES ET MARCHES"
SYNTHESE ET ORIENTATIONS POUR LA RECHERCHE
V5 – 15 OCTOBRE 2011
Animé par Madeleine Besson, Christine Balagué et Daniel Kaplan, avec le concours de
Renaud Francou et l'apport régulier d'Anne-France Kogan et de Laurent Gille, le groupe
thématique "Entreprises et marché" s'est intéressé en priorité aux mutations et ruptures
économiques et organisationnelles, ainsi qu'à l'innovation. Au travers de 5 ateliers, d'un
important travail documentaire, d'entretiens bilatéraux et d'échanges en ligne, il s'est
efforcé, de dégager le sens des transformations en cours, le potentiel des
transformations susceptibles d'advenir, ainsi que et les zones de tension ou d'incertitude,
pour en déduire des axes de recherche novateurs, généralement pluridisciplinaires.
Le groupe a fait le choix délibéré de ne pas se concentrer sur les "secteurs du
numérique", mais plutôt sur les dynamiques et les effets de la numérisation sur
l'ensemble de l'économie.
LES 3 VAGUES DE LA NUMÉRISATION DE L'ÉCONOMIE
L'économie d'aujourd'hui est profondément numérique. Que leurs produits soient
immatériels ou non, les entreprises les conçoivent à l'aide d'outils et de réseaux
numériques ; elles en pilotent numériquement la production et la distribution; l'ensemble
des documents et des informations qu'elles gèrent sont d'abord (et souvent toujours)
numériques. Enfin, leurs relations avec leurs clients ou leurs partenaires ont presque
toutes une dimension numérique, parfois au point que l’on parle de « déshumanisation »
de ces relations.
Le processus d'informatisation et de "numérisation" est ancien mais encore inachevé. On
peut en retracer l'histoire en décrivant trois "vagues" successives, qui se recouvrent
plutôt qu'elles ne se suivent : l'informatisation des organisations, celle des échanges,
puis celle des individus.
Chacune de ces vagues produit des effets contradictoires, à la fois de renforcement (faire
mieux ce que l'on faisait auparavant, consolider des positions) et de transformation (faire
autrement, changer de position). A son tour, la combinaison de ces vagues alimente,
accélère ou produit des effets souvent imprévus. A ce titre, on peut tenir la numérisation
pour coresponsable de l'accélération et de la complexification du monde, particulièrement
du monde économique.
La première vague : l'informatisation des organisations
Engagée dès les années 1950, mais alors réservée à quelques fonctions au sein de très
grandes organisations, la structuration des organisations autour de leur informatique est
devenue la norme, sauf dans les plus petites entreprises. Appliquée à ses origines au
pilotage de la production et à la gestion, l’informatisation s’est depuis étendue à toutes
les fonctions de l'entreprise, ainsi qu'à la plupart des métiers de services, lesquels, de ce
fait, apparaissent aujourd’hui tout aussi concernés par la recherche de productivité (et
pour certains, tout autant délocalisables) que les métiers industriels.
Généralisation des logiques manageriales
Les grandes entreprises, ainsi que la plupart des PME, se sont ainsi dotées d'une vision
de leur activité presque totale, quoique souvent moins unifiée qu'espéré. Numérisée,
toute l'activité devient mesurable au travers d'indicateurs de performance et sujette à
optimisation. L'automatisation est une des manifestations de cette faculté nouvelle,

3
conduisant à une augmentation de l'intensité capitalistique de nombreux secteurs, ainsi
que de la part des coûts fixes. La tendance technologique récente de "l'internet des
objets" constitue avant tout une extension de ce mouvement, vers toujours plus de
"traçabilité" et d'automatisation.
Mais l'application d'indicateurs et l'optimisation touche aussi les processus humains, pas
ou peu automatisables, comme par exemple la gestion de projets, celle des
connaissances, ou encore la relation clients.
TENDANCES ET TENSIONS
TENDANCES LOURDES
Rôle moteur des technologies numériques dans la production, l'organisation, la
connaissance des marchés et l'innovation
Universalisation des logiques de management
Servicialisation
La seconde vague : numérisation des échanges et des
marchés
En se combinant avec le développement des réseaux de données, l'informatisation
produit ensuite un mouvement massif de dématérialisation, voire d'automatisation des
transactions économiques et financières. En quelques décennies, la quasi-totalité des
bourses de valeurs ou de commerce sont devenues entièrement numériques. Dans les
principaux circuits industriels et de distribution, les échanges interentreprises sont
entièrement informatisés, de système d'information à système d'information, l'e-
commerce permettant par la suite « d’enrôler » également les consommateurs dans ces
dispositifs numériques.
Il en va de même de l'organisation à l'échelle planétaire de la production des grandes
entreprises, appuyée sur une gestion en quasi-"temps réel" des flux et des stocks. La
numérisation a rendu possible la globalisation et contribue à en définir les
caractéristiques. La transformation des marchés financiers (ainsi que de ceux des
matières premières) résulte également de cette numérisation : accélération des flux,
développement massif des produits dérivés, arbitrages à l'échelle mondiale, trading
automatique…
A ces phénomènes bien documentés s'en ajoutent d'autres, dont la forme et les
conséquences demeurent aujourd'hui plus incertains.
Des entreprises aux frontières floues
En premier lieu, les frontières des entreprises (ainsi d'ailleurs que celles des marchés)
deviennent floues, ou poreuses. Des fonctions entières sont "externalisées" auprès de
fournisseurs spécialisés. Des partenaires et fournisseurs sont associés de manière
presque organique à la conduite de projets, à la conception d'innovation, à la production
"juste à temps". En obligeant à décoder (formaliser) les processus afin de les recoder
ensuite, l'informatisation rend possible le "saucissonnage" (unbundling) de la quasi-
totalité des maillons de la chaine de valeur, leur recomposition sous d'autres formes,
mais aussi l'émergence d'acteurs spécialisés sur chacun de ces maillons. Les circuits
économiques oscillent de manière continue entre "désintermédiation" et
"réintermédiation" sous des formes et avec des logiques nouvelles.
Concurrence par la connaissance et l'innovation
En second lieu, la recherche d'une compétitivité par les coûts et la qualité que rendait
possible l'informatisation devient moins efficace, toutes les entreprises ayant accès aux
mêmes pratiques numériques. La différenciation concurrentielle s'appuie alors de
manière croissante, d'une part, sur la connaissance, voire le contrôle des marchés et des

4
clients et d'autre part, sur la capacité d'innovation – en particulier dans deux domaines :
les produits et les services eux-mêmes, bien sûr, mais aussi les "modèles d'affaires" et
les "écosystèmes" qu'ils organisent.
Mais sur des marchés très interconnectés, sur lesquels l'information circule vite,
l'innovation elle-même ne procure plus de rente durable.
Les pays émergents ("BRIC") développent à leur tour une forte capacité d'innovation et
ne s'en tiennent plus à produire pour le compte des entreprises du monde riche. C'est
alors la capacité d'innover en continu, ainsi que de susciter l'innovation de la part
d'autres acteurs de son éco-système et de capter une part de sa valeur (innovation
ouverte, "pollinisation"), qui fait la compétitivité soutenable d'une entreprise ou d'un
ensemble géographique.
Les logiques de l'immatériel
En troisième lieu, l'immatériel, qui représente une part croissante de la valeur, présente
dans de nombreux cas des caractéristiques économiques particulières : part ultra-
dominante des coûts fixes, non-rivalité, exclusivité difficile ou impossible… La
dématérialisation de leurs supports déstabilise profondément les marchés de la
connaissance, de l'information, de la création. Mais, dans la mesure où connaissance,
information, création représentent une part croissante de la valeur des produits
industriels, on peut prédire que la logique de l'économie immatérielle viendra interférer
avec les modèles économiques de bien d'autres secteurs.
L'"économie de la connaissance", telle que la décrit depuis 2000 la Stratégie de Lisbonne
promue par la Commission européenne, prend bien en compte le changement des
critères de compétitivité, mais beaucoup moins le contexte de la "pollinisation" et les
caractéristiques de l'économie de l'immatériel.
TENDANCES ET TENSIONS
TENDANCES LOURDES
"Les grands saucissonnages" (The Great Unbundlings)
Recentrement du monde
Financiarisation
Entreprise étendue et "augmentée"
Accélération
TENSIONS
Intégration / Décomposition des chaînes de valeur
Matériel / Immatériel
Concurrence / Monopole
Régulation / Libéralisation
Entreprises en réseau / Intégration et concentration
Capital humain / Marché des compétences
La troisième vague : équipement et pratiques
numériques des individus
L'équipement et la connexion des individus, d'abord au sein des entreprises (années
1980-1990), puis à domicile et en mobilité (années 1990-2000), change à nouveau la
donne.
Bien évidemment, il crée un marché pour des applications et contenus numériques, ainsi
que pour des nouveaux modes de distribution (e-commerce, puis m-commerce). Mais il
produit également d'autres conséquences plus structurelles, qui entrent dans une large

5
mesure en tension avec celles qu'ont produites les précédentes vagues d'informatisation,
pilotées par la logique gestionnaire des organisations et le mouvement de libéralisation
des marchés.
L'individualisation du travail
Dans les entreprises, l'équipement en informatique personnelle a accompagné un
mouvement d'autonomisation des "travailleurs du savoir", invités à organiser leur propre
travail, à travailler en "mode projet", à s'impliquer et innover, à collaborer avec leurs
clients et partenaires extérieurs, sous contrôle d'objectifs et de critères de performance.
Cette autonomisation contribue à transformer les collectifs de travail : mobilité
croissante, multiplication et interpénétration d'équipes projets, rythmes imposés par les
clients avec lesquels une part croissante des salariés se trouve en relation directe, fin de
l'unité de temps et de lieu… et en définitive, individualisation des trajectoires
professionnelles elles-mêmes.
Cependant, l'autonomisation ne fait pas toujours bon ménage avec les contraintes des
systèmes d'information : en témoignent les difficultés rencontrées lors de la mise en
œuvre des progiciels de gestion intégrés dans les entreprises, ou encore, au quotidien, le
conflit constant entre les directions informatiques et les "utilisateurs" qui cherchent à se
libérer des contraintes qui leur sont imposées.
La conjugaison de ces facteurs apparaît parfois comme une forme d'"injonction
paradoxale", où chaque individu est sommé d'agir en entrepreneur, tout en étant
étroitement contrôlé et plus lourdement chargé qu'auparavant de tâches non directement
productives.
L'explosion des pratiques numériques personnelles… et sociales
L'explosion des usages numériques personnels, particulièrement depuis l'ouverture de
l'internet au public (1995), a des conséquences économiques multiples. La première est
la part croissante des dépenses de communication, des appareils électroniques, des
consommations numériques, dans la consommation des ménages. La seconde est la
croissance des canaux de communication et de distribution numériques dans un grand
nombre de secteurs. A la faveur du développement de l'e-commerce, des positions
concurrentielles changent, des modèles d'affaires différents s'expérimentent et se
concurrencent, de nouveaux géants émergent tels qu'Amazon, eBay, ou Apple/iTunes.
Le développement du numérique grand public s'appuie cependant, avant tout, sur les
pratiques de communication, interpersonnelle, communautaire et collective. La primauté
des usages communicationnels crée également des transformations souvent difficiles à
saisir pour les entreprises : échanges "pirates" de contenus ; circulation très rapide des
informations comme des rumeurs ; flou des distinctions entre espaces et temps
personnels, professionnels, publics ; émergence de vastes espaces d'expression, de
discussion et d'évaluation. Les marchés deviennent "bavards", surinformés plutôt que
transparents ; les consommateurs n'y sont plus seuls face aux entreprises ; et ces
dernières doivent repenser la manière dont elles défendent leur réputation, développent
leurs marques, attirent et fidélisent leurs clients.
Communautés et collaboration
Cet outillage individuel et social résonne avec l'"individualisme en réseau" que décrivait
Manuel Castells au tout début de l'internet. Il suscite et exprime, sous des formes
successives différentes, une aspiration active à se saisir du numérique pour rééquilibrer
les relations entre individus et organisations/pouvoirs : la "cyberculture" des débuts, les
mobilisations Facebook plus récentes, la demande récurrente de "transparence" ou
encore, les projets tendant à rendre aux individus la maîtrise de leurs données
personnelles, vont dans ce sens.
De l'individu au groupe, cependant, l'échelle des usages "sociaux" comprend de
nombreux degrés. Clay Shirky en distingue quatre, qui ont des incidences différentes sur
les organisations et les marchés :
Personnel : l'échange est son propre but, il entretient le lien et l'estime de soi.
La communauté : l'échange produit une valeur commune pour ceux qui y participent.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
1
/
66
100%