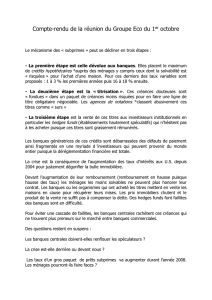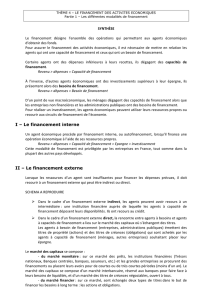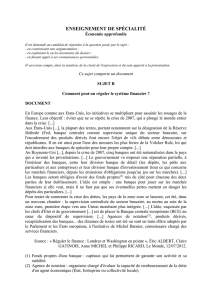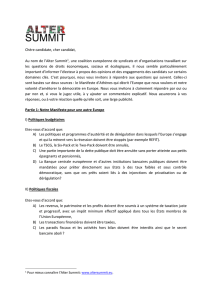En sciences économiques, un resserrement du crédit (ou pénurie de

1
Petit guide, à destinations des banques, pour tuer l’économie réelle
Fin 2008, la crise financière a fait partir en fumée près de 30 000 milliards $ de capitalisation
boursière, soit une chute moyenne de 50% de la valeur de l’ensemble des actions
échangées sur les marchés boursiers mondiaux, et tout ça en à peine quelques mois. Pour
certains adeptes de la méthode Coué, il s’agit d’un retournement sévère mais inattendu
faisant suite à un enchainement d’incidents de parcours ; cela ne remettant pas en cause le
modèle financier en tant que tel. A l’inverse, notre analyse nous donne plutôt à penser que
cette correction majeure est le résultat de l’éclatement d’une bulle spéculative elle-même
créée par le comportement habituel et rationnel du marché. Dès lors que cette crise est le
résultat du fonctionnement de la société, il importe de clarifier tant le contexte de base que
les mécanismes qui nous ont menés jusque là et d’agir en profondeur afin de réformer un
système que l’on peut qualifier de « prédateur ».
Le contexte
1) La forte progression des excédents commerciaux asiatiques (principalement chinois) et
des pays producteurs de gaz et de pétrole a mis sur le marché mondial une épargne
abondante qui cherche un endroit pour être placée. Rien qu’entre 2000 et 2008,
l’excédent commercial cumulé de ces pays sur les USA et l’UE s’élève à près de
6 000 milliards $.
2) Suite à l’éclatement de la bulle internet (2000) et au fort ralentissement économique
américain (2001), la banque centrale américaine (Fed) a mené une politique monétaire
expansionniste (c'est-à-dire d’augmentation de la masse monétaire) grâce à des taux
d’intérêt très faibles. Notons que la réactivité et l’audace de la Fed était alors encensée
à travers le monde.
3) L’Euro s’est largement apprécié depuis le début des années 2000. Cela a renchéri les
exportations européennes et, à l’inverse, encourager les importations. Cette baisse de
compétitivité a freiné la croissance de bon nombre d’entreprises européennes. Cela a,
en outre, découragé les investissements industriels sur le sol européen notamment
pour des produits réservés à l’exportation. Dès lors, la Banque Centrale Européenne
(BCE) a dû maintenir un écart de taux d’intérêt (spread) relativement faible par rapport
à celui des Etats-Unis de peur d’assister à un afflux massif de capitaux vers la zone
Euro, ce qui aurait encore renforcé sa monnaie.
Déficit commercial des USA envers certains
pays en milliards $
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
01999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Opep EU Alena Asie
Déficit commercial de l'UE envers certains pays
en milliards €
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
01999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Asie Brésil Pays énergétiques

2
Comparaison des taux d'intérêt aux USA et
en zone euro
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
1999 2001 2003 2005 2007 2009
Taux Fed Taux BCE
Spread entre les taux d'intérêt US et Euro
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
1999 2001 2003 2005 2007 2009
D’un coté, il y a donc beaucoup d’argent disponible à placer et ce d’autant plus qu’emprunter
ne coûte rien. De l’autre coté, la faiblesse des taux d’intérêt rend les bons et obligations peu
intéressants. De même, la force de l’euro décourage l’investissement (étranger) productif en
Europe. Les financiers vont dès lors se tourner vers d’autres types de placement plus
rémunérateurs. Ca sera l’immobilier aux Etats-Unis et les grandes fusions et acquisitions à
l’échelle mondiale.
L’allumette
Tout petit, on se faisait gronder lorsqu’on jouait avec des allumettes ; encore plus en
présence de produits inflammables. C’est la leçon que semblent avoir oubliés les financiers
qui ont monté les subprimes. Mais au fait c’est quoi un subprime ?
A la base, c’est tout simplement un crédit hypothécaire à taux variable. En contrepartie du
crédit immobilier, le créancier (généralement une banque) prend en gage le logement acheté
par l’emprunteur. Si ce dernier ne peut rembourser, le logement laissé en garantie est saisi
et revendu par le créancier afin de récupérer sa mise de base. A priori, il s’agit donc d’un
crédit immobilier classique. Toutefois, les subprimes ont quelque chose de particulier par
rapport aux autres crédits hypothécaires : c’est qu’ils sont destinés à des emprunteurs à la
situation financière plus délicate que la moyenne, voire très délicate. Sans subprimes, ces
ménages peu solvables n’auraient jamais pu acquérir leur logement. Aucun créancier
n’aurait pris le risque de leur prêter l’argent nécessaire vu la faiblesse de leurs rentrées
financières. C’est donc en grand bienfaiteur libéral de l’humanité que le président Sarkozy
s’est, à l’époque, prononcé pour l’instauration d’un mécanisme identique en Europe. Selon
lui, les subprimes étaient LA solution pour améliorer l’ordinaire de millions de citoyens. On
voit maintenant où cela nous aurait amené, alors que les politiques de logement sociaux ont
fait leurs preuves et que, comme nous le réclamons depuis de nombreuses années, ce n’est
pas de dettes dont ont besoins les travailleurs mais bien d’une juste rémunération !
Les subprimes sont dès lors des crédits à risque ; la probabilité de non-remboursement étant
plus forte. Le taux d’emprunt est supérieur à celui d’un crédit hypothécaire classique. Il inclut
en effet une prime qui rémunère le créancier contre le risque plus élevé de défaut de
remboursement. A priori, le subprime est donc un crédit cher. Pour que le crédit reste attirant
pour l'emprunteur, les créanciers ont dû utiliser plusieurs astuces. Généralement, ils ont
appâté les clients en retardant de quelques années le début du remboursement du crédit.
« Achetez maintenant et ne remboursez que dans deux ans ! » Autre cas classique, ils ont

3
exigés des clients qu’ils placent une certaine somme d’argent dans un produit financier géré
par le créancier. Ce sont les gains enregistrés par ce produit financier qui auraient dû
permettre une réduction des mensualités… à condition que le marché financier soit orienté à
la hausse. Enfin, n’oublions pas également que le taux était variable, ce qui permettait
d’emprunter à un taux moindre que pour du fixe et surtout de brusquement l’augmenter par
la suite.
Pour les créanciers, les subprimes étaient considérés comme individuellement risqués mais
globalement sûrs et rentables. Si un emprunteur ne pouvait payer, le prêteur récupérerait
son logement et le revendrait. Or, comme les prix de l’immobilier progressaient rapidement,
le risque de moins-value était donc inexistant… en théorie.
Néanmoins, il y avait un tout petit problème. Vu que les prêts étaient proposés par des
courtiers en crédit rémunérés à la commission, ceux-ci se sont véritablement décarcassés
pour vendre un maximum de crédits… jusqu’à falsifier les documents attestant de la capacité
d’emprunt des ménages. Aussi, ces mêmes courtiers ont également proposé à des
propriétaires d’augmenter le montant de leur crédit en cours sur le simple fait que le prix de
leur logement grimpait. On a donc assisté à une explosion du nombre de dossier de
subprime jusqu’au jour où des ménages n’ont plus su rembourser.
La multiplication de ces défaillances marque l’éclatement de la bulle financière des
subprimes. Les banques régionales américaines qui au travers des courtiers ont prêtés de
sommes importantes d’argent à des ménages peu solvables, veulent récupérer les sommes
avancées et vont dès lors saisir bon nombre de logements. Dans certains quartiers,
plusieurs maisons sont saisies et mises en vente. Le problème est qu’il n’y a pas
suffisamment de candidats acheteurs. L’offre immobilière excède la demande et,
inévitablement, les prix diminuent. Constant leurs pertes, les banques ont voulu compenser
ces dernières en accroissant les taux d’intérêt. Les augmentations de mensualité se sont
soldées par de nouvelles cessations de paiement, de nouvelles saisies et par conséquent de
nouvelles baisses des prix immobiliers. On estime que 3,1 millions de procédures de saisies
immobilières ont été engagées ou ont abouti en 2008 aux Etats-Unis. On en arrive à parler
de prêts « prédateurs ».
L’allumette et la poudrière
Tout ceci n’aurait dû rester qu’une crise immobilière. L’allumette aurait causé des dégâts
limités à l’économie américaine sans dommages collatéraux majeurs, mais les banques ont
titrisé leurs créances, créant de la sorte une véritable poudrière. Il ne manquait aucun
ingrédient pour que cela explose. Mais au fait, c’est quoi la titrisation ?
C'est une technique financière qui consiste à transformer des actifs en titres financiers
négociables sur le marché boursier. Lorsqu’une banque prête de l’argent, on dit qu’elle
détient une créance. Ces créances sont des actifs financiers inscrits dans le bilan de la
banque. La titrisation va dès lors consister à transformer ces créances en titres de manière à
pouvoir les vendre à un autre opérateur économique. En théorie, on pourrait transformer
toutes les créances et tous les autres actifs qui génèrent un revenu récurent en titres
financiers. Ainsi, une entreprise pourrait titriser ses factures émises ou même ses prévisions
de revenus. A la limite, un Etat pourrait titriser ses recettes fiscales encore à percevoir. Dans
le cas qui nous occupe, les banques régionales américaines ont transformé des crédits
immobiliers en produits financiers.
La technique la plus classique pour une banque consiste à vendre un portefeuille d’actifs peu
liquides comme ses crédits immobiliers à une entité intermédiaire spécialement créée pour la
cause qu’on appelle « véhicule spécial » (SPV ou SVI). Cette société intermédiaire,

4
généralement localisée dans un paradis fiscal, fait en réalité partie de la banque mais
dispose d’une comptabilité indépendante. Son rôle est de découper le portefeuille en
tranches sur base de la probabilité de défaut de remboursement. Elle va ainsi séparer les
bons risques, des moins bons risques et des crédits pourris, c'est-à-dire ceux pour lesquels
la probabilité de remboursement est la plus faible. Elle va ensuite créer des produits
financiers (CDO) correspondant à chaque tranche qu’elle va proposer sur le marché
boursier. La vente de ces titres lui permet de financer l’achat des créances à la banque. Ces
titres sont garantis par le fait que les créances de la banque seront remboursées à terme par
les emprunteurs. En outre, la société intermédiaire va généralement y adjoindre une
assurance « défaut de payement » (CDS) de sorte que les agences de notations jugeront
que ce produit est sûr et lui donneront par conséquent une bonne note. Dans le chef de la
banque, le crédit hypothécaire ou créance se transforme en nouvelles liquidités disponibles
pour de nouveaux prêts. Ces créances sont dès lors sorties du bilan de la banque. Notons
que le mécanisme décrit ci-avant donne les grandes lignes mais qu’il peut certainement être
complexifié.
Les nouveaux titres financiers sont acquis par des investisseurs institutionnels (banques
d’investissement, fonds de pension, fonds commun de placement, assureurs…) qui en
assument le risque. Ces derniers sont rémunérés grâce au payement des mensualités par
les emprunteurs. Les titres les plus sains sont évidemment les moins rémunérés. A l’autre
bout de l’échelle, les titres les plus pourris, c'est-à-dire ceux pour lesquels le risque de non
remboursement est plus élevé, sont ceux qui rapportent le plus. Ils seront revendus soit à
des investisseurs prêts à assumer de gros risques contre un taux d’intérêt élevé, soit garder
au sein du véhicule spécial avec des gros intérêts à la clé.
En résumé, la banque vend ses crédits hypothécaires à un intermédiaire. Ce dernier crée et
vend un nouveau produit financier à des clients investisseurs. Ce produit financier est garanti
par le remboursement des emprunts hypothécaires que la banque a elle-même consenti et
par une assurance « défaut de payement ». Cette méthode comporte de nombreux
avantages :
1) Elle permet à la banque de se « débarrasser » d’un risque en le cédant à un ou plusieurs
autres opérateurs. En fin de compte, les vrais détenteurs du crédit hypothécaire sont
ceux qui ont achetés les nouveaux titres. En cas de défaut de remboursement du crédit,
ce sont ces investisseurs, dont probablement pour partie le véhicule spécial, qui ne
récupéreront pas leur mise.
2) En schématisant, on peut dire qu’une banque collecte de l’épargne à court terme et
qu’elle prête à plus ou moins long terme. Elle doit cependant garder une certaine quantité
de liquidités pour faire face à des imprévus et pour assurer à ses épargnants qu’elle peut
les rembourser (solvabilité). Dans le cadre des accords Bâle II, la somme des crédits
octroyés par une banque est limitée par le montant de ses fonds propres (ratio
McDonough). En titrisant, la banque vend un portefeuille de crédits et n’est donc plus
tenue de respecter cette règle prudentielle. Elle récupère une marge de manœuvre pour
compenser de nouveaux prêts.
3) La revente de titres à une société intermédiaire débouche sur un apport de capital frais
dans la banque. Ces nouvelles liquidités pourront évidement être prêtées ou investies ce
qui augmentera le futur chiffre d’affaire de la banque.
4) Dans le cas où la banque rachète les créances les plus pourries (donc les plus
rémunératrices) ou que l’autorité de régulation exige que les comptes du véhicule spécial
soient consolidés dans celui de la banque, la revente de la partie la moins risquée du
portefeuille de crédit (en principe la moins rémunératrice) permet à la banque
d'augmenter la rentabilité de ses capitaux propres, ce qui pourrait attirer de nouveaux

5
investisseurs. Toutefois, les exigences en termes de solvabilité seront plus importantes.
La banque devra dès lors détenir plus de fonds propres en contrepartie de ces titres.
5) Dans le cas où la banque rachète des titres avec une meilleure notation que l’ensemble
des titres qu’elle a vendu, elle doit détenir moins de capitaux propres pour assurer sa
solvabilité. En effet, les accords de Bâle II prévoient que le pourcentage de fonds propres
nécessaire est modulable en fonction de la notation du produit dans lequel, ils sont
investis ou prêtés. Une banque qui prête une somme X doit généralement détenir
l’équivalent de 8% de cette somme en fonds propres. Une banque qui place un même
somme dans des titres côtés AAA ne doit détenir que 1,6%. Cette différence peut
rapidement chiffrer lorsque l’on parle de millions d’euros placés ou prêtes.
6) La banque et la société intermédiaire localisée dans un paradis fiscal ne font en réalité
qu’un, bien que leur comptabilité soit séparée. On dit dès lors de ces opérations qu’elles
sont « hors bilan » puisqu’elles ne rentrent pas dans l’activité normale d’une banque
c'est-à-dire collecter de l’épargne et accorder des prêts. Cette opacité permet aux
banques de masquer leurs résultats effectifs, voire même de les manipuler de manière à
n’afficher que les résultats flatteurs. Toutefois, il arrive que l’autorité de régulation exige
que des banques qu’elles intègrent dans leurs comptes consolidés les résultats de leurs
activités hors bilan. C’est le cas en Belgique depuis l’automne passé... du moins le temps
que cette crise passe.
Au final, le mécanisme de titrisation est devenu un outil classique de la gestion bancaire.
Dans le cas de la crise des subprimes, il a clairement montré ses effets pervers. Le bon sens
aurait voulu que les titres vendus ne soient composés que des crédits de même type, en
l’occurrence uniquement des crédits immobiliers, que les risques soient correctement
évalués et que tout ceci soit transparent. Cela n’a pas été le cas. Des sociétés intermédiaires
ont cru bon de mélanger des créances de tout horizon (hypothécaire, consommation…) et de
toute qualité. Puis, les sociétés d’investissement qui ont achetés ces titres les ont elles-
mêmes découpés pour les mélanger avec d’autres morceaux créant de la sorte des
nouveaux produits financiers et ainsi de suite… Progressivement, plus personne ne savait ce
que représentaient réellement ces titres écoulés par milliards à travers le monde. Toutefois,
malgré cette opacité, les agences de notation continuaient à donner de bonnes cotes à ces
produits financiers, renforçant la confiance des investisseurs.
Comment les si sérieuses agences de notation ont-elles pu donner de bonnes cotes à des
produits financiers sans savoir ce qu’il y avait dedans ?
• Les agences de notation ont pour but de donner une indication sur le risque de perte
pour les investisseurs. Elles estiment un produit sur base de critères objectifs vérifiables.
Elles ne vont donc pas retourner le produit sous toutes ses coutures dans le cadre d’une
investigation poussée mais bien utiliser des batteries de tests ou des grilles d’analyses
standardisées. Dans le cas des subprimes, elles ont ainsi considéré que le risque de non
recouvrement était limité à un maximum 2%, comme pour un crédit hypothécaire
classique. A l’évidence, cela n’a pas été le cas. Autre exemple, si un titre est garanti par
une réserve de fonds propres destinée à absorber les premières pertes (mécanisme de
tampon) ou par une assurance, alors pourquoi ne mériterait-il pas une note excellente ?
Les titres issus des subprimes étaient dans ce cas sauf que ni les intermédiaires, ni les
assureurs n’ont eu les reins assez solides pour couvrir les défauts de payement, un
risque statistiquement improbable… et pourtant.
• Les agences de notation sont financées par les entreprises qu’elles notent ou dont elles
notent les produits financiers. Une note insuffisamment flatteuse pourrait se répercuter
par la perte de futurs marchés. Force est de constater que les agences de notation ne
sont pas indépendantes. Cette partialité envers les entreprises qu’elles analysent montre
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%