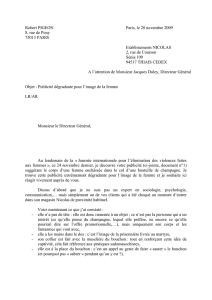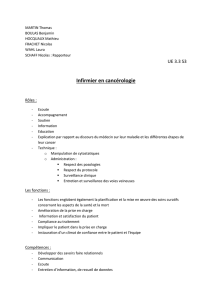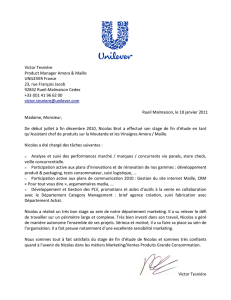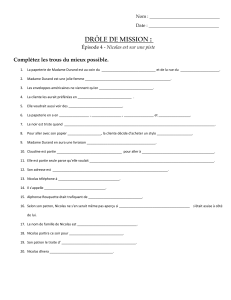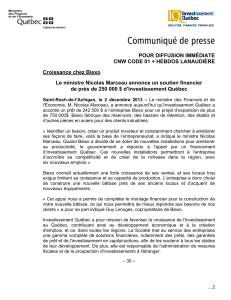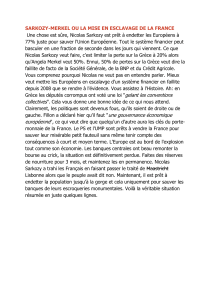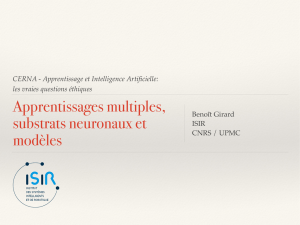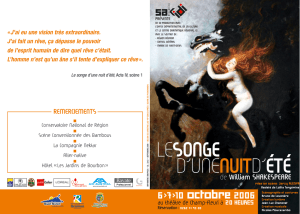L`expérience du savoir chez Nicolas de Cues

Faculté de philosophie Lyon III
M. DELARUE Dimitri
Master II recherche
Vers une mystique spéculative.
« L’expérience du savoir chez Nicolas de Cues. »

2
PLAN DU DEVOIR
INTRODUCTION .............................................................................................................. 3
I. « L’HOMO MENSURA », ou du rapport à l’altérité. ....................................................... 5
A. Présentation générale de l’homme du sens commun. ....................................................... 5
B. La fonction normative de l’homme. .................................................................................. 7
II. « HEN KAI PAN », ou la reconnaissance du principe unificateur. ................................. 10
A. Le savoir du non savoir. .................................................................................................. 10
B. L’intelligence ou l’intuition fondamentale du « hen kai pan ». ...................................... 12
III. “DIEU MESURE”, ou la compréhension spéculative de l’univers. ............................ 15
A. De Dieu ............................................................................................................................ 15
B. Le Non-autre. ................................................................................................................... 17
C. La quête de l’Absolu. ....................................................................................................... 18
CONCLUSION ................................................................................................................ 21
BIBLIOGRAPHIE PRINCIPALE
Nicolas de Cues, De la docte ignorance, Paris, éd. De la Maisnie, P.U.F., 1930.
Nicolas de Cues, Du non-autre. Le guide du penseur (préface, traduction et annotation
par Hervé Pasqua, in Sagesses chrétiennes, éd. Cerf.
M. de Gandillac, Œuvres choisies de N. de Cues, éd. Aubier montaigne.
M. de Gandillac, La philosophie de N. de Cues, éd. Aubier montaigne.
Maître Eckhart, Œuvres (sermons-traités), trad. P. Petit, éd. Tel Gallimard.
Héraclite, Fragments, trad. Pradeau, éd. GF

3
INTRODUCTION
Nicolas de Cues (1401-1464) est un penseur qui marque une transition dans
l’histoire de la pensée. En effet, il se positionne entre la fin du Moyen-Âge et le début de la
Renaissance. Ainsi on verra dans son œuvre une rupture avec l’ancien schème théocentrique,
et l’avènement d’idées considérées comme hérétiques selon l’ordre théologique traditionnelle.
Mais l’auteur du Profane n’en sera guère affecté, et, à l’encontre d’un Giordano Bruno après
lui, ne connaîtra pas le bûcher
1
. Cependant, ces considérations ne seront pas plus approfondies
ici, car c’est moins le côté biographique qu’épistémologique qui intéressera, et bien que ce
premier côté a certainement favorisé l’œuvre du cardinal. On s’attellera donc à la place
qu’occupe le savoir de l’homme dans la philosophie cusaine, et son évolution progressive vers
des objets de connaissances plus sérieux. Et on tentera de montrer en quoi le cusain fait partie
de la tradition « mystique spéculative », et comment à travers plusieurs de ses ouvrages il
entreprend d’enseigner la voie qui conduit l’homme du monde de l’être, de l’altérité, au non-
autre, ou principe divin fondateur de toute existence, de tout ce qui est. Car c’est par un effort
de comprendre l’homme dans son existence et au sein de sa dimension expérimentale qu’il
accèdera à la pensée de l’expérience ultime, celle de Dieu. L’expression « mystique
spéculative » n’est donc pas arbitraire, car elle relève d’une tradition qui, depuis Hermès
Trismégiste et Pseudo-Denys l’Aréopagite en passant par Maître Eckhart, indique un passage
« du temple de Dieu au temple de l’âme
2
». Contemplation et spéculation sont donc liées, et
l’influence du néoplatonisme éclairé par le christianisme ne manquera pas de jouer un rôle
majeur dans la pensée du cardinal. Au théorétique grec se substituera l’équivalent dit
spéculatif, et selon un cheminement semblable, il y aura la nécessité de quitter l’influence des
choses terrestres afin de s’approcher au maximum d’une union avec le divin. C’est donc en
revenant d’un voyage à Constantinople que Cues eut deux intuitions, deux idées
1
Nicolas fut nommé cardinal en décembre 1448. Son tempérament de réformateur (il voulait réformer le Vatican
même !) ne lui a jamais vraiment fait défaut. Ses traités théologico-philosophiques subversifs ne lui attireront pas
d’ennuis, à la différence d’un Maître Eckhart, pour qui seront condamnés 28 de ses articles lors de la bulle du
pape Jean XXII, en 1329. Eckhart sera dès lors considéré comme hérétique. Et l’on sait que Nicolas avait pour
influence ce maître rhénan.
2
Corbin, Temple et contemplation, Flammarion (1980), p.336 : « La transition du temple de Dieu au temple de
l’âme marque l’entrée en contact de la pensée divine et de la pensée humaine, puisque l’intelligence de l’âme est
en contact, dans ce temple, avec l’intelligence de Dieu. Et ce contact est précisément la source de toute théologie
spéculative au sens étymologique du mot speculum : une katoptrique mystique ».

4
fondamentales qui formeront le socle de sa pensée : La coïncidence des opposés, ou les
opposés coïncident dans un Dieu infini ; et la docte ignorance, ou l’on comprend
l’incompréhensible que par voie d’incompréhension. Il se retirera donc dans son lieu natal, à
Cues, afin d’écrire son ouvrage le plus considéré aujourd’hui, De la docte ignorance.
La pensée du cardinal, quelque peu révolutionnaire pour l ‘époque, semble
énigmatique et mystérieuse au premier abord, dans la mesure où il met en branle de
nombreuses conceptions bien établies. Sa méthodologie a pour but d’inciter l’homme à
évoluer par lui-même, et à se retirer des pures déterminations rationnelles qu’il crée lui-même.
Il faudra passer d’une pensée de l’abstraction à une pensée de la conciliation des contraires,
de la raison discursive à la raison spéculative (ou intuition), en cela que « le mystique,
assurément est quelque chose de mystérieux, mais seulement pour l’entendement (verstand),
et cela simplement parce que l’identité abstraite est le principe de l’entendement alors que le
mystique (en tant que synonyme du spéculatif) est l’unité concrète de ces déterminations
[…]
3
». Le principe de contradiction, cher à Aristote, ainsi que l’idée d’un monde clos, à
laquelle se substituera la notion d’infini, seront donc mis à mal, et apparaîtront dans le
système cusain comme de simples déterminations de « l’homme mesure ». Et seule la prise de
conscience de l’ignorance fondamentale pourra mener l’homme à un savoir plus essentiel,
celui de Dieu, dont on a pas besoin de prouver l’existence, car celui-ci est la présupposition
absolue et l’objet d’un consensus universel. On essaie donc de retrouver l’unité mentale
perdue par la scission, que l’on sent définitive, entre la connaissance de la nature et la réalité
divine, et ce en enlevant à l’homme toute possibilité de se justifier autrement que par la grâce.
On traitera de l’expérience du savoir chez l’homme à partir de ses modes de
connaissance qui lui permettent l’accès à l’Un immaculé : la première partie s’attachera à
l’homme du quotidien en tant qu’il est principe de mesure et d’évaluation des objets
(gegenstand) qui l’affectent. Ensuite, dans un second temps, on analysera la condition et le
moyen lui permettant de penser le monde autrement que par sa raison discursive et
séparatrice. Enfin, on terminera cet essai en soulignant l’aspect inaccessible du divin, et en
étayant la façon dont l’homme peut, selon ce qu’en dit la mystique, accéder à l’expérience
intime d’union avec le divin.
3
Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, addition au §82, trad. B. Bourgeois, p. 518.

5
I. « L’HOMO MENSURA », ou du rapport à l’altérité.
A. Présentation générale de l’homme du sens commun.
Reprendre la formule fameuse du sophiste Protagoras selon laquelle « l’homme est
mesure de toutes choses »
4
peut nous orienter sur la conception cusaine de la connaissance
inadéquate
5
du monde sensible. L’homme est ainsi le principe déterminant de ce qui est, et par
là il ne peut conquérir qu’une connaissance relative ( sur la base d’un relativisme
phénoménal) et donc qu’une connaissance subjective. L’identité entre pensée et être reste
proprement dépendante de l’activité humaine. L’universel est insaisissable, et seule la
variabilité de la nature peut servir de support cognitif à l’homme.
En effet, Le monde se présente tout d’abord et nécessairement à nous par les sens
comme une pluralité d’objets finis et opposés en contraires. Chaque objet se définit par
rapport à sa contradiction, et donc toute qualité d’une chose n’est qu’au regard de son autre. Il
règne ainsi dans le monde une perpétuelle métamorphose, un changement incessant
déterminant les choses selon différentes qualités : le chaud se transforme en froid, et
inversement, le solide en liquide etc. Ainsi, ici-bas, les hommes sont plus enclin à des
« conjectures », à des efforts de représentations vraisemblables du réel, qu’à la vérité. Car
toute chose, en tant qu’elle participe au processus de variation et de changement, se voit
altérée et ne donne pas à l’homme une assise sûre concernant sa quiddité. Il a dès lors toujours
déjà face à lui de l’autre, des objets indépendants qui ne cessent d’être travaillés par le temps.
Et la pensée, bien que dépendante des corps, peut exercer par l’expérience de l’abstraction son
détachement, et entrevoir par là qu’il y a des formes immuables, mais toujours perverties dans
le milieu naturel. Il est par conséquent impossible de trouver deux choses identiques dans la
nature
6
, quand bien même dans la pensée conceptuelle cela est possible. Ainsi, « que les
4
La formule complète est la suivante : « L’homme est la mesure de toutes choses, des choses qui sont, qu’elles
sont, des choses qui ne sont pas, qu’elles ne sont pas » (La vérité). Il est important de voir que Protagoras utilise
le terme chrêma, et non celui de pragma pour désigner la chose. Le terme chrêma désigne une chose dont on se
sert, une chose utile. Et le terme métron désigne la mesure ou le critère. Ainsi l’homme (anthrôpos) règle les
choses. Nous verrons par la suite que Nicolas de Cues n’est pas tout à fait étranger à cette formule qui, loin de
n’exprimer qu’un simple relativisme sceptique, évoque l’action inhérente à l’homme sur les choses.
5
« Inadéquate » ici révèle plus un caractère de moindre importance dans la connaissance, mais ne signifie pas
pour autant que l’homme, comme principe mesurant, soit aux antipodes de la possibilité d’une connaissance plus
essentielle. Car c’est dans le chemin de la quête spirituelle que la valeur suprême du sensible apparaît, en tant
que révélation visible de l’invisible.
6
Principe qu’il n’y a pas deux choses identiques dans le monde. Et cette idée se retrouvera dans la pensée
leibnizienne, dans son principe des indiscernables, suivant lequel deux êtres réels diffèrent toujours par des
caractères intrinsèques, et non pas seulement par leurs positions dans le temps ou l’espace ; ainsi « il n’y a jamais
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%