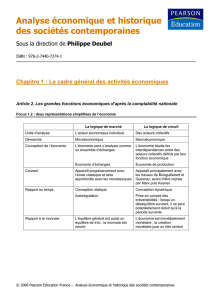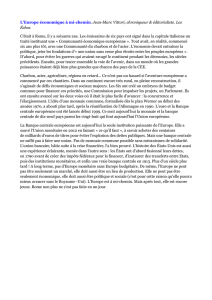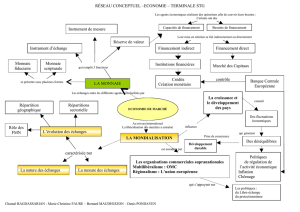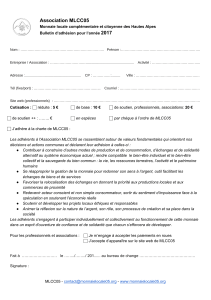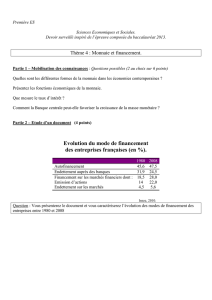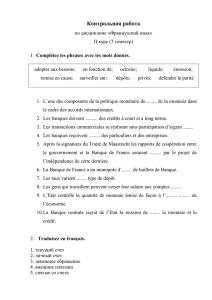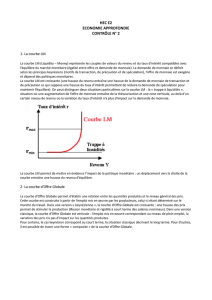Doc. 1 - prepa eco carnot

LA CROISSANCE DES ANNÉES 20 - DOCUMENTS COMPLÉMEN-
TAIRES
Doc. 1 : le cadre financier de l’après guerre
Doc. 2 : 1914-1918 : le prix de la victoire
JACQUES-MARIE VASLIN
DANS le film de Clint Eastwood Mémoire de nos pères, sorti en salles en octobre, les trois héros de-
viennent les outils d'une vaste opération de propagande en faveur d'un emprunt de guerre. Cette utili-
sation de l'image du soldat courageux à des fins de finances publiques ne date pas de la bataille du
Pacifique. La France a fait des exploits du « poilu » un argument promotionnel pour drainer l'épargne
vers les caisses de l'État pendant la première guerre mondiale.
Lors de la déclaration de la guerre, en 1914, l'économie française ne semble pas prête. L'épargne est
plutôt orientée vers des placements étrangers, plus rémunérateurs. A la veille des hostilités, les Fran-
çais détiennent 45 milliards de francs-or à l'étranger, dont le quart en emprunts russes. L'emprunt du
20 juin 1914, quelques semaines avant le début du conflit, essuie même un échec cuisant. Persuadé
que la guerre sera de courte durée, Alexandre Ribot, alors ministre des finances, refuse obstinément
toute augmentation d'impôt. Il compte régler les dépenses au moyen d'emprunts à court terme, les
bons de la défense nationale, et d'avances de la Banque de France.
Mais, devant l'enlisement du conflit, il devient impératif d'emprunter sur le long terme. Une première
émission a lieu dès 1915. L'incertitude de l'avenir et les privations de la guerre la rendent délicate.
Pour éviter d'essuyer un nouvel échec, une propagande intense est mise en oeuvre. Les Français
sont conviés par tous les moyens à vider leur bas de laine. Des cartes postales, des fables, des
planches de dessins sont imprimées pour inciter les Français à verser leur or. Les calendriers cou-
verts d'images d'Épinal vantent les mérites de l'épargnant. Le clergé est aussi mis à contribution au
moyen de sermons et d'encouragements répétés des journaux catholiques. Le versement de l'or,
d'acte financier, devient patriotique avec en prime la bénédiction des prêtres. A l'école, les buvards
des élèves, les jeux, les images distribuées, rappellent aux mères que, pour hâter le retour de leur

mari, elles doivent y aller de leur poche. L'image du héros est alors omniprésente, jusqu'au billet de 20
francs portant l'effigie de Bayard, le « Chevalier sans peur et sans reproche ». Clemenceau y va aussi
de son couplet en déclarant le 20 novembre 1917 que l'emprunt est « après l'aide du sang, l'aide pé-
cuniaire dont la victoire sera la garantie ».
Des affiches recouvrent les murs, à la ville comme à la campagne. Elles représentent la plupart du
temps une allégorie de la bravoure du « poilu », la grandeur de la nation ou encore la terreur qu'inspi-
rent les Allemands, ces derniers étant systématiquement représentés sous les traits les plus féroces.
La propagande pour les emprunts de guerre permet aussi de justifier le conflit : la démocratie contre
l'autoritarisme. La nation entière est mise à contribution, les soldats en allant au front et les civils en
amenant leur or. La guerre devient totale. Pour illustrer les affiches, les banques font appel à des ar-
tistes comme le caricaturiste Abel Faivre, le peintre Victor Prouvé, qui a travaillé pour Daum et Gallé,
ou encore Poulbot, célèbre par son personnage de titi parisien.
L'après-guerre laissera un goût amer aux épargnants. La dette représente 170 % du produit intérieur
brut (PIB) en 1919. Les planches à billets n'ont pas chômé, les billets en circulation sont passés de 6
à 30 milliards de francs. Conséquence inévitable, les prix ont triplé pendant la guerre. Les épargnants
qui ont versé leur or contre des rentes ou des bons de la défense nationale sont les véritables per-
dants : ils seront payés en monnaie dépréciée. En 1928, Poincaré consacre la fin du franc germinal en
dévaluant la monnaie de 80 %. Il devient alors impossible de retourner à la situation qui prévalait
avant la guerre. Les rentiers sont ruinés. C'est le prix de la victoire.
Le Monde - 28.11.06
Doc. 3 : Déflation : La monnaie plutôt que l'emploi
Roland MARX (Professeur d'histoire à la Sorbonne)
Au lendemain de la Grande Guerre et jusqu'à la catastrophe financière de 1931, tous les gouverne-
ments britanniques successifs, quelle que soit leur coloration politique, accordent une priorité absolue
à la restauration de la livre sterling comme principal instrument monétaire international. Ils espèrent
ainsi que le retour à une monnaie forte permettra à leur pays de retrouver sa grandeur passée. Alors
que le rapport dollar/livre est tombé à 3,4 en février 1920, ils entendent à la fois rétablir la parité de
1913 (4,86 dollars pour une livre) et la convertibilité en or de la monnaie britannique, suspendue en
1919. L'objectif est atteint en 1925 et consacré par le Gold Standard Act. La préservation de ce résul-
tat sera la hantise des chanceliers de l'Echiquier, de Winston Churchill à son successeur travailliste
Philip Snowden. Contrairement à l'Allemagne avant 1924 et, dans une moindre mesure, à la France
jusqu'à la définition du "franc Poincaré" en 1928, la politique suivie outre-Manche est celle d'une défla-
tion volontariste et continue. Ses conséquences sont toujours vivement discutées.
Les trois piliers de la déflation
Cette politique déflationniste repose sur trois piliers: la hausse des taux d'escompte, une politique
budgétaire restrictive et une déflation salariale.
La Banque d'Angleterre, en ajustant toujours ses taux d'escompte un cran au-dessus des taux améri-
cains, encourage le retour de capitaux à court terme sur la place de Londres, soutenant ainsi la livre
sur le marché des changes. Les taux élevés pratiqués, en restreignant le crédit, donc en freinant
l'investissement et l'activité, évitent aussi de cette façon la montée inflationniste.
La politique d'excédent budgétaire, quant à elle, vise d'abord à éponger la dette née de la guerre. Cet
excédent n'est pas obtenu par l'augmentation des recettes, mais par la diminution des dépenses. Côté
recettes, le taux normal de l'impôt sur le revenu passe de 30% en 1921 à 20% en 1929; mais la re-
lance de l'activité qu'on attend de cette mesure n'est guère au rendez-vous et les rentrées fiscales en
pâtissent. Par ailleurs, afin que les importations récoltent tous les fruits d'une monnaie forte, les droits
de douane sont progressivement abolis: en 1925, Churchill ne maintient des droits protecteurs qu'au
bénéfice des industries automobile, horlogère, pneumatique et cinématographique. Le libre-échange
est alors un évangile; le débat protectionniste, un court moment entamé en 1923, ne reprendra qu'en
1931.
L'effort est porté sur la restriction des dépenses publiques. Entre 1919 et 1921, l'État se désengage de
bien des fonctions, y compris les assistances économiques qu'il a assumées pendant la guerre, reti-
rant pour finir aux agriculteurs, dans le budget de 1921-1922, quelque 22 millions de livres de sub-
sides au titre des garanties de prix. Seules les mines de charbon bénéficient, jusqu'en 1926, d'aides
financières dont la suppression est à l'origine de la plus grave crise sociale de l'entre-deux-guerres, la
grève générale. Les économies touchent aussi la Défense, à laquelle on ne consacre en 1929 que

2,5% du revenu national (contre 3,5% en 1913), et on se garde de tenir les promesses d'accroisse-
ment des dépenses éducatives. Alors que, en 1918-1919, sous l'impulsion de deux hommes d'État
impérialistes, Lord Milner et Leo Amery, on a pensé favoriser par des crédits massifs l'émigration des
Britanniques vers les terres vierges et accueillantes de l'Empire, on ne consent, à partir du Settlement
Act de 1922, qu'à une dépense qui varie de 1,5 à 3 millions de livres sterling par an.
Mais il est des dépenses qui ne sont guère compressibles: les pensions d'État, et tout particulièrement
les pensions de guerre, s'élèvent à 96 millions en 1921 et encore 56 millions en 1929. Malgré sa dimi-
nution par les conservateurs en 1925, l'indemnisation de l'important chômage (le nombre de chômeurs
est toujours supérieur au million dans les années 20) s'élève à 11,2% des dépenses en 1928. Globa-
lement, les dépenses publiques sont d'une grande stabilité: si elles passent de 949 millions en 1920 à
751 millions en 1924 (soit une baisse de 21%), elles baissent moins que les prix (- 29%). Ceci dit,
l'austérité budgétaire est suffisante pour rembourser la dette, dont la charge, accrue par la hausse des
taux d'intérêt et la déflation, s'élève en moyenne à 300 millions de livres par an, soit entre 30 et 40%
des dépenses budgétaires, ainsi consacrées à une redistribution au profit des rentiers.
La déflation salariale, quant à elle, après une courte période de hausse après guerre, s'applique de
1920 à 1923: le salaire hebdomadaire moyen diminue de 31,5%. La baisse parallèle des prix permet
tout juste de conserver les salaires réels au même niveau. Par la suite, les salaires hebdomadaires
réels se maintiennent, dépassant modestement de 9%, en 1929, leur niveau de 1913.
Des conséquences discutées
Sur le plan strictement monétaire, la déflation est un succès, puisque la livre retrouve provisoirement
son taux de change d'avant guerre. Mais la croissance est freinée, si bien que le PNB par habitant
n'augmente que de 5,5% entre 1919 et 1929, tandis que le taux de chômage se maintient (sauf en
1927) au-dessus de la barre des 10%. C'est alors que les syndicats ouvriers s'opposent aux compres-
sions salariales et dénoncent la plaie du chômage. Le mécontentement explose en 1926, avec la
grande grève des mineurs, mal soutenue par l'échec de la grève générale du mois de mai, qui touche
en particulier transporteurs, métallurgistes, imprimeurs et travailleurs du bâtiment.
Cette politique est aussi vivement accusée par des économistes et des hommes politiques - parmi
lesquels John Maynard Keynes, alors étoile montante de la pensée économique - d'être à l'origine de
tous les maux de la production industrielle et de taux de chômage constamment élevés. Pour ces
critiques, la recherche d'une monnaie forte renchérit les marchandises anglaises sur les marchés
étrangers et freine donc la production; les pratiques restrictives de crédit de la Banque d'Angleterre
freinent l'investissement et nourrissent la crise industrielle et commerciale. Keynes relie les extraordi-
naires taux de chômage des années 20 aux restrictions imposées à la production et à la consomma-
tion par l'orthodoxie monétaire; il n'hésite pas, en 1925, dans son pamphlet Les conséquences éco-
nomiques de M. Churchill, à quantifier la portée d'une politique néfaste de "dépression et de déca-
dence": 10% de chômeurs supplémentaires! Il inspire à David Lloyd George, redevenu l'incontestable
leader du parti libéral en 1926 et dont il est le conseiller, un programme nouveau d'investissements
publics: le grand thème de la campagne des libéraux en 1929 est "We can conquer unemployment"
(nous pouvons vaincre le chômage).
Aujourd'hui que le keynésianisme a du plomb dans l'aile, la politique déflationniste de l'entre-deux-
guerres trouve de nouveaux défenseurs. Selon eux, près de la moitié du commerce extérieur se fai-
sant alors avec l'Empire et les dominions, à l'intérieur d'une zone monétaire dominée sans problème
par la livre, une grande partie des échanges n'était pas influencée par la politique monétaire, ou
même a bénéficié de la confiance générale dans la livre. Une légère dévaluation, telle que celle sug-
gérée par Keynes en 1925 (4,4 dollars par livre sterling au lieu de 4,86), aurait risqué de diminuer
l'attraction de la monnaie britannique sur les financiers étrangers. De plus, loin de favoriser un ac-
croissement de la production et des exportations, elle aurait pu déclencher une guerre commerciale et
des dévaluations compétitives ailleurs dans le monde. Le chômage n'aurait pas été causé par la défla-
tion, mais par une crise des secteurs traditionnels, concurrencés par de nouvelles sources d'énergie
et souvent insuffisamment modernisés, à laquelle les manipulations monétaires n'auraient rien chan-
gé. De plus, les prix britanniques élevés auraient été en partie dus à une augmentation "inconsidérée"
des salaires à la fin de la guerre et immédiatement après, et la réduction salariale aurait été inévitable,
à travers de douloureux conflits sociaux et une baisse conjoncturelle de l'emploi.
Cette thèse approche une vérité: la politique déflationniste ne porte pas à elle seule la responsabilité
de la faible croissance et du fort chômage britannique des années 20 en Grande-Bretagne. L'industrie
britannique souffre alors de maux structurels. C'est le cas en particulier dans ces vieux bastions tradi-
tionnels et exportateurs que sont le charbon, la sidérurgie, la construction navale et le textile, qui ac-
cusent une perte de compétitivité. Moderniser ces vieilles industries et développer davantage les in-
dustries nouvelles s'impose. Mais on retrouve alors la responsabilité de la durable politique déflation-

niste qui, en freinant l'innovation et l'investissement, d'une part, et en limitant la demande intérieure
globale, d'autre part, ne le permet pas, favorisant ainsi à la fois chômage structurel et chômage key-
nésien.
Cependant, en 1929, la majorité des électeurs britanniques ne sont pas acquis à une politique de type
keynésienne, comme en témoigne le net échec des libéraux aux élections de cette année-là. Seule la
grande crise des années 30 a raison de la politique de déflation; elle conduit en 1931 à la dévaluation
de la livre et donne ses chances aux théories que Keynes systématise en 1936. La crise pousse aus-
si, dès avant la guerre, des économistes, y compris orthodoxes, à l'instar d'un William Beveridge, futur
père de la sécurité sociale anglaise, sur la voie de réflexions nouvelles.
Les raisons de la déflation
La volonté de consolider l'Empire par l'affermissement des liens monétaires - donc économiques -
avec les dominions joue certainement un rôle dans le choix déflationniste. Devenus pratiquement
souverains, certains dotés, à l'instar de l'Afrique du Sud depuis 1920, d'une banque centrale, les do-
minions pourraient être tentés par de nouveaux mirages, en particulier l'américain.
Les Anglais nourrissent aussi l'idée orgueilleuse de faire de leur monnaie l'instrument de la renais-
sance du continent européen sous leur égide. En reconstruisant une livre sterling de qualité, la
Banque d'Angleterre entend se doter de l'instrument indispensable à la création d'un cercle fort large
de "clients". Au lendemain de la Conférence de Gênes de 1922, qui échoue à bâtir un système moné-
taire international solide, au vu du double refus de la Banque fédérale américaine de s'engager au-
dehors et de la Banque de France, toujours très soupçonneuse devant l'avidité supposée des Britan-
niques, ces derniers sont tentés de jouer de leurs propres atouts monétaires. Parfois par l'intermé-
diaire des banques, dont Barings, ils sont les parrains et actionnaires de banques centrales en Au-
triche, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, auxquelles ils imposent des règles rigides d'indépendance à
l'égard des pouvoirs publics dans leur État. Dès 1923, vingt banques centrales d'Europe et des domi-
nions font partie d'un système sterling. En 1924, lors de la stabilisation du mark avec la mise au point
du plan Dawes, Londres tente de faire de la nouvelle Reichsbank une cliente du sterling: elle échoue
devant l'opposition des États-Unis et leur exigence de trois quarts de réserves-or. Le Gold Standard
Act, l'année suivante, consolide donc un "empire" européen quelque peu restreint, que les traditions
anciennes comme les politiques des États nouveaux mettent à mal dès les débuts de la crise mon-
diale. L'impérialisme monétaire rencontre ses limites.
Une attente quasi unanime
Mais la recherche d'une "bonne monnaie" n'est pas seulement le rêve d'hommes d'État impérialistes,
des "gnomes" de la City, ou du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Montagu Norman. Elle corres-
pond à l'attente quasi unanime de l'opinion publique. En 1925, Winston Churchill, chancelier de l'Echi-
quier et auteur ultime du rétablissement de la livre, est applaudi par le plus grand nombre. Le retour à
l'étalon-or est lié par les moralistes les plus austères à une honnêteté élémentaire qui permettra - c'est
l'illusion de l'homme de la rue - de renouer avec l'ancienne prospérité du Royaume et de faire baisser
le chômage qui sévit à partir de 1921. Aux yeux des financiers, mais aussi des industriels et des
commerçants, la santé recouvrée de la monnaie signifiera l'entrée dans une ère d'abondance.
Keynes, s'il discute le taux de parité livre/dollar alors choisi, ne nie pas les profits qu'une monnaie
saine pourra valoir à l'économie de son pays: n'a-t-il pas proclamé en 1920, horrifié par l'inflation nais-
sante, que Lénine serait le seul vainqueur en cas de laxisme monétaire ?
Les profits vont de toute évidence venir des fructueuses opérations, si chères à la City, sur les règle-
ments internationaux, sur les frais de dépôts et sur les activités de courtage. Chacun bénéficiera de la
sécurité procurée par la détention, dans les banques centrales européennes, de livres sterling qu'elles
ne chercheront pas à échanger contre de l'or, puisque la convertibilité fera d'un compte-sterling à
Londres ou de réserves en papier l'équivalent de réserves métalliques moins aisément maniables et
utilisables. Le système sera celui d'un Gold Exchange Standard, avec un papier aussi bon que l'or. Le
pays, fortement importateur d'aliments et de matières premières, jouira de conditions de paiement
optimales, de nature à améliorer la compétitivité des productions britanniques et à tenir les coûts de
revient. Partant, on verra s'améliorer le marché du travail et diminuer le chômage. Quant aux risques
que pourra valoir la convertibilité en or, ils sont réduits à la fois par l'absence de motivation des
banques centrales et par la restriction de la vente d'or aux particuliers. Seuls des lingots seront offerts
à cette vente, en aucun cas des pièces sonnantes et trébuchantes: la rareté des clients potentiels
rendra ainsi hautement improbable une fuite des citoyens devant la monnaie fiduciaire. On retrouve là
les théories fort anciennes de David Ricardo.
Bien entendu, il y aura un prix à payer, dont les inspirateurs de la politique déflationniste pensent qu'il
sera passager et n'entraînera que des orages de courte durée. C'est ainsi la conviction exposée par la

commission Cunliffe, instituée dès avant la guerre. On retrouve ses idées dans l'avis exprimé, à la
requête du cabinet Baldwin, par une autre commission "sur la monnaie et la Banque d'Angleterre", le
5 février 1925. La plupart des commissaires, des témoins entendus, des économistes alors les plus
fameux, dont Cecil Pigou, pourtant attentif à une forme de redistribution des richesses (4), ne retien-
nent aucune solution alternative. Ils font fi, en particulier, des avis exprimés par la Fédération des
industries britanniques, qui suggère de tout miser sur la production et les exportations. Ils suivent
d'autant moins le groupe de pression industriel que les manufacturiers sont divisés, les uns étant libre-
échangistes, d'autres protectionnistes, d'autres encore soucieux de promouvoir des industries nou-
velles face aux défenseurs d'anciennes industries de base: cotonnades, aciéries, constructions na-
vales.
Alternatives Économiques - n°167 - Février 1999
Doc. 4 : 1922-1924: l'hyperinflation allemande
Denis CLERC
L'hyperinflation qui a frappé l'Allemagne de 1922 à 1924 a profondément marqué les mentalités Outre-
Rhin. Il faut reconnaître qu'il y a de quoi. Avant la guerre de 1914, le mark, comme la plupart des
monnaies européennes, était convertible en or: le mark-papier et le mark-or étaient donc identiques et
désignaient deux formes de la même monnaie. Avec la suspension de la libre convertibilité-or, le
mark-papier perdit de sa valeur car, comme tous les pays belligérants, l'État allemand finança en par-
tie la guerre par l'émission de monnaie, provoquant de ce fait une poussée inflationniste. C'est ainsi
qu'au début de 1919, les prix avaient un peu plus que doublé par rapport à l'avant-guerre (en France,
ils avaient quadruplé).
La fin de la guerre se traduit par une recrudescence de l'inflation: le niveau des prix est encore multi-
plié par cinq environ entre début 1919 et le milieu de 1921. Mais il n'y a là rien que de très normal,
puisque l'Allemagne sort très appauvrie d'une guerre ruineuse pour tous les protagonistes: l'appareil
de production ne parvient pas à satisfaire toute la demande qui s'exprime, gonflée de l'épargne forcée
des temps de guerre. L'hyperinflation ne commence qu'en août 1921: les prix doublent au cours des
cinq derniers mois de l'année. Puis ils triplent au cours des sept mois suivants.
Ce n'était pourtant qu'un apéritif: entre août 1922 et décembre de la même année, multiplication par
six. Puis par... un milliard de décembre 1922 à décembre 1923. La hausse est si forte et si rapide au
cours des derniers mois que la Reichsbank - la Banque centrale - ne parvient plus à imprimer de nou-
veaux billets: elle en est réduite à surcharger ceux qui existent. Les prêts sont alors libellés en livres
de seigle ou en kilos de charbon. Le prix du kilo de pain varie d'une heure à l'autre et dépasse, en
décembre 1922, cent milliards de marks. On ne compte plus les billets de banque: pour payer, on les
pèse. Autant dire que la monnaie officielle n'existe plus.
Des monnaies privées font d'ailleurs leur apparition, autorisée par une loi de juillet 1922. Les
Chambres de commerce locales, certaines villes, voire certains gros commerçants ou certaines entre-
prises se mettent alors à émettre leur propre monnaie. Il s'en suit une anarchie monétaire qui, loin de
résoudre le problème, contribue à l'aggraver, car ces monnaies n'ont qu'une validité fort limitée et
contribuent donc à morceler le pays " en îlots monétaires isolés ". L'économie allemande se paralyse
donc peu à peu, le chômage grimpe, les paysans refusent d'approvisionner les villes, craignant d'être
payés en monnaie de singe. Bref, après la ruine par la guerre, c'est la ruine par l'effondrement moné-
taire.
Les choses paraissent simples. L'État allemand est endetté jusqu'au cou et le traité de Versailles lui
impose, de surcroît, de payer de très lourdes réparations de guerre. Keynes, qui avait fait partie de la
Commission chargée d'évaluer les dommages de guerre, en avait démissionné et avait publié un livre
- qui se vendit à plus de 150000 exemplaires - pour dénoncer les prétentions exorbitantes des Alliés.
Vouloir faire payer l'Allemagne, écrivait-il en substance, c'est la condamner à la ruine et au chômage à
perpétuité. Il avait raison sur le fond, la suite de l'Histoire l'a montré. Mais, en l'occurrence, peut-on
imputer à cette écrasante dette de guerre la responsabilité de l'hyperinflation?
Curieusement, keynésiens et monétaristes convergent pour l'affirmer. Les premiers en soulignant que
ces prélèvements au profit de l'extérieur ont réduit à la fois la demande intérieure et l'offre (faute de
profits suffisants pour financer l'investissement). Ils ont donc provoqué une récession structurelle que
l'émission de monnaie s'est révélée incapable d'enrayer: fouetter une rossinante ne la fait pas avancer
plus vite et contribue à l'affaiblir un peu plus. Quant aux monétaristes, ils soulignent évidemment l'ori-
gine monétaire de l'inflation: émettre de la monnaie, c'est jouer avec le feu et déclencher des anticipa-
tions de hausse ultérieure des prix, si bien que l'inflation ne peut qu'aller en s'accélérant.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%