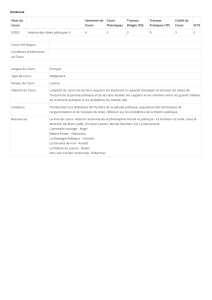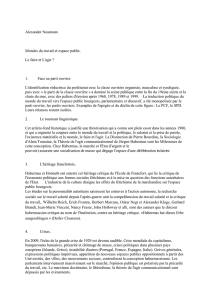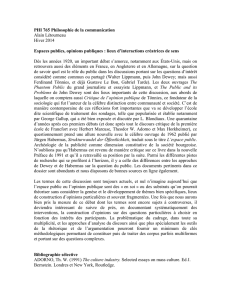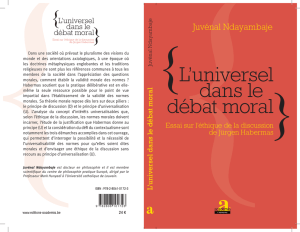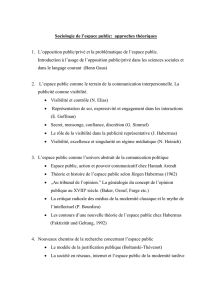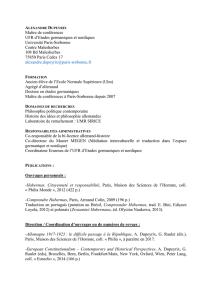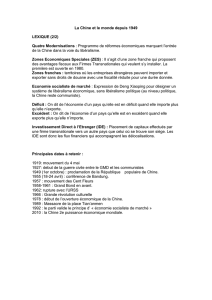Cours 5-6 2016-2017. Liber-Repu-Conserv-Commun

Université de Namur FASEG John Pitseys
Bruxelles/ 2015-2016
Philosophie politique et économique
Les critiques républicaines, conservatrices et communautariennes du libéralisme
1. Libéraux et républicains
1.1. Le libéralisme comme perfectionnement du républicanisme (Kalyvas)
Le contrat social et la volonté générale.
Communauté politique comme résultant de la volonté des membres de la communauté
Liberté et égalité protégées/garanties par les lois communes
Le pluralisme social et la limitation de l’Etat. Attention au pluralisme social et aux
divergences entre individus. La question de la liberté individuelle est centrale, et l’Etat
doit être limité/neutre/éviter tout paternalisme
L’Etat doit limiter son pouvoir sur les individus. Il connait également des limitations
internes dans l’exercice de la contrainte publique.
1.2. Le républicanisme comme matrice du libéralisme (Skinner)
Du point de vue historique, le rapport entre républicanisme et libéralisme est un rapport de
dérivation et d’innovation. Le libéralisme est une doctrine dérivée du républicanisme en ce sens
qu’il a tiré du républicanisme plusieurs de ses principes fondamentaux, au premier plan celui de
la défense de l’état limité contre l’État absolu. S’il est vrai, comme l’écrit Bobbio, que tous les
auteurs à qui l’on attribue la conception libérale de l’État insistent sur la nécessité que le
pouvoir suprême soit limité, il est tout aussi vrai que la même exigence est affirmée avec autant
d’énergie par les théoriciens politiques républicains que ce soit pour le gouvernement
monarchique, comme pour les républiques. Machiavel, pour prendre un exemple connu, qualifie
le « pouvoir absolu » de « tyrannie » et explique ailleurs qu’« un prince qui peut faire ce qu’il
veut est un fou ; un peuple qui peut faire ce qu’il veut n’est pas sage ».
Le libéralisme est une théorie politique individualiste qui pose la protection de la vie, de la
liberté et de la propriété des individus comme fin principale de la communauté politique. Les
libéraux vantent à juste titre ce principe par opposition aux doctrines communautariennes qui
posent l’affirmation d’une certaine conception du bien moral comme fin de la communauté
politique, aux doctrines théocratiques qui considèrent que la fin de la communauté politique
se situe dans une perspective eschatologique, enfin aux doctrines organicistes, qui trouvent la
finalité de l’État dans le bien de la société en général, ou du groupe, ou de la nation. Mais que
la fin principale de la communauté politique soit la défense de la vie, de la liberté et de la
propriété des individus, les républicains l’avaient déjà dit. Cicéron dans son De Officiis
désigne la garantie de la propriété comme le motif qui a poussé les hommes à abandonner la

condition de la liberté naturelle et à instituer des communautés politiques ; quand Machiavel
explique en quoi consiste l’« intérêt commun de la vie républicaine», il ne fait mention
d’aucune fin collective et souligne que l’intérêt commun que les citoyens tirent de la « vie
républicaine » consiste dans le «pouvoir de la
Un discours différent va s’établir pour le principe de la séparation des pouvoirs. Même si la
réflexion des théoriciens libéraux est allée, sur ce thème, beaucoup plus loin que les maîtres
du républicanisme classique, il est aussi vrai, comme je l’ai montré à propos des républiques,
que le principe de la séparation des pouvoirs, entendu comme distinction des fonctions de la
souveraineté, était déjà bien présent dans les écrits des théoriciens républicains. En revanche,
ce qui est propre au libéralisme classique, c’est la doctrine des droits naturels (ou innés, ou
inaliénables). Bien que cette doctrine ait exercé un rôle fondamental pour la défense des
libertés individuelles et pour l’émancipation des peuples et des groupes, elle souffre d’une
évidente faiblesse théorique que les mêmes théoriciens libéraux ont mis en lumière. Les droits
sont en fait tels seulement si l’usage ou les lois les reconnaissent, et ils sont ainsi toujours
historiques et non naturels, et s’ils ne sont pas historiques et ne sont pas reconnus par les lois,
ce sont des aspirations morales, importantes si l’on veut, mais rien de plus que des aspirations
morales.
1.3. Le libéralisme comme vulgate du républicanisme.
Il est parfois reproché aux penseurs politiques libéraux contemporains de mettre
l’accent exclusivement sur les droits du citoyen en ignorant la question de ses devoirs et
de ses responsabilités, ce qui encourage les individus à pratiquer une surenchère
perpétuelle dans la revendication de leurs droits (Skinner, 1994, 1993]) et contribue à
rendre le concept de vertu civique inintelligible (Mouffe, 1992).
Certains libéraux ont proposé pourtant une théorie originale de la vertu civique. Ainsi William
Galston (1989, 1991) distingue quatre sortes de vertus requises pour l’exercice responsable de
la citoyenneté : des vertus générales, sociales, économiques et politiques. Parmi ces dernières
on relève notamment la capacité à mettre en question l’autorité et l’aptitude à la communication
et au
dia
logue au sein de l’espace public. De même Stephen Macedo (1990) souligne
l’im
portance de la justification publique rationnelle
(
public
reasonableness
)
dans l’exercice de
la citoyenneté. Où peut-on apprendre ces vertus ? Essentiellement au sein des institutions
d’éducation. C’est, souligne Amy Gutmann (1987), à l’école que doivent s’acquérir l’esprit
critique et la capacité de prendre de la
dis
tance par rapport aux présupposés culturels que
chacun hérite de son milieu.
Toutefois, la conception proprement républicaine du civisme suppose sans doute
quelque chose de plus que la compétence argumentative, l’aptitude au dialogue et
l’esprit critique : un véritable sens du bien commun, une attitude de respect actif à
l’égard des institutions démocratiques, une capacité d’engagement au service de quelque
chose qui transcende l’intérêt individuel. En ce sens, on peut bien dire, avec Nicolas
Tenzer, que
«
le républicanisme est une forme de communautarisme. Il repose, en
effet, sur le souci de faire partager, à l’intérieur d’un État, une conception commune du
bien, un même engagement dans la vie de la cité et conduit à donner à la participation à
la vie civique une valeur supérieure à tout autre bien
»
(1995, p. 162). Ainsi Adrian
Oldfield voit dans la
partici
pation à la vie politique
«
la forme la plus élevée du vivre-
ensemble à laquelle la plupart des individus puissent aspirer
»
(1990, p.6).
Pour la tradition de pensée fondée sur cette conception du républicanisme civique, la
principale erreur du libéralisme contemporain tient au fond à son adhésion étroite à un

idéal de liberté négative, au sens où l’entend Isaiah Berlin (1990 [1969]) en référence à la
«
liberté des Modernes
»
de Benjamin Constant (Taylor, 1979b), c’est-à-dire non pas la
liberté comme participation à la souveraineté politique, mais la liberté comme absence
de contrainte de la part de l’État,
pro
tection à l’égard de l’arbitraire et droit de vaquer à
ses propres affaires sans avoir de comptes à rendre à la collectivité, dès lors qu’on
n’empiète pas sur la liberté des autres
1
.
2. Le républicanisme contemporain
2.1. La question de la participation : Arendt
Repères
Hannah Arendt, née le 14 octobre 1906 et morte le 4 décembre 1975 à New York, est
une philosophe allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l’activité
politique, le totalitarisme et la modernité (Les Origines du totalitarisme (1951), Condition de
l'homme moderne (1958) et La Crise de la culture (1961). Son livre Eichmann à Jérusalem,
publié à la suite du procès d'Adolf Eichmann en 1961, a suscité de nombreuses controverses
au sein même du monde culturel et intellectuel juif.
Son analyse de l'espace public repose sur la distinction conceptuelle entre le domaine privé et
le domaine public. C'est sous cet angle qu'elle critique la modernité, en ce que justement
celle-ci serait caractérisée par la disparition d'une véritable sphère publique, par laquelle
seulement l'humain peut être libre.
La réinterprétation de la démocratie athénienne
- Arendt s’inspire de l’expérience sociale et politique de la démocratie athénienne, dont
la compréhension lui apparait nécessaire pour comprendre l’expérience de la liberté,
1
Cependant, dans la période récente, en réponse à certaines
objec
tions des libéraux, s’est
développé ce qu’on désigne parfois comme une variante
«
instrumentale
»
de la pensée
républicaine, ou un
«
républicanisme instrumental
»
(Patten, 1996), qui ne récuse nullement
l’idéal moderne de la
«
liberté négative
»
mais souligne que, pour préserver les institutions
libérales d’un risque permanent de stagnation, de corruption ou de captation abusive, les
citoyens doivent faire preuve sans cesse de vertu civique et d’intérêt pour les affaires publiques.
Ces républicains estiment ainsi qu’une citoyenneté active doit être valorisée non pas
nécessairement parce qu’elle constituerait une chose intrinsèquement bonne, mais parce
qu’elle a au moins le mérite de contribuer au maintien d’une société libre, ce qui revient à
dire que la liberté négative n’est réalisable que si les citoyens sont aussi de
«
bons citoyens
». Si un tel point de vue, défendu notamment par Quentin Skinner (1984, 1990, 1994 [1993]),
passe aux yeux de John Rawls pour fondamentalement libéral du fait qu’il ne donne la
préférence à aucune conception particulière de la vie bonne (1995 [1993], p. 250), il est
pré
senté plutôt par Skinner lui-même comme une sorte de
«
troisième voie
»
(selon
l’expression de Spitz, 1995), qui voit la loi comme un moyen au service de la liberté,
«
un
moyen, écrit Skinner, de garantir une liberté que notre penchant naturel à la corruption
viendrait autrement miner », ce qui revient à reprendre la formule de Rousseau
«
si souvent
mal comprise
»
selon laquelle
«
l’une des raisons d’être les plus fondamentales de la loi au
sein d’une société libre est de nous forcer à être libres, c’est-à-dire de nous forcer à adopter les
comportements civiquement vertueux qui sont indispensables à la conservation de notre liberté
»
(1994 [1993], p. 106).

qu’elle entend comme participation à la vie publique. Dans le modèle démocratique
athénien du Vème siècle avant notre ère, La distinction entre vie privé (idion) et vie
publique (koinon) est fondamentale.
Dans la maisonnée (oikos), il est nécessaire de travailler, ce qui implique des rapports
de domination et de violence. Alors que dans l’espace public (polis), propre de
l’activité politique (koinon). c’est la nécessité de la concertation qui est la règle. Les
actions y sont imprévisibles et fragiles et se basent sur un réseau de relations régi par
le respect de la liberté de chacun et l’acceptation de la singularité de tous. Dans
l’espace politique de la polis, l’agora est le lieu spécifique la prise de parole, de la
délibération et de mise en place de décision. Ainsi l’agir politique se constitue de deux
éléments : la praxis, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques politiques en temps que
telles et ce qui a trait à la parole en publique appelé la lexis.
Arendt définit le citoyen ainsi : « C’est cet homme qui quitte le domaine privé pour
exercer la liberté politique avec ses semblables. Il tente également avec ses pairs de
fonder un nouveau gouvernement qui doit représenter l’ensemble des citoyens et dont
la légitimité provient des corps politiques subalternes. » (Arendt, 1995, Qu’est-ce que
la politique) Si tous les citoyens sont conviés à participer à la vie politique, c’est qu’il
existe une égalité de chacun dans la polis, mais seuls les meilleurs pourrons être chefs
de guerre ou juges. En cela, il existe une représentation dans la citoyenneté athénienne.
- Arendt propose une définition de la polis. C’est « l’organisation du peuple qui vient de
ce que l’on agit et parle ensemble, et son espace véritable s’étend entre les hommes
qui vivent ensemble dans ce but, en quelque lieu qu’ils trouvent » (Condition de
l’homme moderne). La polis permet est le lieu où l’homme se dégage de sa condition
d’animal. Dans la pensée antique grecque. Mais le citoyen doit pratiquer la praxis et la
lexis pour être humain. Ce qui implique la nécessité d’un espace politique pour que
l’humanité s’accomplisse – Arendt s’inscrit ici dans la tradition d’Aristote : l’homme
est un animal politique car il est doué de parole.
- La liberté naît de la polis, et son actualisation se fait grâce aux décisions prises dans
l’agora. Le citoyen grec manifeste ainsi sa singularité, en dévoilant son nom.
L’expression de l’individualité de chacun est tributaire de la citoyenneté. Il faut être
citoyen pour révéler son identité. Seule l’appartenance à la polis donn un nom à
l’homme grec.
La figure de l'individu nait de la polis mais s’éprouve dans la libre expression de ses
opinions. Les décisions sont prises en commun, mais les opinions restent propres à
chacun. Pouvoir appartient à chacun, saisi comme membre de la Communauté.
Isonomie idéale « sans division entre gouvernants et gouvernés ». [p30, la crise de la
culture] Il n’y a donc aucun dirigeant politique dans l’espace public. Le pouvoir est
une potentialité pour chacun ; une virtualité qui ne se cristallise que de façon éphémère
lors du moment de la décision.
- L'action et la parole requièrent un espace public au sein duquel les individus entrent en
relation, manifestant à la fois leur unicité et la communauté qui les lie, et faisant ainsi
émerger un espace d'apparence, soit « l'espace où j'apparais aux autres comme les
autres m'apparaissent, où les hommes n'existent pas simplement comme d'autres objets
vivants ou inanimés, mais font explicitement leur apparition ». Espace public est le
lieu de la pluralité : réseau des relations humaines, qui, constitué comme domaine
politique, comme polis, est l'espace où tous sont égaux en tant qu'appartenant à

l'humanité, mais aussi où chacun se distingue des autres en ayant une perspective sur
le monde qui lui soit propre : « la pluralité humaine, condition fondamentale de
l'action et de la parole, a le double caractère de l'égalité et de la distinction. »14; l'action
« est l'actualisation de la condition humaine de pluralité, qui est de vivre en être
distinct et unique parmi des égaux »/
- L’espace public comme « lieu vide ». L’espace public est un réceptacle toujours à
remplir, fondamentalement indéterminé (Lefort, 1972). Espace public est à la fois le
lieu de la « natalité » et de la « fragilité » : émergence de choses nouvelles et
imprévisibles ; persistance des choses soumise à l’échange de la parole. C'est en ce
sens que Hannah Arendt considère l'homme libre comme « faiseur de miracle »
(Condition de l’homme moderne)
- La prise de décision se base sur la persuasion, qu’Arendt définit comme la mise en
commun des meilleurs arguments pour aboutir à un « sens commun ». Elle ajoute : «
c’est donc la parole partagée et l’action à plusieurs qui conféraient le sens de la réalité
aux Grecs ». [Arendt, 1958, p127] Cette action partagée et concertée entre citoyens
correspond au coeur de la démocratie athénienne et de la réalité démocratique selon
Hannah Arendt.
La perversion de la modernité
- Pour Arendt, l’émergence de la modernité politique et scientifique marque une perte
du « sens commun ». Critique des théories contractualistes et utilitaristes, qui selon
elle intrumentalisent l’activité politique.
- Pour l’utilitarisme comme pour le contractualisme libéral, l’individu précède la
communauté. L’objectif de l’activité politique est de satisfaire les intérêts et/ou les
préférences de l’individu, ou de la communauté d’individus composant la société. Le
mouvement intellectuel et social du politique qui caractérise la modernité fait entrer la
sphère privée dans le domaine public et sépare la liberté de la politique. L’espace
public n’est plus dominé par la politique, mais par la société. La polis a disparu au
profit de l’État. L’État n’est plus qu’un organisme de protection de la société
regroupant aussi bien les individus que les biens. Il y a donc une disparition d’une
transcendance au profit d’un fonctionnement rationnel et surtout déshumanisé du
rapport au politique.
- Il n’y a plus une assemblée de citoyens mais un face-à-face entre l’individu et l’Etat.
Individu solipsiste. Et l’Etat comme garde-fou des libertés individuelles.
L’individu se sépare de la communauté. La figure du citoyen disparaît au profit de
celui de l’individu qui, pour Hannah Arendt, est le « dernier avatar » du bourgeois. «
Le bourgeois s’occupe exclusivement de son existence privée et ignore totalement les
vertus civiques. Il a poussé si loin la distinction du privé et du public, de la profession
et de la famille, qu’il ne peut même plus découvrir en lui-même aucun lien de l’un à
l’autre. » (Condition de l’homme moderne) Penser l’évènement
L’Etat devient un organe mécanique, instrumental, coupé de la vie politique. Hannah
Arendt écrit que l’État moderne n’aurait qu’un seul rôle : l’administration de choses
qui serait un rôle social, apolitique voir antipolitique dans certain cas.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%