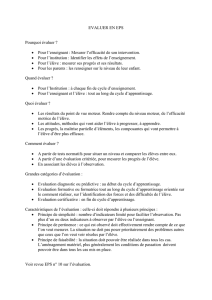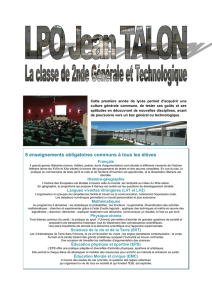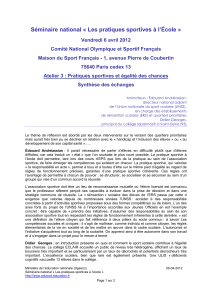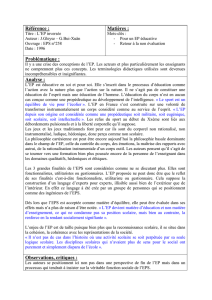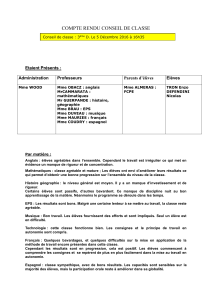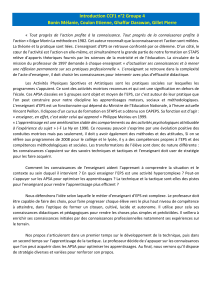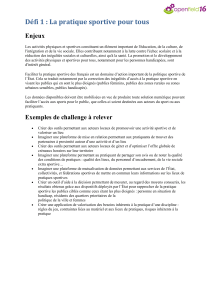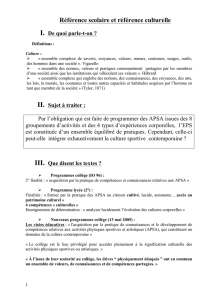EPS en France (1940-Aujourd'hui): Sportivisation et Conséquences

Ecrit 1
Texte série 4
L’EPS de 1940 à nos jours : la sportivisation et ses
conséquences
Auteur : Gilles Fernandez
I- Continuité, un retour à la tradition éclectique et hygiénique
(1945-1959) :
1. Présentation.
Bornée par deux IO, cette période marque un retour à une EP traditionnelle et aux
valeurs de base des années 1920/1930.
Face à ce modèle hygiénique, le courant sportif va proposer une alternative que le
corps des enseignants (mieux formés, plus sensibilisés à ce sport, plus nombreux et plus
organisés) va largement exploiter dans les leçons d’EP.
2. L’EP scolaire :
2.1 Les instructions ministérielles de 1945 :
Le 1 octobre 1945, de nouvelles instructions sont proposées pour abroger celles de
1941 et proposer ce que beaucoup appellent un cadre éclectique « ouvert ».
Le texte formalise quatre principes méthodologiques à respecter :
- L’EPS concerne tous les âges, même si chaque âge à ses caractéristiques propres.
Il est nécessaire de s’attaquer à la faiblesse organique des enfants, à leur
épanouissement et à leur santé. L’idée d’unicité de l’être est rappelée.
- L’EPS doit tenir compte de la valeur physique, mais aussi technique et
psychologique de l’enfant et même des saisons, du climat ou du matériel
disponible. L’évaluation médicale de l’élève retrouve sa place centrale afin
d’assurer un développement normal. La constitution de quatre groupes d’élèves en
référence à leur valeur physique perdure et se trouve même renforcée avec la mise
en place des services d’hygiène scolaire et universitaire et des centres de
rééducation physique pour les enfants du groupe 4 (dispensés d’EP normal).
- A chaque méthode correspond une finalité appropriée. Une formation complète et
équilibrée passe par une articulation cohérente de l’éclectisme des moyens. Les
finalités n’apportent donc rien de nouveau : développement normal, attitude
correcte, habitude du geste naturel, affinement du geste, développement de l’esprit
d’équipe, amélioration de la discipline, de la virilité et de l’altruisme et préparation
à la vie sociale.
- L’EP est toujours organisée en deux temps : la leçon développe les qualités de
base et le plein air, des applications plus globales, dynamiques, jouées.

Si le texte laisse une liberté apparente d’adaptation aux enseignants, il reste, toutefois,
très précis et contraignant sur l’organisation de l’EP dans les établissements : en effet, tout est
prévu par ce texte :
- Le découpage de l’année.
- Une planification de la formation sur le cursus de l’élève.
- L’organisation de la séance avec un plan type.
- L’organisation des groupes et des élèves.
2.2 Les oppositions conceptuelles et corporatives :
Si de 1945 à 1959, l’EP scolaire semble peu évoluer. Andrieu (1992) montre que cette
période voit s’opposer deux grandes tendances :
- La tendance sportive de l’Institut National des Sports (INS), où dans des
conditions matérielles précaires, une équipe de cadres est constituée autour de M.
Baquet, directeur technique de l’INS. Une revue technique (1947) - revue qui
deviendra la revue EPS en 1950 – sera chargée de formaliser et de diffuser cette
méthode sportive par une étude précise des diverses spécialités sportives et des
techniques correspondantes.
- La tendance gymnastique construite de la ligue française d’EP avec notamment, P.
Seurin. A travers cette institution et leur revue « l’homme sain », il s’agit de faire
partager l’idéal de Tissié et de faire perdurer l’option médicale et hygiénique de
l’EP. L’ouvrage collectif, sous la direction de P. Seurin « vers une EP
méthodique », en 1949, résume parfaitement la conception développée. Référence
aux sciences biologiques.
2.3 Les IO de 1959 : un rappel à l’ordre inutile.
L’inspection générale semble, de par la constitution de ses membres, acquise au
courant gymnique, « pro-médical ». devant la vivacité du courant sportif, devant
l’introduction massive du sport dans les leçons d’EP par les enseignants, devant l’incohérence
ou, du moins, la diversité des EP sur le terrain, mais également devant le « danger » que
représente le projet politique de Herzog, cette IG, très tardivement, va rédiger un nouveau
texte pour recadrer l’action pédagogique et éducative des enseignants. Si le sport n’est pas
critiqué, c’est l’utilisation exclusive et démagogique (pour faire plaisir aux élèves, sans visée
de formation…) de cette pratique qui est dénoncée. Ainsi l’EP doit s’organiser en deux
temps : - Une gymnastique construite de formation où des exercices simples, localisés puis
plus complexes et combinés viseront le développement des qualités de base et
l’amélioration corporelle et mentale.
- Une gymnastique fonctionnelle d’application permettant d’appliquer dans des
exercices plus motivants, plus dynamiques, plus joués et plus globaux, les
acquisitions initiales. Les méthodes naturelles et sportives permettront d’adapter
l’individu à l’objet ou à l’environnement.
Il s’agit bien d’un « éclectisme fermé » (Combeau-Mari, 1993) visant « la recherche
du rendement optimum et fonctionnel » (Seurin, 1949).
Ce texte, complètement inadapté au contexte de l’époque et aux évolutions de la
profession, n’aura aucun effet tant le décalage est important. La profession est, en cette fin des
années cinquante, largement acquise à la conception sportive ou du moins à la pratique
sportive.

3. Le sport et le système scolaire :
Le 11 mars 1946, sous le gouvernement provisoire de la république, le BSP « renaît ».
Le décret va surtout créer, pour les plus de 18 ans, un degré supérieur. Cette distinction
(brevet populaire, brevet supérieur) renforce la dimension sportive et compétitive de cette
épreuve. De plus, dès 1947, des challenges sont organisés avec la distribution de récompenses
(subventions, matériel…) pour les départements, les clubs sportifs et les établissements
scolaires ayant obtenu le plus fort pourcentage de BSP. De nombreux établissements scolaires
organisèrent une préparation à ce BSP dans l’optique d’obtenir du matériel (ballons,
maillots…) ; ce qui conduira, incontestablement, à sensibiliser fortement les élèves et
enseignants, aux pratiques sportives. Les séances de sport scolaire et la demi-journée de plein
air sont naturellement les lieux les plus appropriés pour mettre en place cette formation.
Dès la libération, l’OSSU reprend son titre, sa place à l’éducation nationale et surtout,
est reconnu d’utilité publique. Nous pouvons dégager six points qui marquent le
développement et l’orientation du sport scolaire :
- En 1945, la création des associations sportives devient obligatoire dans les
établissements du second degré et le jeudi après-midi doit être libéré par le chef
d’établissement. Cette disposition, fondamentale, est la base de l’extension du
sport à l’école.
- Par les IO de 1945, ce sport scolaire est officiellement placé dans le prolongement
de l’EP obligatoire et, surtout, de l’initiation sportive dispensé dans le plein air.
Une volonté de cohérence entre les différents temps et espaces scolaires d’EP est
recherchée.
- De nombreuses garanties pour protéger les enfants des excès du sport de
compétition sont prises (contrôle médico-sportif, catégories d’âge, formes de
compétition). On conserve ici, l’idée de développer un sport pur, vrai, spécifique et
autonome.
- Le décret du 25 mai 1950 intègre un forfait de trois heures dans l’emploi du temps
hebdomadaire des enseignants d’EPS pour animer les AS.
- On multiplie les conventions et les partenariats, pour les compétitions, entre les
différentes structures et institutions sportives. Une cohérence externe est ici
recherchée dans la formation sportive de la jeunesse.
- En 1948, l’OSSU est admise au conseil national des sports ; ce qui consacre sa
reconnaissance par les instances sportives nationales.
4. Le contexte explicatif :
C’est la situation de la jeunesse qui est inquiétante : « 80 % des jeunes sont des
déficients physiologiques, scoliotiques, insuffisants respiratoires et musculaires »
(Berthoumieu, IG, 1946).
Cet aspect social et sanitaire est renforcé par la puissance des sciences biologiques
qui dominent toujours les références scientifiques.

II- Rupture : l’éducation sportive, un choix politique (1959-
1965).
1. Présentation :
« Les années 1960 sont une véritable charnière dans l’histoire de l’EP en France »
(Andrieu, 1990).
2. La stratégie de M. Herzog dans un contexte politique nouveau :
L’avènement de la 5ème République, en 1958, et le retour du Général De Gaulle
placent le pays dans un contexte fort différent. De nouvelles valeurs sont alors prônées. L’idée
de prestige est véhiculée. La France doit briller à l’extérieur et dans tous les domaines
(culturel, scientifique, artistique, industriel, et naturellement sportif). Le sport devient « un
révélateur de la force d’un pays dans les relations internationales » (Thibault, 1971).
Le 5 octobre 1958 est créé un haut commissariat à la jeunesse et aux sports et De
Gaulle fait appel, pour conduire cette politique, à une figure emblématique du monde sportif,
Maurice Herzog. Herzog, fortement soutenu par le Général, disposera d’une liberté d’action
très importante et, pour la première fois, de moyens adéquats à son projet de révolution
sportive.
Le ministre développera deux idées :
- Le développement de la pratique sportive de masse doit aboutir à la sélection
d’une élite forte. Le système de la « pyramide coubertinienne » est la référence.
- L’EP qu’il s’agit de moderniser, est à la base de ce projet. C’est par l’EP scolaire
que la sensibilisation et l’initiation sportives doivent s’effectuer. Un système de
détection des aptitudes sera mis en place.
Herzog annoncera rapidement sa ferme intention de « rendre l’EP moderne et
attrayante en l’orientant vers une initiation aux sports et aux activités de plein air ».
Sa stratégie peut être présentée en quatre étapes caractéristiques d’une attitude
particulière à chaque fois :
- Stratégie de séduction des acteurs de l’EP :
Par exemple, il va instituer une épreuve d’EP obligatoire aux baccalauréats en
1958. par ce biais, il montre aux syndicats et aux enseignants son souci de faire
reconnaître la discipline.
Selon Martin en 1996, « soucieux d’éviter un conflit, Herzog accepte, à titre
provisoire, la publication d’instructions qui en réalité, sont fort loin de recevoir son
adhésion ». Il laisse faire l’IG, sachant très bien le peu d’impact qu’auront ces IO
sur les pratiques, contrairement à sa réforme du bac.
- Stratégie matérielle :
Par exemple, il obtient du ministère des finances, une loi de programmation
quinquennale sur l’équipement sportif. La première loi (1961-1965) est votée,
d’autres suivront et vont permettre de doter la France de structures sportives de
qualité. Il augmente, de façon nette, le recrutement des enseignants d’EP. Enfin, il
met en place les « métiers du sport » avec le diplôme de conseiller sportif en 1960,
puis le BE à partir de 1963, etc.
- Stratégie de pouvoir :
Malgré de vives et nombreuses contestations de l’IG, Herzog profitera d’un
rapport de force favorable et fera passer son projet à coups de circulaires entre

1961 et 1962. le coup de force est décisif. Toutefois la profession prend conscience
de l’insuffisance d’une telle démarche et action politique. Il apparaît pour
beaucoup, nécessaire de mener une réflexion sur les fondements éducatifs de cette
pratique sportive afin de mieux ancrer l’EP dans les valeurs de l’école.
- Stratégie d’infléchissement :
Face aux réticences et résistances professionnelles, Herzog doit nuancer son projet
initial : L’EP ne sera pas une éducation sportive mais une éducation physique et
sportive. Après avoir rendu officiellement l’EP sportive, il va mettre en place deux
commissions qui auront pour tâche de définir les bases éducatives du sport et de
son utilisation à l’école.
o La première commission aura pour tâche de mener une réflexion générale
et philosophique sur les valeurs du sport. C’est Borotra qui sera le président
de cette commission intitulée « doctrine du sport ». Une plaquette présente
en 1965, le sport comme un moyen exceptionnel d’éducation, un précieux
facteur d’épanouissement de la personne et un moyen de promotion
humaine. Les IO de 1967 vont largement s’en inspirer.
o La seconde commission, plus traditionnelle, aura pour tâche la rédaction de
nouvelles IO.
3. Vers une éducation sportive :
3.1 La circulaire du 1er juin 1961 :
Le choix de commencer la réforme par le plein air peut s’expliquer par le caractère
plus récréatif de cet espace éducatif scolaire. La circulaire créant la demi journée de sport
impose aux enseignants de préparer et d’organiser des compétitions sportives.
3.2 La circulaire du 21 août 1962 :
Intitulée « instructions pour l’organisation des activités de sport : initiation,
entraînement, compétition », cette circulaire réorganise totalement le cadre et le contenu de
l’EP scolaire. Pour la première fois, l’initiation sportive est introduite dans les deux heures
d’EPS hebdomadaires. Une cohérence d’ensemble apparaît en trois temps :
- La leçon : initiation technique.
- La demi-journée de sport : entraînement aux compétitions de masse (interclasses).
- Le sport scolaire : compétitions plus sélectives.
L’objectif n’est plus la santé mais il faut « donner aux élèves le maximum de
connaissances techniques et d’entraînement physique ».
3.3 Le sport scolaire :
L’ASSU sera créée dans une optique plus sportive, plus compétitive et plus
associative. L’idée de complémentarité apparaît de façon explicite entre l’EP et le secteur
associatif. Le sport scolaire devient le maillon indispensable entre le monde scolaire
(initiation pour tous) et les clubs civils. Il sera autant un outil de sensibilisation à la
compétition qu’un outil de sélection, d’orientation des meilleurs éléments.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%