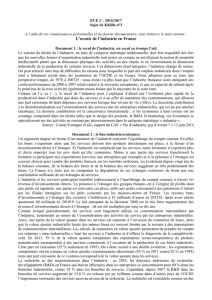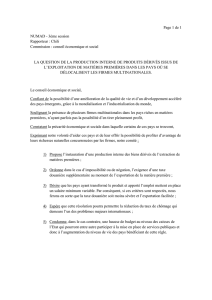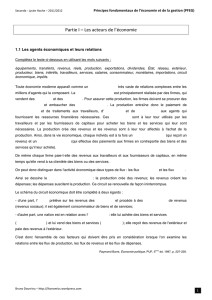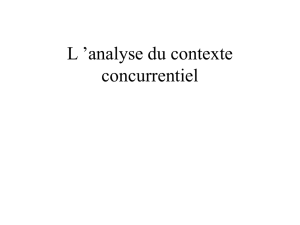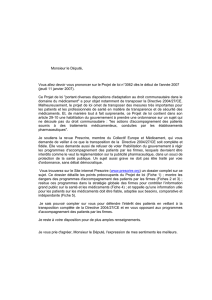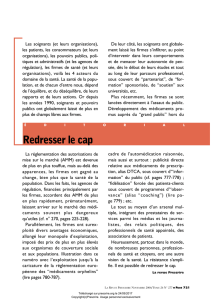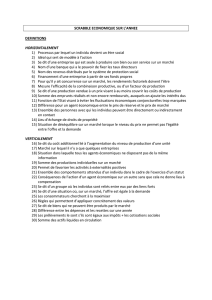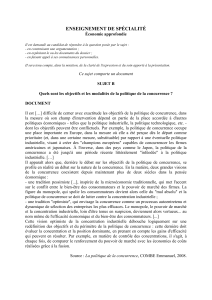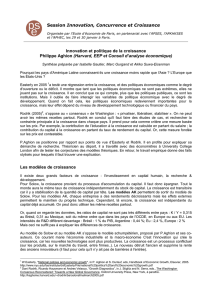Demain, quelle industrie

ECE 2 – 2016/2017
Sujet de Khôlle n°3
A l’aide de vos connaissances personnelles et du dossier documentaire, vous traiterez le sujet suivant :
L’avenir de l’industrie en France
Document 1 : le recul de l’industrie, un recul en trompe l’œil
Le constat du déclin de l’industrie, au sens de catégorie statistique traditionnelle, doit être requalifié dès lors
que les nouvelles formes d’organisation industrielle sont prises en compte en privilégiant la notion de propriété
intellectuelle plutôt que la dimension physique des activités ou des objets, et en reconnaissant la dimension
industrielle de la production de certains services. Ces dimensions étant intégrées, l’industrie change de nature.
On peut retracer sans trop de difficultés les raisons pour lesquelles la part des emplois industriels dans l’emploi
total a fortement reculé dans les économies de l’OCDE et en France. Nous adoptons pour ce faire une
perspective longue, de 1970 à 200725 : nous avons vu plus haut que l’industrie française avait enregistré des
contre-performances de 2000 à 2007 relativement à la moyenne européenne, et que sa capacité de rebond après
le point bas de la crise avait été également moins bonne que la moyenne de la zone euro.
Comme on l’a vu (…), le recul de l’industrie peut s’expliquer d’abord par l’évolution plus rapide de la
productivité dans l’industrie que dans les services et à un effet de saturation des consommateurs, qui allouent
une part croissante de leurs dépenses aux services lorsque leur niveau de vie s’élève. La deuxième contribution
à la désindustrialisation est l’externalisation des services par les entreprises industrielles, qui est un pur artefact
statistique. La dernière contribution est la concurrence internationale : si les économies à haut revenu ont un
avantage comparatif dans les tâches telles que le design des produits, la R&D, le marketing, ces économies se
spécialiseront sur des activités ne rentrant pas nécessairement dans la catégorie statistique « industrie ».
Source : Lionel Fontagné et alii, rapport du CAE « Pas d’industrie, pas d’avenir ? » 13 juin 2014
Document 2 : le lien industrie/croissance
Un argument majeur en faveur d’un maintien de l’industrie concerne l’équilibrage du compte courant. En effet,
les biens s’exportent alors que les services doivent être produits directement sur place, à la faveur d’un
investissement direct à l’étranger. Si l’industrie est remplacée par les services, notre économie n’exportera plus
et devra importer tous les pro- duits qu’elle consomme. Même si une partie des services franchissent la
frontière et participent aux exportations (services aux entreprises par exemple) et si la présence à l’étranger est
souvent choisie pour vendre des produits français sur les marchés extérieurs, les évolutions depuis vingt ans de
la balance courante, de la balance des biens et de la balance des services suggèrent un rôle prédominant des
biens. La France n’a donc pas su compenser la dégradation de ses échanges extérieurs de biens par une
amélioration suffisante de ses échanges de services.
L’industrie et les services participent toutefois indirectement à l’équilibrage du compte courant, à travers les
revenus d’investissements directs. La présence à l’étranger des groupes français est à l’origine de profits dont
une partie est rapatriée, une partie est réinvestie sur place, enfin une partie correspond à des paiements d’intérêt
par les filiales étrangères sur les prêts consentis par les maisons-mères en France. Les revenus bruts
d’investissement à l’étranger (les recettes) s’établissent à 53 milliards d’euros en 201218, après avoir atteint
quasiment 60 milliards en 201019. Le fait marquant de la décennie 2000 est la très forte augmentation des
revenus d’investissements directs à l’étranger : ils ont été multipliés par cinq en dix ans.
Comme évoqué précédemment, les services sont largement utilisés en consommation intermédiaire par
l’industrie, notamment en raison de l’externalisation des activités de service par les entreprises industrielles.
Ainsi, une partie de la valeur ajoutée dans les services est exportée à l’occasion du commerce de biens, alors
que la valeur ajoutée industrielle locale des mêmes biens est souvent limitée par le recours à des importations
de consommations intermédiaires. Les calculs de commerce en valeur ajoutée permettent de prendre en compte
ces relations « inter-industrielles » liant les services à l’industrie et d’affiner le diagnostic de la compétitivité-
coût. En 2011, 39 % de la valeur ajoutée européenne des exportations (extra-européennes) de produits
manufacturés correspondait à des services consommés à l’occasion de la production de ces biens industriels.
Cette part est croissante (35 % seulement en 1995). On a donc assisté à une double évolution : les exportations
européennes ont un contenu en valeur ajoutée communautaire décroissant (85 % en 2011 contre 92 % en 1995)
mais une part croissante de ce contenu correspond à de la valeur ajoutée dans les services.
La recherche se fait majoritairement dans l’industrie : en 2010, les dépenses intérieures de recherche-
développement (R&D) en France qui étaient effectuées dans les entreprises se concentraient pour 80 % dans les
branches industrielles, contre 18 % dans les branches de services. Cependant, depuis 2007 la R&D dans les
branches de services augmente de 15,8 % en volume par an, reflétant comme dans d’autres pays de l’OCDE
l’importance croissante des services aussi au niveau de la recherche. La recherche est considérée comme un des

piliers de la croissance soutenable. En dépensant en R&D, les entreprises et l’État investissent dans la
production de connaissances, générant de nouveaux produits ou procédés de fabrication qui permettent aux
entreprises de rester concurrentielles en coûts de fabrication, en qualité et en diversification de produits. À long
terme, ces connaissances se traduisent en gains de productivité et en accroissement de bien-être.
La R&D engendre aussi des externalités de deux types : les externalités pécuniaires et les externalités de
connaissances. Les premières ont trait à l’augmentation des rentes ou du chiffre d’affaires d’un secteur suite à
la recherche effectuée dans un autre secteur (par exemple, l’apparition de nouveaux ordinateurs se répercutera
dans la productivité du secteur bancaire). Les externalités de connaissances se rapportent aux transferts non
rémunérés de connaissances d’un secteur à l’autre dues au fait que la connaissance est un bien social : la
recherche dans un secteur donné produit des connaissances utiles pour d’autres secteurs (par exemple, des
progrès en informatique ont bouleversé la façon de faire de la recherche dans le secteur pharmaceutique).
Source : Lionel Fontagné et alii, rapport du CAE « Pas d’industrie, pas d’avenir ? » 13 juin 2014
Document 3
Ces effets d'entraînements ont été également analysés avec davantage de précision dans le cas de l'industrie
microélectronique dans le bassin grenoblois: un emploi créé dans l'entreprise motrice, en l'occurrence
STMicroelectronics, engendre environ un emploi chez les fournisseurs directs du site. Ces deux emplois créés
dans la filière microélectronique grenobloise engendrent à leur tour environ quatre emplois dans l'économie
tertiaire pour répondre aux besoins des familles. Ces quatre emplois se partagent à peu près à part égale entre le
local et le national. Sur un plan strictement local, on peut donc considérer qu'un emploi supplémentaire chez
STMicroelectronics en suscite quatre autres. Un effet de levier considérable qui justifie l'ardeur des collectivités
locales pour attirer les industriels sur leur territoire.
Source : Brieuc Brougnoux, « Pas d'avenir sans industrie », Alternatives Économiques n° 266, février 2008.
Document 4
L'industrie reste en effet, quoi qu'on en dise, une activité structurante qui ne se résume pas à une batterie de
statistiques. Elle tire l'innovation, nourrit le commerce extérieur et le développement du secteur des services
aux entreprises. Même si un composant électronique incorpore 95% d'activité immatérielle, il n'y a pas de
développement autonome des services sur fond de désindustrialisation intégrale. Voilà pourquoi le débat sur la
désindustrialisation française ne relève pas du discours de circonstance, mais constitue bel et bien un enjeu
majeur pour la croissance du pays, le niveau de vie et l'avenir de nos enfants.
Le diagnostic révèle une pathologie grave. L'industrie manufacturière française a commencé à détruire des
emplois dès le premier choc pétrolier de 1973 et perdu depuis plus de 40 % de ses effectifs pour glisser, pour la
première fois dans l'histoire contemporaine du pays, sous la barre des 3 millions en 2008. Dans le même temps,
la part de la production intérieure brute, autrement dit de la richesse créée dans notre pays par l'industrie,
passait d'un quart à un sixième (16%). C'est ainsi que la société dite postindustrielle s'est installée
subrepticement dans nos vies. Sans crier gare.
Source : Patrick Artus, Marie-Paule Virard, « La France sans ses usines », Fayard, 2011.
Document 5 : la réindustrialisation n’est pas nécessairement synonyme de plus d’emplois industriels
Retrouver les emplois perdus de l’industrie semble être le motif principal d’une politique de ré-industrialisation
pour l’économie française, si marquée par le chômage. Deux cas de figures sont à alors envisager : le ré-
industrialisation s’opère sur des activités existantes, la structure de la spécialisation productive restant identique
(autrement dit, on conserve les mêmes parts dans le PIB des industries/produits) ; le ré-industrialisation est
basée sur des activités nouvelles, nécessairement innovantes, la structure de la spécialisation étant alors
modifiée. (…) Cette ré-industrialisation doit s’effectuer autour d’activités nouvelles, créatrice de croissance,
plus adaptée à la demande interne et mondiale. Ces activités nouvelles doivent être génératrices d’externalités
positives et d’effets de diffusion dans l’ensemble du tissu industriel. Il ne s’agit pas d’envisager une politique
industrielle dirigiste qui décide ex ante des activités futures, mais plutôt de définir une politique qui autorise et
incite à la création d’activités et de gammes nouvelles. C’est en effet en dégageant une valeur ajoutée (par
travailleur) plus importante que les termes de l’échange deviendront plus favorables. Une telle politique, menée
avec succès, ne peut cependant pas garantir un solde net d’emplois créés positif. Rien ne dit que les nouvelles
activités auront un contenu en emplois supérieur aux activités sur le déclin.
Source : Sarah Guillou et Lionel Nesta, Blog de l’OFCE, 20 juillet 2012
Document 6 : la politique commerciale pour protéger l’industrie

Les thèses protectionnistes reviennent en force, au moins dans certains pays européens et aux Etats-Unis. Elles
prennent des formes variées et reçoivent des justifications diverses : « juste échange » plutôt que « libre
échange », taxes environnementales et sociales aux frontières de l’Europe, ou même de la France,
« réciprocité » dans les rapports aux pays émergents … Qu’en penser ? (…) Désormais, les firmes chinoises ou
indiennes ont pu s’insérer dans pratiquement tous les niveaux des chaînes de valeur. (…) Or, dans la
compétition avec les chinois, les armes sont désormais inégales. Le gouvernement chinois protège son marché
intérieur et impose des taux importants et croissants de contenu local et des transferts massifs de technologie. Il
constitue, à la japonaise des années 1970 et 1980, des oligopoles compétitifs de trois à quatre grandes firmes
publiques dans chacun des grands secteurs jugés stratégiques. Il les incite à s’internationaliser et soutient grâce
à une diplomatie économique très active leur expansion à l’étranger. Il met à leur service des capacités
d’investissement pratiquement illimitées.
Il est donc selon moi parfaitement légitime, pour les gouvernements européens, ainsi que les gouvernements
américains et japonais (…) de renégocier les règles du jeu de la globalisation. (…) Cependant, même si des
accords sont toujours préférables à la guerre commerciale, il convient d’avoir un plan B qui constitue une
menace crédible. J’ai dans divers articles parus en 2012 proposé d’étudier une option de totale réciprocité avec
les grands pays émergents, qui ont de fait achevé leur rattrapage technologique, plutôt que d’utiliser des taxes
aux frontières, imposées au nom d’un « dumping social » impossible à quantifier. Par exemple, traiter avec les
firmes globales, d’origine chinoises ou indiennes mais pas seulement comme le fait la Chine : bienvenue aux
biens et services quelles que soient les firmes qui les produisent, mais à condition qu’ils soient en partie
produits sur le territoire européen. « Négocier » donc un « contenu local pour accéder au marché local »,
variable selon les biens, comme le font les chinois.
Source : P.N.Giraud, « La mondialisation. Emergence et fragmentations », Coll.Sciences Humains, 2012,
p.110
Document 7 : réaliser la montée en gamme des produits français
Les solutions, au niveau des politiques nationales (et au niveau européen) sont clairement indiquées par le
modèle que nous avons présenté (P.N.Giraud). Il existe deux grandes voies, qu’il faut naturellement combiner
pour obtenir l’effet maximum : augmenter la proportion de nomades au sein de la population d’un territoire et
leur « prix » dans l’économie nomade globalisée ; accroître l’attrait des biens et services sédentaires par rapport
aux biens et services nomades, c’est-à-dire stimuler une amélioration du rapport qualité/prix de ces produits
(…). La Stratégie de Lisbonne (décidée en 2000) fut l’axe majeur de la politique économique de l’UE entre
2000 et 2010. L’objectif de cette stratégie était de faire de l’UE « l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde d’ici à 2010 (…) ». Cette politique consiste pour l’essentiel à
accroître les investissements en formation et en recherche, c’est-à-dire à améliorer le capital humain. Ce sont
incontestablement des chantiers essentiels. (…) Pour stimuler la croissance du secteur sédentaire, il s’agit
d’inciter les consommateurs du territoire à consommer plus de biens et services sédentaires susceptibles d’être
importés, à préférer les biens indéplaçables aux biens déplacés. (…) Les politiques d’amélioration de la qualité
passent par des actions multiformes (…). Un certain nombre de mesures réglementaires et fiscales pourrait y
contribuer. On pourrait par exemple supprimer la TVA sur les biens et services sédentaires et la reporter
entièrement sur les biens et services nomades, à conditions de s’assurer que les secteurs sédentaires concernés
soient concurrentiels et répercutent les baisses de taxes en baisses de prix. (…) Reste évidemment, si on ne
parvient pas à bonne fin grâce aux deux voies précédentes, la solution des transferts purs. Elle consiste à taxer
les gagnants de la mondialisation pour opérer des transferts vers les perdants, soit sous forme monétaire, soit
plus intelligemment sous forme de biens publics, en particulier de formation. Cette politique a cependant
l’inconvénient de rendre le territoire moins attractif pour les nomades « égoistes » et donc d’en inciter
quelques-uns à choisir un autre territoire, moins soucieux de réduction des inégalités.
Source : P.N.Giraud, « La mondialisation. Emergence et fragmentations », Coll.Sciences Humains, 2012, p.110
Document 8 : la faiblesse des marges des entreprises françaises
La compétitivité hors-prix se construit aussi grâce à l’innovation. Les enquêtes COE-Rexecode réalisées auprès
des consommateurs européens et citées par Fontagné et Gaulier (2009) montrent ainsi que bien que la notoriété
des entreprises françaises soit appréciée, les produits français sont très nettement surpassés par les produits
allemands auprès des consommateurs en ce qui concerne l’innovation technologique.
La capacité d’investissement des entreprises est toutefois fortement conditionnée par leurs marges. C’est en
dégageant des marges suffisantes que les entreprises disposent de la trésorerie nécessaire pour réaliser ces
investissements ou lever des fonds pour les y aider. Et les marges des entreprises dépendent, à prix de vente
donné, de leur compétitivité-coût. Compétitivité hors-prix et compétitivité-coût sont dont intimement liées.

Une étude récente de l’Insee suggère que sur les quinze dernières années, le taux d’investissement en France est
plutôt plus élevé que chez nos voisins européens dès lors que l’on tient compte des cycles économiques. Malgré
une contraction de leurs marges, les entreprises françaises auraient en effet continué à investir en raison d’une
baisse du coût d’accès au capital. En revanche, les investissements réalisés sont plus des investissements de
remplacement du capital existant que des investissements dans de nouveaux produits ; ils contribuent donc
moins à l’amélioration de la compétitivité hors-prix de nos entreprises.
Source : Florian Mayneris « Coût et qualité. Le problème de la « compétitivité » de l’économie française,
www.laviedesidées.fr; 6 mai 2014
Document 9 : les économies qui arrivent à la frontière de production ne peuvent plus être compétitives
par l’imitation des technologies les plus avancées
Pendant la période faste des Trente Glorieuses (…) la croissance des pays européens a reposé essentiellement
sur le « rattrapage », c’est-à-dire sur la reconstitution du stock de capital et sur l’imitation technologique.
L’organisation économique était dominée par les activités des grandes entreprises, soit publiques, soit
fortement subventionnées par l’Etat, avec relativement peu d’ouverture au commerce extérieur, peu de
concurrence sur les marchés de biens et services, et peu de flexibilité sur le marché de l’emploi. Dans ce
contexte, pour assurer le plein emploi et le bien-être social, l’Etat disposait de trois leviers d’intervention. En
premier lieu, un secteur public étendu donnait à l’Etat la possibilité d’orienter la politique industrielle. Ensuite,
les politiques « keynésiennes » lui permettaient de gérer le cycle macroéconomique ; dans le cadre d’une
économie relativement fermée, on pouvait en effet impulser l’activité économique en augmentant la dépense
publique, sans craindre que cela ne profite à un pays voisin. Enfin, l’Etat-providence permettait à l’Etat de
régler les problèmes sociaux résiduels à coups de subventions et de revenus de substitution, (protection sociale,
allocations familiales …).
Depuis les années 1980, ce modèle a cessé de fonctionner. Nous sommes entrés dans une ère où la croissance
des pays développés est tirée non plus par l’imitation technologique mais par l’innovation. En effet, la
mondialisation nous met directement en concurrence avec d’autres pays « imitateurs », mais qui disposent
d’une main d’œuvre moins coûteuse ; la seule façon de survivre à cette concurrence est d’être parmi ceux qui
inventent les nouveaux procédés ou produits, autrement dit qui innovent à la frontière technologique.
Dans une économie désormais ouverte et tournée vers l’innovation, de nouvelles entreprises et de nouveaux
emplois sont créés en permanence, tandis que d’autres sont détruits ; d’où l’importance, pour l’Etat, non pas
tant de contrôler directement les entreprises, mais de les réguler. De même, dans une économie mondialisée, la
gestion macroéconomique par la demande perd de son efficacité, car relancer la dépense publique peut se
traduire par un creusement du déficit commercial, et non par une reprise de l’activité. La France en a fait l’amer
expérience entre 1981 et 1983, lorsque la relance de la consommation a profité essentiellement à nos
partenaires, en stimulant davantage les importations que la production nationale. Enfin, l’ Etat providence
théorisé par Beveridge dans les années 1940 est entré en crise : il ne s’agi plus seulement maintenant de
protéger, mais d’accompagner les individus dans un parcours professionnel plus mobile que par le passé, où
l’on change plus fréquemment d’emploi ou de métier.
Ce modèle « keynésien » ayant vécu, il est nécessaire de relever, avec d’autres outils, d’autres perspectives, les
défis imposés par la mondialisation des échanges et le passage à une économie de l’innovation. Dès lors, deux
choix sont possibles : soit, comme le proposent les néolibéraux, réduire le rôle de l’Etat ; soit, renforcer les
prérogatives de l’Etat en redéfinissant son rôle. C’est cette dernière approche que nous défendons.
Source : P.Aghion et A.Roulet « Repenser l’Etat. Pour une social-démocratie de l’innovation », La république
des idées, 2011, p. 9
Document 10 : le rôle de la concurrence et de l’ouverture des marchés dans l’innovation
Des travaux récents le montrent : les leviers d’une croissance basée sur l’innovation sont différents de ceux
d’une croissance fondée sur l’imitation ou le rattrapage technologique.
Tout d’abord, l’innovation de pointe (ou d’innovation à « la frontière technologique ») a besoin d’un marché
des biens concurrentiels, et cela pour deux raisons essentielles :
- d’une part, parce que davantage de concurrence incite à l’innovation pour justement échapper à la
concurrence et réaliser des profits de monopole (au moins temporairement, jusqu’à ce que l’innovation
soit rendue obsolète par de nouvelles innovations) ;
- d’autre parce, parce que les nouvelles idées sont souvent introduites par de nouveaux entrants sur le
marché des biens, tandis que les firmes en place tendent à perfectionner les produits ou les technologies
qu’elles ont inventé dans le passée. Ainsi, ce ne sont pas les grands producteurs d’avions à hélices qui
ont introduit les avions à réaction, tout comme ce n’est pas IBM qui a le premier introduit les

ordinateurs portables. Et, de fait, les travaux empiriques montrent que plus la croissance d’une
économie repose sur l’innovation « frontière », plus cette croissance est stimulée par davantage de
concurrence et de mobilité sur le marché des biens.
Le graphique suivant montre bien qu’une augmentation du niveau de la concurrence (ici, cela correspond à un
taux d’entrée plus élevé des firmes étrangères) a un impact positif sur la croissance de la productivité
(autrement dit sur l’innovation) pour les firmes qui sont proches de la frontière technologique.
A l’inverse, cette même augmentation du niveau de concurrence a un effet négatif sur la croissance de la
productivité pour les firmes qui sont loin derrière la frontière technologique.
Dans le premier cas, plus de concurrence incite les firmes à innover davantage pour survivre, alors que dans le
second cas, cela a l’effet inverse pour les firmes qui sont loin de la frontière technologique/ ces dernières savent
qu’elles n’ont aucune chance face aux nouveaux entrants sur le marché des biens. Et plus l’économie est proche
de la frontière technologique, plus est composée de firmes innovantes plutôt que de firmes installées, et par
conséquent l’effet global de la concurrence sur l’innovation sera plus largement positif dans cette économie.
Source : P.Aghion, G.Cette et E.Cohen « Changer de modèle », O.Jacob, 2014, p.97
Document 11 : promouvoir les activités à forte valeur ajoutée et à fortes externalités
Les pays industrialisés n’ont plus d’industrie, ou presque ; l’industrie vend des services ; les services sont une
industrie ; les pays n’échangent plus seulement des biens entre eux, ce sont les entreprises multinationales qui
échangent des tâches entre leurs filiales localisées dans différentes régions du monde ; les formidables gains de
productivité dans les usines ont déplacé la valeur vers les bureaux d’études, vers les idées. Dans ces conditions,
quelle politique économique devrait-on envisager pour soutenir ce que l’on appelle encore l’industrie mais qui
relève en fait de l’agglomération dans des pôles de croissance d’activités à haute valeur ajoutée et fortes
externalités, déversant de hauts revenus sur l’ensemble de l’économie ? La richesse se crée aujourd’hui dans
des clusters de services et d’industries inscrits dans des chaînes de valeur globales. Il convient d’accepter cette
réalité nouvelle, et d’inscrire la politique industrielle dans une gouvernance traitant sereinement les questions
d’économie politique de l’intervention publique sur les entreprises.
Source : Lionel Fontagné et alii, rapport du CAE « Pas d’industrie, pas d’avenir ? » 13 juin 2014
Document 12
Quel que soit le périmètre donné à l’industrie et aux services, c’est surtout la capacité des nouvelles activités à
générer des revenus qui fait la différence. À partir de données de recensement sur 8 millions d’employés dans
320 zones d’emploi sur 30 ans, Moretti (2013) oppose les « brain hubs », agglomérations regroupant des
salariés très qualifiés à haut revenu entraînant chacun cinq emplois induits, aux anciennes capitales industrielles
perdant emplois et habitants. La différence entre les deux types de zones ne tient pas à une quelconque frontière
entre industrie et services, mais à une concentration des qualifications. Plus fondamentalement, la question
posée est celle du changement structurel : les économies de l’OCDE ont très largement basculé de l’agriculture
et l’industrie vers les services depuis l’après-guerre. La désindustrialisation – au sens statistique – n’est qu’un
aspect du processus de dématérialisation de la croissance de nos économies.
Source : Lionel Fontagné et alii, rapport du CAE « Pas d’industrie, pas d’avenir ? » 13 juin 2014
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%