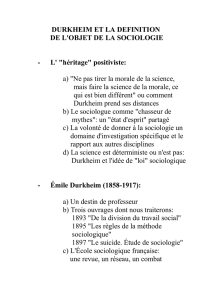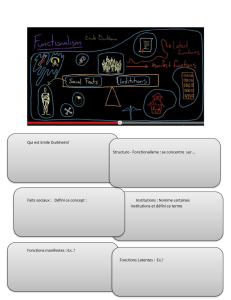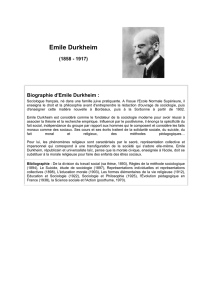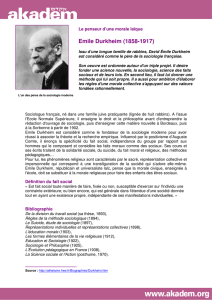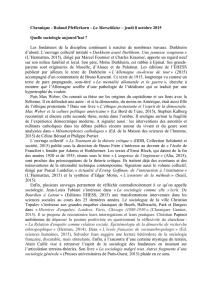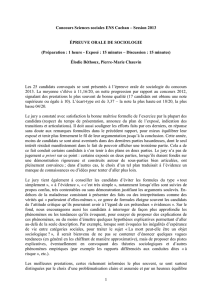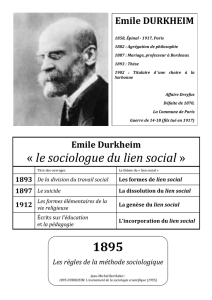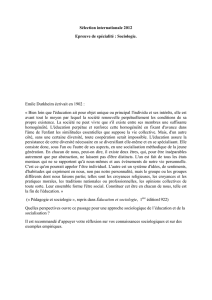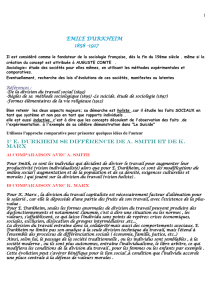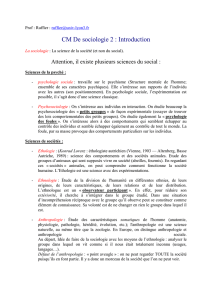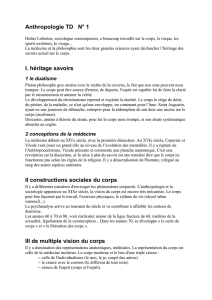Émile Durkheim.Clémentine - prepa-bl

Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique,
Presses universitaires de France, édition Quadrige, 1894
Fiche de lecture :
Préface de la première édition :
Une science des sociétés ne peut consister en « une simple paraphrase des préjugés
traditionnels », il faut qu'elle « fasse voir les choses autrement ». Ainsi il ne faut pas se
laisser intimider par les résultats des recherches (« Si chercher le paradoxe est d'un sophiste,
le fuir, quand il est imposé par les faits, est d'un esprit sans courage ou sans foi dans la
science »).
C'est aussi pourquoi, avant de juger les affirmations du sociologue, il faut être sûr de les avoir
bien comprises : si on dit que le crime est un fait normal dans la société (comme la douleur
peut l'être dans le corps humain), c'est bien à la condition de le haïr et de le réprimer.
Néanmoins il y joue un rôle (la douleur nous prévient d'une maladie par exemple, et quelqu'un
qui ne la connaîtrait pas ne serait pas humain !).
Préface de la seconde édition : Les formules développées dans cet ouvrage sont destinées à
évoluer et à être retravaillées avec la pratique de la sociologie.
Chapitre I : QU'EST-CE QU'UN FAIT SOCIAL ?
Il y a des faits sociaux : le rôle de père, d'époux, le système de monnaies par ex existaient
avant que je ne sois né, et continueront d'exister après ma mort. De plus ils sont doués d'une
force de coercition, qui ne se ressent peut-être pas quand je m'y conforme mais qui s'affirme
(sous différentes nuances) dès que j'essaie de m'y opposer.
Faits sociaux : → « manières d'agir, de penser et de sentir, qui sont extérieures à
l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s'imposent
à lui ».1Cette définition ne vise pas à donner une philosophie du fait social mais un critère (la
contrainte) par lequel on puisse le reconnaître, ce n'est donc pas forcément la seule possible.
Cette contrainte est le plus souvent intériorisée par l'individu.
→ une deuxième définition : des faits généraux (=répandus) qui ont une existence propre
indépendante de ses manifestations individuelles, d'où l'utilisation des statistiques afin de
pouvoir « observer à l'état de pureté » les faits sociaux, car ils expriment « un certain état de
l'âme collective ». Mais attention, si le fait social est général c'est parce qu'il est collectif (ie
plus ou moins obligatoire), et non l'inverse.
Chapitre II : REGLES RELATIVES A L'OBSERVATION DES FAITS SOCIAUX
Règle fondamentale : considérer les faits sociaux comme des choses.2
I) Phase antérieure au développement de toute science : des concepts formés par la pratique et
pour elle (représentations non forcément justes mais qui permettent de penser la réalité) = des
prénotions, dont il faut se méfier.
Il faut partir d'observations empiriques pour ensuite peut-être trouver des lois, et non prendre
des idées pour l'objet de la science. La morale est elle aussi le simple développement d'une
idée initiale. Il en va de même pour l'économie politique : par ex la loi de Say n'a jamais été

établie inductivement. Il n'y a aucune loi de l'école classique qui puisse réellement être
qualifiée de « naturelle ».
Les faits sociaux doivent être traités comme des choses parce qu'ils sont des données
directement accessibles, contrairement aux idées. Cette réforme dans la sociologie est
comparable à celle qui s'est opérée en psychologie (considérer les états de conscience de
l'extérieur et non du point de vue de la conscience de l'individu analysé).
II) Il faut mettre en place une rigoureuse discipline méthodologique :
1° Écarter systématiquement toutes les prénotions, la difficulté majeure étant que parfois nous
y sommes attachés (croyances politiques, religieuses...).
2° Définir de façon objective l'objet de la recherche, c'est-à-dire en fonction de propriétés qui
sont inhérentes aux phénomènes étudiés. Pour cela il faut utiliser les caractères
extérieurement visibles et la définition doit comprendre tous les phénomènes répondant à ces
critères (et non par exemple effectuer un tri : celui-ci ne serait fondé que sur une idée
préconçue). Le concept vulgaire de l'objet peut servir d'indicateur à la définition sociologique
mais il peut arriver qu'il ne soit pas identique à celle-ci. C'est ainsi que les sauvages ne sont
pas dépourvus de morale, car le signe extérieur de la morale est « une sanction répressive
diffuse » (et il ne faut fonder notre jugement sur la présence de notre morale dans leur
société).
3° Il faut utiliser des caractères extérieurs les plus objectifs possibles. Pour cela il faut trouver
un caractère présent dans les règles juridiques, morales, les dictons populaires etc.. qui
constituera un point de repère objectif.
Chapitre III : REGLES RELATIVES A LA DISTINCTION DU NORMAL ET DU
PATHOLOGIQUE
La science peut-elle permettre une telle distinction ? Une théorie répandue voudrait que la
science ne serve qu'à décrire et expliquer des faits, et à donner les moyens à la réalisation
d'une fin déterminée à l'avance (= la méthode idéologique). Néanmoins la mise en place de
ces moyens constitue déjà une fin en soi, ainsi cette théorie montrerait en fait que la science
ne sert strictement à rien.
I) Comparaison avec la maladie chez un organisme (étudiée par le biologiste) afin de trouver
le critère permettant de distinguer normal et pathologique (ou morbide), ie donc un critère de
la maladie :
Ce critère ne peut pas être la souffrance (pas forcément liée à la maladie), on ne peut pas non
plus dire que la santé est la parfaite adaptation à un milieu (quelle serait la parfaite ?→ il
manque un critère. Il est d'ailleurs possible qu'on ne l'ai pas sous les yeux.), ni que la maladie
est ce qui affecte nos chances de survie (la vieillesse est normale et a pourtant le même effet).
De plus ce dernier critère serait inapplicable, les comparaisons étant beaucoup plus difficiles
en sociologie qu'en biologie et l'établissement d'une moyenne de vie étant impossible
concernant les sociétés... Enfin cela ne mènerait qu'à considérer que tel phénomène pourrait
être mauvais pour la société → encore une fois on veut trop tôt chercher à définir la nature de
ces phénomènes.
=> critère de normalité : la généralité. Mais attention :
→ ce critère ne peut être propre qu'à une espèce sociale donnée
→ et ne peut être appliqué qu'à une phase propre du développement d'une société.

II) Chercher les causes de la normalité de fait (=généralité) d'un phénomène permet de l'ériger
en normalité de droit (= utilité à la société) [un état peut être normal de fait sans avoir
aucune utilité → n'est donc pas normal de droit], et de rendre la pratique plus facile (en
connaissant les causes on saura mieux, dans un cas particulier, distinguer le normal du
pathologique).
Lorsqu'une société est dans une période de transition il s'avère nécessaire de procéder ainsi car
un fait autrefois normal de droit peut ne subsister que par « la force aveugle de l'habitude ».
Attention néanmoins, il ne faut substituer cette méthode à la précédente ni l'employer en
premier (tout ce qui est utile n'est pas forcément normal : ex il n'est pas normal de prendre des
médicaments).
III) Il faut appliquer cette procédure car cela nous permet d'éviter des erreurs et d'apporter un
autre éclairage sur les faits observés. Illustration du crime : normal (plusieurs arguments sont
avancés, cf notamment la critique externe qui en reprend un) et utile à une société (parfois
précurseur d'un changement dans la morale, par exemple).
De plus ce critère ne peut être écarté car si l'on ne considérait pas comme normal ce qui est
général cela signifierait qu'on appliquerait des critères subjectifs à ce que l'on considère
normal.
Chapitre IV : REGLES RELATIVES A LA CONSTITUTION DES TYPES SOCIAUX
cf Chap III, I) : il faut donc constituer ces espèces sociales et en faire une classification.
Espèce sociale : notion qui permet un moyen terme entre le « nominalisme des historien » (il
n'y a que des sociétés hétérogènes sans aucun rapport entre elles) et le « réalisme extrême des
philosophes » (une nature humaine).
I) Pour cela il ne faut surtout pas étudier chaque civilisation → l'objectif de la classification
est de gagner du temps (de plus il n'est pas certain qu'on puisse finalement aboutir à un
résultat par cette méthode). La solution : chaque société est formée de parties qui sont des
sociétés plus simples qu'elle, issues du passé → il faut donc trouver la société la plus simple
qui ait jamais existé.
II) Société simple = avec une absence complète de parties → idéal type : la horde, qui se
retrouve à l'état de clans dans des sociétés un peu moins simple, l'existence de clans nous
autorisant à supposer qu'il y a d'abord eu des sociétés plus simples. On met ensuite en place
une classification de sociétés de plus en plus complexes (ce ne sont ici que des pistes qui
devront être exploitées).
III) On peut parler d'espèces sociales pour la même raison qu'il y a des espèces en biologie, la
seule différence étant qu'il n'y a pas de continuité entre les différentes générations de sociétés.
Chapitre V : REGLES RELATIVES A L'EXPLICATION DES FAITS SOCIAUX
I) La sociologie ne consiste pas uniquement à expliquer le rôle des phénomènes étudiés, mais
aussi à expliquer comment ils sont nés et ce qu'ils sont 3. En effet l'utilité d'un phénomène
n'explique pas son existence : un fait peut exister sans être utile ou peut changer de fonction.
De plus expliquer le fait par la finalité c'est donner une certaine contingence à l'existence de
ce fait, or lorsque l'on pratique l'analyse sociologique on s'aperçoit que les faits sociaux (qui
parfois ne semblent avoir de but précis) se produisent avec une certaine régularité dans de
mêmes circonstances.

Il faut donc rechercher la cause, et cela d'ailleurs avant de chercher à déterminer les effets car
ceux-ci seront plus facile à trouver après. Néanmoins il faut quand même chercher les effets
afin de savoir si le fait social étudié est nuisible à la société.
II) La méthode pour étudier les faits sociaux ne doit pas être psychologique (analyse des
consciences individuelles) car cela reviendrait à dénaturer les faits sociaux, qui ne peuvent
résulter d'une simple addition des comportements individuels puisqu'ils exercent sur ces
derniers une force coercitive. Dire que la société n'est que la somme des individus reviendrait
(par analogie) à dire que les phénomènes biologiques s'expliquent par les phénomènes
inorganiques ! → « un tout n'est pas identique à la somme de ses parties ». Par
l'association, les consciences individuelles constituent une individualité psychique d'un genre
nouveau (d'où la notion de « conscience collective »).
→ deux règles : 1) La cause déterminante d'un fait social doit être cherchée parmi les faits
sociaux antécédents, et non parmi les états de la conscience individuelle. 2) La fonction d'un
fait social doit toujours être recherchée dans le rapport qu'il soutient avec quelque fin
sociale.
III) L'origine première de tout processus social de quelque importance doit être recherchée
dans la constitution du milieu social interne (= l'ensemble formé de la réunion des faits
sociaux), et non par ce qui peut être externe à la société étudiée.
Les éléments du milieu social interne = les personnes et les choses (objets, mais aussi mœurs,
monuments littéraires ou artistiques...). Ces dernières ne peuvent donner l'impulsion aux
transformations sociales (néanmoins elles pèsent sur la vitesse et la direction de celles-ci), le
facteur actif est donc le milieu humain et c'est surtout sur celui-ci que doivent se concentrer
les recherches des sociologues. → deux paramètres agissent : le nombre de unités sociales (=
« volume de la société ») et le degré de concentration de la masse (= « densité dynamique »),
ie le nombre des individus qui sont en relation morale (vivent une vie commune). Tout
accroissement dans le volume et dans la densité dynamique des sociétés → vie sociale plus
intense → modification des conditions fondamentales de l'existence collective.
En considérant le milieu social comme facteur déterminant de l'évolution collective on rend
possible la causalité : sinon il faudrait considérer que l'évolution vient du passé. Or il n'y a pas
de causalité en histoire.
IV) Ces règles donnent une certaine conception de la vie collective, qui ne ressort ni du
contractualisme (la société est créée par un lien artificiel) ni de la théorie du droit naturel (la
vie en société est spontanée de par la nature même de l'être humain) : la société est bien due à
ce qu'une force domine les individus, mais de façon naturelle.
Chapitre VI: REGLES RELATIVES A L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Seule la méthode comparative (ou « expérimentation indirecte ») peut être utilisée en
sociologie4. → il nous faut donc postuler : A un même effet correspond toujours une même
cause. (ie l'existence de la relation de causalité).
Et dans la méthode comparative, seule celle des variations concomitantes convient, mais il
faut interpréter les résultats obtenus et les vérifier à l'aide de comparaisons nouvelles. Si l'on
s'aperçoit que ces faits n'ont en fait aucun lien direct alors il faut chercher un troisième
phénomène.

Cette méthode est l'instrument par excellence des recherches sociologiques, car elle seule
n'implique pas qu'il faille dresser un inventaire complet des phénomènes : quelques faits
suffisent. Néanmoins pour être rigoureux il faut comparer non des variations isolées mais des
séries de variations, qui peuvent comprendre des faits provenant :
- d'une seule société, ce qui suffit lorsque les faits étudiés sont d'une grande généralité et que
nous disposons d'informations statistiques assez étendues et variées
- de plusieurs sociétés de même espèce lorsqu'il s'agit d'une institution, d'une règle juridique
ou morale... Ne s'applique qu'aux phénomènes qui ont pris naissance pendant la vie des
peuples comparés, or ils sont beaucoup moins nombreux que les phénomènes transmis.
- de plusieurs espèces sociales distinctes : On ne peut expliquer un fait social de quelque
complexité qu'à condition d'en suivre le développement intégral à travers toutes les espèces
sociales. Mais pour faire des comparaisons il suffit de considérer le fait social dans plusieurs
espèces sociales au même stade.
Conclusion : Cette méthode est :
- indépendante de toute philosophie, même si à mesure de son développement elle fournira
des matériaux à la réflexion philosophique. Elle sera tout aussi indépendante des doctrines
individualiste, communiste ou socialiste « auxquelles elle ne saurait reconnaître de valeur
scientifique, puisqu'elles tendent directement, non à exprimer les faits, mais à les réformer ».
En revanche elle fournit une attitude de réflexion (respectueuse mais non fétichiste) sur les
institutions.
- objective (les faits sociaux s'imposent à nous par la contrainte).
- exclusivement sociologique : il est possible de traiter les faits sociaux scientifiquement sans
les dénaturer, et un fait social ne peut être expliqué que par un autre fait social, ce qui est
possible en considérant le milieu social interne comme le moteur principal de l'évolution
collective.
Critique interne :
Il nous faut tout d'abord souligner la rigueur avec laquelle l'auteur de cet ouvrage majeur s'est
appliqué, tout le long de son ouvrage, à exposer sa thèse. En effet il met systématiquement en
place un raisonnement logique qui s'appuie sur des démonstrations, illustrées d'exemples.
Souvent il apporte même plusieurs preuves à une affirmation. Le contenu est donc solide, et il
est important de le souligner afin de rendre un juste hommage à cet ouvrage, qui s'impose
aujourd'hui comme l'un des grands textes fondateurs de la sociologie.
Émile Durkheim applique donc systématiquement sa méthode sur les exemples. Néanmoins
une de ses illustrations (p.107, chap.V, II) s'avère être tout à fait erronée : en effet il s'appuie
sur une notion qui n'a jamais été réellement scientifique, celle de race. Il pêche par cela même
qu'il critique5, puisqu'il a pris une conception répandue de l'humanité mais non
scientifiquement prouvée. En effet si des différences organiques et psychiques peuvent exister
entre les différents membres de l'espèce humaine, elles ne recoupent absolument pas celles de
« race », distinction que Durkheim utilise comme si elle constituait un acquis de la recherche
scientifique, ce qui constitue bien son erreur puisque, pour une fois, il oublie de revenir sur la
façon dont a été établie cette distinction.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%