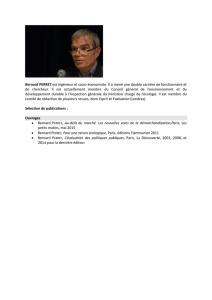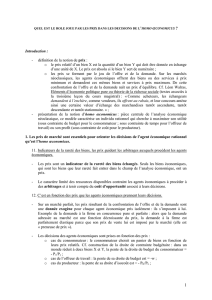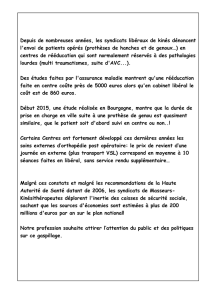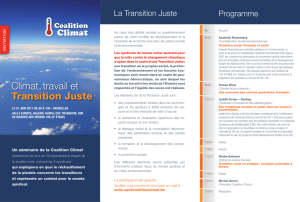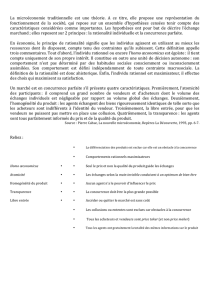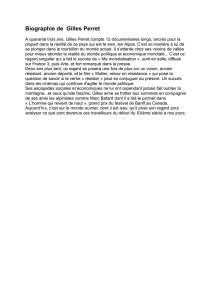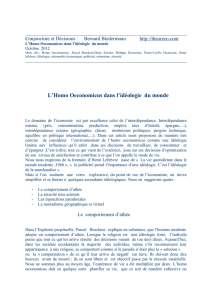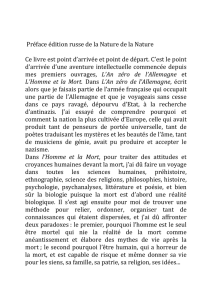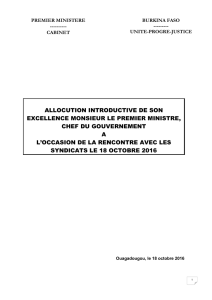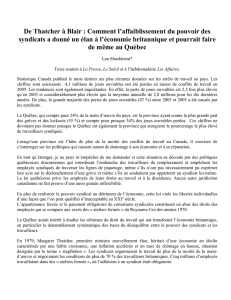la diversité sociologique de l`Europe

Conférence Europe Citoyenne avec Bernard PERRET (sociologue-économiste) 23.05.06
Pour la diversité sociologique de l’Europe :
Comment valoriser le capital social collectif au sein de la construction de l’Europe ?
Publications :
- l’avenir du travail (1998)
- l’évaluation des politiques publiques (2001)
- de la société comme monde commun (2003)
- les nouvelles frontières de l’argent (une réflexion sur la monétarisation de la vie
sociale)
Présentation :
Pour moi B. Perret est un des penseurs qui essayent de rebrancher l’économie sur la société et
son apport particulier dans ce travail est d’insister sur les transformations du travail, de
l’économie et du microsocial. A partir de ses analyses, tentez il tente de développer une
nouvelle théorie de l’action et n’hésite pas à fustiger la contre-productivité du système des
privilèges dans la société française.
B. Perret rejette la « société du marché » en citant Rousseau : « On a tout avec l’argent hormis
des mœurs et des citoyens. »
L’Europe commet cette même faute en essayant de construire un ensemble sur la seule base
économique. Le facteur humain est terriblement sous-évalué dans la construction européenne.
Tous les secteurs qui sont originairement du ressort de l’humain sont délégués aux Etats
membres et l’Europe s’y intéresse seulement marginalement.
D’où le titre de cette intervention : Comment valoriser le capital social collectif au sein de la
construction de l’Europe ?
Pourquoi parler de capital social dans le contexte de l’Europe ? Parce que nous croyons que la
diversité sociologique en Europe est souvent sous-estimée comme facteur de richesse de ce
continent. Diversité qui se décline par les différents systèmes d’éducation et de formation,
d’organisation du travail, de management, mais se traduit également par des attitudes très
divergentes à l’égard de questions plus existentielles comme la bioéthique, l’euthanasie,
l’immigration etc.
Tout cela est traité par l’Europe du point de vue d’un « think tank » qui émet des
recommandations générales et propose l’échange des meilleures pratiques sans proposer une
propre politique sociale à propos de l’évolution de nos sociétés nationales
C’est pourquoi nous avons demandé à B. Perret de nous apporter des précisions dans trois
domaines :
1. Quelles sont les principales mutations du travail par rapport aux changements du
contexte économique ? (tertiairisation, ressources identitaires, échanges non-
monétaires)
2. Comment pouvons-nous préserver les richesses (psycho-/éthno-) sociologiques du
monde du travail pour faire société en Europe et ne pas dégrader les ressources
culturelles de notre développement économique ?
3. Comment arbitrer entre la diversité de faire société et la convergence en matière
économique en Europe pour rapprocher la politique économique de la politique
sociale ?

Bernard Perret :
Ma contribution la plus utile pourrait être l’introduction d’un certain nombre de notions pour
débattre des rapports économie et société de façon un peu plus rigoureuse. Parce que entre le
social et l’économique c’est toujours ce dernier qui est dominant. Dans nos propres
comportements nous sommes d’abord des homo oeconomicus et le social est confiné à des
réactions de contestation qui s’opposent à cette logique dominatrice.
La notion de « capital social » est intéressante, parce qu’elle permet de donner une certaine
force, une certaine existence à un point de vue qui ne soit pas un point de vue économique sur
l’évolution de la société et de reprendre pas ce biais les différentes questions dont la question
des mutations du travail, de l’emploi, de la monétarisation des échanges socials etc..
La notion du « capital social » a été inventée parallèlement par un sociologue français,
Bourdieu, et un sociologue américain ? Coleman. Pour ces deux sociologues le « capital
social » était un bien personnel, à savoir un accès à des réseaux, un accès à des ressources
culturelles – un peu comme le capital humain, la formation etc. – et c’est avant tout pour les
individus un moyen de dominer, d’accéder aux richesses économiques, d’améliorer leur
position dans la société. La meilleure illustration en France sont les Grandes Ecoles avec les
clubs des anciens qui permettent d’accéder à des réseaux, au pouvoir et aux ressources
économiques.
En 1995, un sociologue américain, Robert Putnam, a écrit un article sur l’évolution du capital
social aux Etats-Unis et l’a caractérisé comme « bien collectif ». Il définit le capital social
comme la densité et la productivité des liens sociaux au niveau de l’ensemble d’une société.
La définition de Putnam du capital social fait référence à :
- la caractéristique de l’organisation sociale tels que les réseaux, les normes et la
confiance sociale
- il facilité la coordination et la coopération en vue d’un bénéfice mutuel.
Il définit pour la première fois le capital social comme une richesse collective, comme l’état
de santé d’une collectivité qui vont avoir des effets économiques aussi bien en terme
d’égalité, de bien-être social, que d’éducation etc.
Mais Putnam ne s’est pas arrêté là, et il a fait une recherche à partir d’une accumulation
d’indicateurs statistique :
- sur les réseaux sociaux
- sur les rapports de confiance entre les individus
- sur l’adhésion aux normes, aux valeurs morales
- sur l’adhésion aux normes d’honnêteté, de coopération etc.
Et il en a déduit que le capital social aux Etats-Unis a augmenté jusqu’en 1965 et a ensuite
connu un déclin qui s’est accéléré dans les années 90. Ce fut un choc de découvrir cet
appauvrissement qui accompagne l’augmentation du PIB moyen par tête, d’où le titre du
livre : « Bowling alone ». Pour symboliser ce comportement de plus en plus individualiste des
américains : adhérent moins aux syndicats, participant moins à la vie locale, aux associations,
se méfiant davantage de leur concitoyens etc.

Un deuxième aspect important du travail de Putnam est d’avoir trouvé une forte corrélation
entre le capital social et d’autres indicateurs du bien-être social : la santé, l’éducation, le faible
taux de criminalité, le bien-être des enfants etc.
D’où donc un constat assez alarmant : une richesse sociale expliquant le développement
économique et le bien-être se trouvant menacé simultanément. Putnam a mis en évidence des
facteurs de cette dégradation qui sont liés à l’évolution du contexte économique, comme :
- l’accroissement de la mobilité professionnelle et géographique (moins d’engagement)
- l’augmentation de la durée du travail annuelle
- la bi-activité dans les ménages (qui nuit à l’éducation des enfants…)
- le mode de résidence, la rurbanisation (urban strawls) (isolation !)
- le changement dans les loisirs, plus individualistes (télé, jeux vidéos etc)
On a tenté de mesurer la même chose en Europe avec un constat moins clair, plus mitigé,
essentiellement dû à la sortie du totalitarisme, mais en gros on retrouve les mêmes tendances.
Ce qui paraît le plus frappant dans toutes ces comparaisons internationales, c’est la « dés-
institutionnalisation du lien social ». C’est-à-dire le déclin des structures sociales comme la
Croix Rouge ou les syndicats des parents d’élèves qui font un maillage entre le niveau micro-
social (localité où les gens se connaissent) et qui en même temps sont reliés à des grandes
structures et à des institutions de la société. Putnam montre très bien que c’est cela, le cœur du
capital social.
Cette approche nécessite une réflexion sur les bons et les mauvais réseaux avec ceux qui sont
refermés sur eux-mêmes comme les réseaux mafieux qui sont reliés négativement aux
institutions et à l’ensemble de la société.
Il y a tout de même des problèmes de comparabilité des études internationales dus aux formes
de mise en réseau des individus et on ne sait pas très bien quoi faire de la sociabilité
informelle. Par exemple, en France, les gens ont l’habitude lorsqu’ils veulent participer à la
vie politique, de descendre dans la rue plutôt que d’adhérer à un parti politique, un syndicat
ou à une association.
Néanmoins cet outil pose très bien la question de la reproduction de la vie sociale. On se place
un peu sur le même terrain que les économistes en terme de développement, de reproduction
etc., on met en exergue que l’accumulation, la reproduction de la société ne peuvent pas être
un phénomène purement économique. Il faut que le développement social ait ses propres
mécanismes et il se peut même que le développement économique soit menacé si l’économie
détruit le capital social.
Cette tendance auto-destructrice du capital social engendré par médiation du développement
du capitalisme est au centre de mes travaux sur le travail. Nous vivons actuellement une crise
du monde du travail dans la mesure où les formes de socialisation qui existaient à l’ère
industrielle dans les grandes entreprises fordistes avec des grands collectifs du travail, avec
une massification du travail, une forte structuration idéologique et solidariste par les
syndicats, une culture ouvrière très intégratrice, y compris la nature conflictuelle entre la
capital et le travail….
Tous ces éléments là avaient pour effet de favoriser une dynamique assez vertueuse – au
moins à moyen terme – entre l’économique et le social, parce que le développement
économique sécrétait en quelques sortes des formes d’organisations collectives qui étaient
structurantes pour la société.

Or, derrière tout cela il y a bien entendu les grands thèmes de notre époque ; la
mondialisation, les inégalités, la précarité. Mais pour moi ce qui est le plus important dans les
mutations du monde du travail, c’est le destin du capital social, c’est-à-dire comment les
nouvelles formes d’organisations du travail produisent de l’individualisme, de l’isolement, du
chacun pour soi : parce que dans une société de services, on a des collectifs de travail plus
éclatés, la relation salarié-employeur est plus individualisée et on a une organisation qui met
davantage en exergue les différences individuelles, l’accomplissement et la valorisation
personnelle, plus qu’une culture du métier, une culture collective acquise dans le travail etc.
Je vais très vite sur une multitude de changement, mais cet éclatement du travail est une
réalité qui évolue dans des directions extrêmement variées avec d’un côté des emplois hyper-
qualifiés dans l’économie du savoir, du soin, de la santé qui valorisent les relations sociales et
le rapport humain etc. et de l’autre côté on a aussi pas mal d’activités qui se développent en
direction du travail peu qualifié comme le commerce, la maintenance, le nettoyage etc..
L’idée générale est que la société de services favorise plutôt l’éclatement des mondes sociaux
du travail et que le travail pour chacun de nous devient plutôt un terrain d’individualisation,
d’accomplissement personnel, plutôt qu’un terrain de création d’un collectif cohérent. Le
déclin des syndicats est la conséquence pour une bonne part de ce fait. Un travailleur un peu
rationnel aujourd’hui a conscience que les syndicats ont peu d’importance contrairement à sa
relation personnelle à son patron pour pouvoir s’accomplir etc.
Q. Cependant, dans la société de services on penserait qu’il faut davantage de
compétences collectives qui vont à l’encontre de l’isolement du travailleur ?
BP : En effet, c’est un paradoxe, cette nouvelle économie pour une bonne partie, requiert de
bonnes capacités communicatives et utilise le capital social individuel. Mais ce capital social
individuel ne peut plus être reproduit par cette économie, il n’y a plus de mécanisme de
reproduction inhérent au monde du travail. C’est-à-dire le capital social que l’on utilise dans
le travail a été acquis par la famille, l’éducation, les réseaux de proximité. L’économie est
devenue prédatrice du capital social qu’elle utilise, mais son fonctionnement n’est pas
favorable à sa reproduction.
Bien entendu, les gens les plus favorisés développent des contre-stratégies en envoyant leurs
enfants dans les Grandes écoles, dans des activités extra-scolaires ou leur paient un coach. Et
on voit dans d’autres milieux sociaux le repli sur soi, le repli sur du mauvais capital social
(par exemple les gangs de quartier) qui se renferme sur lui-même et se coupe de l’ensemble
de la société.
Q. Est-ce que cela veut dire que l’homo œconomicus aurait gagné en nous ?
BP : Je jugerais les choses en tant que sociologue. Ce n’est pas en soi un tort d’avoir
privilégié la perspective de l’homo œconomicus, car nous sommes toujours très ambivalents,
à la fois rationnels et en même temps affectifs, aspirant à de grandes choses etc. C’est le
propre de l’homme. Ce qui a changé structurellement l’organisation sociale et l’évolution
économique font que c’est l’homo œconomicus qui peut s’exprimer le plus librement, qui
incite à s’exprimer et à faire valoir sa logique. Et cela correspond à nos objectifs, nos désirs
qui nécessitent de l’argent.
Tout cela me fait dire qu’une stratégie de résistance au capitalisme doit aujourd’hui être
multidimensionnelle : en demandant davantage d’Etat, d’augmentation des salaires, plus de

formation etc., bref toutes les revendications classiques de la Gauche on ne touche pas le cœur
du problème. Le fond de la question ne peut être qu’une résistance à la logique de
marchandisation qui remettrait en question la satisfaction de l’homo œconomicus. Et cette
résistance est extrêmement complexe : elle passe par la culture, par la vie associative,
l’organisation de l’habitat etc. et elle ne peut pas se limiter aux luttes des altermondialistes ou
contre la financiarisation.
Idée ME : Parfois je pense que les gens qui pratiquent à titre personnel le « downsizing »
écologique (et ainsi dans la décroissance éco) sont davantage dans la résistance que les
socialistes qui veulent relancer la croissance pour créer des emplois. D’ailleurs, à ce titre je
n’ai jamais compris le soutien, le consensus national de la France en matière de stratégie
nucléaire.
Q. Comment la personne peut-elle se construire aujourd’hui dans le travail ? Y-a-t-il des
nations qui procurent à leurs citoyens des conditions de travail plus favorables pour se
construire en tant que personne ?
BP : Paradoxalement, pour ceux qui ont toujours un travail, le travail demeure un lieu
extrêmement important pour construire sa socialisation et son autoréalisation. En revanche, il
y a une fonction qui est moins bien remplie, c’est cette fonction de solidarité, de collectifs qui
construit la société aussi bien du point de vue micro-socialet macro-social. C’est cela
qu’apporte la notion du capital social. Elle attire l’attention sur le lien, la cohérence entre le
micro-social et macro-social. C’est cela qui pose problème aujourd’hui pour construire une
société civile active.
Je pense que les sociales démocraties du nord restent quand même très résistantes dans la
mesure où les syndicats restés assez fort parviennent à contrôler le processus de
développement d’un certain nombre de stratégies compensatrices (p.ex la flex-sécurité
danoise qui maintient l’individu dans un statut par-delà une forte mobilité professionnelle).
Je crois que l’on ne peut pas substituer le rôle des syndicats comme médiateur par de
nouvelles institutions de la société civile. Mais les syndicats français n’ont pas de culture de
négociation, ni de compromis et de stratégie à long terme et s’excluent ainsi de plus en plus
du jeu de ce nouveau modèle économique.
En France, l’Etat joue un rôle important pour la construction du capital social : d’abord par un
secteur public très important, très protecteur pour les individus : l’Etat providence, la sécurité
sociale entièrement gérée par lui. Mais en France, l’Etat a joué quelque part un rôle un peu
pervers, car il s’est substitué aux partenaires sociaux, à la société civile, aux familles pour
jouer le rôle des corps intermédiaires.
Aujourd’hui il est en panne, pris en otage par les corporatismes qui jouent un rôle
extrêmement conservateur qui bloque sa modernisation etc., et ensuite l’Etat est devenu trop
gros dans la mondialisation et ainsi il manque d’argent pour jouer ce rôle de médiateur et en
même temps il continue à empêcher les corps intermédiaires de la société civile de jouer leur
rôle.
En France, on a cette exclusivité mondiale en un droit social codifié qui ne repose pas sur un
accord entre les partenaires sociaux qui est la source de légitimation principale et la seule
source d’autonomie pour la sphère sociale. Le contraste avec l’Allemagne est à ce point de
vue quand même très fort.
(Fin face une, le reste est une transcription à partir de mes notes)
 6
6
 7
7
1
/
7
100%