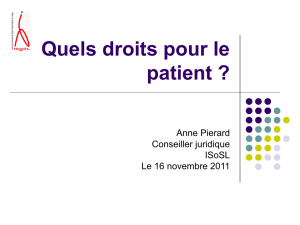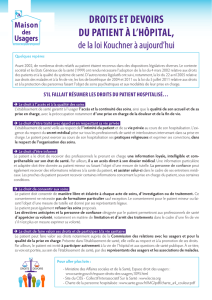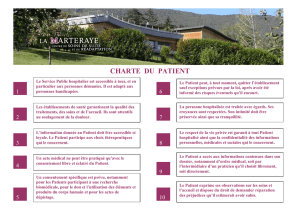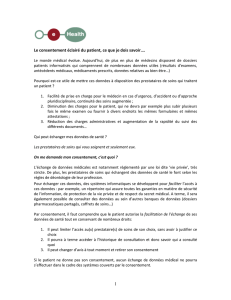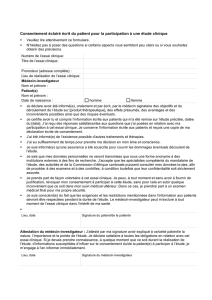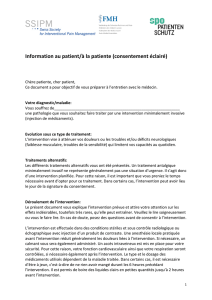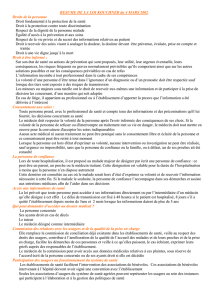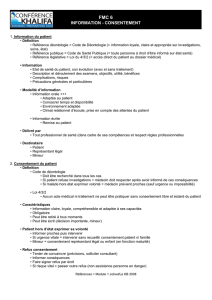LE REFUS DE SOINS

1
ABEILLE & ASSOCIES
AVOCATS
9, rue d’Arcole
13006 MARSEILLE
Tel : 04.91.37.61.44.
Fax : 04.91.37.14.89.
LE REFUS DE SOINS
Extrait de l’intervention de Me Sylvain PONTIER, le 8 avril 2004
L’information du patient et son consentement aux soins se trouvent au cœur de
l’évolution, ces dernières années, de la relation médicale vers une plus grande
autonomie de l’usager du système de santé.
La nécessité d’obtenir son consentement pour tout acte médical expose le médecin à
un refus.
Il parait évident, ne serait-ce qu’au nom de la liberté individuelle, que la volonté du
patient soit respectée.
Toutefois, lorsque la vie du patient est en danger, le droit du malade de s’opposer à un
traitement se heurte à l’obligation du médecin de sauver la vie.
La question du refus de soins ramène à la problématique récemment abordée par la
Jurisprudence Administrative Française à savoir s’il existe une priorité entre deux
obligations du médecin :
- la sauvegarde de la vie humaine et
- la nécessité du consentement aux soins.
Dans cette controverse, certains s’interrogent sur la place, au sein de ces
considérations, de la liberté thérapeutique des praticiens.
Cette problématique oppose deux principes d’application contradictoires dans la
pratique médicale :
- le principe de la bienfaisance qui gouverne l’action du praticien aux frontières
du paternalisme médical
- le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne par respect de son refus
de soins (et son pendant pénal par l’incrimination de la non assistance à
personne en péril), aux frontières de l’autonomie de la volonté.

2
On s’accorde à considérer, qu’il s’agisse du choix du mode de traitement ou de la
continuation d’un traitement face à la perspective du décès du patient (phase ultime de
la relation médecin-malade), que l’action thérapeutique ne doit, en aucun cas,
fonctionner pour elle-même sans considération de l’intérêt du seul et véritable
intéressé.
Comme on le verra, la jurisprudence récente est favorable aux patients victimes mais
porteuse d’une grande insécurité juridique pour le praticien.
Elle tend cependant à placer celui-ci dans les retranchements d’une médecine
défensive.
La question de savoir si le respect de la volonté du patient implique pour le médecin
l’obligation de laisser mourir celui qui refuse les soins, s’est posée de manière très
pratique et accrue dans le cas de refus de transfusion sanguine par conviction
religieuse de la part des patients « témoins de Jéhovah » hospitalisés dans des
établissements de santé publique.
I. L’ETAT DU DEBAT AVANT LA LOI DU 4 MARS 2002
Le respect de la volonté du patient s’explique juridiquement par l’application d’un
précepte parfaitement connu de tout médecin car figurant à la base du serment
d’Hippocrate : « primun non nocere » (article 40 du Code de Déontologie).
En effet, la pratique médicale doit avant tout veiller, à chaque instant, à ne pas nuire
aux patients.
Mais basé sur un adage simple, ce devoir a des contours diffus.
a) Des fondements textuels épars
Les sources textuelles du devoir d’humanisme des médecins qui indiquent que soit
respectée la volonté du patient sont multiples : déontologiques, légales (Code Civil,
Code de la Santé Publique) ou internationales.
Cette pléthore de textes ne permet pas une nécessaire lisibilité du droit français et reste
source d’insécurité juridique pour le corps de santé.
La question du refus de soins a récemment fait l’objet d’une traduction législative,
hélas pour trop générale, dans la loi du 4 mars 2002, que nous étudierons ci-après.

3
La loi du 9 juin 1999, insérée au Code de la Santé Publique dans son ancien article L
1111-2, et visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs a pour la première fois
posé explicitement le principe légal selon lequel « la personne malade peut s’opposer
à toute investigation thérapeutique » et ainsi consacré le droit de la personne malade
de refuser des soins médicaux à finalité thérapeutique.
Au niveau déontologique, l’article 36 alinéa 2 du Code de Déontologie Médicale (daté
de 1995) dispose que « lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse des
investigations et traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir
informé le malade de ses conséquences ».
Cette disposition est à mettre en parallèle avec l’article 47 du même code qui prescrit
une nécessaire continuité des soins.
La circulaire du 6 mai 1995 introduit la charte du malade hospitalisé selon laquelle
« tout patient, informé par un praticien des risques encourus, peut refuser un acte de
diagnostic ou un traitement, l’interrompre à tout moment à ses risques et périls ».
Le fondement textuel jusqu’alors employé était l’article 16-3 du Code Civil issu de la
loi biotique du 29 juillet 1984, modifié par la loi du 27 juillet 1999, et posant le
principe « qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de
nécessité médicale pour la personne » et que « le consentement de l’intéressé doit être
recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
Corollaire logique de cette recherche de consentement : le patient, capable et
conscient, doit pouvoir refuser de commencer ou de poursuivre le traitement ou
l’intervention conseillée par son médecin.
Les textes internationaux ratifiés par la France participent de cet élan de défense et de
promotion du respect de la dignité et de l’intégrité des patients.
Aux termes de l’article 3-1 de la déclaration sur la promotion des droits des patients en
Europe : « aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé et
préalable du patient ».
b) Une sanction d’origine jurisprudentielle
La première décision jurisprudentielle en matière de refus de soins est datée du 15
décembre 1859 (Tribunal Correctionnel de Lyon) ce qui fait de la solution actuelle une
réponse traditionnelle.

4
La Cour de Cassationjuge, dès 1942 que le non respect du consentement constitue à la
fois un manquement du médecin à ses devoirs et une atteinte grave aux droits du
malade.
Lorsque la volonté du malade va clairement contre ses intérêts vitaux, le médecin ne
doit pas prendre trop facilement acte du refus de ce dernier et doit maintenir une
relation permettant de faire évoluer sa position.
Cependant, si finalement rien n’y fait, le médecin doit s’incliner mais en aucun
cas ne dissimuler au patient un traitement.
On peut croire voir se dessiner le spectre du délit de non assistance à personne en péril,
mais cette incrimination ne s’entend pas dans le cadre du respect du refus de soins
éclairé du patient capable.
Il en est ainsi lorsque la thérapeutique adéquate n’a pu être appliquée « en raison du
refus obstiné et même agressif du malade » (Cour de Cassation Chambre Criminelle,
3 janvier 1973, Dalloz 1975 page 591 note LEVASSEUR).
Peu importe également que les motifs du refus soient médicaux, philosophiques ou
religieux (Cour de Cassation Chambre Criminelle, 30 octobre 1974, Dalloz 1975 page
178, note SAVATIER), le médecin doit s’incliner.
Le médecin n’encourt aucune sanction s’il prescrit, dans ce cas, un traitement palliatif
(Conseil d’Etat, 6 mars 1981, revue de Droit Sanitaire et Social 1981, pages 407 note
DUBOUIS et 413 conclusions LABETOULLE) dès lors que ce traitement n’est pas
illusoire (Conseil d’Etat au disciplinaire 29 juillet 1994 revue de Droit Sanitaire et
Social 1995 page 57 note DUBOUIS).
La jurisprudence administrative a, un temps, semblé définir les conditions dans
lesquelles l’urgence permettait de passer outre le refus clairement exprimé du patient à
l’occasion de deux jugements de la Cour Administrative d’Appel de Paris en date du 9
juin 1998 Mme Senanayake (petites Affiches, 23 avril 1999, p. 10).
Reconnaissant un « état de nécessité né du conflit entre deux devoirs également
impérieux du sacerdoce médical » comme le décrit Monsieur MEMETEAU (petites
affiches 23 avril 1999, n° 81 page 10), la jurisprudence a défini trois conditions strictes
et cumulatives exigées justifiant l’intervention :
- Exigence d’un pronostic vital (danger imminent pour la vie du patient).
- Absence d’alternatives thérapeutiques (pouvant être mises en place en
pratique).
- Actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état (Quid
des soins palliatifs ?).

5
Dans le sens de cette solution jurisprudentielle, Madame HEERS, Commissaire du
Gouvernement pour ces affaires, indiquait que « l’exigence du consentement n’est que
l’ordre de la modalité quand celle de la survie est l’ordre de la nature, de l’essence,
de la finalité (…) de l’acte médical ».
La Cour Administrative d’Appel a ainsi solennellement jugé que la préservation
de la vie prime la volonté individuelle.
Ces décisions de la Cour Administrative d’Appel ont fait l’objet d’un pourvoi devant
de le Conseil d’Etat (Cf. arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 2001, Madame X…,
Droit et Patrimoine n° 101, février 2002, JCP ed E, n° 6, p. 302, II, 10025 ).
Cette décision du Conseil d’Etat du 26 octobre 2001 a mis un coup d’arrêt à cette
solution en indiquant clairement que pour avoir voulu « faire prévaloir de façon
générale l’obligation pour le médecin de sauver la vie sur celle de respecter la volonté
du malade », la Cour Administrative d’Appel de Paris a « commis une erreur de droit
justifiant l’annulation de son arrêt ».
Par une solution qualifiée par Monsieur FRION de « minimaliste en ce sens qu’elle
évite tout risque d’impérialisme médical ou d’acharnement thérapeutique », le
Conseil d’Etat a considéré que le médecin ne dispose d’aucune prérogative
prévalant, en général, sur celle du malade et a ainsi refusé de reconnaître une
quelconque hiérarchie entre le principe de l’autonomie du consentement et celui
qui oblige le médecin à soigner et le cas échéant à sauver la vie du malade.
Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a cependant jugé les médecins
irresponsables des griefs avancés à leur endroit (car action en resp) en considérant que
ce qui doit prévaloir c’est le caractère extrême de la situation dans laquelle se trouve la
malade et qu’en l’espèce les médecins avaient accompli dans l’intérêt du patient « un
acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. »
Cette jurisprudence, pragmatique en ce qu’elle invite les médecins à agir en
conscience, au cas par cas, implique en substance que si les médecins avaient dans
cette espèce finalement respecté la volonté de leurs patients, ils n’auraient pour autant
commis une faute.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%