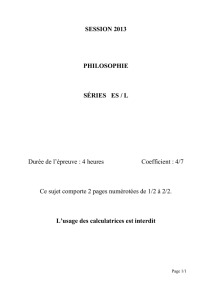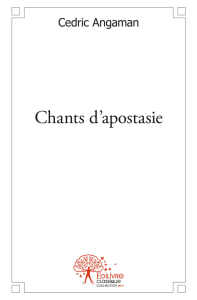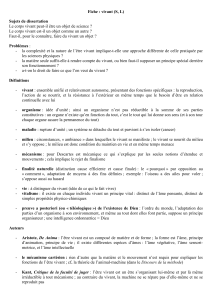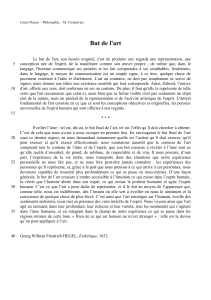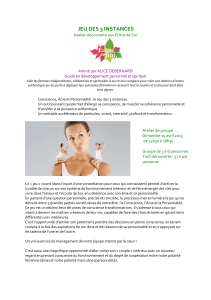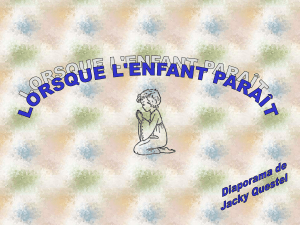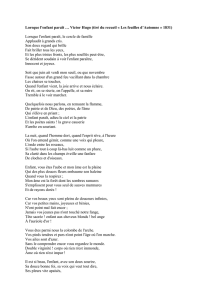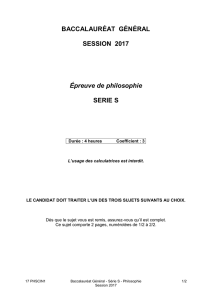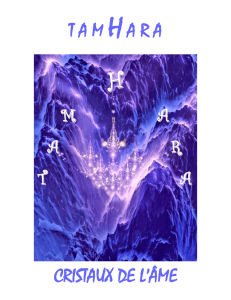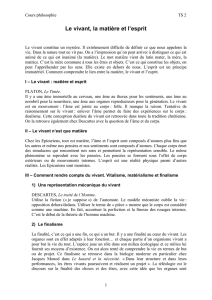Mgr Freppel

1 / 28
M.J.C.F.
Équipe saint Thomas d'Aquin
G u i d e philosophique
I n t r o d u c t i o n
- Pourquoi s'acharner, au MJCF, sur les questions de philosophie ? Pourquoi y revenir sans cesse ? C'est ardu,
difficile, rébarbatif ; ce n'est vraiment pas ce qui passionne le monde d'aujourd'hui. Ne vaudrait-il pas mieux se
concentrer sur les questions d'apologétique, plus concrètes et donc plus aisément accessibles et davantage susceptibles
d'exciter la curiosité que les problèmes philosophiques ?
A cette première objection, on pourrait ajouter une seconde, assez voisine :
- N'avons-nous pas mieux à faire, en tant que catholiques, que discuter de philosophie naturelle ? Les vérités
surnaturelles enseignées par Notre-Seigneur Jésus-Christ et par l'Église ne sont-elles pas bien plus importantes ? La
contemplation du mystère de la Sainte Trinité, tel qu'il est révélé par Dieu Lui-même, n'est-elle pas bien plus
enrichissante que l'étude des preuves de l'existence de Dieu qui peuvent être trouvées par notre seule raison ? La loi
divine de la Charité et la Révélation de l'Amour de Dieu ne sont-elles pas bien plus enthousiasmantes que l'explication
de la simple morale naturelle ?
Ces deux objections manifestent une grave méconnaissance de notre état d'homme d'une part et de la situation actuelle
du monde d'autre part.
- Grave méconnaissance de notre état d'être humain, tout d'abord. Car avant d'être baptisé et élevé au rang de fils de
Dieu, l'homme n'est pas n'importe quoi. Une pierre ou un chien ne pourraient pas recevoir la Foi : il faut pour cela être
doté d'intelligence.
L'homme ne pourrait accéder à la vie surnaturelle s'il n'était auparavant doté de sa nature d'être intelligent et libre.
L'ordre de la grâce dépasse infiniment celui de la nature, bien sûr. Mais il le présuppose néanmoins. Si l'homme est apte
à entrer en contact avec Dieu, c'est de par sa constitution naturelle qui le différentie de tous les autres êtres matériels.
Dom Delatte insiste beaucoup sur ce point :
« L'homme est une créature raisonnable et intelligente. Intelligente, qu'est ce que cela veut dire ? Cela
veut dire que l'homme est élevé au-dessus de l'animal. L'animal est un être tout concentré, tout fermé,
tout ramassé en lui-même, tout occupé de lui, qui ne s'intéresse qu'aux choses qui le touchent
personnellement dans son être sensible. L'animal n'est pas artiste : il y a chez lui incapacité de s'élever
à la contemplation de la beauté, il est tout entier replié sur lui-même. S'il pouvait y avoir un
raisonnement dans sa tête, ce serait celui-ci : "les choses ne sont bonnes que lorsqu'elles sont utiles ;
elles ne sont utiles que lorsqu'elles sont utiles pour moi". L'occupation de soi, la concentration sur soi,
l'hypertrophie du moi, voilà le caractère de l'animal.
Le caractère de l'intelligence est au pôle opposé. Un être intelligent est un être décentralisé, un être
qui sort de soi. L'intelligence, c'est la faculté de l'universel, c'est la faculté qui nous fait voir, non
seulement ce qui est vrai pour moi, ce qui est bien pour moi, ce qui est beau pour moi ; mais ce qui est
vrai en soi, ce qui est bien en soi, ce qui est beau en soi. Voilà ce qui constitue la caractéristique et la
dignité de l'homme, ce qui l'élève au-dessus de la sensibilité et de l'animalité pure. L'homme est un
être décentralisé, affranchi de lui-même, capable de sympathiser avec toute intelligence créée, d'entrer
en association avec Dieu lui-même. »
1
.
Nature humaine qu'il est donc capital de connaître et de respecter, sous peine de se fermer définitivement à
l'ordre de la grâce.
1
Dom Paul Delatte -Contempler l'invisible (Solesmes). pp. 89-92.

2 / 28
« Au fond, qu'est-ce qui nous retient dans notre marche vers Dieu ? Quelles sont les difficultés qui retardent
notre vie ? (…) Regardons ce qui se passe dans le monde. Pourquoi n'est-on pas chrétien ? Est-ce par effroi
du caractère surnaturel ? Non. C'est uniquement en raison de vérités, de devoirs strictement et simplement
naturels, devant lesquels on ne veut pas s'incliner (...) Il ne faut pas négliger les considérations d'ordre
purement naturel, parce que la nature est la base première sur laquelle vient se greffer la surnature »
2
.
Refus de la nature humaine qui entraîne une incapacité à la grâce. N'est-ce pas là le drame du monde actuel ? Plus
encore qu'une crise de la foi, il nous faut constater une crise de l'intelligence. « Les choses ne sont bonnes que
lorsqu'elles sont utiles ; elles ne sont utiles que lorsqu'elles sont utiles à moi » : ce serait, dit Dom Delatte, le
raisonnement de l'animal s'il pouvait raisonner. Mais qui ne voit que c'est exactement celui du monde moderne ?
- l'école ne cherche plus à enseigner ce qui est vrai en soi, ce qui est bien en soi, ce qui est beau en soi, mais
uniquement ce qui est utile,
- les médias accentuent encore cette hypertrophie du moi : il ne s'agit jamais de savoir ce qui est vrai ou bien en
soi, mais uniquement ce que ressent tel ou telle. On reste dans le domaine du sensible et de l'individuel ;
- pire encore, c'est l'existence même d'une vérité universelle qui est niée par les philosophies à la mode : à
chacun son opinion, à chacun sa liberté. L'homme est comme enfermé en lui-même par le subjectivisme et le
libéralisme ambiants,
- dans la vie économique, politique ou sociale, enfin, tout est centré sur la personne et sa liberté individuelle,
indépendamment de tout bien commun objectif vers lequel devrait être ordonnée la société.
C'est vraiment le caractère propre de l'homme, celui qui le distingue des animaux, qui tend à être effacé par
l'organisation du monde moderne ; tout semble être conçu pour faire oublier à l'homme son originalité propre : la
contemplation de la vérité. Or c'est justement sur cette orientation naturelle de l'homme vers la Vérité que peut être
fondée la Foi surnaturelle. Si elle est fondée sur autre chose (la sentimentalité, par exemple), ce ne sera plus la Foi (c'est
à dire l'adhésion de l'intelligence à la Vérité révélée) ; nous glisserons dans le modernisme qui a précisément pour
caractéristique de remplacer la Foi par le sentiment religieux.
Satan attaque aujourd'hui l'ordre surnaturel par l'ordre naturel. Il détruit la Foi en détruisant son support naturel :
l'intelligence. Nous avons donc le devoir d'être intelligents. Toute tentative de restauration catholique négligeant l'effort
philosophique risque d'être vouée à l'échec parce que les bases manqueront. Pour prêcher la Foi, il convient de rétablir
dans les esprits la notion de vérité. Comment parler de Rédemption sans donner une idée de ce qu'est la nature
humaine ? Enfin, l'exposition de la morale ne passera que par une réfutation du libéralisme ambiant : ce sont là des
nécessités logiques. Passer outre, c'est fonder la religion sur les sables mouvants de l'imagination ou de la sensibilité (cf.
les charismatiques).
Mais ne croyons surtout pas que ce premier effort, visant à redonner à l'homme sa simple dignité naturelle, puisse être
réalisé sans les forces surnaturelles : n'oublions pas que l'homme est corrompu par le péché originel, et qu'il a besoin de
la grâce pour être fidèle à sa seule vocation naturelle. La confusion est si grande, à notre époque, qu'il faut presque une
grâce spéciale pour parvenir à comprendre ce qui est pourtant une vérité de bon sens accessible à n'importe quelle
intelligence : qu'il existe une vérité objective. Il convient, là comme partout, de « tenir les deux bouts de la chaîne » : ne
pas exposer les vérités de la Foi sans les appuyer sur les fondements rationnels qui lui sont nécessaires (ce serait
s'exposer à tomber dans le modernisme), ne pas non plus séparer l'exposé de ces vérités purement naturelles de la prière
et de la grâce (ce serait tomber dans le naturalisme). La Foi doit tout imprégner, tout éclairer. Ce n'est pas pour l'ordre
naturel que nous combattons, c'est pour l'Amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
_______________________________________________________
N. B. Ce guide est destiné à être un instrument de travail et de référence au service des animateurs. Il doit donc être
utilisé tel quel et non comme un recueil de topos tout faits qu'un topoteur en manque pourra se contenter de lire à
haute voix devant les membres de son équipe sans autre préparation : nous nous sommes même efforcés de faire des
exposés qui ne puissent pas être repris tels quels en topos, afin de contraindre les utilisateurs de ce guide à travailler par
eux-mêmes. Seul le travail personnel permet en effet une assimilation véritable.
Nous ne saurions trop insister par ailleurs pour que les animateurs ne se contentent pas d'étudier ce guide, mais le
dépassent allègrement. Nous indiquons, dans cet esprit quelques pistes d'études à la fin de chaque chapitre. A chacun
d'en faire son profit pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes.
2
Dom Paul Delatte -Contempler l'invisible (Solesmes) pp. 102-103.

3 / 28
I - L a V é r i t é .
A – Difficultés.
Huit aveugles se retrouvent un jour autour d'un éléphant. Le premier s'emploie à lui tâter la jambe, un autre la
queue, un troisième le haut de la queue, un quatrième le ventre, un cinquième le dos, un sixième les flancs, un septième
les défenses ; le dernier, enfin, n'en saisit que la trompe. Et les voilà qui se disputent tous les huit sur ce qu'est
réellement un éléphant ! « Un éléphant ressemble à des colonnes », affirme le premier qui avait tâté les jambes. « Pas
du tout, rétorque le second, il ressemble à un balai ». Le troisième prétend qu'il ressemble à une branche, le quatrième à
un tas de terre, le cinquième à un mur, le suivant à une montagne. « Il ressemble à des cornes » répète de son côté celui
qui a touché aux défenses, tandis que pour le dernier, l'éléphant évoque irrésistiblement l'aspect d'une grosse corde.
Cet exemple illustre bien la façon dont nos contemporains conçoivent la vérité. Pour eux, nous sommes tous
semblables à ces aveugles, incapables de percevoir ce que sont réellement les choses. Chacun ne voit qu'un aspect
particulier de la réalité et personne ne peut prétendre imposer aux autres sa vision des choses. Toutes les opinions sont
relatives à la personne qui les conçoit, aucune ne saurait donc avoir de valeur absolue. Toutes se valent.
Cette conception moderne de la vérité a des conséquences en tous domaines :
- en morale, tout d'abord. Le principe fondamental de la morale n'est plus la soumission à une loi prenant sa source
dans la nature et la finalité de l'homme, puisqu'on ne peut connaître la nature de l'homme. C'est au contraire la tolérance
: chacun doit respecter les opinions des autres et ne pas chercher à imposer à son voisin ses conceptions éthiques.
- en politique, cela entraîne la démocratie moderne, c'est-à-dire libérale (ce n'est pas la démocratie en tant que mode de
désignation d'un gouvernant qui est ici en cause, mais le principe moderne selon lequel les lois sont la simple
expression d'une volonté générale et non plus une ordination de la raison en vue d'obtenir un bien objectif).
- en religion, la conséquence sera le modernisme et un faux œcuménisme. Selon le modernisme, la religion n'est pas
fondée sur la Vérité mais sur le sentiment. Les formules dogmatiques n'ont pas pour fonction d'exprimer des vérités
immuables révélées par Dieu, mais bien plutôt de réaliser une sorte de consensus parmi les croyants cherchant à
exprimer leur expérience religieuse. En pure logique, les différentes religions sont alors considérées comme diverses
voies permettant toutes d'accéder au même Dieu : c'est la vision moderne de l'œcuménisme.
B - Exposé des principes.
Un simple regard nous manifeste un monde à la fois un et complexe : à travers la multiplicité de la matière que
personne ne contestera, nous percevons également une certaine unité : que nous considérions l'homme de Cromagnon,
l'australopithèque ou notre voisin, nous constatons en chacun de multiples différences physiologiques qui n'empêchent
pas cependant de faire de chacun un être qui partage avec ses congénères des propriétés fondamentales qui font de lui
un homme. Avant de se poser le problème de la connaissance humaine, il nous faut rendre compte de cette constatation.
Nous n'analyserons qu'ensuite le processus par lequel l'homme atteint à la fois cette unité et cette diversité.
1 - Regard sur le monde (induction de la matière et de la forme).
D'un prisonnier nourri depuis dix ans au pain sec et à l'eau, personne n'aura jamais l'idée de dire qu'il est du pain
et de l'eau : chacun sait que la nourriture est assimilée par la fonction de la digestion et qu'elle est en partie utilisée à la
production des nouvelles cellules du corps humain. Si c'est toujours la même matière qui était hier du pain et qui
devient aujourd'hui mon propre corps, je suis cependant obligé d'admettre que ce n'est plus la même chose : il y a eu
transformation. C'est la constatation de cette transformation, que nous voyons partout, qui nous permettra d'approfondir
quelque peu ce qui constitue la nature des choses, ce qui fait leur unité. Comment la même matière, qui était hier une
chose, peut-elle aujourd'hui être une autre chose ? Que se passe-t-il ?
Nous sommes obligés d'admettre que tout changement présuppose une certaine stabilité. Si je dis « Jacques a
beaucoup changé ces derniers temps », je constate certes un changement, mais je présuppose l'existence d'un sujet
stable et donc reconnaissable - Jacques - qui subit ce changement. Sans cela, la constatation du changement est
impossible. Dans tout changement, il faut donc distinguer ce qui demeure et ce qui disparaît.
Dans le cas de la digestion, par exemple, il demeure une certaine quantité de matière qui était tout à l'heure du pain et
qui sera bientôt une cellule humaine. Mais cette matière n'est plus la même chose. Elle n'est plus du pain. Ce qui a
disparu, c'est ce qui faisait qu'elle était du pain.
Admettre le changement nous oblige donc à distinguer deux éléments dans toutes les choses que nous pouvons
voir : un élément matériel, multiple, qui peut se voir, se toucher, se sentir ; mais puisque cette matière ne constitue pas
la chose dans ce qu'elle est fondamentalement (cette même matière peut être autre chose demain) nous devons
reconnaître un autre principe explicatif qui est au-delà de la matière. Ce qui fonde la constitution même de la chose,
c'est la façon dont cette matière est organisée, dont elle est ordonnée.
Exemple : ordonnée de telle façon, cette quantité de matière est oxygène + hydrogène. Ordonnée différemment,
cette même matière n'est plus la même chose : c'est maintenant de l'eau.
Ce principe qui ordonne - et donc qui unifie - la matière en elle-même multiple, nous l'appelons forme. C'est ce principe
qui unifie les différents aspects matériels que peut revêtir un être pour en faire un tout sensible, et non pas seulement

4 / 28
plusieurs objets de sensation juxtaposés. C'est parce que l'eau est eau qu'elle contient deux parts d'hydrogène pour une
part d'oxygène et que ces trois atomes ne font qu'un tout. La forme est principe d'unité de l'être.
Allons plus loin : l’eau n’est pas oxygène + hydrogène ordonnés de telle manière : dans l’eau, il n’y a plus
d’hydrogène ni d’oxygène, c’est autre chose. La matière reste la même (la masse reste la même, par exemple), mais la
chose a changé. Le principe qui ordonne la matière (la forme) est donc en même temps principe d’être de la chose, ce
qui la définit : c’est par lui que la chose est ce qu’elle est et non une autre chose. Considéré sous cet aspect, nous
n'employons plus le terme de forme, mais celui d'essence, de nature, pour désigner ce principe explicatif des choses qui
se surajoute à la matière.
Comprenons bien que forme et essence ne sont qu'un seul et même principe, considéré sous deux aspects
différents : c'est en tant que l'ovule fécondé est un fœtus de nature humaine qu'il va se développer de telle et telle
manière pour former un tout harmonieux. On parle de forme quand on constate le rapport de ce principe avec la matière,
d'essence quand on regarde ce principe en lui-même.
Arrivé à ce stade, il convient de bien saisir deux points importants :
1 - ce principe, qu'on l'appelle forme ou essence, n'est pas et ne peut pas être matériel, puisqu'il a pour fonction d'unifier
et d'ordonner la matière pour en faire une chose (comme la figure de César transforme le plâtre en statue). Il domine au
contraire la matière et lui donne une signification, un "être-ceci". Il n'est donc pas de nature sensible, mais intelligible.
2 - Ce principe immatériel qui organise la matière pour en faire telle ou telle chose n'est pas seulement une vue de
l'esprit : il existe bel et bien dans les choses, puisqu'il est principe de leur être, leur colonne vertébrale pourrait-on dire.
Ceci étant dit, nous pouvons enfin aborder la question de la connaissance.
2 - La connaissance sensible.
C'est par nos cinq sens que nous entrons en contact avec le monde extérieur, la chose est évidente. La question
est surtout de savoir ce que les sens nous disent du réel, quelle connaissance ils nous en apportent. Ne nous dévoilent-ils
du monde extérieur que sa multiplicité ou nous révèlent-ils également son unité ?
Tout d'abord, bien sûr, chaque sens nous dit quelque chose de particulier sur le réel : le son n'est perçu que par
l'ouïe, la couleur que par la vue etc. On a alors les cinq sens externes avec leur objet propre : le toucher a pour objet le
chaud et le froid, le sec et l'humide, le dur et le mou ; le goût a pour objet la saveur ; l'odorat l'odeur, l'ouïe le son, et la
vue la couleur. Mais au-delà de cette connaissance élémentaire, qui n'apporte à l'homme que des données éparses et
diverses qui nous font accéder à ce que nous appelions précédemment la multiplicité et la complexité du réel, les sens
peuvent-ils nous faire toucher l'unité même du réel, ce qui constitue la colonne vertébrale de l'objet connu ?
Regardons le comportement de l'animal qui partage avec nous la connaissance sensible. Le chien, face à son
maître, n'appréhende pas seulement une somme de figures plus ou moins géométriques, de couleurs et de sons. Il perçoit
toutes ces choses comme formant un ensemble, comme faisant un seul tout et un tout distinct du reste : il saisit que son
maître est autre chose que le bout de viande qu'il tient à la main. C'est donc que la connaissance sensible nous fait
accéder non seulement à des données éparses recueillies par chaque sens, mais également à ce tout, à cette unité qui
sous-tend la complexité du réel matériel. Par les sens, c'est donc tout l'objet connu qui "vient" dans le connaissant, tant
sa multiplicité que son unité, puisque cette multiplicité vient "ordonnée". Ainsi, de par l'acte d'appréhension sensible,
l'objet connu et le sujet connaissant sont intimement unis, « ne font en quelque sorte qu'un » dira saint Thomas.
"Communion" magnifique de deux êtres que cette intuition sensible, certes, mais dont il nous faut montrer les
limites :
- A elle seule, cette intuition est transitoire et ne permet donc pas, au sens strict, une connaissance, laquelle est
quelque chose de l'objet demeurant en moi malgré l'absence physique de l'objet. Une telle connaissance est
rendue possible grâce à ce que nous appelons les sens internes. Reprenons notre chien. Si son maître rentre tous
les soirs chez lui en ouvrant la serrure de sa porte, ce chien, resté garder la maison, associe bien vite le bruit de la
clé à l'image de son maître et se réjouit déjà de la venue de ce dernier. Il est donc capable de se souvenir d'une
intuition passée et de se la représenter intérieurement malgré l'absence de l'objet : preuve que l'objet connu a
laissé une "trace" dans le connaissant qu'on appellera image ou fantasme. Ces facultés de souvenir et
d'imagination, sensibles (elles portent sur le particulier, non sur cette "ossature" immatérielle de l'objet qu'est son
essence) et immatérielles (d'où leur nom d'image), permettent néanmoins une véritable connaissance, laquelle
devient principe d'action. C'est à ce niveau, mais à tort cependant, que l'on parle "d'intelligence animale".
- Cette intuition sensible, si elle nous unit avec l'objet connu en tant qu'il est un objet individuel, ne nous permet
cependant pas de "lire", de comprendre cette unité prise en elle-même, de découvrir l'essence à travers sa
fonction de forme de la matière. La substance (autre nom pour désigner la forme ou l'essence) n'est vue par les

5 / 28
sens qu'en tant qu'elle est individualisante (dans sa "fonction" de forme), non dans son être même, dans la
définition essentielle qu'elle apporte à l'objet individuel. Celle-ci ne peut en effet être "vue" par les sens puisque,
étant immatérielle, la forme échappe par-là même aux sens. Seules les conséquences sur la matière de cette
forme substantielle sont perceptibles par les sens : c'est ce que nous appelions le tout sensible, le fait que
plusieurs données sensibles diverses ne fassent qu'un tout individuel.
3 - La connaissance intellectuelle.
A travers ce tout sensible qui, par la perception des sens, s'est inscrit en nous (le fantasme), l'intelligence va
pouvoir "lire" l'unité de l'objet. Étant en effet une faculté spirituelle, elle ne considérera plus seulement la substance en
tant qu'elle est individualisante, mais en tant qu'elle est principe de définition de la chose ; autrement dit, en tant
qu'essence universelle. La connaissance intellectuelle ne porte plus sur tel arbre, mais sur la notion d'arbre perçue à
travers tel arbre ; elle ne porte pas sur tel triangle gravé sur la pierre, mais sur la notion même de triangle.
Nous le constatons, le processus intellectuel par lequel nous appréhendons cette essence est une sorte de lecture
intuitive. Acte simple par lequel nous "voyons" (le terme est d'Aristote) l'essence d'une chose à travers l'image (en tant
qu'elle est une) qui s'est gravée en nous. d'où le nom de simple appréhension pour désigner cet acte. Nous l'appelons
encore abstraction pour signifier que l'intelligence ne construit pas son objet, mais ne fait que le dégager de son
revêtement individuel, que de lire à l'intérieur (intus legere) de l'être concret individuel son principe d'unité immatériel
(et par-là même universel) en faisant abstraction de ses caractères individuels.
Il est important de souligner le type d'activité que l'intelligence fournit à ce stade. L'intelligence, loin de
construire l'universel, le découvre. L'idée universelle n'est donc pas une interprétation de la réalité, une universalisation
subjective (nous appelons ceux qui l'affirment idéalistes), mais une pénétration de l'objet qui porte en lui-même sa
définition, son essence (cf. §1, regard sur le monde). Face à la réalité, l'intelligence est donc active dans son effort
d'attention par lequel elle se met à la disposition de la chose qu'elle contemple ; mais elle est passive en ce sens qu'elle
ne cherche pas à construire quoi que se soit, mais uniquement à recevoir. Tel est le point fondamental de la
connaissance que nous devons bien connaître, tellement il est remis en cause par les modernes. C'est de là que la vérité
tire sa définition : adéquation de l'intelligence au réel. Nous serons dans le vrai dans la mesure où nous saurons dégager
l'universel contenu dans l'objet. Cet universel, en tant qu'il est en nous, prendra l'aspect d'un concept (simple : homme),
puis d'une définition (composée : animal raisonnable).
Nous pourrions ensuite décrire les différents actes de l'intelligence. Cela nous paraît secondaire ici, puisque la
querelle avec les modernes n'est pas premièrement là. Signalons-les simplement pour mémoire. Penser (l'acte de
l'intelligence) se dit de trois manières :
- Je pense à la gratitude : j'ai en moi le concept de gratitude, peut-être encore confus, mais appréhendé par
l'intelligence : c'est l'acte de simple appréhension, opération par laquelle je conçois une chose sans en rien
affirmer.
- Je pense que la gratitude est due à Dieu : c'est l'acte de jugement, opération par laquelle je lie deux pensées par
l'affirmation ou la négation. Juger nécessite donc une prise de position de la part de l'intelligence, un engagement
de l'esprit : il affirme ce qu’il croit être conforme à la réalité, nie ce qui lui est contraire. Pensant à la gratitude,
j'affirme qu'elle est attribuable à Dieu.
- Je pense à la nature exacte de la gratitude, cherchant à savoir si elle est un dû de justice. C'est l'acte de
raisonnement, opération par laquelle on lie deux jugements connus pour parvenir à un troisième jugement encore
inconnu.
4 - Attention : non au nominalisme !
Ceux que l'on appelle "nominalistes" considèrent que les réalités matérielles (les seules avec lesquelles nous
soyons directement en contact) sont purement particulières (ils refusent en bloc le §1). Dès lors, toute connaissance
porte sur le particulier et il n'y a qu'une différence de degré entre la connaissance sensible et la connaissance
intellectuelle : l'intelligence n'est rien d'autre qu'une faculté d'association d'images, un peu améliorée chez l'homme ;
l'abstraction de l'intelligence ne consiste pas à abstraire ce qu'il y a de particulier dans l'objet pour découvrir son aspect
universel qui le définit, mais à abstraire un particulier des autres particuliers : ainsi, si je ne regarde chez les animaux
que le nombre de jambes qu'ils possèdent, je construis les concepts de bipèdes et de quadrupèdes, rangeant sous la
même classe l'homme, le singe et l'autruche. Si je classe ces mêmes êtres selon qu'ils sont à poils ou à plumes, j'arriverai
à des associations totalement différentes. C'est donc, disent-ils, que l'effort d'universalisation est incapable de nous faire
connaître le monde tel qu'il est. Il n'a pour but que l'intérêt pratique, en tant qu'il permet le langage et l'essor des
"sciences" expérimentales.
La différence entre ce nominalisme et le réalisme que nous décrivions précédemment est immense. Tandis que le
réalisme nous fait aboutir, à la limite à travers un seul être, à la définition universelle, le nominalisme cherche une
universalité quantitative, par principe inaccessible. Une telle théorie se mord la queue. L'universalisation quantitative
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%