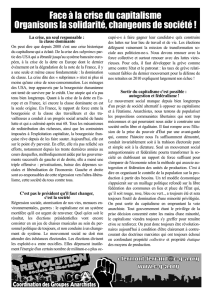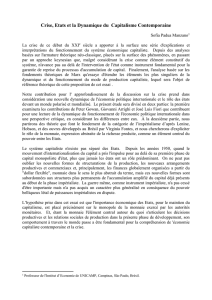Georges Politzer : Principes fondamentaux de philosophie

Georges Politzer
PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE PHILOSOPHIE
Guy BESSE
et
Maurice CAVEING
EDITIONS SOCIALES
1954
Sommaire :
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION………………………………………………………………...……………...…………………………p.7
I. Qu'est-ce que la philosophie ?
II. Pourquoi devons-nous étudier la philosophie ?
III. Quelle philosophie étudier ?
a) Une philosophie scientifique : le matérialisme dialectique
b) Une philosophie révolutionnaire : la philosophie du prolétariat
IV. Conclusion : Unité de la théorie et de la pratique
PREMIERE PARTIE – ETUDE DE LA METHODE DIALECTIQUE MARXISTE
Première leçon. — La méthode dialectique…………………………………………………………………………p.15

2
I. Qu'est-ce qu'une méthode ?
II. La méthode métaphysique
a) Ses caractères
b) Sa signification historique
III. La méthode dialectique
a) Ses caractères
b) Sa formation historique
IV. Logique formelle et méthode dialectique
Deuxième leçon. — Le premier trait de la dialectique : tout se tient. (Loi de l'action réciproque et de la connexion
universelle)…………………………………………………………………………………………………………..p.22
I. Un exemple
II. Le premier trait de la dialectique
III. Dans la nature
IV. Dans la société
V. Conclusion
Questions de contrôle
Troisième leçon. — Le deuxième trait de la dialectique : tout se transforme. (Loi du changement universel et du
développement incessant)……………………………………………………………………………………...…….p.29
I. Un exemple
II. Le deuxième trait de la dialectique
III. Dans la nature
IV. Dans la société
V. Conclusion
Questions de contrôle
Quatrième leçon. — Le troisième trait de la dialectique : le changement qualitatif………………………...………p.37
I. Un exemple
II. Le troisième trait de la dialectique
III. Dans la nature
IV. Dans la société
V. Conclusion
Remarques
Questions de contrôle
Cinquième leçon. — Le quatrième trait de la dialectique : la lutte des contraires (I)………………………….……p.46
I. La lutte des contraires est le moteur de tout changement. Un exemple
II. Le quatrième trait de la dialectique
III. Caractères de la contradiction
a) La contradiction est interne
b) La contradiction est novatrice
c) L'unité des contraires
Questions de contrôle
Sixième leçon. — Le quatrième trait de la dialectique : la lutte des contraires (II)…………………………...…….p.53
I. Universalité de la contradiction
a) Dans la nature
b) Dans la société
II. Antagonisme et contradiction
III. La lutte des contraires, moteur de la pensée
Questions de contrôle
Septième leçon. — Le quatrième trait de la dialectique : la lutte des contraires (III)………………….……………p.60
I. Le caractère spécifique de la contradiction
II. Universel et spécifique sont inséparables
III. Contradiction principale, contradictions secondaires
IV. Aspect principal et aspect secondaire de la contradiction
V. Conclusion générale sur la contradiction. — Marxisme contre proudhonisme
Questions de contrôle
DEUXIEME PARTIE – ETUDE DU MATERIALISME PHILOSOPHIQUE MARXISTE
Huitième leçon. — Qu'est-ce que la conception matérialiste du monde ?..................................................................p.72
I. Les deux sens du mot « matérialisme »
II. La matière et l'esprit
III. Le problème fondamental de la philosophie
IV. Les deux sens du mot « idéalisme »
V. Le matérialisme et l'idéalisme s'opposent en pratique aussi bien qu'en théorie
VI. Le matérialisme philosophique marxiste se distingue par trois traits fondamentaux
Questions de contrôle
Neuvième leçon. — Le premier trait du matérialisme marxiste : la matérialité du monde.........................................p.78

3
I. L'attitude idéaliste
II. La conception marxiste
III. Matière et mouvement
IV. La nécessité naturelle
V. Marxisme et religion
VI. Conclusion
Questions de contrôle
Dixième leçon. — Le deuxième trait du matérialisme marxiste : la matière est antérieure à la conscience...............p.89
I. Nouveau subterfuge idéaliste
II. La conception marxiste
a) Objectivité de l'être
b) La conscience, reflet de l'être
III. La pensée et le cerveau
IV. Les deux degrés de la connaissance
V. Conclusion
Questions de contrôle
Onzième leçon. — Le troisième trait du matérialisme marxiste : le monde est connaissable………………..……p.101
I. Ultime refuge de l'idéalisme
II. La conception marxiste
a) Le rôle de la pratique
b) Une falsification de la notion marxiste de pratique
III. Vérité relative et vérité absolue
IV. L'union de la théorie et de la pratique
Questions de contrôle
TROISIEME PARTIE – LE MATERIALISME DIALECTIQUE ET LA VIE SPIRITUELLE DE LA SOCIETE
Douzième leçon. — La vie spirituelle de la société est le reflet de sa vie matérielle………………………………p.114
I. Un exemple
II. Les « explications » idéalistes
III. La thèse matérialiste dialectique
a) La vie matérielle de la société est une réalité objective existant indépendamment de la conscience et de la
volonté non seulement des individus, mais de l'homme en général
b) La vie spirituelle de la société est un reflet de la réalité objective de la société
c) Comment surgissent les nouvelles idées et théories sociales
d) La question des survivances
IV. Conclusion
Questions de contrôle
Treizième leçon. — Le rôle et l'importance des idées dans la vie sociale………………………………..………..p.124
I. Un exemple
II. L'erreur du matérialisme vulgaire
III. La thèse matérialiste dialectique
a) C'est l’origine matérielle des idées qui fonde leur puissance
b) Vieilles idées et nouvelles idées
c) Les nouvelles idées ont une action organisatrice, mobilisatrice et transformatrice
IV. Conclusion
Questions de contrôle
Quatorzième leçon. — La formation, l'importance et le rôle du socialisme scientifique…………………………..p.133
I. Les trois sources du marxisme
a) La philosophie allemande
b) L'économie politique anglaise
c) Le socialisme français
II. Le socialisme utopique
III. Le socialisme scientifique
a) Sa formation
b) Ses caractères
IV. Le rôle du socialisme scientifique
a) La fusion du socialisme et du mouvement ouvrier
b) Nécessité du Parti communiste. — Critique de la « spontanéité »
V. Conclusion
Questions de contrôle
QUATRIEME PARTIE – LE MATERIALISME HISTORIQUE
Quinzième leçon. — La production : forces productives et rapports de production………………………….……p.145
I. Les conditions de la vie matérielle de la société
a) Le milieu géographique
b) La population
II. Le mode de production

4
a) Forces productives
b) Rapports de production
III. La propriété des moyens de production
IV. Le changement du mode de production, clé de l'histoire des sociétés
V. Conclusion
Questions de contrôle
Seizième leçon. — La loi de correspondance nécessaire entre les rapports de production et le caractère des forces
productives………………………………………………………………………………………………...………..p.156
I. Les forces productives sont l'élément le plus mobile et le plus révolutionnaire de la production
II. L'action en retour des rapports de production sur les forces productives
III. La loi de correspondance nécessaire
IV. Le rôle de l’action des hommes
Questions de contrôle
Dix-septième leçon. — La lutte des classes avant le capitalisme……………………………………………….….p.163
I. Les origines de la société
II. L'apparition des classes
III. Sociétés esclavagiste et féodale
IV. Le développement de la bourgeoisie
Questions de contrôle
Dix-huitième leçon. — Les contradictions de la société capitaliste………………………………………………..p.173
I. Les rapports capitalistes de production : leur contradiction spécifique
II. La loi de correspondance nécessaire en société capitaliste
a) La correspondance entre les rapports capitalistes de production et le caractère des forces productives
b) Le conflit entre les rapports capitalistes de production et le caractère des forces productives
III. La lutte de classe du prolétariat, méthode pour résoudre la contradiction entre les rapports de production et les forces
productives
IV. Conclusion
Questions de contrôle
Dix-neuvième leçon. — La superstructure…………………………………………………………………………p.184
I. Qu'est-ce que la superstructure ?
II. La superstructure est engendrée par la base
III. La superstructure est une force active
IV. La superstructure n'est pas liée directement à la production
V. Conclusion
Questions de contrôle
Vingtième leçon. — Le socialisme………………………………………………………………………..………..p.192
I. Répartition et production
II. La base économique du socialisme
III. Conditions objectives du passage au socialisme
IV. La loi fondamentale du socialisme
V. Conditions subjectives du passage au socialisme et de son développement
VI. Conclusion
Questions de contrôle
Vingt et unième leçon. — Du socialisme au communisme……………………………………………………..….p.205
I. La première phase de la société communiste
II. La phase supérieure de la société communiste
III. Forces productives et rapports de production sous le socialisme
IV. Les conditions du passage du socialisme au communisme
V. Conclusion
Questions de contrôle
CINQUIEME PARTIE – LA THEORIE MATERIALISTE DE L’ETAT ET DE LA NATION
Vingt-deuxième leçon. — L'Etat…………………………………………………………………………………...p.216
I. L'Etat et « l'intérêt général »
II. L'Etat, produit des antagonismes de classes inconciliables
a) Origine de l'Etat
b) Rôle historique de l'Etat
III. Le contenu et la forme de l'Etat
a) Le contenu social de l'Etat
b) La forme de l’Etat
IV. Lutte de classes et liberté
a) La bourgeoisie et la « liberté »
b) Le prolétariat et les libertés
Questions de contrôle
Vingt-troisième leçon. — La Nation (I)……………………………………………………………………………p.239

5
I. Nation et classe sociale
II. La conception scientifique de la nation
a) Qu'est-ce qu'une nation ?
b) Quelques erreurs à éviter
III. La bourgeoisie et la nation
a) La formation des nations bourgeoises
b) La bourgeoisie à la tête de la nation
c) La bourgeoisie traître à la nation
IV. La classe ouvrière et la nation
a) L'internationalisme prolétarien
b) Le patriotisme prolétarien
Questions de contrôle
Vingt-quatrième leçon. — La Nation (II)……………………………………………..……………………………p.255
I. La question coloniale : le droit des nations à disposer d'elles-mêmes
II. Les nations socialistes
a) Question nationale et révolution socialiste
b) Caractère des nations socialistes
III. L'avenir des nations
Note sur l'Alsace et la Moselle
Questions de contrôle
AVANT-PROPOS
Publiés en juillet 1946, réédités en janvier 1947, en mai 1948 et en décembre 1949, les Principes
élémentaires de philosophie de Georges Politzer ont été accueillis avec empressement. Ils
renfermaient, sous une forme accessible, l'essentiel des cours donnés en 1935-1936 à l'Université
Ouvrière par un de ceux qui, ne séparant jamais l'action de la pensée, moururent en héros pour que
vive la France.
Dans la « Préface » aux Principes élémentaires de philosophie, Maurice Le Goas qui, élève de
Politzer, recueillit ses cours et permit ainsi leur publication, écrivait :
Georges Politzer, qui commençait chaque année son cours de philosophie en fixant le véritable sens
du mot matérialisme et en protestant contre les déformations calomnieuses que certains lui font subir,
ne manquait pas de signaler que le philosophe matérialiste ne manque pas d'idéal et qu'il est prêt à
combattre pour faire triompher cet idéal. Il a su, depuis lors, le prouver par son sacrifice, et sa mort
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
1
/
259
100%

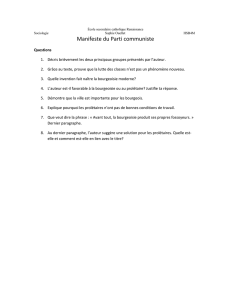
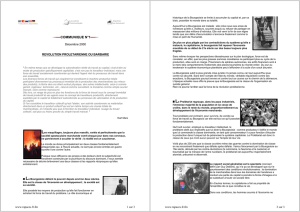

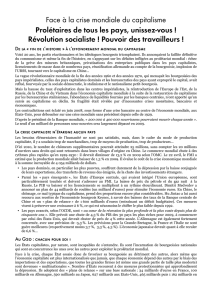
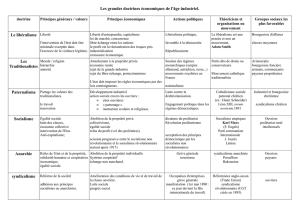
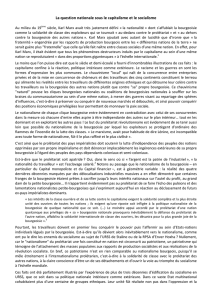
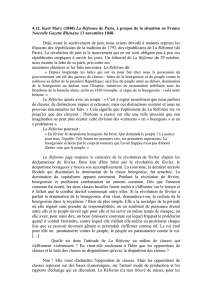
![séance du 12 octobre 2011 [Mode de compatibilité]](http://s1.studylibfr.com/store/data/002668868_1-06947beb75f93cfb0cbb41a15efae1ca-300x300.png)