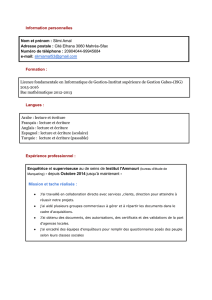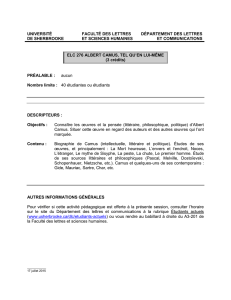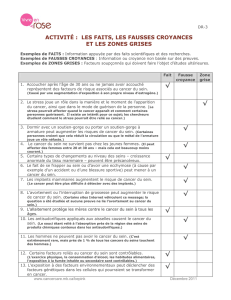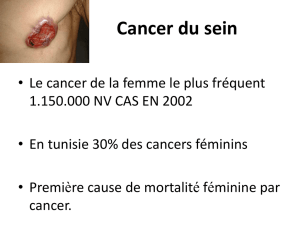OSMONDE, Gabriel, Alternaissance, Paris, Editions Pygmalion, 201

OSMONDE, Gabriel, Alternaissance, Paris, Editions Pygmalion, 2011.
VI
Luna Park
« Je vous autorise à me couvrir d’injures, car je voudrais me référer à Marx, penseur devenu infréquentable
depuis la victoire universelle du capital. Pourtant en matière de Sisyphe moderne, il est allée bien plus loin que
cet attachant play-boy de la philosophie qu’était Camus. Avec son pompeux schématisme, Camus postule : la
condition humaine est un esclavage quotidien et l’unique issue serait le défi jeté à la figure de celui qui nous a
conditionnés ainsi. Marx serait mort de rire devant ce credo digne d’un adolescent surexcité. Sa vision est moins
théâtrale, mais combien plus juste. Le capitaliste, explique-t-il, n’a pas besoin de rudoyer ses ouvriers pour qu’ils
augmentent la cadence. De la fenêtre de son atelier, l’ouvrier voit une longue kyrielle de misérables qui sont
prêts à tout pour être engagés. Sans aucune injonction de la part du patron, ce Sisyphe s’active de plus belle, pour
ne pas se retrouver dehors, dans la file. Ce qui pour ce petit-bourgeois de Camus était une terrible malédiction –
le travail – est considéré par l’ouvrier réel comme une aubaine, un bienfait inestimable. Un salaire, un statut, le
sentiment d’avoir gagné au loto de la société. Un jeu qui lui permet de choisir entre deux marques de cigarettes
ou de rêver d’une nouvelle voiture qui l’emmènera chaque matin à son rocher de Sisyphe, sous les regards
envieux de la file d’attente. Marx bar Camus à plate couture. Il a percé le secret de cet effrayant bonheur humain
basé sur la liberté de jouer. Dommage qu’il n’ait pas étendu cette réflexion à d’autres domaines de la vie
sociales… » p.230
« […] Chez Marx, l’ouvrier s’accroche à son rocher, car un chômeur peut le lui voler. Chez Godb, cette
concurrence concerne tous les aspects de notre vie. Le jeu consiste, on le sait, à évaluer la valeur marchande de
sa personne. Oui, troquer sa force, sa beauté, son intelligence, contre tel ou tel statut social. Ou bien, comme dit
Godb, à convertir sa Première naissance en la Deuxième. […]. » p.230-231
[…] « Camus aurait dû s’inspirer de l’histoire drôle que je vais vous raconter. Deux ébouerus, un vieux et un
débutant, sont en train de vider une fosse d’aisances. Le vieux, tout au fond, puise avec un seau, le transmet à
l’apprenti qui le déverse dans une benne. Au bout d’une heure, le jeune, fatigué, laisse échapper le seau : le vieux
reçoit le contenu sur la tête. Il s’ébroue et, foudroyant le jeune de son dédain, déclare : « Jamais tu ne seras
puiseur, tu mourras simple porteur ! » ». p.231
« […] le jeu social n’est pas réservé à une classe. Les prolétaires n’ont rien à envier aux dominants. Vous avez
vu, hier, dans La Danse d’un poulpe, la folle agitation d’un plexus, d’un patron de multinationale dont nous
avions filmé les jeux : travail, mondanités, vacances, magouilles politiques, sa double vie intime. Plus on monte
sur l’échelle sociale, plus la complexité du jeu devient délirante. Existentiellement, vos éboueurs sont plus libres
que ce magnat entouré d’une horde de subordonnés, de gardes du corps, de solliciteurs, de rivaux, de maîtresses.
Et pourtant il fait tout pour être, à son haut niveau, un « puiseur ». » p.231
« […] j’ai cru comprendre que le jeu, enfin ce qu’il appelle « la Foire aux esclaves heureux », sert à réconcilier
l’homme avec l’absurdité de son destin social. Mais pas uniquement. La fièvre de la Foire nous permet d’oublier
une absurdité plus criante encore – l’extrême brièveté de notre vie. Car notre Sisyphe qu’il soit éboueur ou
magnat, ne jouera à ce jeu que pendant vingt ou trente mille jours. p.231-232
Récemment, j’ai été témoin d’une révolution qui a rejeté tout ce qui avait été ma vie et surtout les théories que
j’avais enseignées. Les nouveaux jeux commencent, je devine qu’ils ne seront pas trop différents des précédents,
peut-être juste plus fébriles. Il s’agira toujours de pouvoir, d’argent, de désir, de violence. Ce qui sera traduit par
« morale », « progrès », « amour », « patriotisme »… Et les hommes viendront, comme jadis, à la Foire pour
troquer ce que la nature leur a donné contre ce que la société daignera leur offrir. p.232
« Vous voyez bien, la tâche qui nous attend est vaste, dit-elle aux autres. Répertorier toutes les farces et attrapes
de la Deuxième naissance et puis… oser imaginer une vie au-delà de la Foire. » p.233

VII
Les impasses du salut
« Vous refusez le progrès ! Selon vos doctrines, l’humanité doit se figer et ne plus respirer ! »
« Vous sapez l’effort des milliers de bénévoles qui se dévouent pour les populations les plus déshéritées… »
« Vos statistiques sont terriblement tendancieuses. Sous prétexte que les occidentaux polluent beaucoup, vous
voulez interdire le développement à la moitié de la population du globe… »
« C’est très confortable de s’enfermer dans votre tour d’ivoire. Mais que proposez-vus sur le terrain ? oui, ici et
maintenant ! »
« Vous prétendez changer le monde sans y toucher. Joli projet de révolution ! »
« Enlevez vos gants blancs ! La vie n’est pas du cinéma. Et surtout pas votre cinéma à vous ! »
« Vous ignorez les hommes réels, ceux qui ont faim, désirent avoir une famille, une maison, une voiture, qui
veulent que leurs enfants connaissent une aisance matérielle. Vous ‘admettez pas la légitimité de leurs
aspirations. Ces hommes-là ne vous suivront jamais ! »
J’entends aussi quelques accusations plus agressives : les diggers sont traités de sectaires, d’intellos nantis,
d’agents du capitalisme. Un Indien, un homme gras et qui transpire beaucoup, s’exclame d’une voix
incroyablement haut perchée : « La civilisation indienne n’a pas de leçons à recevoir. L’histoire millénaire de
notre pensée a déjà trouvé les réponses à toutes les questions existentielles où pataugent les penseurs de
l’Occident. Que ce soit l’hindouisme, le bouddhisme ou le jaïnisme, notre vision du monde est merveilleusement
cohérente et je vous déconseille de l’aborder avec vos outils intellectuels, toujours sommaires et inadaptés. Le
yogi le plus illettré appréhende la vie avec mille fois plus de profondeur que ne font vos universitaires… » p.270
« Il y a trois ans, j’aurais clamé exactement ce que, tous, vous venez d’exprimer. J’étais à l’époque partisan
d’une écologie interventionniste et d’une action humanitaire musclée. Je croyais savoir ce dont les exclus avaient
besoin : manger à leur faim, se loger, pouvoir nourrir leurs enfants. Oui, comme dans notre court-métrage : une
famille de miséreux souffrant de malnutrition et puis, grâce à l’intercession des vertueuses ONG, la même
famille installée dans un logement moderne, devant un téléviseur à écran plat. Ce raccourci n’a rien de
caricatural, il est toujours d’actualité, car c’est ainsi que les humanitaires voient la marche vers un monde plus
solidaire, pacifique, heureux. Les diggers ne nient pas la beauté d’une telle vision. Sauf que, et les chiffres le
disent clairement, le passage vers cette aisance matérielle signifie aujourd’hui la hausse de la production et donc
de la pollution. Avec les meilleures intentions du monde, les millions de personnes qu’on espère tirer de la
misère rejoignent inévitablement la population des pays développés dont le mode de vie est mortel pour la
planète. p.271-272
– Pour commencer, il faut cesser d’alimenter la machine avec nos vies, nos corps, nos idées, à se débrancher car,
vous le savez, même les plus contestataires parmi vous sont happés dans les rouages de la machine… » p.272
« Qui dit « révolte », dit « révolution ». Qu’allez-vous changer dans la société actuelle ? » p.272
« Tout. Absolument tout. La prédation économique qui conçoit cette planète comme une proie à dévorer. Les
rapports sociaux qui, aujourd’hui, ne se conçoivent que sous forme de domination, de concurrence, d’écrasement
des faibles. La politique, ce concentré de bestialité humaine. Les relations entre sexes, cet art suprême de
l’hypocrisie. La famille, ce vivier de chair fraîche pour la machinerie sociale. L’&éducation qui façonne les
crânes des enfants en petits rouages pour les mieux insérer dans le mécanisme. Nous changerons l’objectif des
recherches scientifiques, le but de l’exploration de l’espace, l’application des découvertes en médecine, la notion
du travail, de la valeur des choses produites et des phénomènes naturels, l’essence des liens qui nous unissent les
uns aux autres, notre manière de voir autrui, de lui parler, de la comprendre, de l’aimer… Je continue ? » p.273

VIII
Un homme sans psychologie
Un jour j’ai lu une biographie de Hitler. La description de son enfance m’a intriguée. Ou plutôt la personne de sa
mère, l’amour exalté qu’elle portait à cet enfant chétif, malingre et que les médecins croyaient condamné. Jamais
peut-être la cathédrale de Braunau, la ville natale de Hitler, n’avait entendu sous la nef des prières aussi
ferventes : la mère s’y rendait chaque jour, sombrait dans une déchirante extase de suppliques et de larmes.
L’enfant a survécu, malgré ses tares organiques, les rosseries fréquentes que lui infligeait son père alcoolique, la
pauvreté et plus tard les blessures reçues durant la Première Guerre mondiale. On connaît le reste : son talent de
peintre, modeste mais non négligeable, les échecs de ses débuts artistiques, les premières pitreries nazies qui,
inexplicablement vite, ont donné naissance à une force écrasante, presque magique. Ses postures de tribun, à la
fois clownesques et redoutablement efficaces… Les historiens, les philosophes ont tout expliqué depuis : l’esprit
de revanche des Allemands, plus leur légendaire bellicisme, plus l’homme de la situation qui fédère toutes les
passions dans un rapprochement explosif, semblable à la fusion nucléaire. Le totalitarisme. Oui, on a tout dit là-
dessus. Pourtant, pour moi, le mystère était ailleurs. Je me disais : d’accord, la guerre, la sauvagerie, les
souffrances de millions d’enfants battus et souvent assassinés par leurs proches (à l’époque, j’ai consulté les
statistiques : plus de dix-huit mille enfants martyrisés chaque année en Europe), des meurtres passionnels entre
époux, l’extrême cruauté envers les vieux. Sans parler de la violence criminelle. Mais surtout de quelle paix
peut-on parler si des centaines de guerres locales font des milliers de victimes par jour ? […] » p.324
« Cette révélation a marqué ma jeunesse : pas de frontière entre la guerre et la paix ! Et donc pas de justification
possible pour le carnage qui ne cesse jamais et s’intensifie juste de temps en temps. Cette continuité a été ma
première découverte. Et c’est elle qui m’a poussée vers un constat encore plus stupéfiant : la continuité
psychique préservée à travers les guerres, les paix, les crises, les périodes d’abondance. En fait, l’homme ne
cesse jamais d’éprouver des sentiments, de passer d’un état d’âme à l’autre, bref, d’avoir une vie psychologique.
Le petit Hitler était tendrement aimé par sa mère et atrocement battu par son père. Grandi, il adorait les animaux,
ses chiens surtout et refusait de manger de la viande. Seuls les végétariens avaient grâce à ses yeux, il considérait
les autres come Leichefresser, mangeurs de cadavres. Pendant la guerre, il a continué à aimer ses chiens, à
respecter une diète végétarienne, au milieu d’une Europe couverte de cadavres. Plus généralement, ces centaines
de millions de personnes touchées par la folie d’effroyables massacres continuaient à avoir les mêmes sentiments
qu’en temps de paix : la peur de mourir, le souci d’avoir assez d’aliments, l’attachement à leur famille, l’amour
pour leur femme ou leur mari, la haine, la rancune, la jalousie, l’autosatisfaction, la joie, le bonheur, l’angoisse,
l’indifférence. Une telle constance de notre être psychique me paraissait si ahurissante que je n’aurais sans doute
pas osé aller, toute seule, jusqu’au bout de ma pensée. p.325
L’homme se drogue aux sentiments comme d’autres aux stupéfiants. En grandissant, l’enfant apprend toutes les
gammes psychiques et, peut à peu, l’art d’interpréter ces mélodies émotionnelles devient un plaisir, indépendant
du contenu réel de ce qu’il ressent. Aimer, dominer, être jaloux, faire mûrir une vengeance, pardonner, expier, se
châtier, se laisser saigner le cœur par une parole anodine, rester indifférent face à la souffrance d’un rival, se
délecter de la naïveté d’un simplet, pécher pour défier on ne sait quel dieu, risquer la mort pour tenter la fatalité,
s’apitoyer sur son sort pour pouvoir constater qu’il est plutôt enviable, mentir et se mentir, jouer au révolté, au
persécuté, au mal aimé, à l’amant comblé, au parent qui se sacrifie pour ses enfants, s’immoler sur le feu du
devoir dont on se moquera le lendemain, se prendre pour un saint, un salaud, un repenti, un réprouvé… Tout cela
n’est qu’une infime partie du kaléidoscope psychique que l’homme tourne et retourne, peu attentif au réel qui
provoque ses émois, attiré juste par l’effet passionnel de ce jeu. Oui, un drogué, car le sentiment a son expression
chimique, ces incessants flux d’adrénaline, dopamine, ocytocine et bien d’autres hormones qui soûlent notre
cerveau avec leurs petits paradis. Mais, je le répète, ce n’est pas tant le paradis qui compte, car l’émotion que
l’homme recherche peut être douloureuse, destructrice même. Non, ce qui prime pour cet addict aux sentiments,
c’est sa maîtrise de prestidigitateur : […] on est obligé de constater que la quasi-totalité de l’existence humaine
est un univers psychique fictionnel. p.328

« Golb décrit les deux types de comportement que l’homme adopte, suivant les deux habitudes dont je viens de
parler : ou bien, en zombi pavlovien, il exécute une série d’actes répétitifs (travail, repas, communication avec
son entourage), ou bien, il se drogue en fabulant des drames, des passions, des souvenirs refoulés. Il est rare que
le zombi et le mythomane existent à l’état pur. Chaque individu est à la fois l’un et l’autre, dans des proportions
évidemment différents. […] » p.329
« […] Les sentiments sont des fictions bricolées par l’homme pour son plaisir. Toujours exagérées, romancées,
surjouées, donc fausses. La réalité qui en découle l’est autant. Toutes nos activités, même celles qui paraissent
les plus rationnelles, ont pour mobile cette fiction sentimentale, cette drogue psychique… » p.330
IX
Un homme qu’une femme créera
« La femme que nous avons définie comme « femme maigre aux petits seins » règne en maître dans le tissu
relationnel des sociétés modernes. Essayons de comprendre ce paradoxeet d’en désigner leresponsable.
« Hypothèse I : le responsable serait l’homme, ce mâle d’aujourd’hui dont la dégénérescence physique n’est plus
à démontrer (nombre de tests confirment l’affaiblissement significatif de l’instinct charnel chez l’homme, le flou
grandissant de sa personnalité sexuelle marquée pr la forte tendance « homo » et, au niveau physiologique, la
baisse accélérée de la quantité et de la qualité de son sperme). Ce mâle, déstabilisé par la combaivité actuelle des
femmes, est enclin à chercher une partenaire qu’il puisse dominer au moins par sa corpulence. D’où sa
préférence pour des femmes-adolescentes.
« Hypothèse II : la propagation exceptionnelle de « la femme maigre aux petits seins » est due à la déliquescence
généralisée de la société occidentale. La décadence de toute civilisation se caractérise par le nivellement, la
confusion et l’anéantissement des hiérarchies, des oppositions et des contrastes qui faisaient, autrefois, sa force
et sa vivante complexité. Aujourd’hui, dans le mixage frénétique des races, des classes, des âges et des sexes,
« la femme-adolescente » apparaît comme l’espèce la mieux adaptée à cette égalisation. Le mâle moderne, de
plus en plus orienté vers le modèle homosexuel, réussit à dissimuler son penchant en choisissant ce type de
femmes. Car physiquement et mentalement cette femme est une sorte d’homme, ou plutôt un adolescent
indifférencié.
« Hypothèse III : cette fluctuation des rapports entre les sexes serait imputable au féminisme. Ne voulant plus
être objet (surtout pas un objet sexuel), la femme a progressivement banni tout ce qui, en elle, pouvait être
chosifié, fétichisé érotiquement. Son corps en a été la victime principale, raboté par cet élan vers
l’indifférenciation. Exit le galbe charnu des cuisses, l’évasement voluptueux de la croupe, la lourdeur des seins.
Le sexe féminin s’est réduit à l’unique trace visible : le sexe au sens génito-urinaire du terme. De ce point de
vue, la femme-adolescente est une femme idéale.
« Hypothèse IV : cette femme idéale est le résultat de l’infantilisation de la société occidentale contemporaine.
Ce processus a déjà été maintes fois analysé dans ses composantes principales : le jeu qui envahit la vie sociale,
allant du culte obscène (face à la misère des affamés) du football et du tennis jusqu’à la politiques-spectacle, la
fabrication de l’actualité par la télévision, etc. Le mâle occidental infantilisé par ces jeux veut également jouer au
sexe. Il retombe en enfance et cherche une partenaire qu’il n’a pas eu l’audace de saillir dans sa prime jeunesse :
une jeune fille à peine pubère. Une femme-adolescente. Eh oui, toujours cette « femme maigre aux petits seins »,
sex-symbol de la régression infantile chez les quadragénaires en culottes courtes.
« Chacune de ces hypothèses peut être infirmée ou confirmée, là n’est pas la question. Ce qui compte, c’est le
résultat de cette série de phénomènes plus ou moins bien décodés. Il est simple.
« L’homme moderne est, de facto, un pédophile. S’il ne bascule pas dans la pédophilie criminelle, c’est grâce
aux femmes-adolescentes qui répondent à a spécificité de ses pulsions érotiques. Mais cette réponse est à double
tranchant. La croissance exponentielle des crimes sexuels contre l’enfant prouve une chose : la femme-
adolescente est, certes, un bon dérivatif [p.357] qui peut détourner les intentions pédophiles d’un homme en les
dirigeant vers une vie conjugale apparemment classique. Sauf que cette même « femme maigre aux petits seins »
pousse l’homme à considérer ce type corporel comme le plus propice à la satisfaction de ses désirs. Les femmes-
adolescentes, nous l’avons vu, sont largement majoritaires et se veulent normatives. Ce sont elles qui aujourd’hui
s’arrogent la formation sexuelle de l’homme. Presque tous les « élèves » se plient à cette éducation et finissent
leurs jours en compagnie de vieilles épouses-adolescentes. Quelques forts en thème optent pour une solution plus
originale : au lieu de copuler avec des femmes sans féminité, pourquoi ne pas choisir des hommes qui savent être

plus tendres et plus féminins que les femmes ? L’homosexualité déferlante d’aujourd’hui est due à la recherche
désespérée de la tendresse. Enfin, quelques cancres perturbés par cette sexualité infantilisante déraillent et se
mettent à violer les enfants ou les adolescents qui, charnellement, ressemblent tant un type féminin très
majoritaire de nos jours.
« Il faudrait, enfin, évoquer une hypothèse qui n’a jamais été formulée et qui pourtant explique l’essence de la
mystérieuse domination sexuelle exercée par « la femme maigre aux petits seins ».
« Hypothèse V : la femme-adolescente règne car elle nous permet d’oublier la mort. Sujet tabou, dans la société
actuelle, entourée de mille hypocrisie rhétoriques (« quatrième âge », « fin de vie »…), la mort n’ pas de prise
sur a femme-adolescente car celle-ci ne vieillit pas. Elle se dessèche légèrement, c’est tout. A vingt-cinq ans, elle
a le même corps qu’à quarante-cinq, ou plutôt pas de corps, justement. Une enveloppe physique, réduite au strict
minimum fonctionnel, et qui, certes, jaunit un peu, se ride délicatement sans qu’aucun changement majeur
n’intervienne.
« La femme-adolescente nie le temps !
« Les femmes aux gros seins, aux corps extrêmes, vieillissent, on le sait, avec la visibilité spectaculaire des
cataclysmes. Chaque âge dans la vie de leurs corps est une époque marquante, dramatique. L’affaissement d’une
lourde et belle poitrine est comparable à l’engloutissement d’une Atlantide, le déclin de leur beauté à la mort
d’une galaxie. Leur corps personnifie le Temps. p.358-359
« La femme-adolescente, outre ses multiples avantages, anesthésie notre angoisse métaphysique, notre effroi de
mortels. Elle sait débrancher le mécanisme du temps. Le prix à payer est élevé : l’impossibilité d’aimer. Car
l’amour n’est rien sans la vision extatique de la beauté menacée à tout moment par une faillite physique et la
mort. p. 359
X
L’homme aux vingt mille femmes
« C’est surtout la langue de ce philosophe qui nous intéressera. Non, il ne s’agit pas de son style mais bel et bien
de l’organe qui remplit la bouche de tout un chacun. Nicolas Berdiaev, penseur religieux russe, souffrait d’un
dysfonctionnement de muscles maxillaires : en pleine conversation, trahi par la véhémence de son discours, il
éprouvait une contracture spasmodique, ses mâchoires se bloquaient, sa langue sortait inélégamment de sa
bouche, tel un gros mollusque chassé de sa coquille par la cuisson. Epouvantable spectacle ! Un homme habité
par une idée riche, neuve, claire et qu’il n’arrive pas à articuler.
« […] le fameux tournant linguistique, cet engouement obsessionnel de la philosophie contemporaine pour
l’outil verbal de son expression. Le terme linguistic turn a été introduit, vous le savez, par Gustav Bergmann. Il
s’est aperçu que les philosophes de nos jours avaient un dada : la langue. Le souci du contenu a cédé la place, au
XXe siècle, à l’intérêt exclusif pour la forme. De Platon à Bergson, notre humble langage semblait nous suffire.
Et puis, un jour, les penseurs ont fait cette découverte : la langue humaine est un instrument grossier, redondant,
imprécis, truffé de contresens et de double sens, bref, impropre à dire une pensée rigoureuse. Le majestueux
édifice métaphysique, toute cette architecture célébrant Dieu, Temps, être, néant, âme, esprit et autres Idées
absolues, tout cela n’était donc soutenu que par le bois vermoulu, noueux, mal équarri du langage. Il y avait de
quoi avoir une langue pendante comme celle de Berdiaev. Ou bien plus tragiquement, perdre l’usage de la parole
comme Franz Rosenzweig dont nous avons étudié L’Etoile de la rédemption.
« Ces deux métaphores de mutisme ne sont pas un simple effet de style. Elles permettent de baliser l’impasse où
se retrouvent – et ils le reconnaissent avec plus ou moins de bonne foi – tant de penseurs contemporains. Une
ahurissante pléthore de théories, un verbiage scolastique décuplé grâce aux médias, tout un cirque de postures et,
à côté, l’impuissance progressive à aborder les vraies questions : la fugace splendeur de la chair, la veilleuse
encrassée de l’âme, la croissance quotidienne de la mort en nous. Et l’après-mort. Dieu, enfin.
« Cette problématique n’intéresse pas les philosophes du « tournant linguistique ». La métaphysique devient un
gros mot. Tous ils nous promettent le grand retour vers le monde concret, les choses réelles, les phénomènes
facilement observables. Et comme cette nouveauté doit s’exprimer dans un nouveau langage, ils se jettent dans
les bras de la linguistique, en pondant avec un zèle de néophyte un nombre extravagant d’ouvrages où il est
question de « grammaire de la pensée », de « grammatologie », de « syntaxe »… Aux cris : « A bas toute la
métaphysique, d’Aristote à Hegel ! », ils se prosternent devant leur nouvelle idole – la Langue Pure. p.393
 6
6
1
/
6
100%