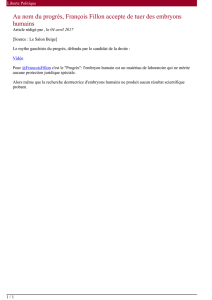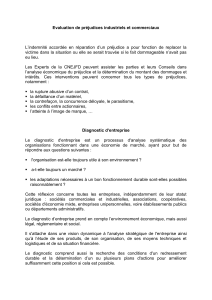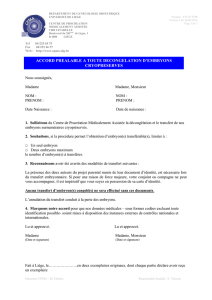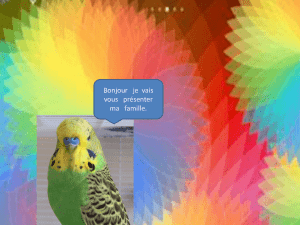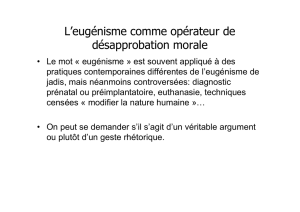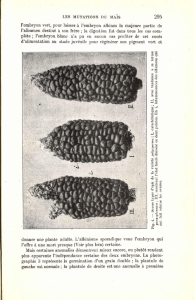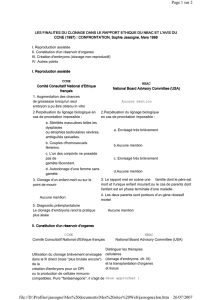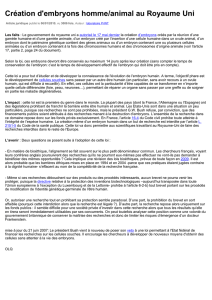Introduction: - Droit

1
L’AFFAIRE PERRUCHE (débat sur les dérives vers un eugénisme libéral)
Année 2002-2003
MULLER Anne-Claire
Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg
4e année, section Service Public

2
Avant-Propos
L’idée du thème de ce mémoire m’est venu alors que j’assistai au cours de Droit de la
biomédecine de Mireille Heers, lors de ma deuxième année à l’IEP. J’ai par ailleurs toujours été
intéressée par les problèmes concernant la responsabilité médicale. En outre, il se trouve que
quelqu’un qui m’est proche souffre de handicaps particulièrement graves, et ce mémoire est en
quelque sorte un hommage que j’essaye de lui rendre, en espérant que ce travail sera à la hauteur
de l’estime et de l’affection que j’ai pour lui.
Je tiens à remercier Monsieur Willy Zimmer pour le temps qu’il m’a consacré et pour ses
précieux conseils lors de l’élaboration de ce mémoire.
Je remercie également toutes les personnes avec qui j’ai pu discuter de ce mémoire, et celles qui
ont bien voulu le relire.
A Paul

3
L’AFFAIRE PERRUCHE
Introduction:
Le Prix Nobel WATSON
1
écrivait «les sciences biotechnologiques nous attribuent des
pouvoirs aujourd’hui que l’on considérait autrefois comme divins ». Ces propos qui peuvent
paraître exagérés semblent pourtant parfaitement fondés lorsque l’on se réfère à l’actualité toute
récente. En effet, il y a quelques mois, l’annonce par la secte raëlienne de la naissance du
premier bébé cloné faisait la une des journaux. La polémique autour de la question du clonage
humain reproductif a alors repris de plus belle, entraînant des débats passionnés qui ont réuni
autant les politiques, les scientifiques, les médecins que les philosophes, en soulevant le délicat
problème de la place de l’éthique dans la pratique médicale et la recherche scientifique.
La question des limites de la frontière éthique se pose de plus en plus ces dernières années avec
les progrès enregistrés par la science médicale, notamment dans le domaine des biotechnologies.
Pour pouvoir mesurer la gravité du franchissement de la barrière éthique dans l’activité
médicale, il convient tout d’abord d’expliquer ce que l’on entend par la notion d’ « éthique ».
L’éthique signifie dans la Grèce antique une sagesse de l’action, elle régule les actes et
donne des repères pour les choix à opérer parmi les moyens qui sont à la disposition du médecin.
Hippocrate (400 ans avant Jésus-Christ) définit la bioéthique comme le respect des patients,
énonçant le principe de la manière suivante : « primum non nocere ».
La notion d’éthique est inhérente à la pratique médicale : elle permet d’orienter les savoirs et
savoir-faire en direction d’un but, d’une finalité, d’un bien. Il y a en réalité différents principes
qui guident l’action médicale. Il y a d’une part les biens de l’individu, comme sa santé, son
bonheur,…et d’autre part les biens de la collectivité et des générations futures. Parmi les grands
principes qui régissent l’activité médicale (comme la bienfaisance, le respect des choix de la
personne, la justice, le respect de la vie humaine et de la dignité humaine,…), un certain nombre
d’entre eux entrent en conflit les uns avec les autres : le principe de bienfaisance avec celui du
1
Scientifique qui a découvert la structure en double hélice de l’ADN en 1951

4
respect de la vie lors de pratiques comme l’euthanasie ou l’interruption médicale de grossesse
2
,
ou encore le principe de justice confronté à celui du progrès de la science avec les
expérimentations sur les malades mentaux, sur l’embryon ou à l’occasion d’essais vaccinaux en
Afrique. Dans le modèle français traditionnel, la priorité du principe de bienfaisance est la règle.
La finalité de la médecine est la guérison face à la souffrance, à la vulnérabilité et à la
dépendance. Le médecin soutient et protège le malade et prend les décisions seul. Le
paternalisme est alors la règle, le médecin se passe du consentement du patient pour ne pas
l’accabler. Cependant, une évolution apparaît, et de plus en plus, le consentement du patient est
nécessaire. Le modèle anglo-américain se singularise pour sa part par l’importance accordée au
respect de l’autonomie du patient : le patient est informé et son consentement est exigé. Le
malade et le médecin sont des égaux dans une relation contractuelle de prestations de services (la
médecine est alors appréhendée comme un bien quelconque où le prix est fixé en fonction de
l’offre et de la demande). L’évolution de la médecine a entraîné, de fait, de nouvelles attentes des
patients à l’égard des médecins et la France se calque de plus en plus sur le modèle anglo-saxon,
même si certaines différences subsistent, comme le fait que le patient français ne soit pas
propriétaire de son corps ou encore que ce qui autorise l’intervention sur le corps du malade,
c’est d’abord la loi. On assiste tout de même à une augmentation de l’utilitarisme et du
consumérisme : les malades et les patients considèrent de plus en plus la médecine et la santé
comme un bien de consommation comme les autres, pour lequel ils payent le prix et attendent en
retour un résultat. Ce glissement progressif vers une exigence de résultats soulève des
questionnements et pose certains problèmes que nous évoquerons plus loin dans notre travail.
Le Professeur HASSELMANN
3
rappelle que l’éthique n’est pas un ensemble de règles
institutionnelles (comme le droit) ni une science ou une technique, elle est bien plutôt un savoir,
un travail de la raison humaine pour penser les valeurs. Depuis toujours, la médecine est
essentiellement, dans son essence même, une démarche éthique : son action porte sur autrui, et sa
finalité est de redonner la santé et le bien-être. Le problème actuel avec les progrès immenses de
la science dans la bioéthique est que l’homme peut agir sur son humanité physique, psychique et
psychologique et peut transformer le monde de sa descendance. Ceci entraîne un conflit de
valeurs contradictoires.
2
Interruption médicale de grossesse : IMG
3
Professeur à la faculté de médecine de Strasbourg

5
Vouloir définir l’évolution du sens du terme éthique à travers l’histoire serait fastidieux,
notamment en raison du trop grand nombre de théoriciens et philosophes qui se sont penchés sur
la question. Cependant, il peut être utile de se remémorer la réflexion actuelle en matière
d’éthique afin de mieux comprendre les enjeux du sujet qui nous intéresse ici. Ainsi, Hans Jonas
considère que l’homme doit agir de telle sorte que « l’humanité soit, que les effets de son action
soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur la terre aussi
longtemps que possible ». Il y a une responsabilité au sens d’une mission à l’égard du plus
fragile et du plus menacé dans le futur. D’autres, comme Williams, accordent une place
fondamentale au contexte dans lequel l’homme évolue. L’individu (et donc le médecin) reçoit de
la société dans laquelle il vit les questions et les réponses éthiques. Cependant, seule une
référence à l’universel permet de mettre à jour des rapports de pouvoir sous-jacents à des
pratiques. On retrouve enfin la doctrine utilitariste. La doctrine utilitariste du 19e siècle, incarnée
notamment par John Bentham et John-Stuart Mill, considère qu’une action est moralement bonne
si elle conduit au plus grand bonheur le plus grand nombre de personnes. Est moral ce qui est
utile. Cette affirmation peut paraître choquante, c’est pourtant ce principe qui guide un certain
nombre de politiques de santé publique menées actuellement. Cette approche a des points
positifs évidents que sont principalement son pragmatisme et sa rationalité. Ses points négatifs
sont cependant au moins tout aussi évidents : cela suppose en effet d’évaluer la notion de qualité
de vie (et donc de supprimer éventuellement celles qui ne sont pas utiles), cela suppose
également que ce qui est utile à un individu l’est pour tout autre et pour la société, et surtout, cela
implique la réduction des actes humains à un calcul coût-avantages/inconvénients. Il est clair
qu’aujourd’hui l’utilitarisme est à prendre en compte et occupe une place importante dans la
réflexion qui préside aux politiques de santé : il y a une nécessaire maîtrise des dépenses de
santé publique. Cependant, il faudrait pouvoir éviter que les patients ou malades menacés dans
leur vie n’entrent dans un marché où la santé serait un produit comme les autres, qu’ils seraient
libres d’acheter ou non. En outre, l’évaluation des coûts expose à l’injustice : à partir de quand
décider qu’un traitement ne vaut pas la peine d’être poursuivi ? Ceci suppose en effet
l’attribution d’un prix à la vie humaine. Il y a donc une antinomie profonde entre l’utilitarisme et
l’idéal de justice, le premier semblant être véritablement incompatible avec les droits de
l’homme.
Il convient de réaliser que les liens entre l’éthique et le droit sont extrêmement étroits et
interactifs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
1
/
98
100%