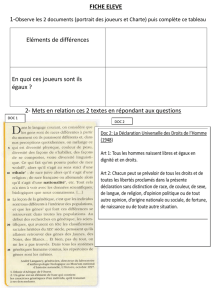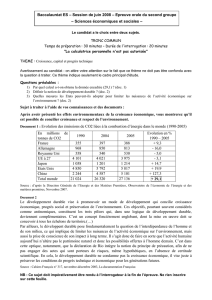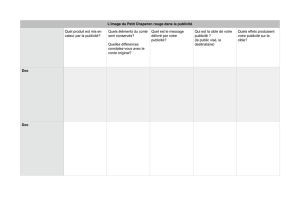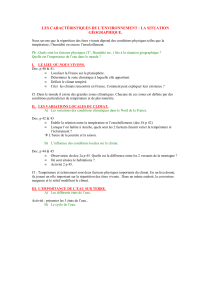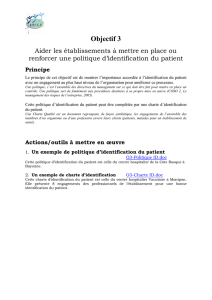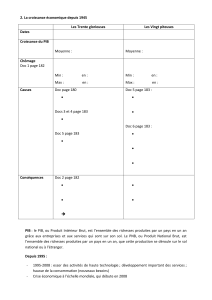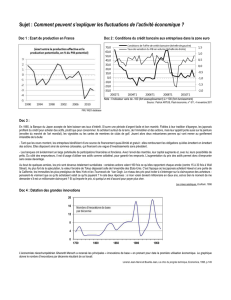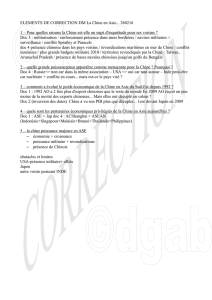Télécharger le fichier

L'expansion de l'Etat connaît-elle des limites ?
Limites peut signifier "frontières" ou "défaillances" : le dossier documentaire et l'intitulé du sujet ("l'expansion
de l'Etat connaît-elle des limites ?" et non "l'intervention de l'Etat connaît-elle des limites ?") invitait à privilégier
le premier sens, et un traitement analytique, positif plutôt que normatif.
Il faut définir l'Etat, par ses fonctions (allocation des ressources, redistribution et stabilisation de l'activité
économique selon Musgrave, coordination des sociétés à solidarité organique selon Durkheim) ou par les
moyens qui lui sont propres (monopole de la violence physique légitime selon Weber, auquel Bourdieu ajoute le
monopole de la violence symbolique légitime)
I) L'expansion de l'Etat, acteur et organisation singuliers, comme contrepartie de la
différenciation des sociétés contemporaines
A) L'expansion de l'Etat est un trait caractéristique des sociétés contemporaines
On peut partir du débat anthropologique autour du choix rationnel qu'opéreraient les sociétés tribales d'un
pouvoir politique non coercitif, soutenu par Clastres (la Société contre l'Etat, 1974) à propos des Guayaki, ou
encore par Evans-Pritchard à propos des Nuer; et récusé par J.-W. Lapierre (Vivre sans Etat ? Essai sur le
pouvoir politique et l'innovation sociale, 1977). Ces positions convergent en ce qu'elles envisagent la
concentration du pouvoir politique comme une figure constitutive des sociétés modernes, différenciées et
hiérarchisées.
Les sciences sociales ont précocement souligné la nécessité de l'expansion de l'Etat. Retenu comme le père
fondateur du libéralisme économique, Smith ne cantonnait pas en réalité l'intervention de l'Etat aux tâches
régaliennes. D'une part, certains biens nécessitent par leurs caractéristiques spécifiques une prise en charge par
l'Etat : c'est le cas de l'éducation, le doc.8 préfigure les analyses en termes de capital humain (G. Becker)
pointant les externalités positives engendrées par son accumulation, et s'inscrit implicitement dans un projet plus
global de La Richesse des Nations, qui esquisse les grandes lignes de l'économie du bien-être : rendements
croissants ou biens publics, pour reprendre les termes utilisés plus tard par les économistes, justifient également
l'intervention publique. Observons par ailleurs que l'argumentation de Smith invoque à la fois le bien-être
collectif et l'intérêt de l'Etat à son auto-conservation.
B) L'expansion de l'Etat répond rationnellement à une demande sociale
Par quels mécanismes le processus polymorphe de différenciation sociale a-t-il mené à l'expansion de l'Etat ?
K. Polanyi a montré à partir du cas britannique comment le mouvement de désencastrement des activités
économiques engendrait par réaction des pressions compensatrices. L'extension de l'économie de marché
déstabilise les relations sociales et les conditions de vie, et des groupes mobilisés font émerger une demande
d'auto-protection. Le système de Speenhamland entre 1795 et 1834, puis plus durablement l'inflexion très nette
de l'intervention publique dans l'entre-deux-guerres, qu'atteste l'évolution des dépenses publiques (doc.4), en
sont des manifestations.
On peut avec D. Rodrik lire dans une perspective similaire l'extension contemporaine de l'intervention de l'Etat
(doc.5). La régression multivariée laisse apparaître trois facteurs fortement significatifs. La structure par âge de
la population détermine le ratio de dépendance rapportant la population inactive à la population active, qui se
répercute sur les dépenses de l'Etat coordinateur de la solidarité collective : une augmentation du ratio de
dépendance accroît mécaniquement les prestations sociales couvrant la maladie, la retraite et la famille.
L'ouverture internationale, en étendant les marchés, appelle également une intervention publique incitatrice et
palliative. Il faut d'une part encourager, voire orienter par des subventions l'innovation, et d'autre part prémunir
par un système de sécurité sociale complet les actifs contre les risques consécutifs à l'internationalisation : aléas
de la demande et les restructurations sectorielles. Enfin, l'urbanisation allège les coûts du maillage territorial par
les services publics. Pouvoir rendre comte des variables explicatives de l'expansion de l'Etat n'est possible que
parce que l'Etat répond par son intervention à une demande sociale.
D. North s'est emparé de cette question en économiste, en montrant que la centralisation étatique de la garantie
des droits de propriété et du seigneuriage monétaire résultait d'un arbitrage rationnel entre les coûts de mise en
place et de gestion de ces dispositifs institutionnels et les bénéfices retirés en termes de coûts de transaction.
C) Cette expansion des fonctions étatiques suppose que l'Etat est un acteur économique et
social singulier : bienveillant, omniscient, omnipotent
Les analyses sociologiques pionnières de l'Etat par Durkheim et Weber, souvent opposées, ont en commun de
le considérer comme doté d'une rationalité supérieure aux agents individuels, en tant que centre de décision
centralisé surplombant la société chez Durkheim, en tant qu'instance motrice de la rationalisation des activités
sociales et la bureaucratisation chez Weber. Cette efficacité singulière est revendiquée par l'Etat lui même : ainsi
le ministère de l'Intérieur diffuse des statistiques mettant en relation le renforcement des contrôles de sécurité et
la baisse de la mortalité sur la route.
Rationalisation, différenciation des sociétés et émergence d'un Etat vont de pair, ce qui explique que la
tendance séculaire à l'augmentation de la part des dépenses publiques soit généralisée à l'ensemble des pays
développés (doc.3). Les limites de cette expansion auraient alors été repoussées au fur et à mesure où les

besoins fonctionnels d'une régulation centralisée s'étendaient. Pourtant, cette augmentation généralisée a laissé
intacte les variations nationales du poids de l'Etat, ce qui nous conduit à réviser cette perspective fonctionnaliste.
II) Les critiques sociologiques et économiques pointant l'hypertrophie de l'Etat ont été
invoquées pour inverser ce mouvement d'expansion.
NB : s'approprier ses critiques peut faire glisser l'argumentation vers le jugement normatif, relier ces critiques
aux réformes des quarante dernières années visant à desserrer l'emprise de l'Etat permet d'éviter cet écueil.
Travaux économiques
et/ou sociologiques
portant cette critique
Préconisations
Réformes réalisées
A) L'Etat
hypercentralisé
La sociologie française
des organisations a pris
comme lieu privilégié
d'observation du "cercle
vicieux bureaucratique"
des organismes publics.
Crozier
doc.1 et doc.2
Assouplir la régulation de
contrôle au profit de la
régulation autonome ou
conjointe (des citations du
doc.1 peuvent être mises en
parallèle avec cette
typologie de J.-D. Reynaud)
- Décentralisation
territoriale (lois Deferre)
- Principe de subsidiarité
- Décentralisation des
négociations sociales
(ex. des 35 heures ou de
la loi de modernisation
du dialogue social)
B) L'Etat
surdimensionn
é
L'école du Public Choice
(Buchanan & Tullock)
L'économie de la
bureaucratie (Niskanen)
Diminuer les dépenses
publiques
Reflux du poids des
dépenses publiques entre
1994 et 2000 (doc.4),
facilité par la reprise de
la croissance.
C) L'Etat
inquisiteur et
tentaculaire
Tocqueville
Elias
Foucault
Privilégier la médiation et la
négociation à la procédure
judiciaire (doc.6)
Les travaux d'I.Théry sur
le démariage montrent
que la médiation peut au
contraire renforcer
l'intrusion étatique dans
la vie privée.
III) Les évolutions récentes de la sphère d'intervention de l'Etat : reflux ou recomposition ?
A) De l'Etat au champ du pouvoir
La critique de la sociologie des organisations oppose les "hauts fonctionnaires", "les grands corps", les
"technocrates", "les élites administratives" au "monde du management", soit implicitement l'Etat aux entreprises.
Cette dichotomie est-elle pertinente ? L'examen des carrières professionnelles et origines des PDG des grandes
entreprises publiques et privées, a contrario réunis par le doc.3, la mettent en doute. En effet, un quart d'entre
eux au moment de l'enquête a connu le "pantouflage". Cette proportion est d'ailleurs majoritaire pour les PDG
enfants de professions libérales et de hauts fonctionnaires. Les trajectoires individuelles manifestent ainsi la
porosité de cette frontière publique / privée, les grands corps de l'Etat fonctionnent objectivement comme une
pépinière de PDG. L'analyse sociologique peut alors substituer à profit comme objet d'analyse la noblesse d'Etat,
groupe homogénéisé par la proximité des origines, des formations et des parcours professionnels à l'Etat, entité
finalement creuse. Les mouvements apparents d'expansion et de reflux de l'Etat peuvent alors être trompeurs, la
noblesse d'Etat maintenant son emprise sur la conduite conjointe des affaires publiques et des activités
économiques. Ainsi, dans le cas du logement, l'apparent retrait de l'Etat avec l'abandon de l'aide à la pierre au
profit de l'aide à la personne dans les années 70 est en réalité une transformation de l'encadrement de l'activité de
construction par l'Etat, sa genèse étant d'ailleurs liée à l'évolution des rapports de force au sein d'un champ
bureaucratique dans lequel l'appartenance individuelle aux secteurs privé ou public n'est qu'un paramètre de
positionnement parmi d'autres plus fondamentaux : la formation, la génération, l'origine sociale, l'expérience.
Lorsqu'on centre ainsi l'analyse sur le champ du pouvoir, le reflux de l'Etat n'apparaît plus comme une tendance
structurelle, mais comme un symptôme à interpréter.
B) Reflux ou désengagement ?
On peut rapprocher les réformes judiciaires (doc.6) d'autres réformes qui au nom de l'efficacité marquent un
désengagement de l'Etat : assouplissement des politiques de la concurrence, effritement du statut du salarié et du

chômeur. On peut aussi évoquer une des monographies qui en ont repéré les effets sociaux (Beaud & Pialoux;
Masclet; Cartier, Coutant, Masclet & Siblot; La Misère du Monde) de ce désengagement.
C) Etat social et Etat pénal
Le doc.9 doit être mis en relation avec des exemples, aux Etats-Unis ou ailleurs, de réformes modifiant
l'équilibre entre la "main gauche" et la "main droite" de l'Etat). Il faut aussi se demander si le cas américain est
exceptionnel ou symptomatique d'une tendance généralisée. La société française contemporaine est caractérisée
par des tensions analogues, mais atténuées.
1
/
3
100%