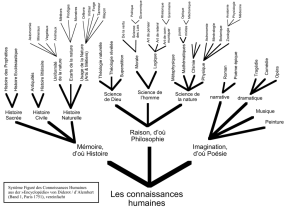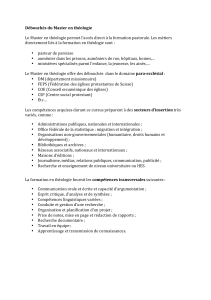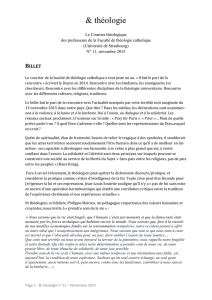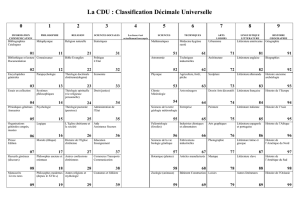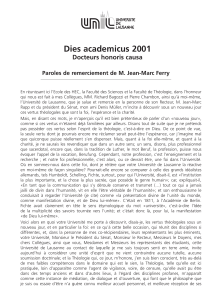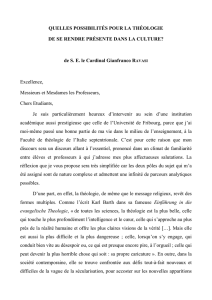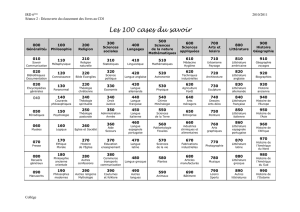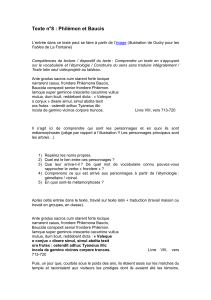Dominique Collin

Communication lors du colloque « A quoi l’homme est-il lié ? De
l’autonomie et de
l’autodétermination ».
« A l’ère du vide, devenir «irremplaçables» ? »
Samedi 12 mars 2016
Où va l’humain ?
Où en est-il en ce début de troisième millénaire ?
Tentons un bilan de santé, qui, sans être exhaustif bien sûr, n’a d’autre mérite que
d’ausculter des symptômes que l’individu postmoderne semble présenter.
Et pour ne pas parler d’un Homme qui n’existe que dans une abstraction universelle,
nous parlerons de cet homme, de cette femme, issus de la modernité occidentale
laquelle dépasse bien sûr les limites géographiques de l’Occident.
1. Diagnostic
a) Cet individu semble vivre dans un rapport au temps dans lequel le présent prend le
pas sur le futur, lequel semble détaché de toute dimension eschatologique. C’est ce que
certains auteurs qualifient de « présentisme ». Une compulsion à la commémoration
semble aller de pair avec une compulsion à l’oubli. Le présent est un espace segmenté,
l’individu passant d’un segment à l’autre avec ou sans « autres », en dehors, semble-t-il,
d’une linéarité qui donnerait « sens » au tout de la vie. (Ainsi du segment de la « vie
privée » vécu sans rapport avec le segment de la « vie professionnelle »). Le segment
qui semble alors être privilégié est celui qui procure le plus de satisfactions en termes de
plaisirs-loisirs. Le segment professionnel est compensé par l’aspiration à la réussite
sociale et, surtout, financière.
b) Cet individu connaît une fragilisation de son identité (laquelle fragilisation n’est pas
perçue en soi comme un affaiblissement de soi): le «bombardement de l’image» (Jean
Baudrillart) entraîne un processus d’identification à des groupements éphémères
rassemblés autour d’une «imagefétiche» (comme une vedette, un film [Stars Wars], une
chanson, le sport, les JMJ sont à ranger dans cette catégorie, etc.). L’individu est sommé
de s’inventer lui-même, ce qui aboutit soit à «la fatigue d’être soi», soit à être fragilisé
davantage à cause des structures lourdes et des

Page 2 sur 7
déterminismes qui pèsent dans la société. C’est la prolifération des micro-sacrifices
consentis à la société (perdre son temps dans les embouteillages, par exemple) ou ceux
que l’on s’inflige à soi même comme « l’art de la défonce » ou le terrorisme qui est une
guerre sans guerre.
c) Cet individu est par conséquent relié (importance décisive des « réseaux ») à des «
tribus », aussi éphémères qu’elles ne lui procurent qu’un fragment d’identité. Il suit
alors volontiers les phénomènes « d’amplification » (bombardement d’informations, de
«buzz») ; ce qui le conduit à exprimer son identité au travers de ce qu’il possède, utilise
ou consomme.
d) Cet individu fonctionne dans un monde où la valeur (la production) est associée à la
destruction (la consommation): il s’ensuit une réversibilité de plus en plus grande entre
le producteur humain et l’objet ou le service produits pour être consommés. Ainsi, un
produit qui est introduit sur le marché joue de cette ambiguïté. Identité réduite à être «
producteur-consommateur-débiteur».
e) Cet individu évolue dans un monde où (presque) tout est juxtaposable, c’est-à-dire à
la fois suspect et acceptable (ainsi en est-il de la sexualité, des libertés individuelles, de
la spiritualité ou du développement personnel, etc.) Tout et son contraire deviennent
possibles, tous les styles et les tendances peuvent exister et se côtoyer.
f) L’individu passe de la structure linguistique communicationnelle « je/tu/il » à celle
qui dit «nous» ou «on».
2. L’homme au miroir de la Parole
Dans cet article intitulé Un discours sur Dieu pour notre société, et publié en 1978, le
théologien louvaniste Adolphe Gesché réfléchit au rapport entre le discours sur Dieu et
la construction de la société. Concluant que l’attitude qui consisterait à refuser purement
et simplement le questionnement sociologique ne serait pas recevable pas plus que celle,
opposée, qui verrait passer «avec armes et bagages [le] théologien à la sociologie1»,
Gesché propose quatre «conditions» qui permettraient «de construire un discours sur
Dieu après le passage à travers la sociologie», conditions qui, «si elles sont
acceptables», précise le théologien louvaniste, «pourraient constituer
1 A. GESCHE, « Un discours sur Dieu pour notre société », dans M. CAUDRON, Foi et société,
Gembloux, Duculot,
1978, p. 47.

Page 3 sur 7
quatre démarches théologiques.2 » La troisième de ces démarches (après celle « d’écoute
» et celle que Gesché appelle « une volonté de purification ») pose « une nécessité de
médiations» afin que la théologie soit «précisément théologie, c’est-à-dire un discours
contrôlé, surveillé, maîtrisé», sans quoi son discours risquerait «très vite de devenir
délirant.3» Parmi ces médiations, il y a bien sûr le discours philosophique et plus
largement celui des sciences humaines.
Mais, à la suite de la réflexion de Gesché, il faut aussi se demander si il est possible - et
à quelles conditions - que la théologie soit une théologie, c’est-à-dire une parole
humaine (comment pourraitil en être autrement ?) qui n’existe que d’être devant Dieu
(coram Deo), au miroir de sa Parole. Si nous devons prendre garde à trop vite (et mal)
parler de Dieu (théologie), peut-être alors est-il préférable de réfléchir (dans le double
sens du français) au témoignage qui atteste que telle parole nous est adressée comme si
elle venait de celui que, par commodité, nous appelons Dieu (théologie).
Est-il convenable de procéder de la sorte à une lecture théologique de la condition de
l’homme postmoderne ainsi que nous venons de la décrire ? Nous dirons qu’une telle
lecture devrait être possible puisque la théologie chrétienne nous dit que Dieu est pour
l’homme, que Dieu est Parole et que l’homme a été engendré par sa Parole de vérité (cf.
Jc 1, 18), qu’ils sont donc fait pour s’entendre.
Du portrait que nous venons d’ébaucher à grands traits, nous pourrions, en première
approximation, dire que l’individu postmoderne semble être en défaut de lui-même
comme sujet. Les symptômes peuvent s’appeler la « désolation des individus », comme
le dit la philosophe française Cynthia Fleury4, de «crise de foi5» comme l’écrit Pascal
Chabot ou ce que René Kaës nomme le «malêtre». Il écrit: «Le malêtre nous dit autre
chose que le malaise: que désormais nous sommes en train de vivre un ébranlement qui
atteint plus radicalement notre possibilité d’être au monde avec les autres et notre
capacité d’exister pour notre propre fin ; cet ébranlement interroge les dimensions
écologiques et anthropologiques de ces mutations. L’être défaille avec ce qui le soutient.
Ce malêtre dans l’humanité de l’homme, dans une large aire de l’humanité, produit à la
fois cette imprégnation sombre et mélancolique qui s’empare des esprits et des corps,
des liens intersubjectifs et des
2 Ibid., p. 48.
3 Ibid., p. 51.
4 C. FLEURY, Les irremplaçables, Paris, Gallimard, 2015.
5 P. CHABOT, Global burn out, Paris, PUF, 2013, p. 28.

Page 4 sur 7
structures sociales, et cette culture de l’excès maniaque et omnipotent.6 » Dans un essai
intitulé Au coeur de l’économie l’inconscient, René Major écrit : « En offrant à plus soif
des objets de substitution au désir du sujet, c’est la soif du manque-à-jouir qu’exploite le
discours capitaliste, mais il ne s’adresse pas au sujet, comme le fait remarquer Lacan. Il
s’adresse à l’individu, c’est-à dire à la fiction d’un sujet sans inconscient ou à un sujet
virtuel. C’est au point que l’individu devient lui-même fétiche comme objet-
marchandise.7 »
Toutes ces analyses et ces réflexions philosophiques, économiques, psychanalytiques
semblent dresser un portrait particulièrement pessimiste de l’être humain et ne sont pas
sans faire penser à la vision luthérienne de l’homme. Pour Martin Luther, «parler de
Dieu, c’est en soi parler à l’homme.
Car comment pourrait-on parler de Dieu autrement que d’un Dieu qui concerne
l’homme en tant que tel ? Or, si la certitude est partie intégrante du discours sur Dieu,
alors ce discours est, dans la mesure où il est adressé à l’homme, une certitude qui rend
certain. Cela ne constitue pas simplement un aspect formel en plus du contenu du
discours sur Dieu, ni simplement un des aspects partiels de la question de savoir à quel
point Dieu peut bien concerner l’homme. Pour Luther, la certitude est plutôt la
quintessence même de l’être de Dieu auprès de l’homme et donc de l’être de l’homme
auprès de Dieu. En présence de Dieu, et là seulement, il n’y a pas d’incertitude. Or,
l’incertitude, c’est le péché de l’homme, la certitude, son salut.8»
La question de la certitude est intrinsèquement liée à la justification puisqu’elle ne peut
être donnée, pour Luther, par les oeuvres. Celles-ci sont incapables de garantir une
bonne conscience. Au contraire, la certitude doit être là d’abord, c’est-à-dire que
l’homme doit se savoir accepté, recueilli, aimé en dernière instance par Dieu, pour être
libre pour l’amour. La certitude de la justification, qui est le droit pour chacun de se
sentir justifié d’exister comme il existe, l’individu ne peut donc pas se la donner à lui-
même. Peut-il alors la demander aux autres ? Les autres sont facteurs de jugements
particuliers qui prétendent tous à l’universalité, d’affrontement permanent du soupçon et
du démenti, de la médisance et de la louange, de la calomnie et de la réhabilitation.
C’est pourquoi, comme l’écrivait Karl Barth, il n’y a pas « d’expérience humaine de la
justification9 ». La certitude
6 R. KAES, Le Malêtre, Paris, 2012, Dunod, p. 4.
7 R. MAJOR, Au coeur de l’économie, l’inconscient, Paris, Galilée, 2014, p. 42.
8 G. EBELING, Luther. Introduction à une réflexion théologique, Genève, Labor et Fides, 1983, p. 209.
9 K. BARTH, Dogmatique, 18, p. 203.

Page 5 sur 7
de la justification est donc eschatologique10, à la fois parce qu’elle est différée, en
langage psychanalytique, on dirait qu’elle laisse à désirer ; mais aussi parce qu’elle
constitue l’épreuve décisive de l’identité d’un être humain, ce qui lui donne ultimement
d’exister comme sujet11. Pour reprendre le célèbre et mal compris adage théologique de
Luther, l’homme est simul peccator et justus, à la fois pécheur et juste. Pécheur, il l’est
tant qu’il ne vit pas dans la certitude que son existence est justifiée, juste il l’est déjà en
tant qu’il croit que Dieu l’a engendré par sa parole de vérité. De même, nous pourrions
dire que l’homme postmoderne exprime à sa mesure cette dualité:
il est à la fois individu et sujet, aliéné et émancipé, sans futur ni passé et présent à
l’avenir. Si l’on voulait forcer quelque peu le trait, j’oserais même dire que l’individu
postmoderne est peut-être davantage mûr pour la foi que les figures anthropologiques
historiques et culturelles qui l’ont précédé12. Il partage en effet avec la foi une même
excentricité : « Dans tous les actes de croire,
celui qui croit est d’un côté « chez lui », d’un autre côté « hors de lui ». Tenir ensemble
ce «chez soi» et cet «hors de soi» fait l’effort de la foi, son courage et, dit selon une
expression plus paradoxale, sa réussite.13 » La foi dont on parle ici n’est pas la forme
presque caricaturale de l’acceptation de telle doctrine ou de tel dogme mais un acte de
parole qui promet, c’est-à-dire « une
parole qui engendre, qui d’elle-même porte des fruits de parole. Il y a moins à attendre
d’elle un résultat ou une production (comme on l’attend d’un engagement) que sa
propre fructification.14 »
L’acte de parole qui engendre l’engendré, c’est la « parole inaugurale15 » pour parler
comme Maurice Bellet : dit dans un langage qui n’est pas de soi religieux (et qui n’y
conduit pas nécessairement), une telle promesse, epangelia, est l’événement surprenant
d’une parole qui ne peut se dire que sous une forme langagière elle-même surprenante :
l’évangile, euangelion.
10 Pour Gesché : « la théologie ne doit pas hésiter à tenir le discours de son langage, sans chercher, à tout
coup, à mimer
celui des autres. Or ce langage, un langage propre, est celui de l’eschatologie (en termes séculiers, plus ou
moins
adaptés : utopie), langage indispensable et spécifique. » (op. cit., p. 59. Je souligne).
11 « Le terme même de justification exprime […] un jugement qui n’est pas encore donné et une justice
qui est en train
de se faire (iusti-ficatio). » Hans-Christoph ASKANI, « La parole suspendue dans l’air ou la foi selon
Luther », dans P.
GISEL (éd.), Les constellations du croire. Dispositifs hérités, problématisation, destin contemporain,
Genève, Labor et
Fides, 2009, p. 100.
12 « Il n’est pas illégitime de se demander si ce n’est pas parce que nous ne sommes justement pas
désenchantés, parce
que nous sommes encore croyants, et particulièrement encore protestants, que notre monde, notre
capitalisme, est si
fécond. » (Mark ALIZART, Pop théologie, Paris, PUF, 2015, p. 11).
13 Ibid., p. 90.
14 J.-L. NANCY, « La vérité de parole », dans J. BIRNBAUM (sous la dir.), Qui tient promesse ?, Paris,
Gallimard,
2015, p. 12.
15 Que ce soit une parole signifie que la foi s'ancre bien dans ce qui fait l'humain de l'homme pour tous les
hommes.
Donc, la foi n'est pas particulariste ou contingente à une histoire, une culture, une tradition. Page 6 sur 7
 6
6
 7
7
1
/
7
100%