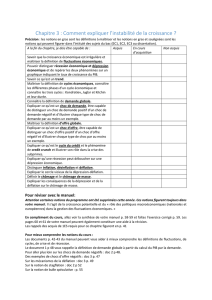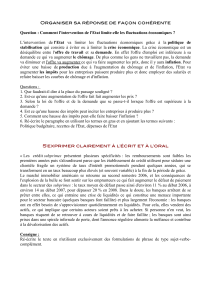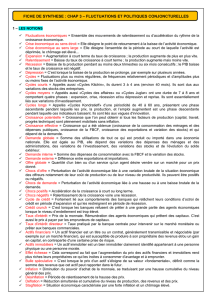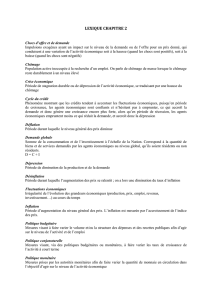Chapitre 1 Economie – Croissance, fluctuations et crises 1.2

Chapitre 1 Economie – Croissance, fluctuations et crises
1.2 Commente expliquer l’instabilité de la croissance ?
Thème
Notions
Indications complémentaires
1.2 Comment
expliquer
l'instabilité
de la
croissance ?
Fluctuations
économiques,
crise
économique,
désinflation,
dépression,
déflation.
L'observation des fluctuations économiques permettra de mettre l'accent sur la variabilité
de la croissance et sur l'existence de périodes de crise. On présentera les idées directrices
des principaux schémas explicatifs des fluctuations (chocs d'offre et de demande, cycle du
crédit), en insistant notamment sur les liens avec la demande globale. On analysera les
mécanismes cumulatifs susceptibles d'engendrer déflation et dépression économique et
leurs conséquences sur le chômage de masse.
Acquis de première : inflation, chômage, demande globale (relire le chap. Régulations et
déséquilibres)
Fluctuations économiques : Ensemble des variations du rythme de la croissance économique.
Crise économique : désigne le moment de retournement de la tendance de l’activité économique qui
met fin à l’expansion pour déboucher sur une récession.
Désinflation : désigne une réduction de l'inflation, dans le cas où celle-ci reste néanmoins positive.
Dépression : Baisse durable de la production.
Déflation : Baisse durable de l’indice des prix, baisse cumulative des prix, revenus et production (cercle
vicieux)
A) L’activité économique est soumise à d’importantes fluctuations
Document 1 - L’évolution du trend de croissance de l’économie française
Le PIB augmente tous les ans sur le long terme : on produit chaque année un peu plus. La
croissance a tendance à ralentir depuis 1975 (premier choc pétrolier) les richesses continuent à
augmenter chaque année mais moins vite qu’avant. Ces évolutions sont liées à des phénomènes
quantitatifs : capital, travail, progrès technique… (ex : accumulation du capital, augmentation de
la population). On a aussi des phénomènes plus structurels, de fond dans l’économie
(urbanisation, tertiairisation). La croissance augmente donc régulièrement. Sur le court terme,
on a des fluctuations (prix, emplois, production). La croissance du PIB varie de façon plus ou
moins cyclique avec des phases.

Document 2 - Une croissance instable
L’expansion désigne un phénomène d’accélération conjoncturelle du rythme de croissance de
l’économie par rapport au taux moyen de croissance de longue période. A ne pas confondre avec
la notion de croissance économique qui désigne l’augmentation soutenue et durable du PIB en
volume d’une économie.
On parle de récession dès lors qu’un pays enregistre deux trimestres consécutifs de contraction
de son PIB réel. A ne pas confondre avec la notion de dépression qui désigne une baisse durable
de la production.
On désigne par la notion de crise le moment de retournement de la tendance de l’activité
économique qui met fin à l’expansion pour déboucher sur une récession.
La reprise quant à elle désigne le moment de retournement de la tendance de l’activité
économique qui met fin à la récession ou dépression pour déboucher sur une phase d’expansion.
Fluctuations économiques : Ensemble des variations du rythme de la croissance économique.
Court Terme
Long Terme
Hausse du PIB
Expansion
Croissance
Baisse du PIB
Récession
Dépression
Document 3- Croissance potentielle et croissance effective
Croissance potentielle : Croissance maximale que peut obtenir un pays s’il mobilise tous ses
facteurs de production (K, T, PT) et cela sans déclencher de tensions dans l’économie (inflation).
Courbe de Phillips (NZ, 1958)
- Phillips a fait cette étude pour la Grande-Bretagne et a constaté que quand le chômage est
élevé, les salaires sont bas. (Employeurs en position de force, ils ont l’embarras du choix).
Un taux de chômage élevé signifie une inflation faible.
- Si le Chômage est bas, les salariés sont en position de force et peuvent exiger une hausse de
salaire
Cette courbe illustre l’idée de tensions sur le marché du travail (tensions inflationnistes).
Il peut aussi y avoir des tensions avec le capital (pannes, casses, rendement marginal décroissant…)
Croissance Effective : croissance effectivement constatée à un moment donné dans une économie,
réellement obtenue par le pays.

La Croissance potentielle varie en fonction du facteur travail (si la population active est élevée, la
production potentielle sera élevée), du capital (investissements pour renouveler/ accroître le CF), du
progrès technique qui détermine la capacité à améliorer la productivité globale des facteurs, à repousser
la contrainte technologique.
La croissance effective dépend de la consommation finale des ménages, des administrations publiques,
de la FBCF, de la demande extérieure et de la variation des stocks.
Le niveau de croissance des pays émergeants dépend de l’investissement (ils ne sont pas victimes de la
loi des rendements décroissants) et du passage d’une économie Etatisée à une économie de marché.
(Exemple pour la Chine fermeture des entreprises d’Etat et déplacement des travailleurs vers le secteur
privé). Cela amène des transformations structurelles. Les travailleurs passent d’emplois improductifs à
des emplois productifs.
Le niveau de croissance des pays développés dépend du progrès technique (PGF) ce qui permet de
dépasser la loi des rendements décroissants et la population faible.
Lorsque la croissance effective dépasse durablement la croissance potentielle, il y a des
tensions dans l’économie (inflation.)
Si la croissance effective est inférieure à la croissance potentielle, cela signifie qu’on ne
mobilise pas toutes les capacités de production (machines pas utilisées au maximum). Il y a
donc du chômage puisque les capacités de production ne sont pas toutes employées.
Si la croissance effective est durablement inférieure à la croissance potentielle, la croissance
potentielle va diminuer (ex : travailleurs au chômage n’acquièrent pas d’expérience, si les
investissements des entreprises ne sont pas faits, la production baisse ; s’il n’y a pas
d’investissements dans R&D il y a moins d’innovations…) Donc la croissance potentielle
devient plus faible.
Doc 4- Ecart entre le PIB réel et le PIB potentiel de la France
Lorsque l’outgap est positif (écart de production positif), cela se traduit par des pressions inflationnistes
car il y a hausse de salaires, augmentation de la demande sur les marchés de matières premières.
(Entraîne la hausse des prix)
La crise des Subprimes a fait que la croissance effective était inférieure à la croissance potentielle, on
n’utilisait pas toutes les capacités de production.
La croissance effective dépend de la fluctuation de la demande globale. (Crise des subprimes :
entreprises n’investissent plus, consommateurs consomment moins…)
Doc 5 – Progrès technique et croissance potentielle
Lors de l’introduction des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de Télécommunications), les
gains de productivité n’ont pas été visibles dès le début. En effet les NTIC se sont diffusés dans
l’économie à parti de 1980 mais c’est seulement au milieu des années 1990 qu’ils ont permis

d’augmenter la croissance économique. Le « Paradoxe de Solow », désigne l’idée que le progrès
technique se diffuse sans effets sur la croissance. Avec l’informatique, ce paradoxe n’est plus d’actualité.
Les éléments qui limitent la croissance potentielle de l’économie sont que l’accumulation de capital
technologique et l’accumulation de capital humain n’est pas suffisante : cela limite notre capacité à
innover donc notre croissance potentielle. La croissance potentielle dépend du niveau d’investissement
dans le capital Humain et le capital Technologique. Il a fallu investir dans le capital Humain avec
l’informatique pour les former.
Doc 6 – Evolution de l’Ecart de production et évolution du taux de chômage aux
Etats-Unis
Quand l’écart de production augmente, le taux de chômage diminue.
A l’inverse, quand l’écart de production diminue, le taux de chômage augmente.
Le taux de chômage 0 n’existe pas, quand l’écart de production est nul, le chômage tourne autour de 6%.
En effet certaines personnes ont des qualifications qui ne sont pas en adéquation avec les besoins des
entreprises, on parle de chômage structurel.
Il existe un autre type de chômage, le chômage frictionnel, qui est un chômage de transition.
Synthèse
L’économie est tout d’abord marqué par des tendances longues. Le trend de croissance correspond à la
tendance à long terme de la croissance. Il repose sur des mouvements quantitatifs (augmentation de la
population, augmentation de la production) et structurels (urbanisation, qualification,…).
On peut observer deux grandes tendances pour la croissance française que l’on retrouve dans la plupart
des pays avancés : la croissance baisse au cours du temps, et la croissance du PIB varie à court terme de
façon plus ou moins cycliques avec des phases. La croissance connait ainsi des phases d’accélération
conjoncturelle par rapport au taux moyen de croissance de longue période (expansion), de diminution de
la production (on parle de récession pour désigner une période d’au moins deux trimestres consécutifs
de recul du PIB, et de dépression qui désigne une baisse durable de la production). La crise est le
moment de retournement de la tendance de l’activité économique qui met fin à l’expansion pour
déboucher sur une récession. Enfin la reprise désigne le moment de retournement de la tendance de
l’activité économique qui met fin à la récession ou dépression pour déboucher sur une phase
d’expansion.
Les économistes déterminent la croissance potentielle de la production d’une économie. Il s’agit de la
croissance maximale que peut obtenir un pays lorsqu’il mobilise tous ses facteurs de production
(population active, équipement, productivité) sans déclencher de l’inflation. Elle résulte de la
combinaison de l'offre des facteurs de production : capital (mesuré par la FBCF), travail (croissance de la
population active) et progrès technique (mesuré par la productivité globale des facteurs). Les projections
de croissance potentielle reposent sur des hypothèses qui reflètent les tendances passées observées, et
ne constituent donc pas des prévisions.

La croissance effective correspond à la croissance réellement obtenue par le pays. Elle dépend
essentiellement des variations de la demande globale qui comprend la consommation finale des
ménages et des administrations, l’investissement en capital fixe des entreprises, des ménages et des
administrations publiques, les exportations, et la variation des stocks.
L’écart de production (output gap) représente l’écart entre le niveau réel du PIB et la production
potentielle.
Lors d'une phase d'expansion, l'écart diminue, et peut même s'inverser : la production est
temporairement supérieure à son niveau d’équilibre. Dans ce cas, l’inflation est en augmentation, car il y
aura des pressions à la hausse sur les coûts de production (en particulier les coûts du travail) ce qui
augmente les prix des biens et des services. Inversement, dans les périodes de récession, le PIB croît
moins vite que la production potentielle et l’écart augmente, ce qui se traduit par une augmentation du
chômage. Une économie qui connait une production effective durablement inférieure à la croissance
potentielle risque de dégrader à long terme son potentiel de croissance (diminution de l’employabilité,
fuite des capitaux,…).
B) Comment explique-t-on les fluctuations économiques ?
Doc 7 – Sensibilisation - l’exemple de la crise de 1929
Les crises préindustrielles étaient des crises liées à des problèmes extérieurs à l’économie : on était
souvent soumis à des aléas climatiques ou biologiques. Il y avait une diminution de l’offre, de la
production agricole, des moyens de production… Lorsque ces problèmes survenaient, les prix
s’envolaient, tuant la moitié de la population qui ne pouvait plus se nourrir.
Pour les crises modernes, c’est l’inverse : il y a un excès de production par rapport aux capacités d’achat
du marché. Autrement dit, il y a crise de surproduction par rapport aux besoins solvables. La crise
précapitaliste était une crise de sous-production, la moderne de surproduction. Les économistes
classiques pensaient qu’il ne pouvait y avoir de crise de la demande car « l’offre créait sa propre
demande », c’est la loi des débouchés de JB Say. La crise de 1929 est la preuve du contraire (choc de
demande négative)
Dans les années 1920 aux Etats-Unis, il y a une expansion très rapide accompagnée d’un chômage bas.
Apparait alors le Taylo-fordisme : développement de la production de masse qui permet la
consommation de masse, le tout étant financé par le recours abondant au crédit.
Le taylorisme est l’organisation scientifique du travail (OST) : on va diviser la production en une série de
gestes très simples qu’on peut confier à des travailleurs peu qualifiés. Ces gestes simples sont
chronométrés pour faire des gains de productivité. Les travailleurs sont payés à la tâche, en fonction de
leur productivité.
La Bulle spéculative de 1929 :
Très fort développement de la bourse à cette époque, on incite les gens à acheter des actions. Le
président Hoover dit alors «la prospérité est au coin de la rue ». La bourse va se développer grâce au
crédit (on achète une action en s’endettant) provoquant un effet de levier.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%