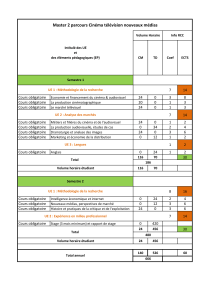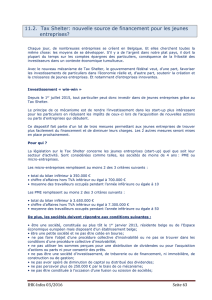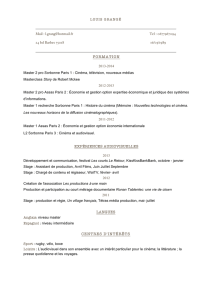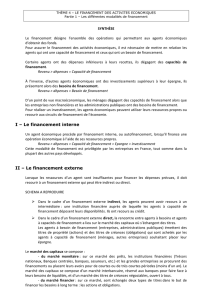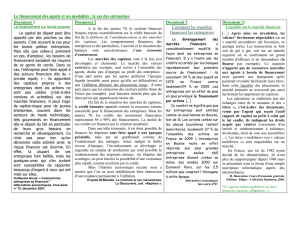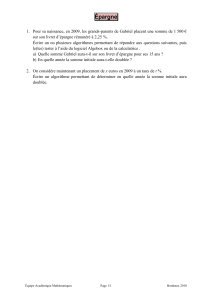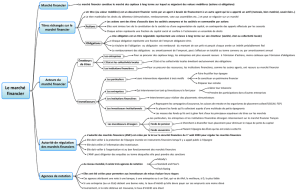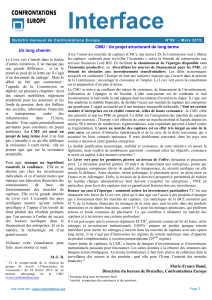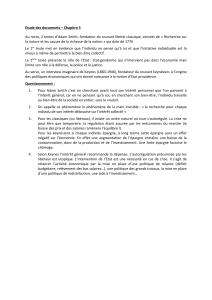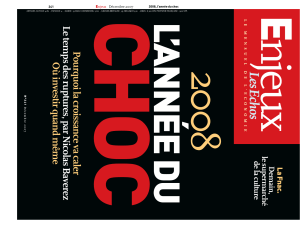Catalogue d`idées pour développer le financement des industries

Catalogue d’idées pour développer le financement des industries culturelles
Lorsqu’ ils développent leur art et leur créativité, les artistes, les créateurs, les entreprises et
industries culturelles sont porteurs de changements, de dynamisme économique, de développement
local, de cohésion sociale et de mise en valeur des identités culturelles. De la sorte, ils contribuent à
la vitalité culturelle et économique, tout comme à la notoriété de leur Communauté. Il est donc
important de les soutenir adéquatement.
Quand on participe aux ateliers, colloques, séminaires et conférences organisés par les secteurs de
l’audiovisuel et du cinéma on est confronté au grand débat qui secoue le milieu des auteurs,
scénaristes, réalisateurs et producteurs : Est-ce que les financements publics ou privés doivent se
développer ? Et si oui, comment ?
La question du financement est cruciale. Le budget et le financement d’un film, d’une pièce, d’une
œuvre ont une influence plus ou moins marquée sur le processus de création. Tous les réalisateurs
l’affirment, les contingences de production, les réalités budgétaires d’un projet et la façon concrète
dont est utilisé l’argent ont une incidence sensible sur l’œuvre.
Qu’en est-il au pays des fabricants de rêve?
La cinématographie francophone belge dans son ensemble est avant tout une cinématographie
subventionnée. Sans aides, elle ne pourrait subsister. Si on considère exclusivement les critères
commerciaux habituels d’audience, d’entrées et de chiffres d’affaire, le cinéma belge francophone
n’existerait pas.
Le dispositif de soutien est sophistiqué et complexe, il est à l’image de l’organisation politique de la
Belgique et de la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les Communautés. Une cascade
d’aides publiques multiformes et enchevêtrée ; fédérales (Tax Shelter, crédit d’impôt…), régionales
(Wallimage(2), Bruxelleimage, Fonds d’investissement culturel « stART »(3), Cultuurinvest…) et
communautaires (nombreux mécanismes de soutien prodigués par le Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel (CCA): aides à l’écriture, à la production, à la finition, à la distribution, à la promotion…)
constituent une jungle intimidante.
Ce prodigieux réseau public de secours est lent. En effet, la plupart des mécanismes de soutien
s’activent quand il y a possibilité de cofinancement, ce qui ralentit considérablement le processus de
financement. Pour avoir accès à l’aide à la production du CCA, il faut amener d’autres financements.
Etablie sur le même principe, l’aide européenne (programme MEDIA 2007(4) et Eurimages (5)) est
elle aussi difficilement mobilisable. Pour l’obtenir un porteur de projet doit réunir au préalable
l’équivalent de la somme apportée par l’Europe. Bref, financer son film est un véritable parcours du
combattant. Pour qu’un film se fasse, en se procurant des fonds de manière classique (recours aux
télévisions, au Tax Shelter, etc.), il faut parfois attendre plusieurs années. Joachim Lafosse, le
réalisateur de Nue Propriété a dû attendre près de 5 ans !
En outre, ce dispositif d’encouragement public est relativement injuste. En effet, ses dons ne sont
pas automatiques (comme en France par exemple) mais sélectifs. Les subventions ne se distribuent,
à chaque échelon du dispositif, qu’au travers de commissions de sélection. Ce processus est
cohérent dans le cadre d’une manne publique peu volumineuse et peu extensible. Cependant toute
sélection soulève un problème moral : où est la démocratie du soutien quand une poignée
seulement de projets est soutenue ? Par exemple, les habitués des commissions qui, en étant à leur
3e ou 4e film, peuvent s’attendre à une aide devenue quasiment automatique empiètent ainsi
sensiblement sur les jeunes générations qui peinent à voire leur 1er film soutenu…

D’autre part, ce système de financement est politiquement menacé à terme puisque l’Union
européenne critique fermement le système des aides publiques.
Dans ce contexte, deux lignes de force se dessinent en Belgique :
- Soit les films sont obligés de passer par la coproduction, ce qui ralentit considérablement le
processus de production.
- Soit on tourne dans des conditions « low budget » et les gens sont sous-payés (ils perçoivent
une fraction d’une rémunération normale et en guise de compensation une participation
aléatoire aux recettes).
Postulats quasi nécessaires pour le financement de la culture
Le véritable danger qui planera sur la pérennité de la création et de la production culturelle est moins
la répétition de tempêtes budgétaires que notre difficulté à élaborer une stratégie d’alliance,
régionale, communautaire, fédérale et européenne avec les anciens et les nouveaux acteurs du
financement de ces industries. Le renoncement serait insupportable, en fait il serait même suicidaire.
Le seul financement public, chroniquement insuffisant, ne donne pas la capacité à la télévision, au
cinéma, au théâtre, à l’opéra, etc. de répondre à leurs défis respectifs. Dans ces secteurs, les acteurs
historiques ne peuvent prétendre réaliser leurs missions comme ils l’ont fait dans le passé. De
nouveaux acteurs du financement vont faire irruption sur la scène, leur participation à la
construction de l’univers culturel et informationnel, dont les coûts explosent, est inéluctable.
L’impérieuse nécessité de développer un modèle alternatif complémentaire aux subventions
publiques est patente. Ce nouveau réseau de financement sera privé. Les deux systèmes ne sont pas
antinomiques. En fait, bien conçus, ils se complètent. La Monnaie l’a bien compris et combine
prodigieusement subvention publique et mécénat individuel. Ainsi l’opéra Semele (qui a ouvert la
saison) de Handel n’aurait certainement pas été possible sans l’apport financier important d’une
mécène chinoise.
L’alliance de l’Etat et du privé est donc non seulement utile mais indispensable, à condition de la
bâtir sur un mode qui en nourrisse et garantisse l’équilibre. La puissance publique y trouvera le
moyen de répondre à ses propres besoins pour assumer pleinement ses missions (création,
émulation, rayonnement et pérennisation de notre patrimoine culturel). Loin de l’abandon, l’alliance
se révèlera à la fois vecteur de régulation, moyen d’une affectation optimisée de la ressource
publique et facteur d’une mobilisation financière et intellectuelle générale. Ce modèle allège le
fardeau de l’Etat dans l’exécution de missions coûteuses.
Certes, la distribution des subsides est sélective et on peut craindre que le financement privé opère
lui aussi un tri selon ses propres critères. Cependant, les motivations d’intervenir chez les
investisseurs privés, fortunés ou non, étant multiples (capitalistes, mais aussi altruistes), les critères
de sélection eux aussi seront variés, ce qui présage une diversité certaine dans la création artistique.
S’interroger sur l’implication des différents types de financement privé est un luxe que le secteur de
la culture ne peut pas se permettre aujourd’hui – à l’heure de la crise des finances publiques, de la
disette budgétaire et de la glaciation des subventions. L’urgence est plutôt à une réflexion sur
comment engendrer de nouveaux soutiens financiers afin de rendre pérenne la création culturelle.
De manière concomitante au développement d’un modèle de financement privé, on peut encore
faire évoluer le système des aides de l’Etat car celui-ci n’a pas atteint ses limites. En repensant son
mode opératoire on pourra le rendre plus efficace, notamment en faisant en sorte que les subsides
s’ouvrent prioritairement au « low budget ». En effet, avoir la possibilité de tourner des films low
budget permet à une jeune génération de cinéastes courageux d’éclore, de faire ses armes, de

travailler, d’expérimenter, de progresser, de se révéler pour le plus grand bonheur de l’inventivité
artistique…
Le financement privé est un filon pratiquement inexploité
Qu’est-ce qui freine le développement des industries culturelles ?
Raisons généralement avancées : le ralentissement économique, l’absence de moyens, une
trésorerie dégradée. Or c’est probablement quelque chose de plus diffus, de sous-jacent qui les
freine. Un mélange d’inertie et de fatalisme, alimenté par une méconnaissance de toutes les
catégories de financeurs potentiels, à fortiori une ignorance de la manière de mobiliser ceux-ci et
une incompréhension des possibilités de financement qu’offre un marché financier élargi. Ce
mélange agit comme un éteignoir de la créativité financière et consume l’énergie de tous. Il faut se
rendre compte du pouvoir envahissant de la résistance au changement chez certains responsables
financiers d’entreprises à vocation culturelle, quelque chose d’inébranlable, de résistant, de la nature
du granit...
Nombre d’entre eux, trop habitués au parcours balisé de la chasse aux subsides, ignorent ou feignent
d’ignorer le recours au financement privé. Par exemple, beaucoup d’entreprises culturelles adoptent
le statut d’ASBL (ou de société coopérative), ce qui leur permet de se financer de manière originale
en mobilisant l’épargne de proximité (les gens du quartier notamment). Ainsi un théâtre de quartier
peut émettre des obligations pour se financer et dans ce cas la procédure de levée de fonds est
moins contraignante que pour un classique appel public à l’épargne. En réalité, assez peu de théâtres
explorent cette voie de financement. Evidemment, l’appel aux capitaux privés exige un effort ; une
communication différente et plus astreignante.
Dans la filière des industries culturelles, la connaissance du financement privé se limite souvent aux
sponsors. Parfois, certains responsables financiers mentionnent également le Tax Shelter. Les plus
avertis d’entre eux arrivent à en expliquer le mécanisme et débattent sur les possibilités de
transversalités et de complémentarités avec d’autres subsides régionaux et communautaires.
Mais peu nombreux sont ceux qui explorent les possibilités qu’offre l’épargne des particuliers.
Fondamentalement, la culture crée un formidable lien social. En apprenant à communiquer sur ce
phénomène et en tablant sur le capital sympathie dont jouissent bien des entreprises à vocation
culturelle, il devient possible de mobiliser des fonds privés auprès d’un large public.
Le Tax Shelter a montré la voie. Il s’agit d’un modèle de financement émergent et pourtant,
avec environ 250 millions d’euros investis dans le cinéma belge et plus de 4200 contrats
d’emplois créés (Contrats à Durée Déterminée), le Tax Shelter est déjà devenu , en six ans, la
première source de financement du secteur audiovisuel belge. Ce mécanisme fiscal a permis
de quadrupler les fonds disponibles pour notre cinéma. Alors que 95 % des films de fiction
produits en Belgique (malgré de nombreuses récompenses) sont des échecs commerciaux !
Néanmoins, ce véhicule financier a propulsé le secteur de l’audiovisuel belge en finançant
des dépenses structurantes pour l’industrie audiovisuelle locale. Ces six dernières années, le
nombre de films 100 % belges a augmenté de 216 %, le nombre de coproductions
majoritairement belges a lui cru de plus de 266 %.
Dans ce modèle de financement, les investisseurs privés s’en remettent au savoir faire des
sociétés intermédiaires qui commercialisent le Tax Shelter. Ainsi, selon l’intermédiaire choisi,
les investisseurs recrutés ne savent pas dans quels films ils placent leurs billes, ce qui permet
d’éviter qu’ils ne choisissent que des films commerciaux, donc plus rentables. Certains
intermédiaires mutualisent les risques de leurs investisseurs en plaçant leur argent dans des
« paniers » d’œuvres comprenant à la fois des films d’auteur et des films plus grand public.

Même des banques (Dexia, Fortis, ING) se sont mises à commercialiser le Tax Shelter, en
s’adressant directement et exclusivement à certains de leurs clients fortunés, qui forment de
la sorte des « Club Deal »ou petits clubs privés d’investissement (jet-set money). Cela
montre que le principe de fonds collectifs d’investissement alimentés par des capitaux privés
s’applique aisément au domaine de l’audiovisuel et du cinéma.
Les perspectives d’avenir pour le Tax Shelter sont appréciables. En fait, de plus en plus
d’entreprises investisseuses sont attirées par les rendements minimum garantis (véritables
valeurs refuge en temps de crise) et le mécanisme commence à être bien compris. Le nombre
d’intermédiaires spécialisés commercialisant ce mécanisme fiscal pourrait se multiplier.
Actuellement des investisseurs (privés et fortunés) sont en train de remettre au goût du jour
un ancien type de véhicule financier, la Pricaf privée(6) (initié en 2003 sans toutefois
rencontrer un réel succès) destiné à financer de nouvelles entreprises de commercialisation
du Tax Shelter. On pourrait d’ailleurs élargir ce mécanisme à d’autres secteurs culturels
(spectacle vivant, édition…) ou à d’autres industries audiovisuelles (les jeux interactifs, le
cinéma dynamique...).
Autre piste, le mécénat privé, elle commence à être explorée par le théâtre et l’opéra, bien
que cette mentalité soit peu développée chez nous (contrairement à la tradition anglo-
saxonne), puisque les arts y sont perçus comme une activité essentiellement subsidiée. Du
fait que l’Etat est clairement perçu comme ayant un rôle prépondérant d’éducation à la
culture et comme ayant tendance à décider de tout pour la collectivité.
Ceci dit, le mécénat individuel est bien la preuve de l’existence de motivations autres que
capitalistiques chez les financeurs privés, que ce soient des entreprises ou des individus
fortunés…
La culture attire déjà les entreprises, les banques et les individus fortunés. Elle peut
également séduire les épargnants, c’est-à-dire un public bien plus large. Mais pour cela, une
révolution de mentalité doit s’opérer. Les principaux intéressés doivent cesser de penser
que dans leur activité le produit fini ne sera jamais bénéficiaire ! Souvent dans les milieux de
la télévision et du théâtre prédomine la perception trompeuse qu’en l’absence de
subventions les productions d’émissions ou de pièces ne sont pas suffisamment rentables.
Idée sous-jacente : la production télévisuelle ou théâtrale a implicitement un potentiel
moindre de retour sur investissement et est de ce fait moins attractive pour les capitaux
privés. Pourtant bien des émissions (documentaires, reportages, fictions, téléréalité, jeux,
séries,…) et pièces de théâtre méritent un minimum de bienveillance de la part des
investisseurs privés les mieux avisés, car elles alimentent d’excellents cash-flows et ROI
(return on investment).
Il faut partir du principe que la culture est rentable, quelle qu’elle soit. Il faut refuser la
dichotomie entre d’un côté la mauvaise culture, de type hollywoodienne, qui rapporte de
l’argent, et d’un autre côté, la bonne culture qui en perd. Le cœur de métier de la culture
c’est l’imagination, le rêve ! Tout comme l’envie d’oser est aliéné à l’art. Ces phénomènes
intangibles et non quantifiables variant en fonction les uns des autres que sont l’imagination,
le rêve, l’envie d’oser et la prise de risque constituent le substrat de l’innovation et de
l’entrepreneuriat. Les entreprises à vocation culturelle doivent apprendre à communiquer
sur ce rapport entre l’ouverture culturelle, l’optimisme mental et le dynamisme
économique et social de toute communauté. Un monde où tout serait identique, ne
susciterait ni espoirs, ni innovations, ni idées…
Les entreprises à vocation culturelle doivent apprendre à valoriser ce qu’elles font et
valoriser ceux qui les soutiennent. En effet, la plupart des individus cherchent, en

investissant, non seulement une récompense financière mais aussi à combler un besoin de
reconnaissance sociale ou encore ils cherchent à se distinguer. Une façon de valoriser ce
qu’elles font consiste à bien informer leur public de financeurs et comme la transparence
crée souvent l’adhésion, elles doivent donc apprendre à faire du reporting sur leurs activités.
Dans cet ordre d’idées, il faudrait multiplier les séminaires, conférences, colloques, tables
rondes sur l’entrepreneuriat culturel comme source de valeur, d’innovation et de lien social.
(« L’entreprise culturelle est un défi mais aussi source de plus-value »…).
L’animation culturelle est clairement devenue une valeur économique, il y a un marché et il
faut inciter les capitaux privés à l’occuper.
Impliquons les particuliers dans le financement à risque de la culture et de l’audiovisuel, en
facilitant, par exemple, l’éclosion de fonds communs de placement « ARTE » dédiés aux
différentes industries culturelles et en proposant divers avantages fiscaux.
Encourageons l’épargne de proximité en permettant à des particuliers d’investir dans des
projets culturels proches et/ou connus d’eux. Et, en cas d’échec, en les autorisant à déduire
les pertes sur leur feuille d’impôts.
Ainsi, la collectivité n’assumerait que très indirectement une partie du risque pris par
l’entrepreneur culturel. Ces fonds communs de proximité culturelle devraient investir, par
exemple, 60 % de leurs ressources dans des initiatives culturelles régionales dont au moins
25 % dans des premiers projets de jeunes artistes. Une manière effective d’orienter l’épargne
locale vers des petites entreprises culturelles de la région.
Selon une étude de Fund Market Lux (2007), 70 % des Belges seraient prêts à investir une partie de leur
épargne dans des placements à dimension culturelle s’ils bénéficiaient d’un avantage fiscal. Cela ouvre
bien des perspectives pour une gestion collective de l’épargne.
Si on permettait à tous ces individus d’investir des montants modestes dans un pot commun, en
l’occurrence un fonds collectif de capital à risque dédié à l’animation culturelle, ce serait là pour eux une
façon simple et originale de se lancer dans l’aventure du financement de l’entrepreneuriat culturel. Le
fonds collectif se chargeant d’investir l’argent récolté dans des entreprises culturelles classiques mais
également dans des projets culturels foncièrement innovateurs. Les épargnants auront ainsi la
possibilité de superviser la constitution (et la progression) du portefeuille d’entreprises culturelles géré
par les gestionnaires du fonds et d’en apprendre beaucoup sur la façon de trier et de sélectionner les
projets culturels innovants.
D’un point de vue macroéconomique, ce genre d’initiative augmenterait sensiblement la manne des
capitaux à risque disponible pour les jeunes générations d’artistes, puisqu’au travers de l’achat de parts
du fonds commun de placement, à un prix démocratique (par exemple 5 € l’unité), l’épargnant « ami des
arts » deviendrait indirectement, à moindre coût et surtout à moindre risque un « business angel »
(ange financier) de la culture.
L’épargnant « ami des arts » pourrait également alimenter des fonds communs de placement dédiés aux
arts en rétrocédant chaque année automatiquement une fraction des intérêts annuels que produit son
compte d’épargne à un ou plusieurs entreprises, institutions ou projets culturels préalablement
sélectionnés et communiqués à la banque dépositaire de son épargne. (Mécanisme de l’épargne
CIGALE) (7)
Les perspectives d’implication du grand public dans le marché des capitaux à risque sont favorables si on
se rappelle le succès de l’emprunt obligataire émis par le Fonds Starter en juin 2004 visant à renforcer
les moyens d’action du Fonds de Participation (organisme public). Cette émission obligataire, qui portait
sur un montant de 65 millions d’euros, avait été souscrite par 12 000 épargnants et elle avait même été
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%