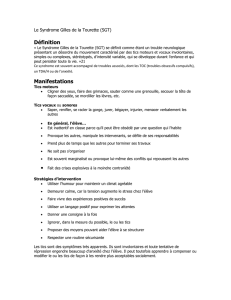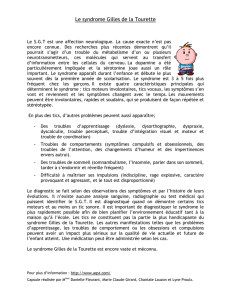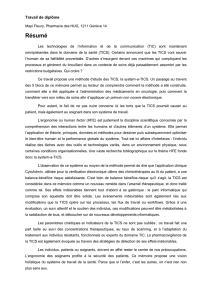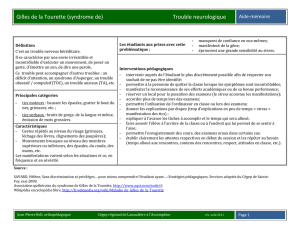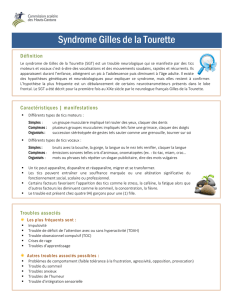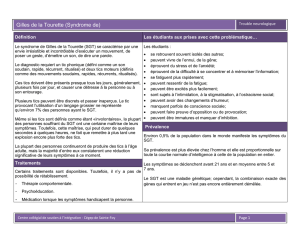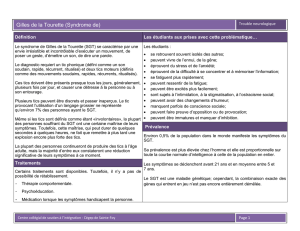Réflexions psychanalytiques sur les tics

1
Réflexions psychanalytiques sur les tics
Sandor Ferenczi
(1ère partie)
La psychanalyse a peu étudié jusqu’à présent ce symptôme névrotique très répandu que l’on
désigne, suivant l’usage français, par le terme général de « tic » ou de « tic convulsif ». Dans un
article où je décrivais les « Difficultés techniques d’une analyse d’hystérie » que j’avais dû
surmonter dans un cas, j’ai fait une brève incursion dans ce domaine, formulant l’hypothèse que de
nombreux tics pourraient s’avérer être des équivalents stéréotypés de l’onanisme et que le lien
remarquable que l’on peut observer entre les tics et la coprolalie après suppression des
manifestations motrices n’était peut-être rien d’autre que l’expression verbale de ces mêmes
motions érotiques déchargées habituellement par les tiqueurs sous forme de mouvements
symboliques.
A cette occasion j’ai aussi attiré l’attention sur les rapports étroits qui existent entre d’une part les
stéréotypies motrices et les actes symptomatiques (chez le sujet normal comme chez le malade) et
d’autre part les tics ou l’onanisme. C’est ainsi que dans le cas en question des contractions
musculaires et des excitations cutanées accomplies machinalement et considérées comme
dépourvues de signification pouvaient s’emparer de toute la libido génitale et s’accompagner
parfois d’un véritable orgasme.
Le Professeur Freud que j’interrogeais incidemment sur le sens et la signification qu’il donnait au
tic me dit qu’il s’agissait probablement de quelque chose d’organique. Au cours de cette discussion
j’arriverai peut-être à montrer dans quel sens cette hypothèse se trouve justifiée.
Voilà donc à peu près toutes les informations que j’ai pu tirer des diverses sources psychanalytiques
en ce qui concerne les tics; et je ne peux même pas dire que j’ai appris depuis quelque chose de
nouveau par l’observation directe ou l’analyse des tics « passagers », si fréquents pourtant chez les
névrosés.
Dans la plupart des cas, on peut mener a bien une analyse de névrosés et même guérir une
psychonévrose sans avoir à prêter une grande attention à ce symptôme. A l’occasion on peut être
amené à se demander quelles sont les situations psychiques qui favorisent l’apparition de tel ou tel
tic par ex. une grimace, un tressaillement spasmodique des épaules ou de la tête, etc.), et à parler du
sens, de la signification d’un symptôme de ce genre. Ainsi une de mes malades hochait
négativement la tête chaque fois qu’elle devait accomplir un geste purement conventionnel (prendre
congé, saluer).
J’avais remarqué que le mouvement devenait plus fréquent et plus marqué quand la patiente
s’efforçait de montrer plus d’affect, par exemple plus d’amitié qu’elle n’en ressentait
intérieurement, et je dus lui faire remarquer que son hochement de tête démentait en fait son geste
ou son air amical.
Je n’ai encore jamais eu de patient qui soit venu en analyse dans le but précis de guérir un tic. Les
petits tics que j’ai été à même d’observer dans ma pratique analytique gênaient si peu ceux qui en
étaient affectés qu’ils ne s’en plaignaient jamais eux-mêmes; et chaque fois c’est moi qui ai dû
attirer leur attention sur ce symptôme. Dans ces conditions, il n’y avait naturellement aucune raison
d’examiner plus avant ce symptôme que les patients, comme on dit, sauvaient de l’analyse.
Or nous savons que cela ne se produit jamais dans les analyses d’hystéries et de névroses
obsessionnelles de type courant. En effet, à la fin d’une analyse le symptôme le plus insignifiant se
trouve intégré à la structure complexe de la névrose et même étayé par multiples facteurs
déterminants. Déjà cette place particulière occupée par le tic nous amenait à supposer qu’il
s’agissait d’un trouble dont l’orientation était totalement différente de celle des autres symptômes

2
d’une névrose de transfert et que par conséquent l’habituelle « action réciproque des symptômes »
ne pouvait rien contre lui. Cette place à part du tic parmi les phénomènes névrotiques donnait une
base solide à l’hypothèse de Freud quant à la nature hétérogène (organique) de ce symptôme.
Certaines observations d’un tout autre ordre me firent alors progresser un peu dans ce domaine. Un
patient (onaniste invétéré) ne cessait d’accomplir certains mouvements stéréotypés pendant son
analyse. Il avait l’habitude de lisser son veston à la taille, souvent plusieurs fois par minute ; il
vérifiait entre temps que la peau de son visage était bien lisse en se caressant le menton, ou il
contemplait avec satisfaction ses chaussures vernies ou cirées, toujours étincelantes. Du reste, son
attitude psychique, sa suffisance, l’affectation de son discours toujours composé de périodes dont il
était l’auditeur le plus satisfait, tout le désignait comme un narcissique comblé dans son amour pour
lui-même, qui, impuissant avec les femmes, trouvait dans l’onanisme le mode de satisfaction qui lui
convenait le mieux.
Il n’avait entrepris le traitement qu’à la demande d’un parent et prit la fuite dès les premières
difficultés. Quelle qu’en fût la brièveté, cette analyse fit sur moi une certaine impression. Je
commençai à me demander si cette « orientation différente » des tics ne tenait pas au fait qu’ils
étaient en réalité des symptômes narcissiques, susceptibles tout au plus de s’associer aux
symptômes d’une névrose de transfert sans pour autant se confondre avec eux. Je ne tenais
d’ailleurs pas compte de la distinction entre tic et stéréotypie, que tant d’auteurs ont soulignée. Je
voyais et je continue à considérer le tic comme une simple stéréotypie qui se produit avec la
soudaineté de l’éclair, condensée en quelque sorte et, souvent, simplement indiquée
symboliquement. Nous verrons plus loin que les tics sont des dérivés d’actions stéréotypées.
Toujours est-il que je me mis à observer sous l’angle du narcissisme les tiqueurs que j’avais
l’occasion de voir dans la vie quotidienne, en consultation ou en traitement. Je me rappelai aussi
quelques cas graves de tiqueurs rencontrés dans ma pratique pré-analytique. Et je fus frappé des
multiples confirmations qui affinaient littéralement de ces diverses sources. Un des premiers cas
que je rencontrai peu après ces réflexions fut celui d’un jeune homme qui présentait une contraction
très fréquente des muscles de la face et du cou. J’observai son comportement, assis à une table
voisine dans un restaurant. A tout moment il toussotait, arrangeait ses manchettes jusqu’à ce
qu’elles soient parfaitement ajustées, les boutons tournés vers l’extérieur ; tantôt il rajustait son col
empesé d’un geste de la main ou d’un mouvement de tête, tantôt il faisait le geste, si fréquent chez
les tiqueurs, de délivrer son corps de vêtements trop étroits.
Pas un instant, encore qu’inconsciemment, il ne cessait d’accorder l’essentiel de son attention à son
propre corps ou à ses habits, même si consciemment il était occupé à tout autre chose s’il mangeait
ou lisait le journal. Cet homme devait souffrir, supposai-je alors, d’une hyperesthésie prononcée,
être incapable de supporter une excitation physique sans réaction de défense. Mon hypothèse fut
confirmée quand, à mon grand étonnement, je vis ce jeune homme, par ailleurs bien élevé et de la
meilleure société, sortir aussitôt après le repas un petit miroir de poche et se mettre devant tout le
monde à ôter consciencieusement avec un cure-dent les parcelles de nourriture restées entre ses
dent, le tout à l’aide du petit miroir ; il n’arrêta qu’après avoir nettoyé une à une toutes ses dents,
parfaitement propres comme je pus le constater, ce qui visiblement le tranquillisa.
Certes nous savons tous que les parcelles de nourriture coincées entre les dents peuvent être parfois
très gênantes, mais se nettoyer à fond les trente-deux dents sans pouvoir remettre ce soin à plus tard,
voilà qui demandait plus ample explication. Je me suis rappelé une de mes propres réflexions
concernant les conditions d’apparition des pathonévroses (ou du «narcissisme de maladie ». Les
trois conditions citées dans cet article comme susceptibles d’entraîner une fixation de la libido sur
certains organes sont :
un danger de mort ou une menace de traumatisme
une lésion d’une partie du corps déjà fortement investie auparavant de libido d’une zone érogène)

3
un narcissisme constitutionnel tel que la plus petite lésion d’une partie du corps atteint le Moi tout
entier.
Cette dernière éventualité concordait donc très bien avec l’hypothèse que l’hypersensibilité des
tiqueurs, leur incapacité à supporter une excitation sans réaction de défense, pourrait constituer le
motif de leurs manifestations motrices, donc des stéréotypies et des tics euxmêmes ; alors que
l’hyperesthésie, qui peut être localisée ou généralisée, ne serait que l’expression du narcissisme, de
l’attachement profond de la libido an sujet lui-même, au corps propre ou à une des parties de celui-
ci, soit : de la « stase de la libido d’organe ». En ce sens, l’opinion de Freud quant à la nature
« organique» des tics se trouvait justifiée, même si l’on devait laisser pendante pour l’instant la
question de savoir si la libido était liée à l’organe lui-même ou à son représentant psychique.
Mon attention ainsi attirée sur la nature organique et narcissique des tics, je me suis rappelé
quelques cas graves de tics que l’on appelle, suivant la suggestion de Gilles de la Tourette, «maladie
des tics ». Ce sont des contractions musculaires progressives, affectant peu à peu presque tout le
corps, qui se compliquent par la suite d’écholalie et de coprolalie et peuvent aboutir à la démence.
Cette complication fréquente des tics par une psychose narcissique caractérisée ne s’opposait
nullement à l’hypothèse selon laquelle dans les cas moins graves de maladies à mouvements
convulsifs, celles qui ne dégénèrent pas en démence, les phénomènes moteurs doivent leur origine à
une fixation narcissique.
Le dernier cas grave de tics que j’ai rencontré était celui d’un jeune homme qui, du fait de son
hypersensibilité psychique., était frappé d’une incapacité totale et qui se suicida à la suite d’une soi-
disant insulte faite à son honneur. Dans la plupart des manuels de psychiatrie, le tic est défini
comme un « symptôme de dégénérescence », le signe, souvent le premier, d’une constitution
psychopathique. Nous savons qu’un nombre relativement important de paranoïaques et de
schizophrènes souffrent de tics. Tout cela me semblait étayer l’hypothèse d’une racine commune à
ces psychoses et à la maladie des tics. Cette théorie se trouvait encore renforcée si l’on rapprochait
les principaux symptômes de la maladie des tics et les connaissances acquises par la psychiatrie, et
surtout par la psychanalyse, sur la catatonie.
Ces deux états ont en commun la tendance à l’écholalie et à l’échopraxie, aux stéréotypies, aux
grimaces et au maniérisme. Mon expérience psychanalytique des catatoniques me faisait supposer
depuis un certain temps que leurs attitudes et leurs positions extraordinaires constituaient un mode
de défense contre des stases libidinales locales (organiques). Un catatonique très intelligent et doué
d’un sens aigu de l’auto-observation me disait lui-même qu’il était obligé d’accomplir constamment
un certain mouvement de gymnastique « pour briser l’érection de l’intestin ».
De même chez un autre malade j’ai pu interpréter la rigidité intermittente de telle ou telle de ses
extrémités, qui s’accompagnait de la sensation d’une hypertrophie considérable, comme une
érection déplacée, autrement dit comme la manifestation d’une libido d’organe anormalement
localisée. Federn groupe les symptômes de la catatonie sous le terme « d’intoxication narcissique ».
Tout cela s’accorde très bien avec l’hypothèse d’une base constitutionnelle commune aux tics et à la
catatonie et expliquerait la grande similitude de leur symptomatologie. Quoi qu’il en soit, on est
tenté d’établir une analogie entre les principaux symptômes de la catatonie - négativisme et rigidité
- et la défense immédiate contre tout stimulus externe qui se manifeste dans le tic par un
mouvement convulsif.
D’autre part, quand les tics se transforment en catatonie dans la maladie de Gilles de la Tourette, on
peut supposer qu’il s’agit seulement d’une généralisation de l’innervation de défense, encore
partielle et intermittente dans le tic. La rigidité tonique proviendrait donc dans ce cas de la somme
d’innombrables contractions cloniques de défense et la catatonie ne serait que l’aggravation de la
cataclonie (du tic).
Mentionnons à ce propos le fait que les tics, comme on sait, surgissent très souvent in loco morbi à
la suite de maladies ou de traumatismes somatiques, par exemple des spasmes de la paupière après

4
la guérison d’une conjonctivite ou d’une blépharite, des tics du nez après un catharre, des
gesticulations spécifiques des extrémités après des inflammations douloureuses. Je rapprocherai ce
fait de la théorie selon laquelle un accroissement névropathique de la libido tend à s’attacher au
siège d’une altération somatique pathologique (ou à son représentant psychique). Dans ces cas il est
facile de ramener l’hyperesthésie des tiqueurs, souvent uniquement locale, à un déplacement
« traumatique » de la libido, et les manifestations motrices du tic (comme nous l’avons déjà dit) à
des réactions de défense contre l’excitation relative à ces parties du corps.
Autre argument en faveur de la conception selon laquelle le tic aurait quelque chose à voir avec le
narcissisme les résultats thérapeutiques obtenus par un traitement spécifique des tics fondé sur
certains exercices. Il s’agit d’exercices systématiques d’innervation alternant avec des mouvements
d’immobilisation forcée des parties atteintes de contractions. Et le résultat est bien meilleur si le
patient se contrôle dans un miroir pendant les exercices. Selon les auteurs, le contrôle visuel
faciliterait le dosage des innervations inhibitrices requises par les exercices et expliquerait ce
résultat. Mais, à mon avis, et en suivant ce qui vient d’être exposé, l’effet effrayant que produit sur
le sujet narcissique la vue dans le miroir des déformations de son corps et de son visage joue
certainement un rôle important (et essentiel) dans sa tendance à la guérison.
(2ème partie)
Je suis parfaitement conscient des insuffisances de la présente argumentation. Je n’aurais pas rendu
publique cette hypothèse, élaborée de façon plutôt spéculative sur la base de maigres observations
et réservée pour ainsi dire à mon usage personnel, si je n’avais trouvé un soutien d’un côte
inattendu, qui vient la rendre bien plus plausible. Ce soutien m’a été fourni par la lecture d’un
ouvrage sur les tics, ouvrage particulièrement riche et instructif, qui comprend en outre une revue
critique de toute la littérature consacrée à ce sujet. Il s’agit du livre du Dr Henri Meige et du Dr E.
Feindel, Le tic et son traitement (traduit du français par le Dr O. Giesel en 1903). Je voudrais
rattacher les réflexions qui suivent au contenu de cet ouvrage.
Etant donné la nature particulière de la pratique analytique, le médecin qui s’y consacre a rarement
l’occasion d’observer certains types de troubles nerveux, tels par exemple les névroses
« organiques » (comme la maladie de Basedow) qui exigent avant tout un traitement physique, ou
les psychoses dont le traitement n’est possible qu’en maison de santé, et toutes les variétés de «
nervosité commune », qui en raison de leur caractère bénin ne font guère l’objet d’une
psychothérapie aussi poussée.
Pour tes cas de ce genre, l’analyste est renvoyé aux observations et aux communications écrites par
d’autres, et si rien ne vaut l’observation personnelle, celles-ci présentent au moins l’avantage de
nous épargner le reproche si répandu de faire des observations partiales, de suggestionner le malade
ou d’être suggestionné par lui. Meige et Feindel ignoraient pratiquement tout de la méthode
cathartique selon Breuer et Freud en tout cas, leurs noms ne figurent pas dans l’index de l’ouvrage.
On trouve bien une référence aux « Etudes sur l’hystérie », mais il semble que ce soit une simple
interpolation du traducteur, qui pensait « devoir faire mention de quelques auteurs allemands
négligés par les auteurs français... » Au demeurant, cette traduction date des premiers temps de la
psychanalyse et par conséquent la convergence profonde qui existe entre les idées émises dans cet
ouvrage et les plus récentes découvertes de la psychanalyse peut en elle-même constituer un critère
d’objectivité.
Je citerai en premier lieu la description courte mais classique que Trousseau donne des tics. « Le tic
non douloureux consiste en des contractions instantanées, rapides, généralement limitées à un petit
nombre de muscles, habituellement aux muscles de la face mais pouvant aussi en affecter d’autres,
ceux des membres, du cou, du tronc, etc. Chez l’un, c’est un clignement des paupières, un
tiraillement convulsif de la joue, de l’aile du nez, de la commissure des lèvres, qui donne au visage
un air grimaçant chez un autre, c’est un hochement de tête, une contorsion. brusque et passagère du

5
cou se répétant à chaque instant chez un troisième, c’est un soulèvement d’épaules, une agitation
convulsive des muscles abdominaux ou du diaphragme c’est, en un mot, une variété infinie de
mouvements bizarres qui échappent à toute description...
Ces tics sont en quelque sorte accompagnés d’un cri, d’un éclat de voix plus ou moins bruyant,
caractéristique... Ce cri, ce jappement, cet éclat de voix, véritables chorées laryngées ou
diaphragmatiques, peuvent constituer tout le tic... C’est encore une tendance singulière à répéter
toujours le même mot, la même exclamation ; et le même individu profère à haute voix des mots
qu’il voudrait bien retenir ».
Le compte rendu d’un cas rapporté par Grasset donne un tableau caractéristique de la manière dont
le tic se déplace d’une partie du corps sur une autre : « Une jeune fille avait eu pendant son enfance
des tics de la bouche et des yeux à l’âge de quinze ans, elle se mit pendant quelques mois à projeter
en avant sa jambe droite, qui plus tard fut paralysée; puis durant quelques mois, un sifflement
remplaça les troubles moteurs. Toute une année, elle lança par intermittence d’une voix puissante le
cri « ah ». Enfin à dix-huit ans... apparurent des gestes de salut, des mouvements en arrière de la
tête, un haussement de l’épaule droite ...
Ces déplacements se produisent souvent à la manière des actes compulsifs, qui généralement se
déplacent de l’élément originel et véritable sur un autre plus éloigné, pour en fin de compte revenir
par un détour au refoulé. Un patient cité par Meige et Feindel appelait ces tics secondaires des «
para-tics » et reconnaissait franchement leur caractère de défense contre les tics primaires jusqu’à ce
qu’ils deviennent à leur tour des tics.
Le point de départ d’un tic peut être une observation hypocondriaque de soi. Un jour... je ressentis
un craquement dans la nuque », raconte un patient de Meige et Feindel. « Immédiatement j’en ai
conclu que j’avais dû me décrocher quelque chose ; pour le vérifier, j’ai recommencé le mouvement
une fois, deux fois, trois fois, sans que le craquement se reproduise, je l’ai varié de mille façons, je
l’ai répété de plus en plus fort ; finalement j’ai retrouvé mon craquement, et ce fut pour moi un réel
plaisir... plaisir bientôt mitigé par la crainte d’avoir provoqué une lésion quelconque... Aujourd’hui
encore je ne peux résister à l’envie de reproduire ce craquement et je ne puis vaincre un sentiment
d’inquiétude dès que je suis parvenu à mes fins. »
Le Caractère tantôt voluptueux tantôt anxiogène de ces sensations nous permet de les considérer
sans hésitation comme une manifestation pathologique de la sexualité du patient, notamment de son
narcissisme hypocondriaque de plus, nous avons là le cas relativement rare d’un patient qui
continue à percevoir les motifs sensoriels de ses mouvements stéréotypés. Dans la majorité des cas,
les motifs ne sont pas, comme nous le verrons, des sensations actuelles mais des réminiscences
devenues inconscientes en tant que telles.
Charcot, Brissaud, Meige et Feindel sont parmi les rares neurologues à n’avoir pas refusé d’écouter
le patient quand celui-ci racontait la genèse de son trouble. « Seul le tiqueur » , lit-on dans Meige et
Feindel, « peut répondre à la question concernant la genèse de sa maladie, s’il remonte dans le
passé aux premiers événements qui ont mis en train la réaction motrice. » Dans cette perspective,
nos auteurs ont permis à leurs patients de reproduire (mais uniquement à l’aide du souvent
conscient) les circonstances qui étaient responsables de la première apparition de leurs contractions.
Nous voyons qu’il y avait là un point de départ possible vers la découverte de l’inconscient et son
investigation par la psychanalyse. Pour les auteurs, ce sont souvent des traumatismes physiques qui
constituent l’explication dernière un abcès à la gencive, cause d’une grimace invétérée, une
opération du nez, motif d’un froncement nasal, etc. Ils mentionnent également les vues de Charcot
sur le tic qui selon lui « n’est qu’en apparence une affection physique ; il s’agit en réalité d’un
trouble psychique... le produit direct d’une psychose - une sorte de psychose héréditaire ».
Meige et Feindel ne manquent pas non plus de signaler des traits de caractère propres aux tiqueurs,
que l’on pourrait qualifier de narcissiques. Ils citent entre antres les confidences d’un patient : « Il
faut bien l’avouer, je suis rempli d’amour-propre, et extrêmement sensible aux compliments comme
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%