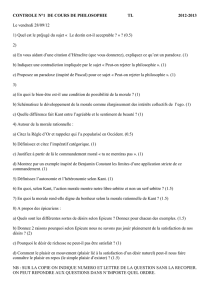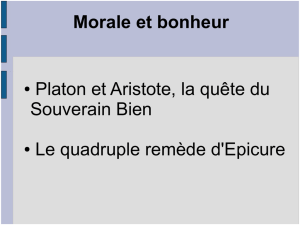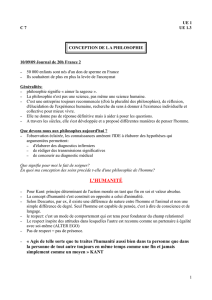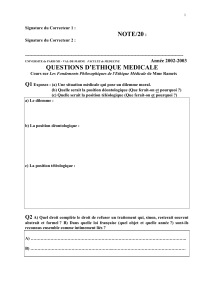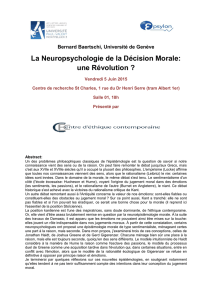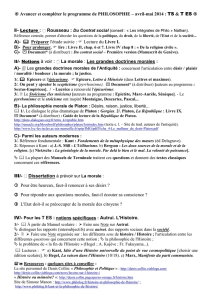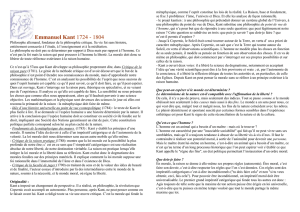Voir - ULB

Kant (1724 – 1804) était professeur de philosophie et grand croyant. Il devint l’une des cibles
favorites de Nietzsche. Il n’a jamais enseigné sa propre théorie appelée le « CRITICISME ».
Il était considéré comme le représentant le plus important de l’ « Aufklärung », mouvement
allemand « des lumières », qui promouvait l’émancipation de l’homme, les progrès de
l’humanité vers l’autonomie (se donner sa propre loi), contre l’hétérotomie (le fait que cette
loi soit imposée de l’extérieur à l’individu). Ici, on parle de la loi morale, l’ensemble des
prescriptions qu’un homme se donne à lui-même pour effectuer une action vertueuse. Kant cherche
le dignité da l’homme.
Selon Kant, chacun doit être capable de se donner sa propre loi. Doit-il y avoir une loi
différente pour chacun, faut-il tomber dans le relativisme ? Non, il faut une loi universelle,
pour tous les lieux, pour tous les temps et pour tous les individus. Mais les lois morales
évoluent comme les cultures, les circonstances économiques. Une loi morale universelle a-t-
elle le même sens pour le prolétaire et pour le grand bourgeois ? L’universalité ne serait-elle
pas un luxe réservé aux grands bourgeois ? (« La bouffe passe avant la morale » résumait
Bertolt Brecht. Dans le relativisme, il y aurait autant de lois qu’il n’y aurait d’individus),
auquel cas l’objectif n’est pas atteint. C’est le danger de l’autonomie. En hétéronomie,
l’individu reçoit la loi morale d’une injonction supérieure (Eglise, tyran,…). L’idée de Kant
est de trouver un juste milieu entre deux pôles.
Le sens courant de « critique » est négatif. Pour Kant, ce mot est positif : critiquer, c’est
rechercher des conditions de possibilité (qu’est-ce qui rend possible…Ex : l’art).
Il a écrit, notamment, trois ouvrages :
1. Critique de la raison pure (1781)
2. Critique de la raison pratique (1788)
3. Critique de la faculté de juger (1790)
Son premier livre s’attarde sur ce qui rend possible la connaissance. D’un point de vue
général, ontologique (l’ontologie est la science de l’être, de ses premiers prédicats), on se
demande pourquoi il y a de l’être et pas du néant et quels sont les sens du mot « être ». Kant
s’interrogera sur ces possibilités d’existence et dira que les positions ontologiques ne sont pas
fondées. D’un point de vue spécifique, Kant déterminera trois domaines dans lesquels on ne
peut accéder à la connaissance objective (Dieu, l’âme et le monde. Voir plus loin). Ce sont les
objets de la métaphysique spéciale.
Dans l’agnosticisme kantien, l’homme ne peut tout connaître. Il est limité par l’espace et le
temps. Ce sont les formes a priori de la sensibilité. Les facultés intellectuelles humaines ne
sont pas suffisantes pour connaître un objet. La sensibilité limite la connaissance. La
métaphysique s’occupe des objets que la connaissance ne peut atteindre : l’âme (est-elle
immortelle ?), le monde (où en est le début et la fin ?), Dieu (existe-t-il et a-t-il créé le
monde ?)
On ne peut apporter une réponse scientifique à ces questions car elles ne sont pas données à la
sensibilité, pourtant ce sont des foyers de sensibilité.
Dans sa « critique »de 1781, Kant veut répondre à trois questions :
1. Que puis-je connaître ? C’est ce qui est donné par la sensibilité

2. Que dois-je faire ?
3. Que m’est-il permis d’espérer ?
4. Il voudra aussi répondre à Qu’est-ce que l’homme ? Concept qui reprend les trois
questions précédentes
La finalité de la philosophie de Kant est anthropologique (c’est la dimension sociale de
l’homme) mais son but ultime est la morale.
Définition de la morale : Le monde est régi par des lois physiques : « les principes de
l’entendement pur ». La loi de causalité signifie que tout EFFET a une cause. La physique est
donc basée sur un enchaînement continu d’effets en causes, jusqu’à l’Inconditionné (Dieu).
Or, Dieu est l’un des inconnaissables.
Qu’est-ce que l’action vertueuse ? L’action est posée dans la nature et est déterminée dans le
temps. C’est un acte de volonté, c’est consciemment voulu. Comment inscrire un acte de
volonté dans la nature alors que celle-ci est régie par la loi des effets à des causes ? Inscrire
une action dans la nature c’est transformer un acte de volonté en principe naturel. Cela
signifie : rendre compossible la causalité de la liberté (qui dépend d’un acte de volonté libre)
et la nécessité naturelle (mécanique). Il y a un saut radical entre la causalité naturelle et la
causalité de liberté. Le principe suprême de la connaissance, les conditions de possibilité de
l’objet de l’expérience sont en même temps les conditions de possibilité de l’expérience de
l’objet. Il y a un accord fondé sur l’espace et le temps entre nous et le monde. Cet accord est
nécessaire et à priori, avant toute tentative de connaissance. C’est la philosophie
transcendantale.
Or, Kant est un pur croyant, à la foi profonde. Mais sa philosophie transcendantale dit qu’on
ne peut tout connaître (seuls les objets de la nature sont accessibles à la connaissance.). La théologie
n’est pas fondée : c’est l’agnosticisme kantien (on ne peut se prononcer sur ces objets car ils
ne sont pas des objets de la connaissance). Malgré tout, ce que je ne peux connaître influence
la morale et ma manière de vivre car ce sont des foyers de sens et de désespoir.
Est-ce possible d’avoir une morale kantienne, en tenant compte de son agnosticisme, sans être
croyant. Y a-t-il, chez Kant, une morale laïque et universelle, indépendante de la foi ?
1. Que puis-je connaître ?
Pour Kant, je ne peux connaître que ce qui est dans l’espace et dans le temps. Je peux
connaître la nature car ses objets sont dans l’espace et le temps. Pour qu’il y ait connaissance,
il faut une application du concept pur de l’entendement aux formes de la sensibilité (espace et
temps). Un objet de connaissance est donc un objet sensible dans l’espace et le temps. Je ne
peux pas connaître ce qui est hors du temps ou de l’espace. Je peux penser que je les connais
mais je ne peux les connaître car ils sont hors des limites de la connaissance. Dieu, l’âme et le
monde ne sont pas donnés dans le temps et l’espace. Ils ne sont donc pas dans les conditions
de la connaissance.
Kant utilise une métaphore : Un navigateur quitte Königsberg (la ville natale de Kant, en
Prusse !) et se dirige vers l’une des îles de la mer baltique. Kant l’appelle « l’île du pays de la
Vérité ». L’île est séduisante et le navigateur croit pouvoir l’atteindre. L’île n’est île que parce
qu’elle est entourée d’eau. Ses limites sont définitivement fixées (comme les limites de la
connaissance sont définitivement fixées. Il n’y a pas d’évolution de la connaissance au-delà
de mes facultés de connaître, selon la loi de l’entendement et des limites de la sensibilité). Un
brouillard épais entoure l’île et cache ses récifs et ses marécages (les objets que je ne peux pas

connaître). L’île est le pays de la « connaissance légitime », ses récifs et ses écueils sont ce
que l’on pense pouvoir connaître. Le navigateur va perdre le contrôle de son navire et
s’échouer. Kant dit que, nécessairement, nous croyons pouvoir atteindre l’île mais nous
tombons dans des erreurs (les apparences transcendantales = l’âme, le monde, Dieu). Ces
apparences transcendantales sont hors des limites de la connaissance (agnosticisme kantien).
Mais Kant rajoute une quatrième notion au-delà de nos connaissances : la liberté. Kant
profondément croyant, dit que l’on peut croire en Dieu et en l’âme. Il est tiraillé entre le pôle
de son agnosticisme et celui de sa religiosité (Malgré le fait que Dieu est hors des limites de la
connaissance, on peut croire en lui, il peut avoir un sens). Le rôle de la philosophie est de
réfléchir sur les limites de l’île. Or on ne peut agir sur les limites de la connaissance. A
l’intérieur des limites de la sensibilité (les bornes sont l’espace et le temps), la connaissance,
elle, est illimitée.
Le but de la morale, c’est l’objet de la connaissance (la nature). Cet objet, le monde, est régi
par la loi physique et rationnelle : le principe de causalité qui, comme nous l’avons vu plus
haut, induit que les lois de la nature sont une succession d’effets qui ont des causes. Si on
remonte la succession mécanique des effets et des causes, on atteint l’Inconditionné, selon
Kant.
La morale, c’est inscrire la liberté dans la nature. Comment inscrire la causalité, non
mécanique, de la liberté dans la nature ? Comment faire pour inscrire un acte libre dans la
nature, pour que mon action dépende de ma liberté, non régie par les lois de la nature ?
La liberté est inconnaissable (comme Aristote, le Souverain Bien est la recherche du bonheur en accord
avec la vertu. Mais personne ne sait ce qu’est le bonheur) et personne ne sait ce qu’est la liberté ! Pour
Kant, la liberté est exactement le contraire d’un « faire ce que l’on veut » (çà, c’est le
relativisme radical). Pour lui, cette attitude est pathologique, non rationnelle. C’est, à
nouveau, de l’hétéronomie.
Puisque la liberté est inconnaissable, il y a récusation de « l’intellectualisme moral » (je
pourrais, par ma simple raison, donner une définition de la liberté, je pourrais définir la
morale). Mais la liberté est le contraire d’une simple volonté soumise aux contingences
économiques, sociales,… (Pour Kant, c’est retomber dans l’hétéronomie, le relativisme moral
absolu qu’il condamne).
Le point de départ de la morale de Kant est la recherche d’une définition de la liberté. Selon
Sartre, l’existence précède l’essence. Pour Kant, au contraire, l’essence est première et
l’essence est la liberté. Tout homme, parce qu’il est raisonnable et rationnel est libre. Cette
liberté, cette essence es la dignité de l’homme. Ainsi, Kant pose l’universalité de la liberté
mais il ne définit toujours pas la liberté.
2. Que dois-je faire ?
Etre libre ! Il existe une morale laïque qui s’inscrit dans l’agnosticisme kantien. Le « postulat
de la raison pratique » signifie que l’homme est libre. Il a une essence première par rapport à
son existence. L’homme, pour être authentiquement homme a le devoir d’être libre. Tous les
hommes sont donc libres mais que dire des prisonniers ? Pour Kant, la liberté n’a pas le sens
sartrien, ce n’est pas un objet que l’on peut connaître. C’est un factum rationis (fait doué de
raison, donnée rationnelle et raisonnable).
Qu’est-ce qu’être rationnel et raisonnable ? La réponse est « Que dois-je faire ? » : Inscrire ma
liberté dans la nature, c’est-à-dire rendre compossible la causalité par la liberté dans la nature.
Imaginons : en passant sur un trottoir, je vois quelqu’un qui risque de se faire écraser. Je veux
l’aider mais je ne peux le faire qu’en respectant les lois de la nature. Il n’est pas nécessaire
d’agir, mon action est contingente. Par devoir d’humanité, je souhaite prévenir l’accident.

Mais mon action est limitée par les lois de la nature, par les lois de la causalité : je ne peux
pas voler pour sauver cet imprudent ! Mon action est limitée par la causalité naturelle
Y a-t-il une liberté possible dans l’action ? Kant dit qu’on ne saura jamais s’il y a eu, s’il y a
ou s’il y aura jamais une action libre dans le monde puisqu’on ne sait pas ce qu’est la liberté.
La liberté est la loi morale. Le fait de la raison est la raison d’être de la loi morale qui est la
manière d’appréhender la liberté. Ce sont les côtés pile (loi morale) et face (liberté) d’une
même réalité. La loi morale nous dit qu’il faut trouver une règle qui ait la même nécessité
qu’une loi de la nature. Mais il y a des tensions entre la loi naturelle (cause – effets) et la
causalité de la liberté (qui dépend de la volonté).Toute action humaine est nécessairement
contingente (elle pourrait ne pas être). Mais toute loi est obligatoirement nécessaire. L’action
contingente, pour être libre, doit être régie par la loi de la liberté universelle, comme si elle
avait la même nécessité qu’une loi de la nature. La liberté a un caractère de nécessité (donc le
contraire est impossible).
La philosophie de Kant est-elle du déterminisme radical, « du caporalisme prussien » ? Kant
affirme le contraire : la loi morale dit qu’il faut élever son action à la nécessité d’une loi de la
nature. En aucun cas, elle ne dit CE qu’il faut faire, elle est formelle et vide. La loi morale
dit : « Respecte-moi » mais elle ne donne pas d’injonction pratique. Chacune de mes actions
contingentes, qui dépendent de ma volonté, est régie par une « Maxime », un principe
subjectif. (Exemple : le recteur tombe devant moi. Aller l’aider est un devoir d’humanité raisonnable, le fruit
de la liberté …ou un désir égocentrique !) L’intention peut être différente et seule l’intention compte.
Personne d’autre que l’actant peut connaître les motivations. Il est seul dépositaire de la
pureté de son intention. La maxime de mon action est le produit de ma volonté mais varie à
chaque action. Elle est particulière et personnelle ; elle varie selon l’action, l’époque,
l’individu, le contexte… Elle inscrit ma causalité de liberté dans la causalité du monde. Il y a
autant de maximes possibles qu’il n’y a d’action dans l’univers. C’est un nouveau danger de
relativisme que Kant condamne radicalement.
D’une part, la loi morale est la liberté mais elle est vide et formelle. « Fait en sorte que ta
maxime ait la même nécessité que la loi ». Ce qui motive l’action doit nécessairement être le
DEVOIR (à première vue, aurait l’apparence du caporalisme prussien, il suffirait de se
soumettre à l’autre pour être vertueux. Mais cette apparence est fausse puisqu’en aucun cas
cette loi ne dit ce qu’il faut faire !).
D’autre part, toute action humaine est régie par sa maxime (la règle : « la décision que je
prends et qui dirige mon action », le principe subjectif de la volonté).La maxime est parallèle
à la liberté et les valeurs absolues reposent sur cette liberté.
Y a-t-il compatibilité entre la loi et la maxime ? Pour répondre à cette question, il faut
s’arrêter au critère (cfr le fantôme de la liberté) : le principe objectif qui dirige l’action.
L’impératif : le moteur de ce qui rendra compatible maxime et loi est fondé sur le devoir qui
repose sur l’impératif (= l’accomplissement de ma liberté). Mais il y a deux sortes
d’impératifs.
L’impératif catégorique (tu DOIS) : Il ne peut pas y avoir contradiction entre l’action et la
liberté. Or, Kant affirme qu’on ne connaît pas la liberté ni l’action morale. Une action est
morale si elle est régie par un impératif catégorique. L’impératif catégorique est la finalité.
« Tu dois respecter ta liberté comme une fin en soi ». Kant a condamné le pathologique (ne
pas se respecter en tant que finalité en soi). Chaque individu existerait en tant que fin propre,
une autonomie qui a le même rapport à l’universalité morale que le respect de l’autre. Un
individu ne devrait jamais être utilisé comme un moyen car il est une personne à part entière,
une fin en soi. L’intention qui doit diriger l’action est le respect de la loi morale. L’actant est
seul dépositaire de l’impératif catégorique qui dirige son action. L’impératif catégorique est

un critère objectif (une simple forme à laquelle on soumet la maxime qui est subjective). Le
critère objectif du « tu dois » est différent du critère subjectif de la maxime. L’actant est seul à
savoir s’il y a compatibilité entre les deux critères.
N.B. Celui dont la maxime serait le bonheur de l’humanité ne serait pas moral puisqu’il
utiliserait une valeur absolue en vue d’autre chose que de la simple vertu (principe objectif qui
doit diriger l’action).
L’impératif hypothétique : fait dépendre la valeur de l’action d’une autre chose | Si…,
alors…| Ma vertu (la valeur de mon action) dépend d’une condition. Elle n’est donc pas faite
pour la vertu elle-même mais en vue d’autre chose, même si c’est le bonheur. Kant ne dit pas
qu’il ne faut pas respecter les Droits de l’Homme mais il dit que si l’on identifie la vertu
comme un moyen en vue d’une autre fin, on n’est pas moral. On est dans le bon quand on est
vertueux pour être vertueux … encore faut-il que l’intention soit pure et on n’est jamais sûr de
la pureté de l’intention, on ne sait jamais si l’action est morale. La morale de Kant est une
morale TRAGIQUE car on n’a la conscience que de son intention. Or on peut se tromper soi-
même, s’utiliser…
« Tu dois » : pourrait être une action morale
« si…, alors… » : toujours non moral
Dans l’exemple de la chute d’un supérieur devant moi, l’action peut être régie par les deux
impératifs, soit le devoir d’aide, soit / et l’intérêt personnel qui n’est pas toujours conscient.
Le mal absolu, radical pour Kant est le mensonge. Il dit même que le mensonge pratiqué en
vue d’aider quelqu’un est le mal absolu, le pire car je me fais l’instrument de moi-même, je
nie ma liberté et ma personne. J’utilise ma liberté en vue d’autre chose. C’est le mal absolu
qui dépend de l’impératif hypothétique ;
Comment rendre compatible l’universalité de la loi morale (qui dit que la maxime de mon
action doit être nécessaire comme une loi) avec la contingence de la maxime (qui, elle, est
différente à chaque action, singulière et particulière) ? Il faut respecter la loi de telle manière
que la maxime ait la même nécessité qu’une loi de la nature (ex. la loi de la causalité). Si je ne
peux déduire le principe subjectif de mon action (= la maxime) à partir de la loi, il faut
trouver une maxime compatible avec cette loi formelle et libre. C’est la morale de
l’intelligence fondée sur les jugements réfléchissants (qui ne dépendent pas de concepts
donnés qui me diraient, à priori, la nature de ma maxime et, donc, que faire). Je dois trouver,
par moi-même, une maxime en accord avec l’universalité de la loi morale, la liberté. C’est un
défi immense puisque je ne sais pas ce qu’est la liberté. Je dois être à la hauteur de ma liberté.
Kant dit « Nous sommes quelque part entre l’animal et l’homme. Sois libre, digne, à la
hauteur d’être un homme, de ta liberté, de ton essence. » L’homme parfait trouverait une
maxime équipotente à la loi morale. La morale kantienne est une morale de l’espoir (peu
pratique !)
Liberté = loi morale => être libre = respecter la loi
morale
Liberté = fait de la raison = essence de l’homme
Loi morale est formelle et vide qui dit :
respecte-moi
élève ton action à la nécessité d’une loi
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%