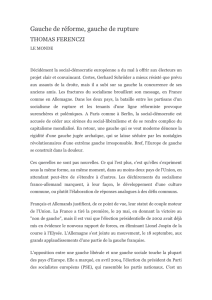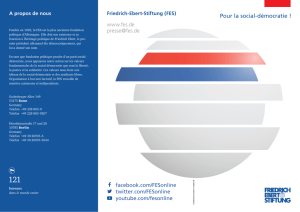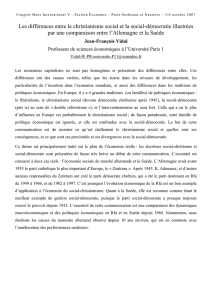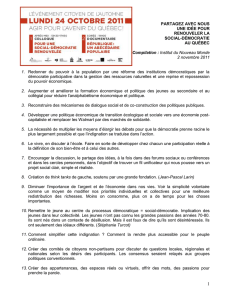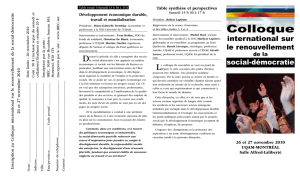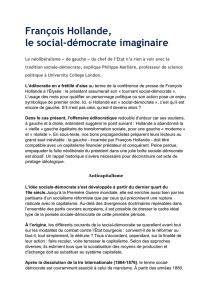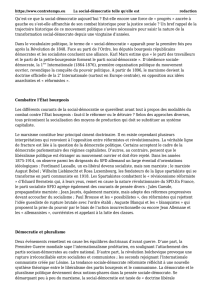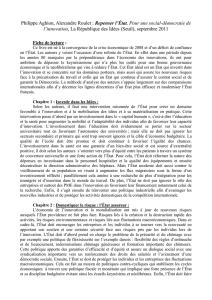document

1
Éléments de synthèse : la social-démocratie et son rapport à l’État
Benoît Lévesque
Professeur émérite, UQÀM
Professeur associé, ÉNAP
Le colloque sur le renouvellement de la social-démocratie se voulait un point de départ
plutôt qu’un point d’arrivée. Un point de départ pour convaincre et mettre à l’ordre du jour
la question politique, dans un sens non partisan, mais dans une direction progressiste et de
gauche. S’il y a une réaffirmation des valeurs exprimées par la tradition social-démocrate, il
y a aussi l’affirmation d’un renouvellement nécessaire, ce qui représente le principal défi
d’un tel chantier québécois, qui se doit d’être relié à des démarches comparables ailleurs
dans le monde, d’où la présence d’un invité international à l’ouverture (Bernard Hamon,
porte-parole du Parti Socialiste français) et de deux autres invités internationaux dans deux
ateliers sur trois (Jean-Louis Laville, professeur au Conservatoire National des Arts et
Métiers, Paris; Jorge Leon, sociologue en Équateur) .
Comme point de départ, ce colloque international fut d’une grande richesse même si nous
étions en amont d’un programmatique social-démocrate. C’est le cas du rapport à l’État
pour la social-démocratie autour duquel on m’a demandé de proposer des éléments de
synthèse. Le fait de parler de renouvellement de la social-démocratie nous permet en même
temps d’identifier les faiblesses pour ne pas dire les dérives de la social-démocratie au
cours des dernières décennies. Toutefois, l’objectif premier est celui des pistes pour un
renouvellement.
De l’État stratège à la social-démocratie
Il y a deux ans quelques-uns d’entre nous avons commencé à réfléchir sur la social-
démocratie, à la suite entre autres de recherches sur un « État stratège ouvert à la
participation citoyenne » réalisées dans le cadre de l’Observatoire de l’administration
publique de l’ÉNAP (http://www.observatoire.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.0). Ces
recherches montraient entre autres la nécessité d’avoir un État capable de vision,
d’anticipation, d’inspiration et aussi capable d’accompagnement pour une société où les
citoyens, loin d’être amorphes, apparaissent de plus en plus actifs et préoccupés à la fois de
questions économiques (exploitation de ressources fossiles) et de questions sociales (les
services publics) relevant de l’intérêt général. De plus, l’État québécois tel que dirigé par
Jean Charest était alors devenu (et continue de l’être) un État pompier et myope, un État en
panique plutôt qu’un État visionnaire.
Certains collègues (dont Alain Noël, co-auteur d’un ouvrage important sur la gauche et la
droite) nous ont alors dit qu’un « État stratège ouvert à la participation citoyenne », c’était
un État social-démocrate. Sans doute, si l’on considère que la social-démocratie soulève au
moins deux grandes questions interdépendantes, mais qui n’ont jamais été résolues de
manière complètement satisfaisante, soit celle de la démocratie et celle de la question
sociale, qui toutes deux posent le rapport à l’État et le rapport à l’économie. La démocratie
est à la fois un moyen et une fin pour vivre ensemble alors que la question sociale est en fait

2
une question économique non résolue et dont la résolution ne peut être purement
économique, une question dont la réponse passe nécessairement par la démocratie (le
politique) pour un encastrement social.
De l’État comme domination à l’État protecteur
D’un point de vue historique, l’arrimage de la démocratie et de la question sociale n’a été
réalisé de la manière la plus avancée et à l’échelle la plus large que par la social-démocratie
ou encore par le socialisme démocratique. Pour y arriver, la social-démocratie a fait de
l’État un instrument indispensable pour la redistribution de la richesse, pour la protection
sociale, pour la régulation et plus largement encore pour l’expression de l’intérêt général.
Ce rapport à l’État exige d’être ré-examiné à la lumière de la pensée politique et de l’histoire
du socialisme.
Dans la pensée politique, l’État est marqué par une ambivalence puisqu’il a été présenté
tantôt comme une sorte Léviathan (ce montre des profondeurs dont parlait la Bible), tantôt
comme protecteur.
- D’une part, pour des auteurs comme Hobbes, l’État résulte d’un contrat social entre
des citoyens soit disant rationnels qui s’en remettent à un pouvoir absolu, une sorte
de Léviathan, pour éviter la guerre et pour protéger la propriété privée et assurer la
sécurité des personnes. Beaucoup plus tard, Max Weber définira néanmoins l’État
comme lieu d’exercice du « monopole de la violence légitime ». En somme, l’État
apparaît ainsi comme expression d’une domination rationnelle (comme d’ailleurs
chez Marx où il est au service de la classe dominante alors que les néomarxistes le
verront comme expression d’un rapport de classes). Dans cette perspective, faut-il se
surprendre que l’État puisse être parfois détourné au profit d’intérêts individuels ?
- D’autre part, plus récemment, Polanyi laissera bien voir comment les citoyens
dépouillés par une économie désencastrée du social tentent à la fois de s’associer à
l’échelle de la société civile (création d’associations volontaires, de secours mutuels
et d’organisations coopératives) et de faire appel à l’État pour les protéger par la
reconnaissance de droits sociaux, selon une trajectoire qui donnera ainsi naissance à
l’État social, puis à l’État providence, dans le cadre d’une grande transformation.
Si l’on revient sur le terrain de la pratique politique, la gauche a eu tendance à privilégier
l’État, le pouvoir de l’État, pour réaliser une société plus égalitaire. À la différence du
communisme qui proposait de s’emparer de l’État par la violence pour ensuite imposer une
dictature du prolétariat, la social-démocratie pour sa part accepte la démocratie
représentative de même que l’État de droit pour mettre en place une société plus égalitaire
et plus respectueuse de la liberté individuelle et collective. À la voie parlementaire,
s’ajoutera la recherche de compromis entre les syndicats et le patronat pour un partage des
gains de productivité à travers des arrangements institutionnels dont la négociation
collective et des services publics collectifs. La voie social-démocratie a permis des sociétés
plus égalitaires et des population mieux éduquées et en meilleure santé, comme on a pu le

3
constater dans la plupart des pays occidentaux (au moins pour les trente glorieuses et
même au-delà ).
Un rapport à l’État qui doit être ré-examiné
D’un point de vue historique, l’arrimage de la démocratie et de la question sociale n’a été
réalisé de manière la plus avancée et à l’échelle la plus large que par la social-démocratie ou
encore par le socialisme démocratique. Toutefois, au cours des « trente douloureuses »
(1980-2010), la social-démocratie n’a pu empêcher l’interruption de la marche du progrès
social sous l’impulsion d’une approche néolibérale (comme l’a indiqué Benoît Hamon, dans
l’atelier d’ouverture). Il nous faut donc reconnaître que la social-démocratie a besoin d’un
renouvellement en profondeur comme le montre la triple crise qu’elle traverse aujourd’hui,
soit une crise électorale (son recul en Europe, notamment), une crise du projet (perte de
base matérielle pour son projet de redistribution et progrès social) et une crise d’identité
(suite à l’expérience de la troisième voie, la social-démocratie est souvent perçue comme un
parti comme les autres).
Que la social-démocratie soit en crise n’est pas nouveau si l’on considère son histoire sur un
siècle et demi. Toutefois, les crises passées de la social-démocratie n’ont été traversées
positivement qu’à la suite de plusieurs redéfinitions voire de refondations. Dans cette
perspective, certaines interventions et commentaires permettent d’identifier quelques
thématiques de la social-démocratie concernant le rapport à l’État qui devraient être ré-
examinées, telles la capacité de l’État social-démocrate a exprimé l’intérêt général, l’État-
providence comme la forme idéale de l’État social, le rapport de l’État à la société civile de
même qu’à l’économie et au non marchand.
Le rapport de l’État à l’intérêt général
Pour la social-démocratie telle qu’elle s’est imposée au cours des trente glorieuses, l’État
(et de son administration publique) a la capacité de définir seul l’intérêt général. Cette
capacité semble devenue problématique dans les dernières décennies non seulement quand
les représentants de l’État s’engagent dans la globalisation de l’économie en signant des
ententes touchant le long terme sans aucune consultation des citoyens (comme cela a été
discuté dans l’atelier présidé par Diane G. Tremblay, à partir notamment de l’intervention
de Christian Deblock). Cette capacité est aussi mise à l’épreuve dans le cas de sociétés
nationales de plus en plus diversifiées, pluralistes et fragmentées.
La somme des intérêts collectifs comme la somme des intérêts individuels ne permettent
pas de constituer l’intérêt général par simple agrégation. Dans cette perspective, il ne suffit
pas de renforcer l’État comme tel mais il faut aussi que ce dernier accepte d’entretenir un
autre rapport à la société civile, de favoriser une démocratie élargie permettant le dialogue
entre les intérêts collectifs et éventuellement la mise en place d’arrangements
institutionnels conséquents. À terme, les décisions pourraient être plus éclairées et
appropriées avec plus de conviction et plus de ressources. À y regarder de plus près, ne
peut-on pas découvrir des expérimentations et des innovations politiques (voir la démarche
de la loi anti-pauvreté exposée par Vivian Labrie) qui pourraient nous inspirer dans la

4
manière à traduire les demandes sociales en politiques publiques? Dans cette perspective,
la capacité de l’État à définir l’intérêt général suppose désormais de mettre à contribution
les acteurs de la société civile, à travers divers mécanismes qui ne limitent pas la
compétence de l’État puisque ces derniers ne sont légitimes qu’à la suite de son accord.
L’État définit le cadre permettant par exemple la co-constrution ou la co-élaboration de
politiques publiques avec des organisations de la société civile.
L’État-providence, la forme idéal de l’État social ?
Même s’il a permis des avancées impensables jusque-là, l’État-providence comme forme
idéale de l’État social a été questionné par certaines interventions notamment dans l’atelier
présidé par Louis Côté et celui présidé par Yves Vaillancourt. Outre la question de la
participation des usagers que le providentialisme limite au profit d’une définition des
programmes par la bureaucratie étatique, l’État-providence repose sur une séparation trop
étanche entre l’économique et le social. D’un côté, l’entreprise à dominante capitaliste
produit la richesse ; de l’autre, l’État-providence la redistribue aux citoyens pour des
services sociaux ou pour la protection sociale. Cette vision de l’État-providence laisse
supposer que le social n’est qu’une dépense, jamais un investissement pouvant produire de
la richesse. Elle laisse supposer aussi que l’entreprise privée ne profite pas des
investissements sociaux et qu’elle ne reçoit pas elle-même des fonds publics (en ce sens, on
pourrait dire qu’il existe aussi une providence pour les entreprises, non seulement celles
qui sont en difficulté, mais aussi celles qui veulent se développer).
Sous cet angle, l’État-providence joue un rôle de correcteur de l’économie de marché, un
rôle défensif dans la mesure où il intervient sur les conséquences et non sur les causes. Or
comme les conséquences du développement économique sont de plus en plus négatives (ex.
l’environnement), les charges de l’État sont de plus en plus lourdes. Dès lors, la social-
démocratie n’a pas trouvé d’autres moyens pour satisfaire ses besoins financiers que
d’encourager la croissance à n’importe quel prix , allant même à favoriser la financiarisation
de l’économie (comme en Irlande et en Islande) et à se tourner vers les grands financiers et
les banquiers comme premiers conseillers pour des décisions d’intérêt général (voir les
conseillers officiels de Barak Obama ou encore les conseillers occultes de Jean Charest pour
une stratégie de développement des ressources du sous-sol québécois). De plus, même si ce
sont des dirigeants progressistes qui se retrouvent au pouvoir, ils deviennent rapidement
prisonniers du paradigme néolibéral, en raison entre autres de la très grande mobilité du
capital et de la très forte dépendance de l’État social à l’égard de l’économie de marché. Il
faut aussi ajouter qu’avec la globalisation de l’économie les gouvernements se retrouve
avec des problèmes inédits de régulation et de coordinations des activités économiques.
En somme, l’État se doit d’être anticipateur et capable d’agir sur les causes et pas seulement
sur les conséquences. Ainsi, sans une vision élargie de l’économie et l’adoption de principes
plus équitables pour la distribution ou répartition (ce qui permettrait de réduire
considérablement les inégalités sociales à leur source), la redistribution pour corriger après
coup sera de plus en plus élevée et apparaîtra inacceptable pour une partie de plus en plus
importante de la classe moyenne. Il existe bien un plancher pour les salaires (salaire

5
minimum), mais pour la rémunération des hauts salariés, il n’existe pas de plafond ou si l’on
veut le plafond, c’est le ciel sur terre, à l’image des buildings de Shanghai ou de Dubaï.
Le rapport de l’État à la société civile
La question du rapport entre État et la société civile dans la perspective de la social-
démocratie a été soulevée entre autres par Jean-Louis Laville et Joseph Yvon Thériault. Le
sociologue et économiste français a rappelé qu’historiquement la solidarité démocratique à
la base de la social-démocratie et du socialisme s’est exprimée sous deux formes : une
forme reposant sur les droits qu’assure l’État, notamment l’État social, et une forme
volontaire basée sur la réciprocité et sur le principe de la commune humanité, voire de la
commune compétence (Bruno Frère).
Si la social-démocratie a surtout misé sur la solidarité démocratique reposant sur l’État, une
social-démocratie renouvelée devrait s’efforcer d’arrimer cette dernière à la solidarité
démocratique reposant sur l’association volontaire et la coopération que l’on retrouve à
l’échelle de la société civile. En arrimant ainsi la démocratie représentative et la démocratie
participative (comme Michel Doré l’a expliqué dans sa synthèse), on peut faire l’hypothèse
d’un renforcement du pouvoir de l’État non par une surdose de contraintes, mais par une
légitimité nouvelle que lui donne la société civile. Dans ce chassé-croisé, la reconnaissance
de la société civile doit s’accompagner d’un soutien étatique aux activités citoyennes et de
pratiques relevant de la co-construction ou co-élaboration de politiques publiques dans les
domaines la concernant.
Par ailleurs, Joseph Yvon Thériault soulève tout de même deux inquiétudes légitimes : l’une
concernant la faible capacité d’une société civile fragmentée à agir dans le sens de l’intérêt
général ; l’autre questionnant la trop grande importance accordée à la société civile qui
aurait contribué à un affaiblissement de l’État et de la confiance accordée aux élus
(l’affaiblissement des institutions démocratiques peut résulter également d’un populisme
où le chef de l’État cherche en priorité l’accord des foules au mépris des institutions
démocratiques comme l’a expliqué Jorge Leon pour l’Équateur). En conséquence, le
sociologue québécois nous invite à renforcer l’État plutôt que la société civile, la démocratie
représentative plutôt que la démocratie participative.
Sans chercher à réconcilier trop facilement cette analyse proposant le renforcement de
l’État avec celle de Jean-Louis Laville sur le potentiel de démocratisation que peut apporter
la société civile, on peut se demander si l’on n’est pas devant deux défis différents mais qui
sont par ailleurs complémentaires :
- soit celui d’une nécessaire revitalisation de la démocratie représentative et de ses
institutions (et donc d’une revalorisation de l’État et des représentants élus, ce que
souhaite Joseph Yvon Thériault) à partir d’un arrimage avec la démocratie
participative (et donc avec les divers groupes de la société civile) selon des
arrangements institutionnels à préciser;
- soit celui d’un investissement dans des espaces publics permettant le dialogue et des
échanges plus nourries entre les micro-espaces publics que constituent les
associations et certaines coopératives évoluant davantage à l’échelle locale, quitte à
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%