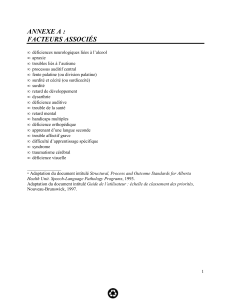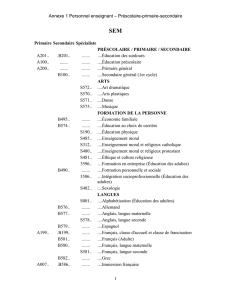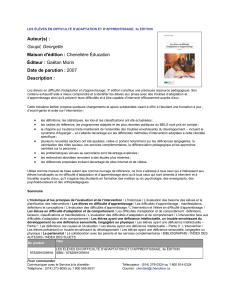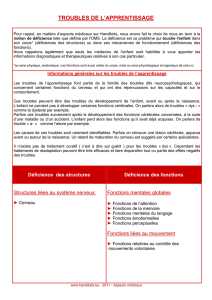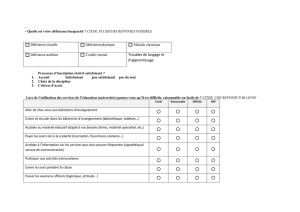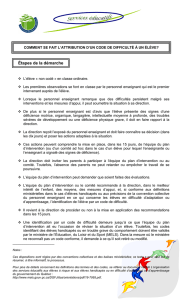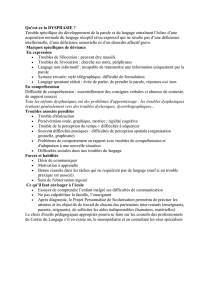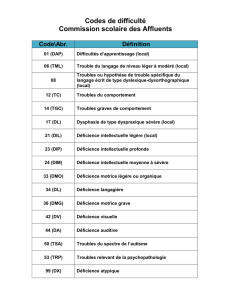Offre de services en déficience physique(MSSS, 17 sept
publicité

OFFRE DE SERVICE POUR LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE PYSIQUE Afin de faire ensemble Direction des personnes ayant une déficience Septembre 2015 0 1 TABLE DES MATIÈRES (à venir) 2 3 INTRODUCTION Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) présente l’offre de service pour le programme-services déficience physique. Ce document décrit l’ensemble des services requis pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience physique, ainsi qu’aux besoins de leurs familles et de leurs proches, dans le but ultime d'assurer leur participation sociale. La finalité de l’offre de service est de fournir des orientations claires pour s’assurer que soit déployé un ensemble de services à ces personnes, peu importe leur âge, leur déficience, leur situation sociale ou leur lieu de résidence. Elle vient camper la vision d’un réseau de services intégrés près des personnes et des milieux de vie, c’est-à-dire une gamme complète de soins et de services de qualité, organisée et coordonnée sur un territoire donné. Cette offre de service concrétise les fonctions du Ministère inscrites dans l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), lesquelles consistent, notamment, à : Établir les politiques de santé et de services sociaux ; Voir à leur mise en œuvre, à leur application […] et à leur évaluation; Diffuser, auprès des établissements, les orientations relatives aux standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience. Les besoins des personnes ayant une déficience physique, de leur famille et de leurs proches constituent le point de départ de la présente offre de service. C’est à partir de ceux-ci que se décline la gamme de services qui se doit d’être rendue disponible de façon concertée, et qui s’appuie sur les différentes étapes du continuum dans lequel chemine la personne. Le tout s’articule en tenant compte non seulement des obligations prévues à la Loi sur les Services de santé et les Services sociaux, mais également des engagements gouvernementaux à l’égard des personnes ayant une déficience. Le présent document en est un d’orientations et laisse le soin aux Centres Intégrés de Santé et de Services sociaux (CISSS)1 de mettre en place les moyens nécessaires pour en actualiser son contenu. Il constitue une référence pour la planification de la gamme de services et il doit faire l’objet d’adaptation pour considérer les réalités territoriales et locales2. Enfin, l’offre de service progressera au fil des années concurremment à l’évolution des connaissances, des pratiques et de l’organisation du réseau de la santé et des services sociaux. Le présent document se veut dynamique et évolutif. 1 Le terme CISSS inclut également le Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services sociaux (CIUSSS). 2 De plus, la mise en application de l’offre de service doit tenir compte de la nécessité d’adapter les services aux caractéristiques des communautés autochtones et ethnoculturelles, et, conformément aux engagements gouvernementaux, à l’analyse différenciée selon le sexe. 4 Enfin, un plan de mise en œuvre, incluant une stratégie d’évaluation, accompagnera le document afin de s’assurer du déploiement et de la consolidation de l’offre de service. 5 CHAPITRE 1 : CONTEXTE La présente offre de service a comme objectif principal de fournir des orientations claires pour assurer le déploiement d’un réseau de services intégrés près des personnes et des milieux de vie, c’est-à-dire une gamme complète de soins et de services de qualité, organisée et coordonnée sur un territoire donné en réponse aux besoins des personnes ayant une déficience physique, de leur famille et de leurs proches. Divers principes, moyens et approches soutiennent la mise en œuvre d’un réseau de services intégrés et doivent orienter les actions afin de répondre adéquatement aux besoins des personnes ayant une déficience physique, de leur famille et de leurs proches. LA MISE EN PLACE D’UN INTÉGRÉS : UN OBJECTIF COMMUN 1.1 RÉSE AU DE SERVICES Au fil du temps, le gouvernement du Québec a adopté des politiques afin de favoriser la participation sociale des personnes handicapées; citons entre autres la politique A part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité (2009) ainsi que la politique « L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées » (2006). De plus, le Conseil des ministres a accepté en 1988 un principe visant la compensation des conséquences financières des limitations fonctionnelles des personnes handicapées dans la détermination de l’aide matérielle qui leur est accordée.3 Par ces positions, le gouvernement rappelle que la participation sociale des personnes ayant une déficience physique est une responsabilité collective et interpelle tous les acteurs publics et privés de la société à contribuer à l’atteinte cet objectif. À cet égard, les alliances intersectorielles sont essentielles pour soutenir la participation sociale des personnes dans les domaines les plus concernés : services de garde, éducation, emploi, habitation, loisir et transport. À titre d’exemple, soulignons l’Entente de complémentarité entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation. Des services accessibles et complémentaires » et la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées (2009-2014) convenues avec le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) respectivement qui visent à obtenir une vision commune et globale des besoins des personnes ainsi qu’à préciser les responsabilités spécifiques et communes des partenaires et ce, dans une perspective de continuité et de coordination des services. Le fonctionnement en réseau de services intégrés doit donc s’actualiser en collaboration avec les différents acteurs de la communauté. La notion de réseau de services intégrés signifie le développement d’une gamme complète de soins et de services de qualité, organisée et coordonnée sur un territoire 3 Gouvernement du Québec, Réunion du Conseil des ministres, Compensation des limitations fonctionnelles des personnes handicapées, 29 juin 1988, décision no.88-151 6 donné par un ensemble d’organisations et d’acteurs interreliés et complémentaires. Il vise à assurer la prestation d’un continuum de services de manière personnalisée, équitable, efficace et efficiente en réponse aux besoins des personnes ayant une déficience physique, de leurs familles et de leurs proches4. Pour le réseau de la santé et des services sociaux, l’intégration des services doit permettre d’apporter une meilleure réponse aux besoins des personnes en limitant les barrières entre les établissements, entre les programmes-services, entre les missions d’un même programme-services et entre les professionnels. Des services intégrés reposent sur l’engagement et la responsabilisation des intervenants et des gestionnaires à l’égard de la population et sur la définition de mécanismes fonctionnels de référence et de suivi5. L’accès à des services continus et de qualité constitue l’attente principale des personnes au regard du système de santé et de services sociaux. C’est par l’intégration des services qu’il devient possible d’atteindre, notamment les objectifs suivants : Offrir des services de proximité (1ere ligne), plus accessibles, mieux coordonnés, plus personnalisés, sans rupture, au moment opportun; Assurer un meilleur soutien des personnes, de leurs familles et de leurs proches dans leur cheminement clinique; Développer et consolider le partenariat avec les nombreux acteurs impliqués dans la réponse aux besoins des personnes, de leurs familles et de leurs proches; Mobiliser les usagers et les intervenants et favoriser leur participation à l’organisation et à la gestion des services; S’assurer de l’engagement et la responsabilité de chacun. L’intégration des services passe, notamment par la collaboration, la concertation et la coordination des services au sein du réseau de la santé et des services sociaux et avec les partenaires des autres réseaux. 1.2 LA COORDINATION DES SERVICES : UN INCOUTOURNABLE Un des déterminants de succès d’un réseau de services fluide et concerté demeure leur coordination. Une coordination efficace est soutenue par une concertation et une collaboration entre les intervenants eux-mêmes et les organisations qui partagent une 4 5 Inspiré de Leatt, P., Pink, G.H. & Guerriere (2000) Towards a Canadian Mondel of Integrated Health Care, Healthcare Papers, vol. 1, no.2, p. 14 et Ontario Hospital Association (1998) Health Networks : Seven Case Studies : A description and preliminary Analysis, Toronto (ontario), OHA., p.4-7. Ministère de la Santé et des Services sociaux (février 2004). L’intégration des services de santé et des services sociaux. Le projet organisationnel et clinique et les balises associées à la mise en œuvre des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. 7 compréhension commune du processus de soins et de services pour la personne, sa famille et ses proches. Ces derniers étant au cœur de la démarche de coordination. La coordination réfère à l’ensemble des activités requises pour assurer l’apport harmonieux de chacun des intervenants sans qu’il n’y ait dédoublement, incohérence ou lacune.6 Divers moyens pour assurer la coordination et la continuité des services ont été déployés au cours des dernières années, notamment la planification concertée des services au moyen d’un PII ou d’un PSI et la fonction d’intervenant-pivot. La LSSSS7 stipule qu’afin de s'assurer de la coordination des services requis pour la population du territoire, le CISSS doit, entre autres : Définir et mettre en place des mécanismes d'accueil, de référence et de suivi des personnes; Instaurer des mécanismes ou conclure des ententes avec les différents partenaires que sont, notamment, les services spécialisés ou surspécialisés, les médecins du territoire, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale et les ressources privées (pharmacies, cliniques médicales, ressources résidentielles, etc.); Accompagner et soutenir les personnes, dont celles ayant des besoins particuliers et plus complexes, afin de leur assurer la continuité des services que requiert leur situation. La personne ayant une déficience physique, sa famille et ses proches a régulièrement besoin de services offerts simultanément par plusieurs intervenants, programmes et organismes. La mise en place de mesures visant à faciliter la complémentarité et la continuité des services requis par une personne et sa famille s’avère donc nécessaire. Ainsi, pour assurer la continuité des services, le plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience8 établit deux standards : la planification concertée des services et la désignation d’un intervenant pivot. 1.2.1 La planificatio n concertée des services et l’intervenant pivot : des standards de continuité La LSSSS9 renvoie la responsabilité aux CISSS de recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins et l’obligation d’élaborer un plan d’intervention ou un plan de services individualisé10. De plus, elle vient préciser que ces plans doivent 6 MSSS (2004) Projet clinique Cadre de référence pour les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. Document principal 7 Article 99.7, L.R.Q., chapitre S-4.2 8 MSSS (2008) Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience : Afin de faire mieux ensemble 9 Article 101, L.R.Q., chapitre S-4.2 10 Article 102 et 103, L.R.Q., chapitre S-4.2 8 contenir un échéancier relatif à leur évaluation et à leur révision et peuvent être modifiés en tout temps pour tenir compte de circonstances nouvelles11. Le plan d’intervention (PI) et le plan d’intervention interdisciplinaire (PII) est élaboré par un ou des intervenants d’un même établissement avec la participation active de la personne, de sa famille et de ses proches, en vue d’identifier les besoins, de déterminer les objectifs poursuivis et les moyens à utiliser pour répondre à ces besoins et la durée prévisible des services. Le plan de services individualisé (PSI)12 permet l’intégration des services sur les plans cliniques et organisationnels pour l’ensemble des partenaires provenant de différents établissements du réseau de la santé et des services sociaux, organismes communautaires ou secteurs d’activités (services de garde, éducation, emploi, transport, justice, municipal, etc.). Il est un outil clinique faisant partie du dossier de l’usager. Le PII se distingue du PSI dans la mesure où le premier implique des intervenants d’un même CISSS alors que le deuxième interpelle des intervenants hors CISSS, qu’ils fassent partie du réseau ou non. Dans les deux cas, ils visent à partager les objectifs et définir les rôles de chacun. Le PII et le PSI génèrent autant de plans d’intervention qu’il y a d’intervenants impliqués au dossier et s’actualisent grâce à la mise en œuvre concertée des plans d’intervention. Que ce soit un PI, un PII ou un PSI, la personne doit toujours être au centre des décisions, tant à ce qui a trait au choix de son projet de vie qu’à la rédaction des objectifs, des orientations d’action et de services. Ces outils cliniques permettent de planifier l’offre de service à dispenser à la personne en réponse à ses besoins. L’élaboration du PII ou du PSI ainsi que la planification et la coordination des services est réalisée par l’intervenant pivot13. Celui-ci est désigné par le CISSS dès l’évaluation globale des besoins de la personne. Il est l’interlocuteur principal pour la personne, sa famille et ses proches et permet d’assurer l’intégration des interventions et des services. Il s’assure que la personne et ses proches soient accompagnés et soutenus dans le processus d’obtention des services. Il leur évite de se retrouver seuls dans les nombreuses démarches à faire. Il assure la communication de l’information entre la personne, sa famille, ses proches et les prestataires de services. La coordination des services permet d’offrir des services intégrés répondant aux besoins des personnes et leurs proches. Une coordination efficace assure l’accès, la continuité et la qualité de services. Elle rend l’offre de services disponible et flexible selon l’évolution des besoins des personnes desservies par le RSSS. 11 Article 104, L.R.Q., chapitre S-4.2 12 La notion de PSI comprend celle du plan de service individualisé et intersectoriel (PSII) lorsque le réseau de l’éducation est impliqué 13 Voir fiche X intervenant pivot 9 La mise en œuvre d’un réseau de services intégrés, introduit dans les récents changements législatifs, est la principale visée de la présente offre de services permettant de répondre aux besoins des personnes, de leur famille et de leurs proches. 1.3 ASSISES LÉGALES La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) a pour but le maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie. Elle vise, notamment à favoriser le recouvrement de la santé et du bien-être des personnes; favoriser l'adaptation ou la réadaptation des personnes, leur intégration ou leur réintégration sociale; diminuer l'impact des problèmes qui compromettent l'équilibre, l'épanouissement et l'autonomie des personnes; et atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des différentes couches de la population et des différentes régions14. Ces objectifs constituent l’une des assises légales qui motive le ministère de la santé et des services sociaux à consolider et développer une offre de service pour les personnes ayant une déficience physique. Par ailleurs, la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées propose des orientations qui guident le MSSS et son réseau, notamment à : adopter une approche qui considère la personne handicapée dans son ensemble, qui respecte ses caractéristiques particulières et qui favorise un plus grand développement de ses capacités; favoriser l’autonomie des personnes handicapées et leur participation à la prise de décisions individuelles ou collectives les concernant ainsi qu’à la gestion des services qui leur sont offerts; favoriser l’adaptation du milieu aux besoins des personnes handicapées et de leurs familles sans discrimination ni privilège15. Durant la dernière décennie, des efforts importants ont été investis pour développer les réseaux locaux de services (RLS) afin de répondre aux besoins des personnes et de leurs proches. À l’époque, la mise en réseau visait l’amélioration de l’accessibilité, de la continuité, de l’intégration et de la qualité des services pour la population d’un territoire donné, et ce, grâce à l’élaboration d’un projet clinique et organisationnel. Plus récemment, on a vu la création d’établissements à mission élargie et l’implantation d’une gouverne à deux niveaux hiérarchiques. Ces derniers changements visent à favoriser et à simplifier l’accès aux services pour la population, à contribuer à l’amélioration de la qualité des services et à accroître l’efficience et l’efficacité du réseau. Désormais, l’organisation de services en santé et services sociaux est abordée sous l’angle du réseau territorial de services (RTS), sans que ne soit écartée la notion de RLS. 14 15 Loi sur les services de santé et les services sociaux, art. 1 Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, article 1.2 10 1.4 ASSISES ORGANIS ATIONNELLES La mise en œuvre du RTS consiste à responsabiliser les organisations et l’ensemble des acteurs à agir collectivement en vue d’offrir des services plus accessibles et mieux intégrés. Certains principes et moyens organisationnels orientent l’action en vue de mieux intégrer les services et de répondre adéquatement aux besoins des personnes. 1.4.1 La responsabilité populati onnelle La notion de responsabilité populationnelle implique que les intervenants qui offrent des services à la population d’un territoire partagent collectivement une responsabilité envers cette population. Elle implique de rendre accessible un ensemble complet de services le plus près possible du milieu de vie, tout en favorisant la convergence des efforts pour maintenir et améliorer la santé et le bien-être de la population. Le CISSS a l’obligation de rendre disponible l’ensemble des services requis pour répondre aux besoins de la population de son territoire; à défaut de pouvoir y répondre, des ententes de services doivent être formalisées. 1.4.2 La hiérarchisation des services Le principe de hiérarchisation implique d’améliorer la complémentarité pour faciliter le cheminement des personnes entre les niveaux de services, par la mise en place de mécanismes de référence16. Une meilleure accessibilité sera assurée par les ententes et corridors de services établis entre les dispensateurs. Cela implique la mise en place de mécanismes bidirectionnels assurant la référence mais aussi la planification du retour de la personne dans son milieu de vie. Au préalable, trois niveaux de services sont reconnus et définis par le MSSS17, soit les services de proximité (1ère ligne), les services spécialisés (2ème ligne) et surspécialisés (3ème ligne). Cette division traduit la complexité des interventions nécessaires pour répondre à un besoin de santé ou à un besoin psychosocial. Ainsi, la hiérarchisation des services vise à assurer à la personne le bon service, au bon moment, au bon endroit et avec l’expertise appropriée. Le premier niveau d’accès est celui des services de proximité (1ere ligne) qui sont destinés à l’ensemble de la population (services généraux, médicaux, sociaux et communautaires et activités de santé publique) et à des clientèles ayant des besoins particuliers (services spécifiques et activités de santé publique). Cet accès est généralement direct et les conditions qui permettent le recours à ces services sont simples, prévisibles, clairement définies et connues des usagers. Ces services visent à répondre à des problèmes de santé ou à des problèmes sociaux usuels et variés. Ils doivent de plus être offerts près du milieu de vie des personnes qui les utilisent. Ces services s’appuient également sur des infrastructures et des technologies légères. Ces services comprennent les services offerts par le CISSS, mais également les services offerts par les médecins généralistes en cabinet privé, les ressources intermédiaires et 16 MSSS (2004) Projet clinique Cadre de référence pour les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. Document principal. 17 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (2004). L’architecture des services de santé et des services sociaux. Les programmes-services et les programmes soutien, Québec; Ministère de la santé et des services sociaux. 11 de type familial, les organismes communautaires, les entreprises d’économie sociale, les pharmacies communautaires. Les services généraux répondent à un besoin de maintien ou d’amélioration de la santé et du bien-être ou encore à des problèmes généralement ponctuels, qui peuvent aussi être de nature aiguë et réversible. Ces services à caractère universel s’adressent à tous, y compris les clientèles particulières. Les services généraux contribuent principalement à « traiter » la personne ou à stabiliser son état ou à réduire les conséquences. Les services spécifiques s’adressent à des clientèles vulnérables et particulières. Ils visent à soutenir les personnes qui vivent dans leur communauté et qui, pour la plupart, doivent recevoir à moyen ou long terme, de façon continue, des services qui leur sont propres. Pour le programme-services en déficience physique, ces services sont principalement des services de soutien à domicile. Les services spécialisés (2e ligne) permettent quant à eux de résoudre des problématiques complexes. Ils sont généralement appuyés sur une infrastructure importante et une technologie avancée ainsi que sur une expertise pointue, mais qui demeure toutefois répandue. Les professionnels interviennent auprès des personnes qui leur sont référés, en soutien auprès des intervenants des services de proximité (1ere ligne), et agissent comme consultants auprès de ces derniers. Les services surspécialisés18 (3e ligne) permettent d’offrir une réponse à des problèmes très complexes, en raison du nombre restreint de personnes concernées ou encore, parce que le développement et le maintien de l’expertise l’exigent. Ils regroupent les services offerts aux usagers qui en ont besoin et dont la responsabilité doit être concentrée pour offrir, de façon efficiente, des services de qualité en raison de la rareté de la clientèle, de la nature ou de l’organisation des services, ou encore en raison des caractéristiques des ressources nécessaires pour offrir ces services. Ils sont la plupart du temps organisés sur une base nationale, et sont accessibles habituellement sur référence. La nature surspécialisée des services est appelée à évoluer dans le temps en fonction de l’émergence des besoins de certaines clientèles et de l’évolution des connaissances et de la technologie. 1.4.3 Le projet clinique et organisationnel Les principes de responsabilité populationnelle et de hiérarchisation des services, qui servent de fondements à la mise en œuvre des RTS, s’actualisent au moyen du projet clinique et organisationnel. Le projet clinique réfère à une démarche qui vise à répondre aux besoins de santé et de bien-être de la population du territoire qui englobent l’ensemble des interventions du continuum de services que sont la promotion-prévention, le repérage et le dépistage, l’évaluation diagnostique ou des besoins, la référence et l’orientation, les interventions ou traitements, l’adaptation et la réadaptation, le soutien à la participation sociale, le 18 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (2007) Cadre de référence pour les services surspécialisés de réadaptation en déficience physique. 12 maintien des acquis et le soutien en fin de vie. Il tient compte du rôle et des responsabilités des acteurs sectoriels et intersectoriels et du potentiel de contribution des divers acteurs. Il suppose que les divers acteurs se rendent imputables des services qu’ils offrent aux personnes et des ressources mises à leur disposition19. Le projet clinique s’inscrit dans une logique d’intégration et de cohérence. D’abord, une logique d’intégration verticale qui vise à corriger les problèmes d’accès à l’expertise requise en temps opportun. L’intégration verticale réfère à la capacité d’articuler la réponse à la totalité des besoins d’une personne allant de la prévention au soutien de fin de vie pour une problématique précise, impliquant un lien entre tous les niveaux de service. Ensuite, une logique d’intégration horizontale qui tend à corriger les problèmes de continuité par l’offre d’une large gamme de services continus et complémentaires en réponse aux besoins de la population en général, mais aussi aux besoins spécifiques de certains groupes plus vulnérables. C’est dans cette logique que l’on retrouve la notion de globalité. L’intégration horizontale vise la capacité d’articuler une réponse à la totalité des besoins d’une personne pour toutes les problématiques auxquelles elle est confrontée impliquant une nécessaire coordination entre tous les niveaux. Elle permet, entre autres, d’améliorer les interventions auprès des personnes présentant plusieurs problématiques. Cette logique d’intégration s’inscrit dans la configuration des programmes qui découpent l’activité du système de santé et de services sociaux. 1.4.4 L’architecture des services Le secteur de la santé et des services sociaux est actuellement organisé en programme. Un programme est un regroupement de services et d’activités. Il existe deux types de programme : les programmes-services et les programmes-soutien. Un programme-services désigne un ensemble de services et d’activités organisé dans le but de répondre aux besoins de la population en matière de santé et de services sociaux ou, encore, aux besoins d’un groupe de personnes qui partagent une problématique commune20. Un programme-soutien désigne un ensemble d’activités de nature administrative et technique en appui aux programmes-services21. La définition d’un programme-services suppose que : le regroupement des services qui forme un programme est fondé sur la notion de besoin. Chaque programme doit regrouper l’ensemble des services et des activités qui permet de répondre aux besoins de la population ou à un profil de besoins d’un groupe de personnes; 19 MSSS (2004) Projet clinique Cadre de référence pour les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. Document principal 20 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (2004). L’architecture des services de santé et des services sociaux. Les programmes-services et les programmes soutien, Québec; Ministère de la santé et des services sociaux. 21 ibid, MSSS(2004). 13 les besoins ou les profils de besoins priment par rapport aux frontières des établissements, aux territoires professionnels, à des domaines d’activités et autre. Ainsi, une même personne peut avoir recours à plus d’un programme-services dont certains s’adressent à la population en général, alors que d’autres concernent des problématiques particulières. Figure A : Architecture des services L’arrimage des neuf programmes-services entre eux et la reconnaissance de leur interdépendance dans la réponse aux besoins des personnes, des clientèles particulières, des groupes vulnérables et de l’ensemble de la population posent de nombreux défis. Ces assises organisationnelles doivent permettre la rencontre des volets organisationnels et cliniques selon le continuum de services. Il en résulte une prestation d’interventions en adéquation avec les besoins des personnes. 1.5 ASSISES CLINIQUES Sur le plan clinique, les intervenants interagissent avec les personnes selon des approches et divers modèles qui conditionnent leurs pratiques. Les modèles et approches cliniques qui doivent guider les interventions en réponse aux besoins des personnes ayant une déficience physique sont les suivants. 1.5.1 Le processus de production du handicap comme modèle conceptuel 14 Le Processus de production du handicap (PPH) est un modèle conceptuel de classification des déficiences et incapacités22. Ce modèle fournit une référence commune pour mieux comprendre l’interaction dynamique entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux et leur effet sur la participation sociale. Le modèle du PPH présente les définitions de concepts telles que causes, déficience, incapacités, facilitateurs, obstacles, habitudes de vie, situation de participation sociale et situation de handicap. Ce modèle permet une conceptualisation commune et partagée de la personne à desservir et de la situation problématique dans laquelle elle se trouve, facilitant, du même coup la collaboration interprofessionnelle. Figure B : Processus de production du handicap (PPH) Facteurs de risque Causes Facteurs personnels Facteurs environnementaux Système organique Aptitudes Intégrité Déficience Capacité Incapacité Facilitateur Obstacle INTERACTION Habitudes de vie Participation sociale Situation du handicap Le cadre conceptuel du processus de production du handicap permet de comprendre comment se déploient les différents services nécessaires à l’élaboration du continuum de services, lequel s’articule autour des constituants reconnus dans le domaine de la santé et des services sociaux, soit : La promotion et la prévention pour agir sur les facteurs de risque; Les services de santé physique pour agir sur les systèmes organiques; 22 Voir annexe 2 : Adaptation du RIPPH/SCCIDIH, « Classification québécoise : Processus de production du handicap », Québec, 1998. 15 Les services d’adaptation-réadaptation pour agir sur les aptitudes et les facteurs environnementaux en rapport avec les habitudes de vie; Les services de maintien et de soutien à la participation sociale pour s’assurer de maintenir une interaction optimale de l’ensemble. La capacité de la personne à se réaliser grâce à l’actualisation de ses habitudes de vie définit son niveau de participation sociale. À cet égard, le but visé par les équipes qui interviennent auprès de la personne est de permettre à celle-ci, d’arriver à une pleine participation sociale malgré la présence d’incapacités. La participation sociale, finalité du programme-services en déficience physique, est définie comme étant La participation sociale est avant tout un phénomène social résultant d’un processus complexe fondé sur l’interaction entre une personne et les membres de sa communauté d’appartenance. La participation sociale implique un échange réciproque, égalitaire, signifiant et de qualité entre la personne et les gens avec qui elle interagit dans ses contextes de vie. Elle atteint son point culminant quand la personne exerce tous ses droits et se perçoit et agit comme l’acteur principal de sa vie23. Les équipes travaillent donc à développer ou maximiser les capacités de la personne à réduire et compenser ses incapacités et visent parallèlement la création de facilitateurs ou l’élimination des obstacles dans l’environnement. L’action des équipes est donc multidimensionnelle et écosystémique puisqu’elle considère autant les facteurs environnementaux que les facteurs personnels et leurs interactions. 1.5.2 L’approche écosystémique 24 L'approche écosystémique consiste en une analyse de la personne en interaction constante avec son environnement familial et social et avec les différents systèmes autour d’elle (garderie, école, travail, loisirs, etc.). Bien que la personne soit au centre du modèle, elle n’est pas seule responsable de son état et donc, de sa capacité de s’intégrer et de fonctionner. Le modèle écosystémique invite à considérer l’ensemble des interactions ainsi que diverses cibles d’intervention. La personne ainsi que sa famille, son groupe d’appartenance, les intervenants, les décideurs qui adoptent les politiques sociales ont une responsabilité partagée puisqu’ils peuvent, par leurs actions et décisions, contribuer à la réduction des situations de handicap. L’approche écosystémique s’applique dans l’évaluation des besoins de la personne et de ses proches, l’analyse de leur situation et la planification des interventions. Les stratégies d’intervention en contexte écosystémique reposent sur un partenariat entre la personne ayant une déficience physique et ses proches et les intervenants de divers services ou disciplines. L’établissement d’une relation de partenariat permet de présumer que les personnes présentant une déficience physique et leurs proches disposent d’un potentiel et sont compétents à maints égards, chacun contribuant d’une façon particulière à l’exploitation de ce potentiel. Ainsi, les intervenants partagent leur 23 Fédération Québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement (2013)La participation sociale des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement : du discours à une action concertée. Document d’orientation. 24 B. Terrisse et F. Larose (2004), L’intervention socio-éducative auprès de la famille, Montréal, Université du Québec à Montréal. 16 expertise ensemble et avec la personne et ses proches en encourageant celle-ci à l’apprentissage de savoirs et savoir-faire lui permettant d’accroître son autodétermination. 1.5.3 L’approche usager -partenaire 25 et l’«empow erment» 26 Comme l’indique sa dénomination, l’approche usager-partenaire considère la personne qui reçoit des soins ou des services comme un réel partenaire qui collabore avec l’équipe interdisciplinaire. Cette approche place la personne au centre des décisions relatives non seulement aux soins et services qu’elle reçoit en accord avec son projet de vie, mais également plus largement à la mise en place des services à l’intention du groupe de population qu’elle représente. L’approche usager-partenaire intègre le principe d’empowerment qui se définit comme étant l’accroissement du pouvoir d’agir d’une personne sur sa vie et sur son environnement, dans une perspective égalitaire, par la prise de conscience, le développement de ses capacités et par l’action. L’approche usager-partenaire utilise ce pouvoir accru et l’autonomie décisionnelle qui en découle, au profit des décisions devant être prises autant pour l’usager que pour l’organisation de services à l’intention de la clientèle. 1.5.4 De l’interdisciplinarité interprofessionnelle 27 à la collaboration Compte tenu de la variété et de la complexité des besoins de la personne et des différents contextes dans lesquels ils se manifestent, le recours à une équipe interdisciplinaire partageant des objectifs communs d’intervention, centrés sur les besoins de la personne, est essentiel. Cette équipe se compose principalement de professionnels formés dans un des champs de pratique de la réadaptation, du secteur de la santé ou des sciences sociales, auxquels se joignent des intervenants d’autres disciplines pertinentes ayant acquis une expertise particulière, notamment des médecins omnipraticiens, des médecins spécialistes et des optométristes. Pour offrir des services de qualité qui répondent adéquatement aux besoins des personnes et de leurs familles et proches, il est essentiel de pouvoir compter sur des ressources compétentes. Ainsi, les intervenants doivent posséder des connaissances sur la déficience physique et les incapacités qui en découlent, sur les principes cliniques à la base des interventions ainsi que sur les comportements efficaces en intervention. Par conséquent, des programmes de formation, des modalités de diffusion des bonnes pratiques, des mécanismes pour favoriser le partage d’expertise des services spécialisés avec les intervenants des services généraux, des services spécifiques, des autres programmes-services ainsi que des organismes communautaires font partie d’un ensemble de moyens à mettre en œuvre pour assurer le développement des compétences de tous ces intervenants. 25 Le terme usager-partenaire est ici employé à la place de l’expression consacrée patient-partenaire 26 V. Dumez, (2013), Évoluer ensemble pour aller plus loin. Rendez-vous de la réadaptation. Université de Sherbrooke (2007), Cadre de référence, Collaboration interprofessionnelle, École en Chantier 27 17 Allant au-delà de l’interdisciplinarité, la collaboration interprofessionnelle constitue un lieu de structuration d’une action collective qui réunit des membres d’au moins deux groupes professionnels autour d’un but commun, à travers un processus de communication, de décision, d’intervention et d’apprentissage, ce processus étant dynamique, évolutif et complexe. La justification de l’existence de la collaboration interprofessionnelle réside dans l’optimisation des moyens pour l’atteinte de résultats reliés à un but commun. À l’instar de l’approche interdisciplinaire, l’approche intersectorielle organise la prestation de services en tenant compte de la globalité et de l’intégrité de la personne. Toutefois, ce type de collaboration, conduit à une prise de décision partagée avec la personne, ses proches et sa famille quant à l’implication des divers professionnels et quant à la délégation d’activités cliniques que ceux-ci peuvent partager avec d’autres types de cliniciens En d’autres mots, il s’agit de voir comment on convient ensemble de l’utilisation optimale des compétences de chaque intervenant et comment s’organise le partage des responsabilités entre les intervenants et les professionnels ayant des actes réservés, dans une optique de gains d’efficience. 18 CHAPITRE 2 : LE DÉFICIENCE PHYSIQUE PROGRAMME-SERVICES EN 2.1 La finalité Le programme-services en en déficience physique regroupe un ensemble de services qui visent à développer et à maintenir les capacités des personnes, à compenser leurs incapacités, à favoriser leur autonomie fonctionnelle et à soutenir leur pleine participation sociale. La nature des besoins de ces personnes fait en sorte qu’elles doivent recourir à un moment ou à un autre, à des services spécialisés de réadaptation et, lorsque cela est nécessaire, à des services de soutien à la participation sociale 28.Les services visent aussi à soutenir la famille et les proches ainsi qu’à assurer aux personnes présentant une déficience physique, l’accès aux services destinés à l’ensemble de la population. De plus, le programme-services rejoint également tout organisme de la société civile qui a des responsabilités à leur égard. Ainsi, il contribue à l’amélioration des services destinés à l’ensemble de la population par le partage de l’expertise de ses intervenants. 2.2 Les orientations ministérielles L’organisation des services du programme-services en déficience physique s’appuie sur les Orientations ministérielles en déficience physique – Objectifs 2004-2009, ayant été reconduites jusqu’en 2012. De plus, ce programme est notamment encadré par le Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience (2008) et tient compte d’autres politiques et orientations ministérielles comme la politique de soutien à domicile Chez soi : le premier choix (2003) et le document Précisions pour favoriser l’implantation de la politique de soutien à domicile (2004). Les Orientations ministérielles en déficience physique – Objectifs 2004-2009 ont fait l’objet d’un bilan de l’état de leur réalisation (à paraître). Ce dernier en vient à la conclusion que ces objectifs demeurent pertinents, et qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l’offre de services à l’intention des personnes ayant une déficience physique. Pour ce faire, trois actions structurantes sont identifiées afin d’organiser les services requis de façon cohérente et harmonisée, de favoriser l’engagement des parties prenantes dans un projet mobilisateur et d’obtenir rapidement des résultats tangibles et opérationnels pour les personnes et leurs proches : Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), 2004. L’architecture des services de santé et des services sociaux. Les programmes-services et les programmes soutien, Québec. 28 19 1. Mettre en place et miser sur les continuums intégrés de services; 2. Assurer l’accès à des services de proximité forts et bien définis (1ère ligne); 3. Ajuster la disponibilité des services aux besoins identifiés au PSI. De ces grandes actions structurantes découlent à plus court terme, les priorités suivantes : 1. L’intensification des services d’aide à domicile pour assurer prioritairement le maintien des personnes ayant une déficience physique dans leur milieu de vie naturel, 2. Le développement d’options résidentielles dans le cadre d’un continuum intégré de services pour une offre de milieux de vie diversifiés, 3. Un accès amélioré à des services de soutien à la famille bonifiés, selon des critères uniformisés et cohérents, 4. La consolidation des services spécialisés dans le contexte des meilleures pratiques cliniques et administratives afin qu’ils soient en mesure de répondre aux besoins immédiats de la personne ayant une déficience physique et de soutenir les services de proximité (1ere ligne). La mise en application des actions structurantes nécessite l’adoption d’un plan de mise en œuvre, par priorité retenue. L’élaboration de ce plan prévu afin de s’assurer du déploiement et de la consolidation de l’offre de service tiendra compte des divers moyens identifiés pour l’atteinte des actions structurantes. Mettre en place et miser sur les continuums intégrés de services en déficience physique, afin de satisfaire tous les besoins identifiés au PSI de la personne ayant une déficience physique. préciser les trajectoires de services et de convenir des rôles et responsabilités de chaque acteur du continuum, incluant les groupes communautaires; élaborer une stratégie de mise en œuvre des continuums intégrés de services en déficience physique; assurer le suivi et l'évaluation des continuums mis en place à l’aide d’indicateurs de suivi et de résultats s'appuyant sur le cadre de référence ministériel sur la performance et reposant sur des systèmes d'information disponibles et complémentaires (SIPAD, GESTRED, I-CLSC, SICHELD, etc.); accélérer et de formaliser les ententes interétablissements du réseau, les alliances avec le communautaire et les alliances intersectorielles (MTESS, MEESR, MTQ, SHQ, OMH); formaliser les protocoles d’entente; mettre en place une table régionale de concertation (ou comité régional en déficience physique). 20 Assurer une première ligne forte. uniformiser et de consolider les services de première ligne et leur accès : accueil et référence, évaluation des besoins par des activités de repérage, détection précoce et diagnostic; assurer la disponibilité de ressources humaines qualifiées et une bonification des ressources financières pour le soutien aux familles, le répit, le dépannage et l’hébergement; élaborer des critères provinciaux précis, des balises d’admissibilité universelles et des mécanismes rigoureux d’attribution pour les programmes d’allocation directe; soutenir les CR pour une accentuation du partage d’expertise de la deuxième ligne vers la première ligne; recourir systématiquement à l’intervenant pivot comme accompagnateur et conseiller afin d’intégrer la personne et la famille dans le processus de décision touchant l’organisation des services dont elle a besoin; accentuer l’implantation et le suivi des projets cliniques et mettre en œuvre un plan d’action régional découlant des recommandations du projet clinique. Ajuster la disponibilité des services aux besoins identifiés au PSI. généraliser l’utilisation du PSI afin d’améliorer l’accès et de diminuer les temps d’attente, et s’assurer que celui-ci est suivi par des indicateurs de performance; maintenir et d’assurer l’évolution du Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience; obtenir un financement additionnel ou de procéder à une réallocation des ressources afin d’augmenter le nombre de professionnels en réadaptation de première et de deuxième ligne et d’offrir une plus grande plage de disponibilité des services (24/7); favoriser le retour à domicile précoce des personnes ayant une ; appliquer des normes communes d’évaluation de la qualité de services, de reddition de comptes, incluant le recours au PSI et les mécanismes de plaintes couvrant l’ensemble des organisations contribuant à l’offre de services. 21 CHAPITRE 3 : LA CLIENTÈLE Le programme-services en déficience physique s’adresse à des personnes de tous âges qui présentent une déficience physique, c’est-à-dire une déficience auditive, une déficience du langage, une déficience motrice ou une déficience visuelle ainsi qu’à leur famille et à leurs proches. Il offre également des services aux enfants ayant un retard significatif dans leur développement ainsi qu’aux personnes ayant un trouble de la communication sociale. 3.1 Les personnes ayant une déficience physique La clientèle du programme-services regroupe des personnes de tous âges, dont la déficience d'un système organique entraîne ou risque d’entraîner, selon toutes probabilités, des incapacités significatives et persistantes (y compris épisodiques) liées à l'audition, à la vision, au langage ou aux activités motrices et dont la réalisation des activités courantes ou des rôles sociaux est ou risque d'être réduite. Bien qu’un système organique puisse être altéré, ce sont plutôt les effets de la déficience physique sur le fonctionnement de la personne qui importent dans la reconnaissance de la clientèle. Dans la mesure où ces effets, en l’occurrence les incapacités, altèrent la réalisation des habitudes de vie, elles peuvent être qualifiées de significatives. Lorsque les incapacités perdurent dans le temps, elles sont considérées persistantes, par opposition à celles qui sont temporaires. Ainsi, le programme-services ne s’adresse pas aux personnes ayant des incapacités temporaires ou encore à celles dont la déficience physique n’a pas d’impact sur leurs habitudes de vie. Par ailleurs, une incapacité est dite épisodique lorsqu’elle revient périodiquement et persiste dans le temps. Les habitudes de vie et les rôles sociaux sont quant à eux définis comme étant les activités quotidiennes ou courantes, et les rôles adoptés par la personne, qui sont valorisés par celle-ci ou son contexte socioculturel selon ses caractéristiques (âge, sexe, identité socioculturelle), et qui assurent, notamment son épanouissement dans la société tout au long de son existence29. 3.2 Les enfants développement ayant un retard significatif dans leur La clientèle du programme-services inclut également les enfants âgés de moins de six ans qui accusent un retard significatif (deux écarts-types sous la moyenne établi avec un outil normalisé ou son équivalent) par rapport à leur âge chronologique dans au moins deux sphères de leur développement : motricité, cognition, développement socioémotionnel, communication et autonomie. Par conséquent, la catégorie « retard 29 Inspiré du RÉSEAU INTERNATIONAL SUR LE PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP (RIPPH), op.cit., p. 36. 22 significatif du développement » inclut les enfants ayant reçu un diagnostic de « retard global de développement » prévu au DSM-5, ainsi que tout autre enfant dont le retard significatif ne peut s’expliquer par un autre diagnostic précis. 3.3 Les personnes ayant un trouble de la communication sociale La clientèle du programme-services inclut également les personnes ayant un trouble de la communication sociale (pragmatique) nouvellement introduit au DSM-5. Ce trouble se définit par des difficultés persistantes dans l’utilisation sociale de la communication verbale et non verbale. Les déficits entrainent des limitations fonctionnelles quant à la communication efficace, la participation sociale et les relations sociales, la réussite scolaire ou la performance au travail, individuellement ou en combinaison. Les symptômes apparaissent pendant la période développementale, mais les déficits ne sont pleinement manifestes que lorsque le niveau de communication sociale dépasse les capacités limitées de la personne. Les symptômes ne sont pas imputables à une autre condition médicale ou neurologique, ou à de faibles capacités dans les domaines de la structure des mots et de la grammaire. Ils ne sont pas expliqués non plus par un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle, un retard global de développement ou un autre trouble mental30. 3.4 Les familles et les proches Les familles, les proches sont des acteurs significatifs dans le développement, l’intégration et la participation sociale des personnes présentant une déficience physique. Ils doivent être soutenus dans le rôle fondamental qu’ils jouent auprès des personnes, de même que pour les besoins qu’ils présentent eux-mêmes en rapport avec la situation. C’est pourquoi le programme-service en déficience physique s’adresse également à eux. 30 Le DSM-5, Consortium national de recherche en intégration sociale (CNRIS), Revue volume 5 #1 31 Droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12, art. 10) 23 CHAPITRE 4 : LES BESOINS L’offre de services en déficience physique est développée pour répondre aux besoins de ces personnes, de leurs familles et de leurs proches ainsi que des acteurs de la société civile qui sont concernés par la déficience physique. C’est la raison d’être même d’une offre de service que de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle à laquelle elle s’adresse. Ainsi, en point de départ du déploiement de la gamme des services devant être offerts par le programme-services en déficience physique, les besoins sont décrits dans la présente section. Cette description inclut des besoins plus généraux de la population, en amont du programme-services, que ce soit pour éviter l’apparition d’une déficience ou de pouvoir la dépister et l’identifier. 4.1 Les besoins de la population Prévention / Promotion Puisque certaines déficiences physiques peuvent être prévenues, la population a besoin de connaitre les comportements à adopter en ce sens. À cet effet, elle a besoin d’être renseignée sur les facteurs de protection sur lesquels elle peut agir et qui permettent d’en éviter l’apparition. Par exemple, l’adoption de saines habitudes de vie telle qu’une bonne alimentation et de l’activité physique régulière peuvent contribuer à prévenir l’apparition d’une déficience motrice ou du langage découlant d’un accident vasculaire-cérébral, ou encore une déficience motrice ou visuelle découlant du diabète menant trop souvent à l’amputation ou au développement d’une rétinopathie. L’adoption de comportements responsables dans l’exercice notamment de sport et loisirs, tels que le port du casque à vélo, le choix de plonger dans les endroits prévus à cette fin ou encore de porter attention au volume en écoutant sa musique sont d’autre façons de prévenir l’apparition d’une déficience physique. De saines habitudes de vie en situation périnatale permettent également de réduire l’incidence de certaines déficiences. À cet effet, le suivi étroit de la santé de la mère et de son bébé permet de prévenir l’apparition ou encore de dépister certaines anomalies congénitales. Lorsque ces actions mènent à l’identification de problématiques, les parents ont besoin d’être soutenus. Les campagnes de sensibilisation en matière de sécurité routière, de santé et sécurité au travail et sécurité incendie contribuent également à réduire l’apparition de déficience physique découlant de blessures orthopédiques graves, traumatismes craniocérébral, blessures médullaires ou brulures graves. Dépistage / Repérage Certaines personnes sont plus à risque que d’autres de développer ou de naitre avec une déficience physique. Lorsque ces problématiques sont dépistées, avant ou dès 24 l’apparition des premiers symptômes, elles peuvent être considérées précocement, réduisant du coup l’ampleur des incapacités qui en découlent et incidemment, l’impact sur la participation sociale de l’individu. Ainsi, la population a besoin de pouvoir compter sur des programmes de dépistage solidement établis. Elle a besoin également d’avoir accès rapidement à des interventions de qualité en temps opportun. Ces interventions peuvent prendre la forme d’enseignement, tant sur la condition de la personne que de comportements favorables à la protection de la détérioration. Elles peuvent aussi prendre la forme d’activités de réassurance. Elles peuvent orienter sur des moyens simples, accessibles à tous, pouvant permettre de compenser les difficultés. Elles peuvent également permettre d’amorcer le développement de capacités au quotidien si tel est le besoin, avec un programme d’exercices à domicile par exemple. Ces services doivent être déployés en accord avec les bonnes pratiques et au besoin, être guidés par l’expertise développée par le programme-service déficience physique. Au besoin, le dépistage mènera à une référence vers les services les plus appropriés. 4.2 Les besoins des personnes a yant une déficience physique Les personnes ayant une déficience physique présentent des besoins particuliers qui interpellent l’ensemble des acteurs du programme-services en déficience physique mais aussi ceux des autres programmes-services. Ainsi, tous les partenaires d’un réseau territorial de service (RTS) doivent considérer ces besoins afin de garantir l’accès à leurs services, en toute équité, aux personnes qui présentent une déficience physique. La description de ces besoins est donc un outil de travail et de planification. Elle n’a pas la prétention d’être exhaustive, mais se veut plutôt être une inspiration sur laquelle s’appuie l’offre de services. Une offre de services pertinente est celle qui demeure à l’écoute des besoins émergents de la clientèle qu’elle dessert et qui fait évoluer ses services et la manière de les offrir, en correspondance avec ceux-ci. Toutefois, il est évident que l’on ne saurait résumer ce que sont et vivent les personnes ayant une déficience physique. Il existe une grande variabilité entre les profils cliniques d’une déficience à l’autre et surtout d’un individu à l’autre. Et bien qu’on n’y fasse pas spécifiquement mention dans cette section, il faut préciser que les personnes ayant une déficience physique possèdent des ressources et des capacités préservées sur lesquelles s’appuieront leur cheminement clinique et leur intégration dans la société. 4.2.1 Les besoins liés à l’organisation des services La personne ayant une déficience physique ont aussi besoin d’information afin de demeurer en bonne santé et de prévenir l’apparition d’autres déficiences physiques, de problèmes de santé physique, de problèmes de santé mentale, ou encore d’avoir besoin 25 d’accéder à d’autres services de la gamme de services de santé et de services sociaux offerts par le réseau. Pour être en bonne santé et maintenir son intégrité, elle a besoin d’avoir notamment d’être rejointe par les campagnes de prévention et de promotion de la santé, notamment en matière d’abus, de même qu’aux services disponibles à l’ensemble de la population de son territoire. Pour ce faire, la personne ayant une déficience physique a besoin d’accéder à l’information disponible, d’accéder aux lieux où sont dispensés les services à la population, et d’être orientée vers les services appropriés en fonction de son besoin et non seulement vers les services déployés en réponse aux besoins découlant de sa déficience physique. Pour la personne ayant une déficience sensorielle ou du langage, cela suppose que l’information et les documents à l’intention de la population soient rendus disponibles dans un format qui lui soit accessible. À titre d’exemples, il peut s’agir de normes de grosseur de caractères, de publications en braille, de capsules audio, ou même vidéo en langue des signes (langue des signes québécoise –LSQ / American sign language ASL). Elles peuvent également avoir besoin d’une adaptation du contenu et que celui-ci soit présenté dans des modes de communication orale et écrite adaptés, c’est-à-dire dans un langage facilement compréhensible. L’accès physique aux lieux où sont dispensés les services implique non seulement de pouvoir y entrer, s’y orienter et s’y déplacer convenablement, mais également de pouvoir accéder aux aires communes de services telles que les toilettes. L’accès physique aux lieux présuppose que la personne aura eu besoin de connaitre où se trouvent ces lieux spécifiquement rendus accessibles et qu’elle ait eu accès au transport pouvant l’y mener. Dans le cadre de la consommation des services comme telle, elle a besoin que les intervenants aient des connaissances sur les approches à préconiser selon sa condition et qu’ils aient accès aux équipements pour la mobiliser de façon sécuritaire au besoin. Elle a besoin de pouvoir communiquer aisément avec le personnel d’accueil et le personnel soignant et avoir accès à des équipements ou services pouvant soutenir cette communication. Elle peut avoir besoin qu’on lui vulgarise l’information pour pouvoir être en mesure de bien comprendre, et qu’on la soutienne dans son cheminement dans le réseau. La personne ayant une déficience physique a besoin qu’on accepte et reconnaisse les moyens qu’elle prend pour compenser ses incapacités31. Elle a besoin qu’on tienne compte de ses capacités et de ses incapacités dans la mise en place des modalités d’accès et de prestation de services, et qu’on voit à l’accommoder au besoin. 4.2.2 Les besoins liés à l’offre de services 31 Droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12, art. 10) 26 La personne ayant une déficience physique présente des besoins qui se moduleront selon l’étape de vie dans laquelle elle chemine (intégration en milieu de garde, en milieu scolaire passage de l’adolescence à la vie adulte, travail, arrivée d’un enfant, vieillissement , etc.), les rôles sociaux qu’elle occupe ou pourrait occuper au regard de son groupe d’appartenance (étudiant, parent, travailleur, bénévole), son projet de vie, ou encore tout autre événement venant briser l’équilibre de son fonctionnement dans son environnement. Divers facteurs tels le type de la déficience et les incapacités en découlant, son âge, le moment de l’occurrence de la déficience (congénitale, périnatale, acquise des suites d’une maladie ou d’un traumatisme, ou liée au processus de vieillissement), la présence ou non de conditions de santé concomitantes sont d’autres éléments qui influenceront les besoins au regard desquels cette personne nécessitera des services. La personne ayant une déficience physique32, a besoin d’avoir accès aux professionnels qui lui permettront d’obtenir un diagnostic juste et en temps opportun, d’être informée des impacts de celui-ci sur son fonctionnement, des traitements et des services qui lui sont disponibles, de leurs conséquences et des alternatives qui s’offrent à elle. Elle a besoin d’être rassurée et de savoir ce qui s’en vient pour elle. Elle a besoin d’être éclairée pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui la concernent et consentir aux soins et services en toute connaissance de cause. Elle a besoin de connaitre les services complémentaires qui lui sont disponibles pour réduire les conséquences ou prévenir la détérioration de sa condition. Elle a besoin de connaitre et d’être orientée vers les instances les mieux placées pour répondre à ses besoins et d’avoir accès aux services qu’elle requiert en temps opportun. Tout au long de son processus clinique, elle a besoin qu’on tienne compte des démarches ayant précédées ou qui sont en cours dans d’autres secteurs afin d’éviter chaque fois, de répéter son histoire. Elle a besoin d’être reconnue pour son expertise à titre de personne vivant avec une déficience physique. Elle a besoin d’être entendue et de pouvoir déterminer son projet de vie, d’identifier les habitudes de vie importantes pour elle, au regard desquelles, elle contribuera à définir et prioriser les objectifs qui lui permettront de les réaliser. Elle a besoin qu’on respecte ses choix et qu’on lui laisse gérer les risques inhérents à ses décisions et surtout, elle a besoin d’être impliquée dans toutes les décisions la concernant. Le but ultime de la personne ayant une déficience physique est de participer à la vie de sa communauté et à devenir ou redevenir un citoyen à part entière. Elle a donc besoin d’être soutenue dans l’identification, la modification ou le retour à ses diverses habitudes de vie et rôles sociaux et, au moment d’intégrer ses différents milieux de vie (domicile, garderie, école, travail, etc.), qu’on l’aide à généraliser ses acquis, dans l’ensemble des domaines de sa vie. 32 Dans le contexte, la personne ayant une déficience inclut également ses parents, par extension, lorsque celle-ci est un enfant. 27 Pour ce faire, la personne ayant une déficience physique doit pouvoir développer au maximum ses capacités qui lui permettront de réaliser ses habitudes de vie et avoir une participation sociale optimale. La personne peut avoir besoin d’apprendre à compenser ses incapacités. En effet, que ce soit temporairement ou de façon permanente, elle peut avoir besoin, pour réaliser ses habitudes de vie, de développer de nouvelles stratégies, d’utiliser des équipements, des aides techniques, ou de faire adapter son environnement. Elle a besoin d’être guidée vers les solutions les plus simples et les plus normalisantes possibles, et d’apprendre à les utiliser de façon optimale et sécuritaire. Elle a besoin d’avoir accès aux aides techniques et technologiques et aux aménagements qui lui sont requis, et lorsque son besoin est permanent, elle peut avoir besoin d’être soutenue dans la recherche d’organismes payeurs pouvant pérenniser cet accès. Au regard de l’utilisation d’une aide technique, elle a besoin d’apprendre à s’en servir de façon appropriée, de l’entretenir, de connaitre les ressources disponibles à contacter en cas de bris, et de connaitre ses responsabilités à l’égard du programme gouvernemental l’ayant octroyée. Nonobstant son besoin d’aides techniques, la personne ayant une déficience physique peut avoir besoin d’aide humaine pour réaliser ses habitudes de vie. Cette aide, lorsque nécessaire sur une base régulière, doit alors être réajustée, selon l’évolution de ses aptitudes, de son environnement, de ses besoins et de sa condition. Lorsque la personne ayant une déficience physique prévoit avoir un enfant, elle peut avoir besoin d’être rassurée sur l’incidence de sa déficience sur la santé et le développement de son bébé. Une fois devenue parent, elle peut avoir besoin d’aide pour développer ses compétences parentales ou être accompagnée dans la réalisation de son rôle parental. La personnes ayant une déficience physique a besoin de donner ou de redonner un sens à ce qu’elle vit et à cet égard, elle a besoin d’écoute et de soutien dans son cheminement psychologique. Elle a besoin de se réaliser, de se sentir utile et de développer ou maintenir des relations interpersonnelles de qualité. Elle a également besoin qu’on respecte ses droits et d’être protégée contre les abus. La personne ayant une déficience physique peut aussi avoir besoin d’être soutenue dans le choix du meilleur milieu de vie pour elle, compte tenu de ses besoins et de ses intérêts, de même que dans la mise en place des services de soutien33 qui lui seront requis. Elle peut avoir besoin d’être soutenue dans l’exploration des ressources communautaires qui lui sont disponibles et qui pourraient lui permettre de s’actualiser. Pour maintenir la réalisation de ses habitudes de vie et préserver son équilibre, la personne ayant une déficience physique peut avoir besoin, de façon épisodique, de services professionnels pour maintenir ses acquis. Dans ces circonstances, elle peut avoir besoin que soient revus certains aspects de son fonctionnement ou que certains 33 Services d’aides à domicile (AVQ, AVD, soutien civique, accompagnement) et services aux proches aidants 28 éléments de son environnement soient réévalués pour s’assurer qu’elle maintienne un niveau optimal d’autonomie dans les milieux de vie dans lesquels elle évolue. 4.3 Les besoins de la famille et des proches Les besoins de la famille et des proches d’une personne ayant une déficience physique fluctuent selon que cette personne est l’enfant (adulte ou non), le parent, le conjoint ou un membre de la fratrie. Vivre avec une personne ayant des incapacités significatives et persistantes découlant d’une déficience physique peut bousculer la dynamique familiale avoir un impact sur les rôles sociaux de ses membres et présenter un lot de responsabilités supplémentaires pour soutenir son fonctionnement au quotidien Ces besoins ne doivent pas être négligés puisque, pour la personne ayant une déficience physique, ils peuvent faire la différence entre vivre en milieu naturel ou en milieu substitut. La famille et les proches d’une personne ayant une déficience physique peuvent avoir besoin d’être soutenus à l’annonce du diagnostic, d’être rassurés et de comprendre la problématique imposée. Ceux-ci doivent souvent amorcer un deuil, que ce soit le deuil de l’enfant sain ou encore le deuil du membre de la famille qui n’est plus le même qu’avant l’apparition de la déficience physique. Ils peuvent également avoir besoin de cheminer psychologiquement dans leur dynamique avec lui, voire même de se redéfinir un nouveau projet de vie. Ils peuvent avoir besoin d’apprendre de nouvelles stratégies pour le soutenir, interagir avec lui ou intervenir auprès de lui, tout en lui laissant le soin de faire ses expériences et de développer son autonomie. Parmi les besoins que présentent les proches on retrouve notamment le besoin d’être reconnu pour leur connaissance de la personne ayant une déficience physique avec laquelle ils vivent, sans toutefois qu’on ne leur attribue les responsabilités d’un intervenant. Ils doivent pouvoir compter sur une ressource fiable pour prendre leur relève en cas d’imprévu. La famille a souvent besoin de passer le flambeau à une personne de confiance pour réaliser une partie des tâches de la maisonnée, le temps qu’ils répondent aux besoins du membre de leur famille qui présente une déficience physique. De manière à pouvoir continuer de s’actualiser, les proches qui vivent avec une personne ayant une déficience physique peuvent avoir besoin de s’absenter occasionnellement de leur domicile pour vaquer à d’autres occupations. Ils ont besoin de se reposer, de prendre une saine distance, de socialiser. Connaitre les ressources de leur communauté où ils pourront se référer en cas de nécessité et y avoir accès revêt également une importance certaine. Ils peuvent avoir besoin de redonner un sens à leur vie, et d’être accompagnés pour redéfinir leurs rôles sociaux à leur pleine satisfaction. De manière à assurer une présence de qualité, ils peuvent avoir besoin d’apprendre les techniques les plus appropriées pour offrir les services d’aides à la personne. Ils doivent également pouvoir accéder à des équipements spécialisés leur permettant d’être en 29 sécurité dans la dispensation des soins à la personne et éviter la détérioration de leur propre intégrité. 30 CHAPITRE 5 : LE CONTINUUM DE SERVICES EN RÉPONSE AUX BESOINS Les activités cliniques permettant de répondre aux besoins de la personne et ses proches s’inscrivent dans un continuum de services. Ce continuum de services structure de grands ensembles de services dont chaque étape a une finalité qui lui est propre, ce qui permet d’assurer chez les principaux acteurs concernés, une compréhension commune. Ces grandes étapes s’appliquent à diverses clientèles et s’incarnent différemment selon le profil de besoins. Le continuum peut être soutenu et opérationnalisé par des trajectoires de services suivant certaines problématiques spécifiques (voir section trajectoires). Le continuum de services campe, à la fois, les notions de continuité et de complémentarité des services requis par la personne aux différentes étapes qu’elle parcourt. Bien que le continuum s’inscrive dans le programme-services en déficience physique, la personne est susceptible de recevoir des services d’autres programmesservices ou secteurs d’activité (santé et services sociaux, éducation, emploi, transport, etc.) lors des différentes étapes de sa vie. Ces services intrasectoriels et intersectoriels peuvent être de nature publique, communautaire et privée et couvrent les aspects suivants : promotion/prévention, repérage/dépistage, évaluation, référence/orientation, traitement, adaptation/réadaptation, maintien et soutien à la participation sociale et soutien en fin de vie. Pour un véritable continuum, les différents services doivent être accessibles au moment approprié, de façon séquentielle ou simultanée, en fonction des besoins de la personne et de l’évolution de ces derniers. Pour répondre à leurs besoins, les personnes ayant une déficience physique et leurs proches sont susceptibles de recevoir des services d’autres programmes-services ainsi que d’autres secteurs d’activités. Cela implique des arrimages entre le programmeservices en déficience physique, les autres programmes-services et les partenaires du 31 RTS et ce, à toutes les étapes du continuum de services afin d’assurer une participation sociale pleine et entière. Ainsi, les alliances intersectorielles constituent une condition de réussite et doivent être prise en compte dans le développement d’un réseau de services intégrés. L’élaboration d’ententes de collaboration, le développement de mécanismes de liaison et la mise en place de projets d’expérimentation conjoints impliquant d’autres secteurs partenaires34, constituent des initiatives à multiplier afin d’assurer l’accès et l’adaptation des services offerts dans ces différents réseaux. C’est d’abord la nature du service dont la personne a besoin qui permettra d’identifier le programme qui dispensera ce service comme le prévoit l’architecture des services. Certains types de services sont offerts exclusivement par un programme-services comme par exemple, les activités de promotion-prévention exclusives au programmeservices santé publique. D’autres ne sont pas offerts par le programme-services en déficience physique, comme l’évaluation diagnostique. Or, certains types de services sont disponibles dans plus d’un programme-services, comme par exemples les soins infirmiers ou les services psychosociaux. À ce moment, c’est l’origine du besoin pour lequel ce service est requis qui permet de distinguer le programme-services qui l’offrira. À titre d’exemple, pour des services psychosociaux, une personne ayant une déficience physique sera orientée dans le programme-services en déficience physique si son besoin est de s’adapter à sa nouvelle réalité liée à sa déficience. À l’inverse, elle sera orientée dans le programme-services généraux si la personne a besoin d’aide à la suite d’une séparation et dans le programme-services dépendance si la personne développe un problème de toxicomanie. Lorsque cela est requis, le programme-services en déficience physique peut mettre à contribution son expertise pour soutenir le programme-service concerné. Situées en amont du continuum de services, les activités de prévention/promotion ainsi que celles de repérage/dépistage sont destinées à l’ensemble de la population. Les personnes ayant une déficience physique doivent y avoir accès, au même titre que tout autre citoyen. Ces services sont sous la responsabilité du réseau de la santé ainsi que d’autres secteurs d’activités. 5.1 Promotion/prévention La promotion consiste à agir de façon générale sur les principaux déterminants de la santé et du bien-être d’une population. Elle contribue en particulier au renforcement du potentiel des citoyens et des groupes. Afin de prévenir les événements pouvant causer des déficiences physiques (maladie, accident, etc.), la fonction de promotion s’exerce principalement par des activités d’éducation, de formation et de sensibilisation adaptées aux milieux où elles se déroulent (domicile, loisirs, travail, études, etc). L’ensemble des citoyens et des groupes, incluant ceux qui sont associés à la prise de décision dans différents secteurs, devient ainsi plus familiarisé avec les divers phénomènes susceptibles d’engendrer éventuellement des incapacités et des situations de handicap. La prévention vise essentiellement la réduction des problèmes sociosanitaires par une intervention sur les facteurs de risque ou de vulnérabilité qui engendrent ces problèmes. 34 notamment, les milieux de garde, les écoles, les organismes de développement de l’employabilité, les services de loisir, le réseau du transport. 32 Elle se traduit bien souvent par des interventions d’éducation, d’information et de dépistage auprès de segments de la population qualifiés de groupes à risque, ainsi que par des mesures législatives ou réglementaires. Les activités de prévention consistent, d’une part, à agir sur les causes à l’origine des problèmes de santé et des déficiences et, d’autre part, à éliminer ou à réduire chez des populations bien identifiées les facteurs de risque entraînant leur apparition. Le programme-services santé publique offre les services de promotion et prévention qui s’adressent à l’ensemble de la population selon une approche populationnelle. Les interventions spécifiques de promotion et prévention qui visent les clientèles vulnérables, dont les personnes ayant une déficience physique. Les services offerts doivent ainsi agir sur les facteurs de risque ou de vulnérabilité et tenir compte des situations susceptibles d’engendrer des déficiences physiques. Des organismes publics ou communautaires d’autres réseaux offrent également des services de promotion et de prévention, en fonction de leur mission spécifique, notamment pour la promotion de l’activité physique et d’une saine alimentation, la prévention des accidents du travail, la sécurité routière, etc. Les personnes ayant une déficience physique doivent également avoir accès à ces programmes sous la responsabilité des autres réseaux. 5.2 Repérage/dépistage Le continuum de services prévoit des activités de repérage et de dépistage. L’intervention minimale est alors une évaluation de la situation et une orientation vers les services requis. Il est utile de distinguer le repérage du dépistage. Le repérage est la détection des individus à risque ou qui présentent des symptômes, des manifestations cliniques ou des écarts dans leur développement en comparaison avec des individus du même âge. Le repérage est ciblé plutôt qu’universel, il se fait lors de contacts avec des services. Le dépistage est la détection dans l’ensemble d’une population d’une maladie ou d’un trouble chez un individu asymptomatique ou à risque. Le dépistage, par définition, est universel et s’adresse à l’ensemble de la population visée. Ces activités de détection constituent une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs du continuum, tant dans le réseau de la santé et des services sociaux que chez les partenaires intersectoriels. La détection précoce peut permettre, à la suite d’une référence vers les services appropriés, de retarder, voire d’éviter l’apparition des symptômes reliés à une déficience physique, et même réduire les incapacités qui pourraient en découler. 5.3 Évaluation (diagnostique ou des besoins) Le processus diagnostic consiste à identifier la nature et la cause du problème de la personne et à confirmer la présence d’une déficience physique. Le diagnostic est généralement établi à la suite de l’administration d’une combinaison de tests normalisés et d’observations du comportement dans le but d’infirmer ou de confirmer une présomption. Le processus diagnostic relève des programmes-services santé physique, services généraux-activités cliniques et d’aide ou santé mentale. De plus, certains professionnels en pratique privée sont habiletés à procéder à l’évaluation diagnostique donnant accès 33 aux programme-services en déficience physique, comme c’est le cas, notamment en déficience visuelle. L’évaluation globale des besoins35, quant à elle, fait partie du programme-services en déficience physique bien que d’autres acteurs puissent y participer. Il s’agit d’une étape charnière qui est habituellement à l’origine des services qui seront offerts subséquemment. C’est à cette étape que l’identification de l’intervenant pivot et la planification des services au moyen d’un PI, d’un PII ou d’un PSI s’amorcent. 5.4 Référence/orientation Le processus de référence/orientation permet, après l’identification des besoins, d’orienter la personne vers les services requis à l’intérieur même du programmeservices ou vers d’autres programmes ou secteurs selon les modalités convenues entre les prestataires de services. L’intervenant pivot identifié au dossier s’assure que la personne soit accompagnée et soutenue dans le processus d’obtention des services. Il assure également la communication de l’information entre la personne, sa famille, ses proches et les prestataires de services. 5.5 Traitement Cette étape du continuum regroupe des activités correspondant à des services médicaux, des soins et des services professionnels ainsi que des interventions en situation d’urgence ou de crise. Les services médicaux et les soins les services professionnels comme les soins infirmiers, la nutrition, l’ergothérapie la physiothérapie, etc. peuvent relever de différents programmes-services ou encore d’autres partenaires, selon la nature du besoin. Si la personne ayant une déficience physique est en épisode de soins aigus pour des problèmes de santé physique (CH-clinique affiliée ou autre), ces services relèvent du programme-services en santé physique. Par ailleurs, si la personne a des troubles mentaux nécessitant des traitements, ces services seront assumés par le programmeservices en santé mentale. Quand il s’agit d’un problème ponctuel et aigu non relié à la déficience physique ou encore de services à domicile de courte durée (personnes postopérées ou posthospitalisées), ces services relèvent du programme-services générauxactivités cliniques et d’aide. Enfin, les soins et les services professionnels s’inscrivant dans le programme-services en déficience physique regroupent les services spécialisés offerts en phase d’adaptation-réadaptation lorsque ceux-ci s’affairent à réduire les incapacités découlant de la déficience physique, et les services spécifiques de soutien à domicile offerts en phase de maintien des acquis et de soutien à la participation sociale. Le programme-services généraux-activités cliniques et d’aide prévoit des interventions en situation d’urgence ou de crise pour la population générale. Ce service s’assure de la mise en place immédiate d’un processus d’intervention de crise par le biais du service d’intervention de crise dans le milieu 24/7 ou d’un autre service selon le besoin. Lorsqu’il s’agit d’un besoin de service de moyenne ou de longue durée, la demande est acheminée vers le programme-services en déficience physique. 5.6 Adaptation-réadaptation 35 Voir section 6.1 34 Les services d’adaptation-réadaptation sont des services spécialisés qui relèvent du programme-services en déficience physique et correspondent à un ensemble d’activités permettant d’actualiser le potentiel d’autonomie de la personne selon ses aspirations et objectifs en agissant à la fois sur le développement de ses habiletés, sur la compensation de ses incapacités et sur la réduction des obstacles environnementaux. Ils visent à assurer une pleine participation sociale. Ces services sont circonscrits dans le temps et prennent fin à la reprise des habitudes de vie ou dès l’atteinte des objectifs de participation sociale. 5.7 Maintien des acquis et soutien à la participation sociale Le maintien des acquis et le soutien à la participation sociale sont des services spécifiques qui relèvent du programme-services en déficience physique et correspondent à un ensemble de moyens mis en œuvre pour une personne ayant des incapacités afin de maintenir au plus haut son niveau de participation sociale. La participation sociale se définit comme étant le résultat des influences entre les caractéristiques d’une personne et les éléments de son environnement physique et social. Elle se traduit comme la pleine réalisation des « habitudes de vie » de la personne. Certains services complémentaires peuvent également être offerts par des partenaires du RTS comme, par exemple des organismes communautaires qui offrent des activités de jour. 35 CHAPITRE 6 : LES SERVICES 6.1 Les services à l’intention des personnes ayant une déficience physique Une gamme de services est disponible pour répondre aux besoins identifiés lors de l’évaluation globale de la personne ayant une déficience physique. Selon la nature des besoins identifiés, leur complexité ou encore l’impact de ceux-ci sur les habitudes de vie de la personne, les services qui seront déployés peuvent être spécifiques (1ère ligne), spécialisés (2e ligne) ou surspécialisés (3e ligne). La prestation de l’ensemble des services spécifiques, spécialisés et surspécialisés n’est pas mutuellement exclusive, au sens où ceux-ci peuvent être offerts les uns après les autres, aussi bien que simultanément. Ils sont également offerts en réponse aux besoins de la personne, donc l’ensemble des services n’est pas nécessairement tout le temps requis. Selon les besoins de la personne et l’organisation des services, ces services peuvent être offerts à domicile ou en établissement lorsque des plateaux techniques ou des équipements et infrastructures sont nécessaires. De façon générale, les services offerts en établissement le sont sur une base externe. Parfois, la nature des besoins de la personne guide la modalité de dispensation des services. Toutefois, ces services, notamment pour la clientèle présentant des incapacités découlant d’une déficience motrice, peuvent aussi être offerts en internat, si la condition de la personne le justifie. En effet, un retour à domicile immédiatement après un épisode de soins en centre hospitalier à la suite d’un accident (ex : un traumatisme craniocérébral, une lésion de la moelle épinière, etc.) ou d’une maladie (ex : syndrome de Guillain-Barré, un accident vasculaire cérébral, etc.), peut s’avérer hasardeux et compromettre la santé et la sécurité de la personne et celle de ses proches. Dans ces cas, la personne est dirigée en unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) mission CRDP. Des services spécialisés de réadaptation sont alors dispensés tous les jours sur une base intensive pour soutenir la personne dans le développement de ses aptitudes, la compensation de ses incapacités et la reprise de ses habitudes de vie. On parle alors de clientèle admise. Quoiqu’il en soit, il est primordial à ce que les services les plus pertinents pour répondre aux besoins de la personne soient dispensés par la bonne personne, au bon endroit et surtout, au bon moment. Le principe de précocité constitue un enjeu majeur puisqu’il peut avoir une incidence sur les résultats pouvant être attendus des services déployés. Une intervention qui est faite précocement pourra éviter que ne s’installe une cascade de conséquences fâcheuses et l’aggravation de la condition de la personne. Dans ce contexte, la coordination des services demeure un enjeu central, et permettra d’éviter les dédoublements, ou pire encore, les bris de services. Chaque territoire n’a pas l’obligation de développer la gamme de services pouvant être requis à sa population en réponse aux besoins qu’elle présente. Or, chaque établissement a le devoir de convenir avec les instances les mieux placées pour le faire, des ententes de services qui prévoiront non seulement les clientèles à desservir et les services qui seront offerts à titre supplétif, mais également les mécanismes de liaison à mettre en place afin de faciliter le cheminement le plus simple et accessible possible de la personne et de ses proches d’une étape du continuum de services à une autre ainsi que d’un dispensateur à un autre. De manière à favoriser la desserte de la clientèle en 36 matière de services diagnostic, de traitement et d’adaptation-réadaptation requis en raison de sa déficience physique, mais non disponibles localement, le réseau dispose du Programme Transport-hébergement. Ce programme est un moyen offrant à la personne et son accompagnateur si requis, une compensation financière des frais de déplacement, repas, séjour et hébergement engagés lorsque le service n’est pas disponible localement. 6.1.1 L’évaluation globale des besoins Ce service vise à évaluer l’ensemble des besoins de l’usager et de ses proches ainsi qu’à planifier le ou les services appropriés à dispenser. Porte d’entrée du programme-services, l’évaluation globale des besoins de la personne est une étape incontournable dans l’organisation d’une offre de service de qualité. Elle est essentielle pour planifier l’organisation d’une réponse adaptée aux besoins (type de services, intensité, choix des modalités et des fournisseurs de services en fonction de la complexité des besoins, de la motivation et du choix de la personne et de ses proches). L’évaluation globale des besoins commande la collaboration de l’ensemble des expertises requises et s’effectue en interdisciplinarité. Ainsi, les professionnels des services spécifiques et/ou des services spécialisés contribuent à l’évaluation globale des besoins lorsqu’il est estimé que leur contribution respective est requise. Cette activité vise la validation des besoins ainsi que de la pertinence d’offrir des services spécifiques, spécialisés ou surspécialisés à la personne ayant une déficience physique. Pour cela, l’équipe analyse les besoins et la demande de services en incluant les démarches d’évaluation antérieure. L’évaluation est réalisée à partir d’outils validés et reconnus et effectuée par des professionnels selon le type d’évaluation. De manière à éviter les redondances et dédoublements et assurer une meilleure fluidité, le programme-service s’assure que ces outils soient communs aux différentes étapes du continuum qu’il couvre. L’évaluation globale des besoins d’une personne peut comprendre : Un bilan de santé; L’évaluation des capacités, des incapacités et l’impact sur ses habitudes de vie; L’évaluation des facteurs environnementaux facilitateurs ou obstacles à la réalisation de ses habitudes de vie; L’identification des services requis; L’expression de son projet de vie; L’évaluation des besoins de ses proches. Cette activité permet également de valider le niveau de priorité des demandes selon les exigences du plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience physique36. Les critères d’établissement de la priorité sont généraux et applicables à 36 Les modalités entourant l’établissement des niveaux de priorités seront éventuellement revues selon le nouveau modèle d’organisation des services. 37 l’ensemble des problématiques. Ils permettent de porter un regard sur la situation globale de la personne37. Cette activité mène à l’élaboration d’un plan d’intervention (PI), d’un plan d’intervention interdisciplinaire (PII) ou encore d’un plan de service individualisé (PSI) selon les besoins de la personne et les services requis. 6.1.2 L’élaboration du plan d’intervention : une démarche structurée et concertée La planification des services est une étape incontournable qui permettra notamment de coordonner les interventions à mettre en place, s’assurer de leur pertinence, de leur cohérence, de leur efficacité voire de leur efficience. Elle pourra également permettre de prévoir d’entrée de jeu les services d’adaptation-réadaptation et de maintien des acquis qui seront requis en chevauchement, comme c’est le cas par exemple lors des sorties de fin de semaine que la personne fait alors qu’elle occupe un lit d’URFI ou lors de son congé définitif. À cette étape, il est important d’outiller la personne et ses proches pour qu’elles participent activement l’élaboration du plan d’intervention, dans une dynamique de partenariat avec les intervenants impliqués à la démarche. C’est à cette étape aussi que se précisent les collaborations attendues avec d’autres acteurs des programmes de l’établissement, d’autres établissements ou d’autres réseaux de services concernant la poursuite de certains des objectifs, de même que se font les références à d’autres ressources du milieu, si cela est requis. C’est également à cette étape qu’un intervenant pivot est identifié afin de coordonner les services. Tout en déterminant les services requis, l’équipe doit informer la personne et ses proches du rôle et du fonctionnement de l’établissement, sur ses domaines d’intervention et ses programmes, ses limites et s’il y a lieu, du rôle des partenaires vers lesquels elle sera dirigée, le cas échéant. Le plan d’intervention Les services spécifiques, spécialisés et surspécialisés s’organisent autour d’objectifs convenus avec la personne et ses proches, articulés dans le cadre d’un plan d’intervention. Ils sont offerts par épisodes de service, c'est-à-dire qu’ils s’échelonnent sur une période déterminée et sont révisés périodiquement. Les objectifs s’articulent autour du pronostic de participation sociale pouvant être attendu de la personne, en toute probabilité, en fonction de son portrait clinique, combiné aux connaissances et à l’expérience de l’équipe interdisciplinaire dans pareille situation. Ce pronostic fonctionnel doit lui-même être révisé périodiquement puisqu’il s’agit d’une estimation à précision croissante qui s’affinera avec l’évolution de la situation. Les services spécifiques, spécialisés ou surspécialisés de réadaptation se réalisent à l’intérieur d’un épisode de services limité dans le temps, avec un début et une fin. Cet épisode de services s’articule dans un plan d’intervention, lui-même élaboré à partir du projet de vie de la personne présentant une déficience physique et des objectifs Ces critères ont fait l’objet d’une fiche descriptive distincte dans le cadre des travaux de la mise en œuvre du plan d’accès. 37 38 convenus avec l’équipe clinique. Durant un épisode de services des changements significatifs de la réalisation des habitudes de vie de la personne sont attendus Un épisode de services prend fin lorsque la personne et ses proches ont atteint leurs objectifs, lorsque la poursuite des interventions n’entrainera pas de progrès ayant un impact significatif sur la réalisation ou le maintien des habitudes de vie de la personne ou de ses proches, lorsque la personne n’a plus les capacités de participer aux interventions qui lui sont proposées ou lorsque la personne ou ses proches signifient de manière éclairée leur intention de mettre fin aux dits services. Le PI doit être révisé périodiquement et permet de réviser le pronostic attendu, s’assurer que les objectifs sont toujours pertinents, que des progrès significatifs sont encore enregistrés et que la personne est encore motivée à poursuivre son processus. 6.1.3 Les services d’adaptation -réadaptation Les services d’adaptation et de réadaptation consistent en un regroupement d’activités cliniques spécialisées, et dans certains cas surspécialisés, centrées sur les besoins de la personne, et ceux de ses proches et les milieux de vie dans lesquels ils évoluent. Ces activités visent le développement ou la reprise des habitudes de vie de la personne lui permettant d’avoir une autonomie fonctionnelle optimale dans les différentes sphères de sa vie. Le concept d’autonomie fonctionnelle se veut inclusif et réfère aux habitudes de vie relatives à l’autonomie personnelle, l’autonomie socio résidentielle, et l’autonomie sociale, scolaire et professionnelle. Chez la personne ayant une déficience physique d’origine congénitale ou périnatale, elle vise l’atteinte du niveau de fonctionnement normalement attendu d’une personne du même âge. Les exigences de l’environnement envers le fonctionnement d’une personne fluctuant en fonction de l’âge de celle-ci. Chez la personne dont la déficience physique s’installe à la suite d’un événement accidentel ou des suites d’une maladie, la réadaptation visera plutôt la reprise des habitudes de vie antérieures, permettant ainsi un retour à une autonomie équivalente ou la plus près possible du fonctionnement de la personne avant cet évènement. Chez la personne dont la déficience physique est associée à une condition dégénérative ou épisodique, l’objectif de la réadaptation sera d’optimiser ses capacités, de réduire ou retarder l’apparition d’incapacités ou de les compenser et de favoriser la réalisation de ses habitudes de vie. Les activités permettant une pleine autonomie fonctionnelle incluent notamment le développement de capacités, la recherche de stratégies compensatoires permettant de réduire les incapacités, de même que l’adaptation de l’environnement. L’attribution d’aides techniques38 est à cet effet un des moyens disponibles pour atteindre la finalité. Les services d’adaptation-réadaptation sont des services spécialisés qui sont offerts par une gamme diversifiée d’intervenants issus de divers domaines39. Les domaines d’intervention Référer à la fiche Attribution d’aides techniques située à l’annexe 4 pour plus de détails. Référer à la fiche Multidisciplinarité des services spécialisés à l’annexe 5 qui présentent les principales professions œuvrant en 2e ligne du programme-services déficience physique 38 39 39 Les services d’adaptation et de réadaptation requis par la personne visent le développement de son autonomie fonctionnelle : Développement de l’autonomie personnelle : Ces interventions se concentrent sur la vie intime de la personne, soit sa capacité d’agir sur le plan physiologique et sur celui de l’identité personnelle. Ces interventions lui permettent de : Développer, récupérer ou ajuster ses capacités40 Acquérir différentes habiletés compensatoires adaptées à sa situation41 Acquérir une perception valorisante d’elle-même; Acquérir une indépendance psychosociale. Développement de l’autonomie socio résidentielle : Ces interventions ont comme objet le fonctionnement de la personne dans son environnement immédiat et avec ses proches. Ces interventions l’amènent à : Développer les habiletés requises pour son âge lui permettant d’être la plus autonome possible à domicile et dans son environnement immédiat; Acquérir, selon son âge, des habiletés de communication orale et écrite lui permettant d’interagir avec son entourage; Acquérir, selon son âge, les compétences favorisant le développement et la poursuite de relations humaines valorisantes dans son milieu de vie naturel; Acquérir les compétences utiles à la gestion des différents aspects de sa vie privée, incluant son emploi du temps, sa santé et ses affaires financières; S’adapter aux différents aménagements de l’environnement physique requis par sa condition; Disposer de l’aide appropriée à la réalisation des activités de la vie quotidienne (AVQ) et de la vie domestique (AVD), ainsi que des autres aides de suppléance, s’il y a lieu, et en maîtriser l’utilisation. Développement de l’autonomie sociale, scolaire et professionnelle : Ces interventions visent l’acquisition d’habiletés nécessaires à une participation active aux activités sociales, scolaires et professionnelles correspondant à son âge, sa culture et ses aspirations (activités communautaires, travail, école, etc.). Ces interventions lui permettent de : Développer les habiletés nécessaires à la réalisation des activités en milieu de garde, à l’école ou dans son emploi; Développer les attitudes et les comportements lui permettant de participer activement à la vie de la communauté; Fréquenter l’école ou un milieu de garde; Occuper un travail rémunéré ou non, temps partiel et temps plein; 40 Principalement en ce qui a trait aux sens et à la perception, aux activités motrices, au langage, aux activités intellectuelles, au comportement, à la respiration et à l’excrétion, etc. 41 Ibid 40 Se familiariser avec les différentes adaptations ergonomiques ou environnementales existantes afin d’être en mesure d’y recourir dans les divers sites et contextes où elle est appelée à fonctionner; Se familiariser avec les différentes ressources existant dans la communauté afin d’être en mesure de les utiliser de façon optimale. 6.1.4 Les services de maintien des acquis et de soutien à la participation sociale Les services pour le maintien des acquis et le soutien à la participation sociale consistent en un regroupement d’activités cliniques spécifiques centrées sur les besoins de la personne, ceux de ses proches et les milieux de vie dans lesquels ils évoluent. Ces activités visent le maintien par la personne d’un niveau optimal d’autonomie fonctionnelle dans ses différentes habitudes de vie, que sa déficience physique soit innée ou acquise, ou encore qu’elle se présente sous forme dégénérative ou épisodique. Les activités de maintien des acquis et de soutien à la participation sociale s’intéressent également aux domaines de l’autonomie personnelle, résidentielle, sociale, scolaire et professionnelle. Les services pour le maintien des acquis et le soutien à la participation sociale regroupent des services professionnels42 ponctuels qui permettent l’ajustement de l’équilibre fonctionnel de la personne dans son milieu. Les services professionnels pour le maintien des acquis font l’objet d’un niveau de spécialisation de première ligne. Ils impliquent des professionnels formés dans leur domaine d’expertise respectifs et possédant des connaissances spécifique au domaine de la déficience physique. Ils font appels à des techniques courantes d’intervention et ne nécessitent pas d’infrastructures particulières. La plupart du temps, ces services sont offerts dans les divers milieux que fréquente la personne. Ils incluent notamment des activités de recherche de stratégies compensatoires et d’adaptation de l’environnement. L’attribution d’aides techniques43 est à cet effet un des moyens disponibles pour atteindre la finalité. Les services pour le maintien des acquis et le soutien à la participation sociale regroupent également des services dits « d’assistance » qui sont quant à eux le plus souvent de plus longue durée et qui permettent de s’assurer que les habitudes de vie de la personne sont réalisées malgré la persistance d’incapacités. Les services d’aide aux activités de la vie quotidienne et domestique, de soutien civique et d’accompagnement en sont des exemples44. Les services de soutien à la participation sociale incluent également la gamme de services mise en place spécifiquement pour les personnes ayant une déficience physique afin de leur offrir une alternative au travail rémunéré, appelés activités de jour45, ou encore leur donner accès à toute autre forme d’activités pouvant permettre le développement d’un sentiment de compétence comme par exemple des activités sportives ou de loisirs, adaptés ou non. Les domaines de l’ergothérapie, la physiothérapie, le service social, les soins infirmiers, la nutrition et l’éducation spécialisée sont les plus courants. 43 Référer à la fiche Attribution d’aides techniques située à l’annexe 4 pour plus de détails. 44 Référer à la fiche Services d’aide à domicile située à l’annexe 6 45 Référer à la fiche Activités de jour située à l’annexe 7 42 41 Les services de maintien des acquis et de soutien à la participation sociale incluent également les activités touchant aux services résidentiels46. Lorsque le milieu de vie naturel ne convient plus à répondre aux besoins de la personne et de sa famille, qu’elle ne peut plus vivre dans sa famille ou qu’elle souhaite vivre ailleurs de façon plus autonome, la recherche d’un nouveau lieu où résider s’impose. Une gamme de services résidentiels se doit alors d’être rendue disponible. La dispensation de services spécifiques de maintien des acquis et de soutien à la participation sociale peuvent permettre d’identifier la nécessité de relancer le processus d’adaptation-réadaptation et d’avoir recours à des services spécialisés de réadaptation. C’est le cas, par exemple, quand la condition de la personne s’est significativement détériorée, qu’une situation particulière met en péril le maintien de sa participation sociale ou lorsqu’elle amorce une nouvelle étape de vie ou vit un changement significatif dans son environnement. Les services pour le maintien des acquis et de soutien à la participation sociale peuvent être offerts avant, après et même en complémentarité, pendant la phase d’adaptation-réadaptation. La concertation et la coordination de l’ensemble de ces activités demeurent primordiales. 6.2 Les services à l’intenti on des proches 47 Étant donné que les proches des personnes ayant une déficience physique peuvent jouer un rôle déterminant dans le cheminement de la personne, une gamme de services est développée spécifiquement à leur intention. Pour cette raison également, le plan d’intervention peut inclure des objectifs qui leur sont destinés. 6.2.1 Le soutien psychosocial Les services de soutien psychosocial ont pour objet de répondre aux besoins psychologiques et sociaux de la famille et des proches dans leur processus d’adaptation à vivre avec une personne ayant une déficience physique. Ces services comprennent des activités d’aide et de soutien individuel, de couple ou de famille et sont offerts afin de réduire les difficultés d’adaptation des proches, de conduire à un meilleur équilibre conjugal ou familial, de prévenir la détérioration des situations problématiques et de contribuer à l’atteinte des objectifs poursuivis pour la personne. Pour toute intervention psychosociale spécifique, l’adaptation à la déficience physique doit être au cœur des difficultés vécues ou perçues48. Ces services visent notamment à : 46 47 Référer à la fiche Services résidentiels située à l’annexe 8 Le vocable « proches » inclut les membres de la famille et les représentants légaux lorsqu’applicable. Les membres de la famille d’une personne ayant une déficience physique peuvent aussi recevoir des services psychosociaux en services généraux si le besoin n’est pas relié directement à la déficience. Par exemples, une détresse en situation de congédiement, de deuil d’un autre parent, de troubles de comportements d’un jeune en difficulté dans la famille, etc. 48 42 Apporter un soutien psychologique et favoriser l’expression des émotions liées à l’annonce du diagnostic ou de toute autre situation difficile reliée aux impacts de la déficience physique; Soutenir la réorganisation du système conjugal ou familial en lien avec les besoins de la personne ayant une déficience physique (comme parent, conjoint, enfant, fratrie, etc.); Offrir des conseils et du soutien aux proches pour favoriser leur équilibre personnel et pour maintenir l’équilibre conjugal et familial. Tout au cours du processus d’aide, une attention particulière est portée à la présence de problèmes sous-jacents à ceux manifestés. Les services incluent également l’accompagnement par un intervenant pivot et l’orientation vers les autres ressources les plus appropriées du réseau ou des partenaires du RTS. 6.2.2 Le soutien au développement des compétences Les services de soutien au développement des compétences sont offerts aux proches de la personne ayant une déficience physique qui reçoit des services, qu’ils soient spécifiques ou spécialisés. Le soutien au développement des compétences peut aussi être offert aux proches lorsque la personne souhaite interrompre les services ou les refuse mais que les proches manifestent eux-mêmes des besoins de services en lien avec la déficience. Ces services ont aussi comme valeur de base, le respect et la reconnaissance de l’engagement des proches. Ils leur proposent un partenariat où l’expertise de chacun (proches et intervenants) sera mise à contribution. Toutefois, ils ne visent pas à ce que les proches se substituent aux intervenants. Ces activités visent à permettre notamment aux proches de : Reconnaître, renforcer et actualiser leurs capacités à intervenir pour assurer le développement optimal du potentiel de la personne; Soutenir le développement de nouvelles compétences en fonction des besoins qui leur sont propres; Proposer des stratégies adaptées permettant d’agir en prévention de l’aggravation d’une situation. 6.2.3 Les services de « soutien aux familles » Les activités de soutien à la famille regroupent une gamme de services afin de permettre aux proches de continuer d’assumer leurs différentes responsabilités, de même que de prévenir leur épuisement. Ces services selon que la personne ayant une déficience physique est un enfant ou un adulte, comprennent le gardiennage la présence-surveillance, le répit, le dépannage, l’appui aux tâches quotidiennes, l’information et la référence aux organismes de la communauté49. 49 Référer à la fiche Services de soutien à la famille située à l’annexe 9. 43 Pour répondre adéquatement aux besoins variés des proches et pour tenir compte du profil de besoins de la personne présentant une déficience physique, une gamme variée de chacun de ces types de services doit être rendue disponible. Ces services peuvent également être offerts selon différentes modalités par l’établissement ou ses partenaires du RTS. 6.3 Les services de soutien à la collectivité Les services de soutien à la collectivité visent à appuyer les partenaires de la société civile dans l’exercice de leur mandat spécifique. Ils visent également à favoriser la mobilisation et l’action des partenaires vers la création de facilitateurs ou l’élimination des obstacles à la participation sociale des personnes présentant une déficience physique. Les services de soutien à la collectivité regroupent trois grands types d’activités : amélioration des connaissances des caractéristiques, capacités et besoins des personnes présentant une déficience physique; amélioration et promotion de l’accessibilité universelle des lieux publics ou des différentes plateformes de communication ; développement ou ajustement d’une offre de services adaptée aux réalités des personnes présentant une déficience physique. Ces services sont dispensés par une diversité d’intervenants ayant une expertise spécialisée leur permettant de sensibiliser, soutenir, former et accompagner le réseau de la santé et des services sociaux et ses partenaires de l’intersectoriel en mettant à leur disponibilité l’expertise développée par le programme-services. 44 CHAPITRE 7 : TRAJECTOIRES DE SERVICES Les trajectoires de services décrivent le cheminement clinique le plus efficace et le plus efficient permettant aux personnes d’avoir accès rapidement aux services dont elles ont besoin d’une manière coordonnée. Une trajectoire de services bien définie permet d’assurer la coordination optimale des services et le suivi systématique de clientèles. Elle vise à améliorer la qualité et l’efficience des services, tout en maximisant l’utilisation des ressources. Les trajectoires de services s’apparentent à la notion de continuum de services qui implique une reconnaissance implicite d’une responsabilité commune des prestataires de services à l’endroit d’une clientèle. Pour élaborer les trajectoires, l’ensemble des services du continuum doit être pris en compte, et ce, à tous les niveaux de spécialisation. La définition des trajectoires de services porte sur différents éléments : la détermination des clientèles communes à plus de deux prestataires de services ; l’offre de service nécessaire aux clientèles communes et les responsabilités respectives des prestataires de services ; les règles liant les prestataires de services, les établissements et les partenaires aux différents moments du continuum afin d’éviter les interruptions de services ou un accès linéaire aux services ; les modes de liaison bidirectionnelle entre les prestataires de services. 7.1 Les attentes ministérielles Actuellement, les seules trajectoires nationales existantes portent sur certaines problématiques (le traumatisme cranio cérébral, blessés médullaires, victime de brûlures graves, implant cochléaire, dépistage de la surdité néonatale, accidentés de la route), mais le besoin de définir des trajectoires pour d’autres clientèles demeure entier. Au niveau national, des trajectoires spécifiques feront l’objet de travaux et seront éventuellement diffusées permettant d’illustrer le cheminement clinique souhaité et d’établir une pratique de référence. Actuellement, des travaux sont en cours portant sur la trajectoire pour les accidents vasculaires cérébraux et la douleur chronique. Au niveau territorial, et prescrit par le plan d’accès, la réalisation de trajectoires de services doit contribuer à garantir une juste adéquation entre les besoins mis en évidence et l’offre de service ici présentée. Les CISSS ont donc la responsabilité de définir des trajectoires de services pour les personnes ayant une déficience physique. 7.2 Des principes pour guider l’élaboratio n d’une trajectoire Les acteurs du programme-services, les autres prestataires de services et leurs partenaires doivent s’engager à offrir des services de manière hiérarchisée, coordonnée et complémentaire, pour permettre une plus grande fluidité des interventions entre les 45 différents acteurs et éviter les bris de services et ce, au moyen de trajectoires clairement définies. La coordination de tous les services requis pour la personne ayant une déficience physique et ses proches devra être assurée par la mise en place de mécanismes intra et inter établissements. La trajectoire de services doit également respecter les mécanismes, les standards d’accès et de continuité prescrits dans le plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience. La personne et sa famille au cœur de la démarche tant pour l’analyse des mécanismes et processus en place que pour la détermination des objets d’amélioration et des moyens pour actualiser le changement souhaité. Une démarche qui doit s’inscrire dans une logique « réseau » plutôt que dans une logique « missions » ou « établissement »; La collaboration entre les prestataires de services pour assurer une offre de services complémentaire et intégrée. Une ouverture à l’innovation afin de planifier pour la personne et sa famille les bons services, au bon moment, par les bons intervenants et avec la bonne intensité. 7.3 Les étapes à considérer dans la réalisation d’une trajectoire de services Une trajectoire représente plus qu’un simple graphique de cheminement. Sa création nécessite au départ de préciser : Les objectifs de santé et de bien-être poursuivis; Les pratiques, stratégies et processus visés; Les partenaires mis à contribution; Le partage des responsabilités; Les ressources requises; Les modalités de référence, de transfert et de suivi; Le suivi de la clientèle et de la communication entre les intervenants; Les résultats et leurs indicateurs. La trajectoire de services doit pouvoir être utilisée auprès du plus grand nombre possible d’usagers atteints d’une même condition clinique. L’intérêt de sa création est proportionnel à l’homogénéité d’un groupe d’usagers. Cet outil peut ainsi être considéré comme utile si une harmonisation de l’offre de services est possible pour au moins 7080 % des usagers visés. Certains critères sont à considérer quant à la pertinence potentielle d’une trajectoire50, soit : Condition de santé ayant : o Incidence élevée 50 Agence de la Santé et des Services sociaux de la Montérégie (2012) Élaboration de trajectoires de services à l’intention d’une population vivant avec une déficience : recension des écrits et recommandations 46 o Définition claire o Prise en charge homogène possible o Importance critique (complexité, sévérité) pour l’usager o Coût élevé pour l’établissement ou le réseau Variabilité importante et non souhaitée de la prise en charge (délais, plaintes, problèmes de communication, etc.); Prise en charge interdisciplinaire impliquant un nombre important d’acteurs; Existence de données probantes ou de recommandations et d’avis professionnels; Obtention possible d’un consensus au sein de l’établissement ou du réseau quant à la nature de la prise en charge professionnelle et de chacune des étapes et responsabilités organisationnelles; Urgence d’agir; Motivation des professionnels et des gestionnaires à améliorer l’harmonisation de la prise en charge de la condition; Disponibilité des ressources pour la conception et mise en œuvre de la trajectoire. 47 CHAPITRE 8 : L’ÉV ALUATION DE PROGRAMME Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a pour mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés et de qualité contribuant ainsi au développement social et économique du Québec. De cette mission découle, notamment la responsabilité de déterminer les priorités, les objectifs et les orientations, de voir à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Le mandat de l’évaluation doit être défini en collaboration avec la Direction de l’évaluation en vue de son inscription au plan pluriannuel d’évaluation, selon la Directive concernant l’évaluation de programme dans les ministères et les organismes51 du Conseil du Trésor. Celui-ci devra comprendre les principaux enjeux de l’évaluation, les livrables, l’échéancier global et les ressources requises pour la réalisation du projet. L’objet d’évaluation de la mise en œuvre de la présente offre de services doit d’ores et déjà être planifié. À la lumière des évaluations déjà effectuées, du bilan des orientations ministérielles en déficience physique, de l’élaboration de la mise en place du système de suivi de la performance du programme-services déficience physique et de la convergence des constats et des analyses d’autres acteurs directement impliqués dans ce programme, l’intégration des services, qui constitue le cœur de la présente offre de service, doit être l’assise principale de la stratégie d’évaluation retenue. Or, l’évaluation de l’intégration des services constitue une tâche complexe et délicate à réaliser. Elle exige d’abord des données qui permettent de mesurer cette notion, ce qui n’est pas possible au moyen des systèmes d’information dans leur état actuel. C’est pourquoi une stratégie d’évaluation qualitative, basée sur des « trajectoires de services » ou plutôt « d’itinéraires d’usagers » est recommandée. Cette approche méthodologiquement éprouvée52, permet non seulement de saisir la gamme de services offerte, mais également d’apprécier les dimensions de continuité, de coordination et, ultimement, d’intégration des services. Enfin, elle permet de rendre compte de l’ensemble des acteurs du réseau public de la santé et des services sociaux ainsi que des partenaires communautaires et privés. De plus, par le suivi de la performance et par la reddition de comptes bonifiée du plan d’accès, une triangulation des données quantitatives et qualitatives permettra d’obtenir un portrait plus juste de l’implantation d’un réseau de services intégrés. CONSEIL DU TRÉSOR, 2014. Directive concernant l’évaluation de programme dans les ministères et organismes- Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01, article 74), Québec, Secrétariat du Conseil du trésor. 52 MSSS (2009) Évaluation de l’implantation des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. Continuité, coordination et intégration des services : volet Trajectoires de services; MSSS (2010) Évaluation de l’implantation des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. 51 48 CHAPITRE 9 : LA G AMME DE SERVICES Chaque CISSS a l’obligation de rendre disponible l’ensemble des services pour répondre aux besoins de la population de son territoire; à défaut de pouvoir les développer, des ententes de services doivent être formalisées avec l’instance la plus appropriée pour offrir ces services. Dans ce chapitre, la gamme de services à offrir aux personnes ayant une déficience physique, à leur famille et à leurs proches est précisée. Sous forme de fiches « autoportantes », la présentation de l’offre de services se veut intégrée, alliant les services spécifiques, spécialisés et surspécialisés53 lorsque requis, de même que ceux à l’intention de la personne et aussi de sa famille et ses proches. Les collaborations nécessaires à l’offre du programme-services en déficience physique sont également essentielles afin de répondre aux besoins dans l’ensemble du continuum de services requis. C'est pourquoi il est incontournable que la gamme de services soit connue et rendue disponible à l’ensemble des acteurs du territoire. Les activités du programme-service en déficience physique sont généralement réalisées par une équipe interdisciplinaire composée en fonction du profil des besoins des personnes ou encore de la nature des activités54. Chaque personne n’aura pas nécessairement besoin de l’ensemble des activités reliées à un profil de besoin, et si elle y a recours, ce sera pour des épisodes de services de durée variable et limitée dans le temps. Le plan d’intervention de la personne, articulé autour de son projet de vie, permettra d’offrir une réponse individualisée à ses besoins. Soulignons que l’organisation des services peut varier d’un territoire à l’autre. Elle découle, notamment d’une décision territoriale et doit tenir compte d’un ensemble de facteurs tel que le volume de personnes à desservir ou les responsabilités inhérentes à une désignation ministérielle par exemples. Dans le cas des services s'adressant à un plus petit volume de clientèle ou nécessitant une expertise particulière, des établissements peuvent être désignés et des consortiums ou des centres d'expertise peuvent être développés. Les établissements ainsi désignés desservent généralement plus d'un territoire et plus d'une région. La science et la technologie évoluent continuellement, influençant par le fait même les approches et les modalités d’intervention. La présente section ne se prétend 53 La référence aux services surspécialisés contenus dans cette section ne fait pas office de désignation ministérielle, mais est inscrit à titre indicatif seulement. Cette information est sujette à changement sans préavis. 54 À l’égard de l’organisation territoriale des services, il importe également de préciser que cette énumération non-exhaustive d’intervenants n’est pas une norme de constitution des équipes de travail, mais est offerte à titre indicatif seulement. Un établissement pourrait faire le choix de faire appel à un autre établissement par le biais d’une entente ou encore d’acheter à la pièce certains types de services en réponse à des besoins spécifiques d’une personne. Les principaux cliniciens œuvrant auprès de la clientèle en déficience physique sont des audiologistes, conseillers en orientation, diététistes-nutritionnistes, éducateurs physique, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, infirmiers, infirmiers auxiliaires, kinésiologues, mécaniciens en orthèses-prothèses, médecins généralistes, médecins spécialistes, neuropsychologues, optométristes, orthophonistes, pharmaciens, physiothérapeutes, préposés, psychoéducateurs, psychologues, psychotechniciens, récréologues, sexologues, spécialistes en activités cliniques, spécialistes en orientation et mobilité, spécialistes en réadaptation en déficience visuelle, techniciens en loisir, thérapeutes en réadaptation physique, techniciens en orthèses-prothèses, travailleurs sociaux, etc. 49 aucunement exhaustive et n’exclut en rien les modalités d’intervention novatrices pouvant émerger. Le jugement clinique demeure prédominant dans le choix des services à dispenser. Par ailleurs, les travaux ministériels en cours pourront moduler certaines fiches qui sont amenées à évoluer au fil des nouvelles connaissances ou orientations en matière d’organisation de services. Pour les besoins du document, la complexité de l’offre de services en déficience physique est ici simplifiée en 2 grandes catégories de services. La première catégorie de fiches présente les services à rendre disponibles pour répondre à certains profils de besoins qui sont notamment déterminés par l’âge de la personne et le site de l’atteinte qu’elle présente. La seconde section présente quant à elle des fiches traitant des services à rendre disponible aux personnes ayant une déficience physique, sans pour autant lui être exclusivement destinés. Ces services peuvent être nécessaires aux personnes desservies par d’autres programmes-services et transcender l’offre de service du programme service en déficience physique. Il importe de préciser que cette découpe demeure arbitraire et a pour seule portée la synthèse d’une offre de service complexe. 50 Services aux différents « profils-clientèle » 51 -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE A AU UD DIIT TIIV VEE DÉFICIENCE AUDITIVE ENFANTS ET ADOLESCENTS CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux enfants et aux adolescents, âgés entre 0 et 17* ans, qui présentent, sur le plan de l’acuité et de la discrimination auditive, des incapacités significatives et persistantes susceptibles d’avoir un impact sur leur développement du langage, leur capacité à communiquer et leurs relations interpersonnelles.. Conséquemment, ces incapacités peuvent restreindre leur degré de participation sociale. Ces jeunes peuvent être sourds ou malentendants de naissance, des conséquences d’une maladie ou d’un traumatisme. Ils peuvent communiquer par la parole ou par signes (LSQ55, ASL56, etc.). Ils peuvent également présenter des acouphènes persistants et dérangeants ou encore une intolérance marquée aux sons. *Ces services peuvent aussi être offerts aux jeunes âgés de 18 à 21 ans qui, par l’obtention d’une dérogation, poursuivent des études de niveau primaire ou secondaire jusqu’à l’âge de 21 ans. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Faciliter l’adaptation du jeune et de ses proches à sa condition auditive et aux changements qui peuvent l’affecter. Favoriser le développement des habiletés auditives et d’une communication orale, écrite ou signée Diminuer le dérangement causé par les acouphènes. Augmenter progressivement la tolérance aux sons. Aider le jeune et ses proches dans le développement et l’utilisation de moyens de communication et de stratégies compensatoires. Favoriser son autonomie, en tenant compte de son âge et de ses aptitudes. Favoriser la réalisation des habitudes de vie à domicile, en milieu de garde, à l’école, en 55 56 Langue des signes Québécoise American sign language 52 emploi étudiant, dans les loisirs et dans sa communauté. Faciliter les apprentissages scolaires. Favoriser la transition de l’école vers la vie active. Favoriser le développement de l’estime et de la confiance en soi. Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes. Assurer le maintien de ses acquis dans l’ensemble des domaines de sa vie. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Développement et maintien des habiletés nécessaires à communiquer Évaluation de l’audition fonctionnelle, des habiletés auditives et du rendement des appareils auditifs. Évaluation des capacités, des limitations et des besoins liés à la communication et de leurs impacts sur la qualité de vie. Accompagnement de la famille et du jeune dans le choix du mode de communication (oral, langue signée, codes du français signé, du LPC, etc.) Interventions visant le développement du langage et des habiletés auditives Soutien et enseignement visant le développement des habiletés et stratégies de communication tenant compte des préférences et des besoins du jeune, notamment : o Enseignement à la lecture labiale; o Ateliers de langues ou de codes signés (LSQ, ASL, français signé, LPC, etc.) destinés au jeune et à ses proches; o Développement des préalables et soutien à l’apprentissage du langage écrit. Soutien et enseignement de stratégies visant l’adaptation aux acouphènes. Recommandation, enseignement et soutien pour l’utilisation des aides de suppléance à l’audition et autres moyens techniques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques»). Interventions, le cas échéant, visant l’utilisation optimale d’un implant cochléaire Développement des capacités et enseignement de stratégies permettant de réduire l’impact des incapacités et l’acquisition d’une autonomie personnelle optimale Développement de l’autonomie face à des responsabilités personnelles ou familiales. Évaluation et interventions visant la réalisation autonome des activités de la vie quotidienne, selon le groupe d’âge du jeune. Évaluation des besoins et recommandation d’aides de suppléance à l’audition pour le domicile. Soutien à l’intégration sociale (milieu de garde, scolaire, activités de loisirs, emploi étudiant) et lors de la transition de l’école vers la vie active Développement des habiletés sociales nécessaires à l’intégration du jeune dans divers environnements (domicile, école et communauté). 53 Soutien à l’intégration à des activités sportives et de loisir en milieu scolaire et dans la communauté (Club sportif, Camp d’été, Camp de jour, etc.). En collaboration avec les différents partenaires, consultation et planification de la transition de l’école aux activités socioprofessionnelles (projets d’étude et de carrière, emploi étudiant, stage, etc.) (consulter les fiches «Activités socioprofessionnelles et communautaires » et « Réadaptation au travail »). Sensibilisation et formation de l’entourage (familial, scolaire ou social) aux conséquences de la surdité, aux stratégies facilitant la communication et aux adaptations requises de l’environnement pour favoriser des conditions d’écoute optimales pour le jeune. Formation, sensibilisation, consultation sur la surdité, la langue et la culture sourde aux différents partenaires (consulter le fiche «Soutien à la collectivité»). Soutien psychosocial et counseling pour le jeune et ses proches Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles; o au comportement et à l’expression des émotions; o à la gestion de l’anxiété; o à l’estime et à la confiance en soi. Soutien et accompagnement du jeune et de ses proches dans leur processus d’adaptation à la déficience auditive: croyances, réactions, etc. Information, appui et aide à la personne et aux proches, comprenant leur participation au continuum de services. Soutien aux familles visant notamment le développement des habiletés parentales qui permettront de soutenir le développement du jeune. Collaborateurs57 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Services en déficience auditive offerts aux adultes et ainés, particulièrement pour la desserte des adolescents et jeunes adultes. Audioprothésistes et médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie Programme-services Jeunes en difficulté Milieux de garde, scolaire et de l’emploi. Services régionaux d’interprétation afin d’assurer l’accessibilité universelle lors de l’utilisation des services du réseau de la santé. Organismes communautaires afin de favoriser la participation sociale. Municipalités : repérage des personnes malentendantes afin d’intervenir dans des 57 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 54 contextes d’urgence et d’évacuation. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Les services visant l’apprentissage d’une langue des signes sont offerts dans la majorité des programmes-services en déficience physique des CISSS. Ceux qui n’offrant pas ce services doivent conclure des ententes avec un autre établissement Dans certains contextes lorsque la déficience auditive s’accompagne d’une déficience visuelle, des services en surdicécité peuvent être requis (consulter la fiche «Surdicécité»).. Les chirurgies d’implantation cochléaire, les services de programmation initiale sont une intervention de réadaptation surspécialisée. Ce mandat est confié au Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval (CHU de Québec - UL) et Institut de réadaptation en déficience physique de Québec du CIUSSS de la Vieille-Capitale par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les services de RFI post-implant cochléaire sont offerts dans la majorité des programmes-services en déficience physique des CISSS Les CISSS n’offrant pas ce service doivent conclure des ententes de collaboration avec un établissement d’une autre région qui offre des services de RFI post-implant cochléaire. Les établissements suivants offrent les services de dépannage/urgence et soutien technique reliés à l’appareillage de l’implant cochléaire : CHU de Québec - UL, Institut Raymond-Dewar du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et Centre MAB-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal. Les contrôles de programmation des implants cochléaires s’effectuent dans les établissements suivants : CHU de Québec - UL, Institut Raymond-Dewar du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal et Centre MAB-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-del’Île-de-Montréal. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Cadre structurant la programmation pour les jeunes ayant un trouble de traitement auditif, 1re partie, AERDPQ, Mai 2006 Cadre structurant la programmation des services d’adaptation et de réadaptation pour les enfants sourds ou malentendants (0-12 ans) Juin 2000 Guide d’attribution des aides auditives à l’intention des intervenants, AERDPQ, Février 2000 Portrait de l’offre de services, AERDPQ, Mars 2015 Cadre structurant les services spécialisés de réadaptation relatifs à l'implant cochléaire, AERDPQ, 2007 Centre québécois d’expertise en implants cochléaires : http://www.implantcochleaire.ca/ 55 -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE A AU UD DIIT TIIV VEE DÉFICIENCE AUDITIVE ADULTES ET AÎNÉS CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux adultes et aux ainés qui présentent, sur le plan de l’acuité et de la discrimination auditive, des incapacités significatives et persistantes susceptibles d’entraver notamment la capacité de communiquer, les relations interpersonnelles et la sécurité et conséquemment, restreindre la participation sociale. Ces personnes peuvent être sourdes ou malentendantes de naissance, des conséquences d’une maladie, d’un traumatisme ou suite au processus de vieillissement. Elles peuvent communiquer par la parole, par signes (LSQ 58, ASL59, etc.), présenter des acouphènes persistants et dérangeants, ou encore une intolérance marquée à des sons. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Faciliter l’adaptation de la personne et de ses proches à sa condition auditive et aux changements qui peuvent l’affecter. Développer ou améliorer ses habiletés et ses stratégies de communication, favoriser le développement ou le maintien d’une communication fonctionnelle et satisfaisante. Diminuer le dérangement causé par les acouphènes. Augmenter progressivement la tolérance aux sons. Améliorer et maintenir l’autonomie et la sécurité de la personne, notamment dans ses déplacements et à domicile. Favoriser la réalisation des habitudes de vie à domicile, dans des études postsecondaires, au travail, dans les loisirs et dans sa communauté. Développer ou maintenir le potentiel d’employabilité ou d’activités occupationnelles. Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes. Faciliter l’exercice des rôles sociaux, notamment celui d’être parent. 58 59 Langue des signes Québécoise American sign language 56 Assurer le maintien de ses acquis dans l’ensemble des domaines de sa vie. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Développement et maintien des habiletés nécessaires à communiquer Évaluation de l’audition fonctionnelle. Évaluation des capacités, des limitations et des besoins liés à la communication et de leurs impacts sur la qualité de vie. Soutien et enseignement visant le développement des habiletés et stratégies de communication tenant compte des préférences et des besoins de la personne, notamment : o Enseignement à la lecture labiale; o Ateliers en langue des signes (LSQ et ASL) destinés à la personne et à ses proches; Soutien et enseignement de stratégies visant l’adaptation aux acouphènes. Recommandation, enseignement et soutien pour l’utilisation des aides de suppléance à l’audition et autres moyens techniques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques»). Interventions, le cas échéant, visant l’utilisation optimale d’un implant cochléaire Intervention PSEE (Parents Sourds enfant entendant). Développement et maintien des habiletés nécessaires de vivre chez soi de manière autonome Développement ou maintien de l’autonomie face à des responsabilités personnelles ou familiales. Évaluation et intervention visant la réalisation autonome et sécuritaire des activités de la vie quotidienne. Évaluation des besoins et recommandation d’aides de suppléance à l’audition pour le domicile. Soutien à l’intégration professionnelle et sociale Sensibilisation ou formation de l’entourage (familial, professionnel ou social) aux conséquences de la surdité et aux stratégies facilitant la communication. Soutien à l’intégration à des activités sportives et de loisir dans la communauté. Formation, sensibilisation, consultation sur la surdité, la langue et la culture sourde aux différents partenaires (consulter le fiche «Soutien à la collectivité»). Évaluation des besoins, recommandation, enseignement et suivi de l’adaptation de l’environnement d’étude ou de travail. Évaluation et intervention pour développer le potentiel d’employabilité de la personne et faciliter les apprentissages reliés à l’intégration dans un milieu de travail (rémunéré, compétitif ou non) (consulter les fiches «Réadaptation au travail» et « Activités socioprofessionnelles et communautaires »): 57 Recommandation sur les aptitudes et limites en lien avec les impacts de la déficience auditive pour l’orientation ou la réorientation professionnelle (consulter la fiche Réadaptation au travail). En collaboration avec les partenaires, soutien dans le processus de recherche et d’obtention d’un emploi. Adaptation de postes de travail ou aménagement de la tâche (outils informatiques, bruit ambiant, ergonomie, etc.). Soutien psychosocial et counseling pour la personne et ses proches Soutien psychologique et accompagnement de la personne et de ses proches dans leur processus d’adaptation à la déficience auditive: croyances, réactions, etc. Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles; o au comportement et à l’expression des émotions; o à la gestion de l’anxiété; o à l’estime et à la confiance en soi; o à la sécurité. Information, appui et aide à la personne et aux proches, comprenant leur participation au continuum de services. Collaborateurs60 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Services régionaux d’interprétation afin d’assurer l’accessibilité universelle lors de l’utilisation des services du réseau de la santé. Programme-service SAPA dans le cadre des activités de repérage de la déficience auditive chez les aînés. Organismes communautaires afin de favoriser la participation sociale. Municipalités : repérage des personnes malentendantes afin d’intervenir dans des contextes d’urgence et d’évacuation. Milieux scolaires post-secondaires Milieux relatifs à l’emploi, SEMO, SSMO et autres. Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) Audioprothésistes et médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie. 60 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 58 Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Les services visant l’apprentissage d’une langue des signes sont offerts dans la majorité des programmes-services en déficience physique des CISSS. Ceux qui n’offrent pas ce service doivent conclure des ententes avec un autre établissement qui offre ce service. Dans certains contextes lorsque la déficience auditive s’accompagne d’une déficience visuelle, des services en surdicécité peuvent être requis (consulter la fiche «Surdicécité»). Les chirurgies d’implantation cochléaire, les services de programmation initiale sont une intervention de réadaptation surspécialisée. Ce mandat est confié au Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval (CHU de Québec - UL) et Institut de réadaptation en déficience physique de Québec du CIUSSS de la Vieille-Capitale par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les services de RFI post-implant cochléaire sont offerts dans la majorité des programmes-services en déficience physique des CISSS Les CISSS n’offrant pas ce service doivent conclure des ententes de collaboration avec un établissement d’une autre région qui offre des services de RFI post-implant cochléaire. Les établissements suivants offrent les services de dépannage/urgence et soutien technique reliés à l’appareillage de l’implant cochléaire : CHU de Québec - UL, Institut Raymond-Dewar du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal et Centre MAB-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal. Les contrôles de programmation des implants cochléaires s’effectuent dans les établissements suivants : CHU de Québec - UL, Institut Raymond-Dewar du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal et Centre MAB-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-del’île-de-Montréal. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Cadre structurant la programmation des services pour les personnes aînées ayant une déficience auditive, AERDPQ, mars 2008 Continuum de services pour les aînés présentant une déficience auditive ou visuelle : Responsabilités des acteurs du programme-services en déficience physique (services spécifiques et spécialisés de réadaptation), AERDPQ et AQESSS, février 2015 Guide d’attribution des aides auditives à l’intention des intervenants, AERDPQ, Février 2000 Portrait de l’offre de services, AERDPQ, Mars 2015 Cadre structurant les services spécialisés de réadaptation relatifs à l'implant cochléaire, AERDPQ, 2007 Centre québécois d’expertise http://www.implantcochleaire.ca/ 59 en implants cochléaires : -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE D DU U LLA AN NG GA AG GEE DÉFICIENCE DU LANGAGE ENFANTS ET ADOLESCENTS CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux enfants et adolescents, âgés entre 0 et 17* ans, qui présentent, au niveau du langage, des incapacités significatives et persistantes susceptibles de limiter la capacité de communiquer avec autrui. Conséquemment, ces incapacités peuvent restreindre leur degré de participation sociale. Cette déficience est conséquente à des troubles d’ordre neurologique d’origine congénitale tels que le trouble primaire du langage (dysphasie), la dyspraxie verbale, certaines formes de bégaiement ou un trouble du traitement auditif61. *Ces services peuvent aussi être offerts aux jeunes âgés de 18 à 21 ans qui, par l’obtention d’une dérogation, poursuivent des études de niveau primaire ou secondaire jusqu’à l’âge de 21 ans. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Faciliter l’adaptation du jeune et de ses proches à la situation engendrée par la déficience du langage. Favoriser le développement de la communication orale et écrite du jeune. Favoriser une alimentation adéquate et équilibrée Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes. Favoriser le développement de l’estime et de la confiance en soi. Aider le jeune à développer ses moyens de communication et ses habiletés compensatoires. Favoriser la réalisation des habitudes de vie à domicile, en milieu de garde, à l’école, en emploi étudiant, dans les loisirs et dans la communauté. 61 Le trouble de traitement auditif est une incapacité à analyser correctement et à traiter les sons entendus sans surdité. Les jeunes ayant un trouble de traitement auditif sont accueillis soit dans les programmes en déficience du langage soit dans les programmes en déficience auditive 60 Favoriser la transition de l’école vers la vie active. Faciliter les apprentissages scolaires. Assurer le maintien de ses acquis dans l’ensemble des domaines de sa vie. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Contribution à la précision du diagnostic lorsque requis. Développement des capacités et enseignement de stratégies permettant de réduire l’impact des incapacités et l’acquisition d’une autonomie personnelle optimale Évaluation des capacités, des limitations et des besoins et de leurs impacts sur la qualité de vie. Interventions visant le développement de diverses capacités liées : o à la communication orale et écrite; o aux habiletés auditives; o à la cognition et perception; o à la planification motrice globale et fine; o aux activités de la vie quotidienne, notamment les soins personnels et la nutrition (sélectivité alimentaire) ; o aux responsabilités inhérentes à un jeune de son groupe d’âge (ex : gestion de l’argent de poche, accomplir des tâches qu’on lui confie, etc.); o aux apprentissages scolaires. Enseignement de stratégies compensatoires. Évaluation, recommandations, enseignement et suivi concernant des aides techniques ou technologiques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques»). Soutien à l’intégration sociale (milieu de garde, scolaire, activités de loisirs, emploi étudiant) et lors de la transition de l’école vers la vie active Sensibilisation et formation de l’entourage (familial, scolaire ou social) aux conséquences de la déficience du langage et aux stratégies facilitant la communication. Développement des habiletés sociales nécessaires à l’intégration du jeune dans divers environnements (domicile, milieu de garde, école, emploi étudiant et communauté). Enseignement de stratégies compensatoires ou d’utilisation d’aides techniques et technologiques facilitant les apprentissages scolaires, notamment ceux reliés au langage écrit. En collaboration avec les différents partenaires, consultation et planification de la transition de l’école aux activités socioprofessionnelles (projets d’étude et de carrière, emploi étudiant, stage, etc.) (consulter les fiches «Activités socioprofessionnelles et communautaires » et « Réadaptation au travail »). Soutien aux démarches entourant la recherche et l’obtention d’un emploi étudiant. Soutien à l’intégration dans des activités sportives et de loisirs en milieu scolaire et dans la communauté. Enseignement et soutien au développement d’une autonomie dans les déplacements 61 (transport en commun, développement des capacités à conduire, etc.). Formation, sensibilisation, consultation sur la déficience du langage aux différents partenaires (consulter le fiche «Soutien à la collectivité»). Soutien psychosocial et counseling pour le jeune et ses proches Interventions pour le développement des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles; o au comportement, à l’expression des émotions; o à la gestion de l’anxiété; o à l’estime et la confiance en soi. Information, appui et aide aux proches, comprenant leur participation au continuum de services. Soutien et accompagnement du jeune et de ses proches dans leur processus d’adaptation au trouble du langage. Soutien aux familles favorisant notamment le développement des habiletés parentales. Collaborateurs62 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Programmes-services en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme Programmes-services jeunes en difficulté Programmes-services en dépendances Milieu scolaire et milieux de garde. Milieux relatifs à l’emploi, SEMO, SSMO et autres. Services en déficience du langage offerts aux adultes et ainés, particulièrement pour la desserte des adolescents et jeunes adultes. Organismes communautaires afin de favoriser la participation sociale. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) 62 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 62 Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Cadre structurant la programmation des services spécialisés de réadaptation pour les jeunes ayant une déficience du langage (0-18 ans), AERDPQ, Avril 2005. Cadre structurant la programmation pour les jeunes ayant un trouble de traitement auditif, 2e partie, AERDPQ, Mai 2006 Guide d’attribution. Programme ministériel des aides techniques à la communication (PMATCOM). Mars 2006 Mesure 30810- Direction de l’adaptation scolaire. Volet 1 et volet 2. Ministère de l’éducation des loisirs et du sport, 2011 63 -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE D DU U LLA AN NG GA AG GEE DÉFICIENCE DU LANGAGE ADULTES ET AINÉS CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux adultes et aînés qui présentent, au niveau du langage, des incapacités significatives et persistantes susceptibles de limiter la capacité de communiquer avec autrui. Conséquemment, ces incapacités peuvent restreindre leur degré de participation sociale. Cette déficience est conséquente à des troubles d’ordre neurologique d’origine congénitale tels que le trouble primaire du langage (dysphasie), la dyspraxie verbale, certaines formes de bégaiement ou un trouble du traitement auditif63. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Faciliter l’adaptation de la personne et de ses proches à la situation engendrée par la déficience du langage. Améliorer ses habiletés et ses stratégies de communication, favoriser le développement ou le maintien d’une communication fonctionnelle et satisfaisante. Favoriser l’autonomie de la personne dans la réalisation de ses activités courantes à domicile et dans sa communauté. Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes. Faciliter l’exercice des rôles sociaux, notamment celui d’être parent. Faciliter l’intégration en emploi et le maintien d’une vie active. Assurer le maintien des acquis de la personne dans l’ensemble des domaines de sa vie. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Développement et maintien des habiletés nécessaires à vivre chez soi de manière 63 Le trouble de traitement auditif est une incapacité à analyser correctement et à traiter les sons entendus sans surdité. Les jeunes ayant un trouble de traitement auditif sont accueillis soit dans les programmes en déficience du langage soit dans les programmes en déficience auditive 64 autonome Évaluation des capacités, des limitations et des besoins et de leurs impacts sur la qualité de vie. Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o à la communication orale et écrite; o aux habiletés auditives; o aux activités de la vie quotidienne (ex. : gestion d’un budget, planification et préparation des repas, entretien du logis, utilisation sécuritaire de différents équipements, etc.). Enseignement de stratégies compensatoires. Recommandations, enseignement et suivi concernant des aides techniques ou technologiques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques»). Soutien à l’intégration professionnelle et sociale Évaluation et intervention pour développer le potentiel d’employabilité de la personne et faciliter les apprentissages reliés à l’intégration dans un milieu de travail (rémunéré, compétitif ou non) (consulter les fiches «Réadaptation au travail» et « Activités socioprofessionnelles et communautaires »): En collaboration avec les partenaires, soutien dans le processus de recherche et d’obtention d’un emploi. Adaptation de postes de travail ou aménagement de la tâche (outils informatiques, bruit ambiant, ergonomie, etc.). Soutien à l’intégration dans des activités sportives et de loisirs dans la communauté. Sensibilisation ou formation de l’entourage (familial, professionnel ou social) pour optimiser les situations relationnelles et de communication. Enseignement et soutien au développement d’une autonomie dans les déplacements (transport en commun, développement des capacités à conduire, etc.). Formation, sensibilisation, consultation sur la déficience du langage et ses impacts chez la personne adulte aux différents partenaires (consulter le fiche «Soutien à la collectivité»). Soutien psychosocial et counseling pour la personne et ses proches Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles; o au comportement et à l’expression des émotions; o à la gestion de l’anxiété; o l’estime et la confiance en soi. Information, appui et aide à la personne et aux proches, comprenant leur participation au continuum de services. Soutien psychologique et accompagnement de la personne et des proches dans le processus d’adaptation au trouble du langage. 65 Collaborateurs64 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Programmes-services en dépendances Organismes communautaires afin de favoriser la participation sociale. Milieux scolaires post-secondaires Milieux relatifs à l’emploi, SEMO, SSMO et autres. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Cadre structurant la programmation de l’Offre de service pour les adultes ayant une déficience du langage, AERDPQ, Octobre 2013. Guide d’attribution. Programme ministériel des aides techniques à la communication (PMATCOM). Mars 2006 64 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 66 -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE M MO OT TR RIICCEE ATTEINTES CÉRÉBRALES (ENFANTS/ADOLESCENTS) CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux enfants et adolescents âgés entre 0 et 17* ans qui présentent une lésion ou une anomalie du système nerveux central** entrainant, sur le plan moteur et neurologique, des incapacités significatives et persistantes pouvant entraver la réalisation des habitudes de vie et restreindre la participation sociale. Ces atteintes peuvent être anténatales, périnatales, ou des conséquences d’une maladie ou d’un traumatisme. Elles correspondent notamment à une déficience motrice cérébrale, une tumeur cérébrale, des séquelles d’une méningite ou d’anoxie, un traumatisme craniocérébral, un accident vasculaire cérébral. *Ces services peuvent aussi être offerts aux jeunes âgés de 18 à 21 ans qui, par l’obtention d’une dérogation, poursuivent des études de niveau primaire ou secondaire. ** Les atteintes exclusives de la moelle épinières sont traitées dans la fiches «Atteintes neuro-musculo-squelettiques et médullaires». Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Assurer une surveillance de la santé et du développement du jeune. Aider à récupérer et à développer son potentiel (moteur, sensitif, perceptivo-cognitif et de communication) de manière optimale, en tenant compte des stades de développement de l’enfant et de son environnement. Diminuer les risques de déformations musculo-squelettiques pendant la croissance dues à la spasticité ou à l’hypotonie, et maintenir l’intégrité des structures. Favoriser une alimentation adéquate et sécuritaire (en tenant compte des limitations orales-motrices et particularités sensorielles du jeune). Aider à développer la gestion des fonctions d’élimination (en tenant compte des stades de développement de l’enfant et de son potentiel). 67 Faciliter l’adaptation du jeune et de ses proches aux impacts de l’atteinte cérébrale et aux changements qui peuvent l’affecter. Favoriser l’intégration du jeune à domicile, en service de garde, à l’école, en emploi étudiant, dans les loisirs et dans sa communauté. Favoriser le développement et la récupération des habiletés permettant la réalisation des habitudes de vie. Favoriser l'intégration et la participation sociale du jeune tout en le préparant à la transition à la vie adulte. Faciliter les apprentissages scolaires. Développer le potentiel d’employabilité ou d’activités occupationnelles. Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes. Permettre l’apprentissage de stratégies compensatoires ou l’utilisation optimale d’aides techniques ou technologiques pour compenser les incapacités. Assurer le maintien des acquis Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Aide au développement des habiletés et au maintien des acquis Évaluation des capacités, des incapacités et des besoins. Interventions visant à développer (en tenant compte du stade de développement de l’enfant) les capacités motrices, perceptivo-cognitives, langagières et comportementales du jeune et à en assurer le maintien dans le temps. Interventions visant à assurer une alimentation adéquate et sécuritaire. Interventions visant à soutenir le développement des fonctions d’élimination (en tenant compte du stade de développement de l’enfant et de son potentiel). Interventions de positionnement et de mobilisation afin d’éviter, les déformations et maintenir l’intégrité des structures malgré la présence de spasticité ou d’hypotonie. Contribution à la précision diagnostique lorsque requis. Développement des capacités et enseignement de stratégies permettant de réduire l’impact des incapacités et l’acquisition d’une autonomie personnelle optimale Développement de l’autonomie face à des responsabilités personnelles ou familiales. Évaluation du potentiel de développement de façon à optimiser les apprentissages visant la réalisation autonome des activités de la vie quotidienne et domestique. Évaluation, recommandation et enseignement de stratégies compensatoires ou d’utilisation d’aides techniques et technologiques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques») facilitant la réalisation sécuritaire des activités courantes à domicile ou dans la communauté. Interventions de réadaptation visant l’autonomie dans les différentes habitudes de vie. Services d’assistance personnelle aux activités de la vie quotidienne et domestique 68 (consulter la fiche « Services d’assistance personnelle aux activités de la vie quotidienne et domestique ») Services de soutien aux familles (consulter la fiche «Services de soutien aux familles»). Enseignement aux proches et aux intervenants des différents milieux de vie à l’utilisation optimale de certaines aides techniques (lève-personne, orthèses, appareil de gavage, etc.). Évaluation des besoins et recommandation d’adaptation du domicile. Identification des besoins en adaptation de véhicule et identification de la démarche à privilégier (voir fiche « Services visant l’utilisation sécuritaire d’un véhicule automobile ») Évaluations, recommandations et accompagnement pour l’intégration d’un milieu résidentiel autre que le domicile familial (consulter la fiche «Services résidentiels»). Soutien à l’intégration sociale (milieu de garde, scolaire, activités de loisirs, emploi étudiant) et lors de la transition de l’école vers la vie active Sensibilisation ou formation de l’entourage (familial, scolaire ou social) aux conséquences de l’atteinte cérébrale. Développement des habiletés sociales nécessaires à l’intégration du jeune dans divers environnements (domicile, garderie, école et communauté). Soutien à l’intégration d’activités sportives, de loisirs et de loisirs adaptés en milieu scolaire et dans la communauté (Club sportif, Camp d’été, Camp de jour, etc.). Consultation et planification de la transition de l’école aux activités socioprofessionnelles (projets d’étude et de carrière, emploi étudiant, stage, etc.) (consulter les fiches «Activités socioprofessionnelles et communautaires » et « Réadaptation au travail »). Formation, sensibilisation, consultation sur la déficience motrice aux différents partenaires (consulter le fiche «Soutien à la collectivité»). Soutien psychosocial et counseling pour le jeune et ses proches Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles et l’expression des émotions; o aux relations amoureuses et à la sexualité; o à la gestion de l’anxiété; o à la gestion des comportements inappropriés (consulter la fiche «Troubles graves du comportement»); Information, appui et aide au jeune et aux proches, comprenant leur participation à la démarche clinique. Soutien psychologique et accompagnement du jeune et des proches dans le processus d’adaptation à l’atteinte cérébrale. Soutien aux familles favorisant notamment le développement des habiletés parentales. 69 Collaborateurs65 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Services en déficience motrice offerts aux adultes et ainés particulièrement requis pour la desserte des adolescents et des jeunes adultes. Milieux de garde, scolaire et communautaire. Programme-services DI-TSA (lorsqu’une DI est associée à la DP) Programme-service santé physique. Programme-services en dépendances Programme-services santé mentale Programme-service jeunes en difficulté Municipalités pour les transports, loisirs, loisirs adaptés, camps de jour, etc. SAAQ, IVAC lorsque le jeune est assuré par un tiers payeur Omnipraticiens et médecins spécialistes Organismes communautaires Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Consortiums en traumatologie pour les enfants et adolescents ayant subi un traumatisme craniocérébral modéré ou sévère. Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine : clinique de dysphagie et clinique de la spasticité IRDPQ du CIUSSS de la Vieille-Capitale et Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine : unité interne de réadaptation fonctionnelle intensive. L’intervention auprès d’un jeune ayant une TCC léger réclame une approche clinique distincte. Les orientations ministérielles en la matière exigent la mise en place de services spécifiques à cet effet. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Guide d'attribution des aides techniques en déficience motrice à l'intention des intervenants Mars 2005 Algorithme décisionnel pour la gestion du risque de complications neurologiques 65 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 70 graves à la suite d'un TCCL, clientèle pédiatrique – Affiche, MSSS (2008) Orientations ministérielles pour le traumatisme craniocérébral léger 2005-2010, MSSS (2005) Guidelines for Pediatric Concussion, Fondation ontarienne de neurotraumatologie Continuum de services en traumatologie. INESSS : http://fecst.inesss.qc.ca/fr.html 71 -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE M MO OT TR RIICCEE ATTEINTES NEURO-MUSCULO-SQUELETTIQUE ET MÉDULLAIRES (ENFANTS ET ADOLESCENTS) CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux enfants et adolescents âgés entre 0 et 17* ans qui présentent une lésion de la moelle épinière, une atteinte du système nerveux périphérique ou du système musculosquelettique. Celle-ci entraîne, sur le plan moteur et neurologique, des incapacités significatives et persistantes susceptibles d’affecter la réalisation des habitudes de vie et de restreindre la participation sociale. Ces lésions peuvent être causées par une malformation congénitale (ex : spina bifida), un traumatisme (ex : blessure médullaire ou orthopédique grave) ou une maladie (ex.: lésion médullaire des suites d'une tumeur)**. *Ces services peuvent aussi être offerts aux jeunes âgés de 18 à 21 ans qui, par l’obtention d’une dérogation, poursuivent des études de niveau primaire ou secondaire. **Les conditions susceptibles d’affecter l’ensemble du système nerveux central sont traitées dans la fiche «Atteintes cérébrales». Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Assurer une surveillance de la santé et du développement du jeune. L’aider à récupérer et à développer son potentiel (moteur, sensitif et proprioceptif) de manière optimale, en tenant compte des stades du développement moteur de l’enfant et de son environnement. Diminuer les risques de déformation musculo-squelettiques pendant la croissance dues à la spasticité ou à l'hypotonie, et maintenir l'intégrité des structures.. Aider à développer la gestion des fonctions d’élimination (en tenant compte des stades de développement de l’enfant et de son potentiel). Faciliter l’adaptation du jeune et de ses proches aux impacts de l’atteinte neuro72 musculo-squelettique ou médullaire et aux changements qui peuvent l’affecter. Favoriser l’intégration du jeune à domicile, en service de garde, à l’école, en emploi étudiant, dans les loisirs et dans sa communauté. Favoriser le développement et la récupération des habiletés permettant la réalisation des habitudes de vie. Favoriser l'intégration et la participation sociale du jeune tout en le préparant à la transition à la vie adulte. Faciliter les apprentissages scolaires. Développer le potentiel d’employabilité ou d’activités occupationnelles. Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes. Permettre l’apprentissage de stratégies compensatoires ou l’utilisation optimale d’aides techniques ou technologiques pour compenser les incapacités. Assurer le maintien de ses acquis. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Aide au développement des habiletés et au maintien des acquis Évaluation des capacités, des incapacités et des besoins. Interventions visant à développer (en tenant compte du stade de développement de l’enfant et de son pronostic) ses capacités motrices, sensitives et proprioceptives et à en assurer le maintien dans le temps. Interventions visant à assurer une alimentation adéquate et équilibrée. Interventions visant à soutenir le développement des fonctions d’élimination (en tenant compte du stade de développement de l’enfant et de son potentiel). Interventions de positionnement et de mobilisation afin d’éviter, les déformations et maintenir l’intégrité des structures malgré la présence de spasticité ou d’hypotonie. Développement des capacités et enseignement de stratégies permettant de réduire l’impact des incapacités et l’acquisition d’une autonomie personnelle optimale Développement de l’autonomie face à des responsabilités personnelles ou familiales. Évaluation du potentiel de développement de façon à optimiser les apprentissages visant la réalisation autonome des activités de la vie quotidienne et domestique. Évaluation, recommandation et enseignement de stratégies compensatoires ou d’utilisation d’aides techniques ou technologiques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques») facilitant la réalisation sécuritaire des activités courantes à domicile ou dans la communauté. Interventions de réadaptation visant l’autonomie dans les différentes habitudes de vie. Services d’assistance personnelle aux activités de la vie quotidienne et domestique (consulter la fiche « Services d’assistance personnelle aux activités de la vie quotidienne et domestique ») 73 Services de soutien aux familles (consulter la fiche «Services de soutien aux familles»). Enseignement aux proches et aux intervenants des différents milieux de vie à l’utilisation optimale de certaines aides techniques (lève-personne, orthèses, etc.). Évaluation des besoins et recommandation d’adaptation du domicile. Identification des besoins en adaptation de véhicule et identification de la démarche à privilégier (voir fiche « Services visant l’utilisation sécuritaire d’un véhicule automobile ») Évaluations, recommandations et accompagnement pour l’intégration d’un milieu résidentiel autre que le domicile familial (consulter la fiche «Services résidentiels»). Soutien à l’intégration sociale (milieu de garde, scolaire, activités de loisirs, emploi étudiant) et lors de la transition de l’école vers la vie active Sensibilisation ou formation de l’entourage (familial, scolaire ou social) aux conséquences de l’atteinte. Développement des habiletés sociales nécessaires à l’intégration du jeune dans divers environnements (domicile, garderie, école et communauté). Soutien à l’intégration d’activités sportives, de loisir et de loisirs adaptés en milieu scolaire et dans la communauté (Club sportif, Camp d’été, Camp de jour, etc.). Consultation et planification de la transition de l’école aux activités socioprofessionnelles (projets d’étude et de carrière, emploi étudiant, stage, etc.) (consulter les fiches «Activités socioprofessionnelles et communautaires » et « Réadaptation au travail »). Formation, sensibilisation, consultation sur la déficience motrice aux différents partenaires (consulter le fiche «Soutien à la collectivité»). Soutien psychosocial et counseling pour le jeune et ses proches Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles et l’expression des émotions; o aux relations amoureuses et à la sexualité; o à la gestion de l’anxiété; o à la gestion de la douleur. Information, appui et aide au jeune et aux proches, comprenant leur participation à la démarche clinique. Soutien psychologique et accompagnement du jeune et des proches dans le processus d’adaptation à l’atteinte neuro-musculo-squelettique ou médullaire. Soutien aux familles favorisant notamment le développement des habiletés parentales. 74 Collaborateurs66 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Services en déficience motrice offerts aux adultes et ainés particulièrement requis pour la desserte des adolescents et des jeunes adultes. Milieux de garde, scolaire et communautaire. Programme-services DI-TSA (lorsqu’une DI est associée à la DP) Programme-service santé physique. Programme-service jeune en difficulté. Municipalités pour les transports, loisirs, loisirs adaptés et camps de jour. SAAQ, IVAC lorsque le jeune est assuré par un tiers payeur Omnipraticiens et médecins spécialistes Organismes communautaires Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Consortiums de l’est et de l’ouest en neurotraumatologie Centre de réadaptation Marie-Enfant (CHU Sainte-Justine) : clinique de dysphagie, clinique de la spasticité et clinique surspécialisée des maladies neuromusculaires. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Cadre structurant - jeunes lésion musculo-squelettique, AERDPQ, 2005 Guide d'attribution des aides techniques en déficience motrice à l'intention des intervenants Mars 2005 Protocoles d’ententes des consortiums de l’est et de l’ouest en neurotraumatologie Continuum de services en traumatologie. INESSS : http://fecst.inesss.qc.ca/fr.html 66 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 75 -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE M MO OT TR RIICCEE ATTEINTES CÉRÉBRALES (ADULTES ET AÎNÉS) CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux adultes et ainés présentant une lésion ou une anomalie du système nerveux central* entrainant, sur le plan moteur et neurologique, des incapacités significatives et persistantes pouvant entraver la réalisation des habitudes de vie et restreindre la participation sociale. Ces atteintes peuvent être de naissance ou des conséquences d’une maladie ou un traumatisme. Elles correspondent notamment à une déficience motrice cérébrale, une maladie d'origine génétique, la sclérose en plaques ou sclérose latérale amyotrophique, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme craniocérébral, une tumeur cérébrale, une intoxication, etc.). * Les atteintes exclusives de la moelle épinières sont traitées dans la fiche «Atteintes médullaires». Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Faciliter l’adaptation de la personne et de ses proches à l’atteinte cérébrale et aux changements qui peuvent l’affecter. Permettre la récupération et la consolidation optimale des capacités motrices, sensitives, perceptivo-cognitives et langagières de la personne. Favoriser l’atteinte d’une condition physique et physiologique optimale. Soutenir l'apprentissage de l'autogestion de la douleur. Permettre la récupération ou la consolidation des capacités liées à la communication, à la nutrition et aux fonctions d’élimination. Favoriser l’autonomie de la personne dans la réalisation de ses activités courantes à domicile, au travail et dans sa communauté. Favoriser l’autonomie et la sécurité de la personne dans ses déplacements. Permettre l’apprentissage de stratégies compensatoires ou l’utilisation optimale 76 d’aides techniques pour compenser les incapacités persistantes. Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes. Permettre la reprise ou l’exercice des rôles sociaux. Permettre l’intégration ou la réintégration en emploi et le maintien d’une vie active. Soutenir l’intégration sociale par la réalisation des habitudes de vie à domicile, au travail, dans les loisirs et dans la communauté. Assurer le maintien des acquis de la personne dans l’ensemble des domaines de sa vie. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Aide au développement et au maintien des habiletés nécessaires à vivre chez soi de manière autonome Évaluation des capacités, des limitations et des besoins et de leurs impacts sur la qualité de vie. Interventions de réadaptation fonctionnelle intensive en internat (consulter la fiche «URFI»). Interventions visant la récupération ou la consolidation des habiletés liées : o à la motricité, proprioception et perception; o à la nutrition; o à la communication orale et écrite; o aux activités intellectuelles; o aux activités de la vie quotidienne (préparation des repas, entretien du domicile, utilisation sécuritaire de différents équipements, etc.). Interventions visant l’autogestion de la douleur, notamment : o entrainement à des activités adaptées à la condition de santé de la personne; o traitement pharmocologique; o gestion de l’énergie; o gestion de l’anxiété. Interventions visant la diminution et la gestion de la spasticité ou de l’hypotonie, de même que le maintien de l’intégrité des structures. Évaluation, recommandation et enseignement de stratégies compensatoires ou d’utilisation d’aides techniques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques») facilitant la réalisation sécuritaire des activités courantes à domicile ou dans la communauté. Services d’assistance personnelle aux activités de la vie quotidienne et domestique (consulter la fiche «Services d’aide à domicile»). Enseignement aux proches à l’utilisation optimale de certaines aides techniques (lèvepersonne, appareil de gavage, etc.). Évaluation des besoins et recommandation d’adaptation du domicile. Évaluation des besoins en lien avec l’accès à un véhicule routier (Consulter la fiche 77 « Services visant l’utilisation sécuritaire d’un véhicule automobile ». Évaluations, recommandations et accompagnement vers un milieu résidentiel autre que le domicile (consulter la fiche «Services résidentiels»). Soutien à l’intégration professionnelle et sociale Évaluation et intervention en vue du retour au travail ou pour développer le potentiel d’employabilité de la personne (consulter la fiche «Réadaptation au travail»)Sensibilisation ou formation de l’entourage (familial, professionnel ou social) aux conséquences de l’atteinte cérébrale. Formation, sensibilisation, consultation sur la déficience motrice aux différents partenaires (consulter le fiche «Soutien à la collectivité»). Soutien psychosocial et counseling pour la personne et ses proches Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles et l’expression des émotions; o aux relations amoureuses et à la sexualité; o aux rôles parentaux; o à la gestion de l’anxiété; o à la gestion des comportements inappropriés (consulter la fiche «Troubles graves du comportement»). Information, appui et aide à la personne et aux proches, comprenant leur participation à la démarche clinique. Soutien psychologique et accompagnement de la personne et des proches dans le processus d’adaptation à l’atteinte cérébrale. Collaborateurs67 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Programme-service SAPA Programme-services de santé physique. Programme-services santé mentale. Programme-services dépendances. Centre d’expertise en douleur chronique. Réseau scolaire secondaire régulier, professionnel et post-secondaire. Organismes communautaires afin de favoriser la participation sociale et le maintien des acquis. Municipalités pour les transports et loisirs adaptés. Milieux relatifs à l’emploi, SEMO, SSMO et autres. 67 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 78 Assureurs (CSST, SAAQ, IVAC, etc.). Fondations. Réseau scolaire régulier professionnel et post-secondaire. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Consortiums en traumatologie pour les adultes présentant un traumatisme craniocérébral modéré ou grave. INESSS La Clinique Parent-Plus du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Centre de réadaptation Lucie-Bruneau. Continuum de services post AVC. Continuum de services en douleur chronique. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Algorithme décisionnel pour la gestion du risque de complications neurologiques graves à la suite d'un TCCL, clientèle adulte – Affiche, MSSS (2008) Orientation ministérielle en TCCL Continuum AVC (rapport d’experts) Guide d'attribution des aides techniques en déficience motrice à l'intention des intervenants AERDPQ, Mars 2005 Harmonisation des pratiques en centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) pour les personnes ayant de la douleur chronique, AERDPQ, août 2012 Continuum de services en traumatologie. INESSS : http://fecst.inesss.qc.ca/fr.html 79 -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE M MO OT TR RIICCEE ATTEINTES MÉDULLAIRES (ADULTES ET AÎNÉS) CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux adultes ou aînés présentant une lésion de la moelle épinière complète ou partielle. Celle-ci entraîne, sur le plan moteur et neurologique, des incapacités significatives et persistantes susceptibles d’affecter la réalisation des habitudes de vie et de restreindre la participation sociale. Ces lésions peuvent être causées par une malformation congénitale (ex : spina bifida), un traumatisme (ex : blessure médullaire) ou une maladie*. *Les conditions susceptibles d’affecter l’ensemble du système nerveux central sont traitées dans la fiche »Atteintes cérébrales». Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Faciliter l’adaptation de la personne et de ses proches à l’atteinte médullaire et aux changements qui peuvent l’affecter. Optimiser la récupération des capacités motrices, proprioceptives et sensorielles. Favoriser l’atteinte d’une condition physique et physiologique optimale. Soutenir l'apprentissage de l'autogestion de la douleur et de l’énergie. Permettre la récupération ou la consolidation des capacités liées à la communication, à la nutrition et aux fonctions d’élimination. Favoriser l’autonomie de la personne dans la réalisation de ses activités courantes à domicile, au travailet dans sa communauté. Favoriser l’autonomie et la sécurité de la personne dans ses déplacements. Permettre l’apprentissage de stratégies compensatoires ou l’utilisation optimale d’aides techniques ou technologiques pour compenser les incapacités résiduelles. Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes. Permettre la reprise ou l’exercice des rôles sociaux. Permettre l’intégration ou la réintégration en emploi et le maintien d’une vie active. Soutenir l’intégration sociale par la réalisation des habitudes de vie à domicile, au 80 travail, dans les loisirs et dans la communauté. Assurer le maintien des acquis de la personne dans l’ensemble des domaines de sa vie. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Aide au développement et au maintien des habiletés nécessaires à vivre chez soi de manière autonome et de leur maintien dans le temps Évaluation des capacités, des limitations et des besoins et de leurs impacts sur la qualité de vie. Interventions de réadaptation fonctionnelle intensive en internat (Consulter la fiche « URFI » Interventions visant la récupération ou la consolidation des habiletés liées : o aux capacités motrices, proprioceptives et perceptuelles; o à la nutrition; o aux fonctions d’élimination; o aux activités sexuelles et de reproduction; o aux activités de la vie quotidienne (préparation des repas, entretien du domicile, utilisation sécuritaire de différents équipements, etc.). Interventions visant l’autogestion de la douleur, notamment : o entrainement à des activités adaptées à la condition de santé de la personne; o traitement pharmocologique; o gestion de l’énergie. Interventions visant la diminution et la gestion de la spasticité. Évaluation, recommandation et enseignement de stratégies compensatoires ou d’utilisation d’aides techniques et technologiques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques») facilitant la réalisation sécuritaire des activités courantes à domicile ou dans la communauté. Enseignement des stratégies permettant de prévenir les complications telles les plaies de pression, les problèmes musculo-squelettiques, urinaires, intestinaux et respiratoires. Services d’assistance personnelle aux activités de la vie quotidienne et domestique (consulter la fiche «Services d’aide à domicile»). Enseignement aux proches à l’utilisation optimale de certaines aides techniques ou façons de faire (lève-personne, soins urologiques, etc.). Évaluation des besoins et recommandation d’adaptation du domicile. Évaluation des besoins en lien avec l’accès à un véhicule routier (Consulter la fiche « Services visant l’utilisation sécuritaire d’un véhicule automobile ». Évaluations, recommandations et accompagnement vers un milieu résidentiel autre que le domicile (consulter la fiche «Services résidentiels»). Soutien à l’intégration professionnelle et sociale Évaluation et intervention en vue du retour au travail ou pour développer le potentiel 81 d’employabilité de la personne (consulter la fiche «Réadaptation au travail » Sensibilisation ou formation de l’entourage (familial, professionnel ou social) aux conséquences de l’atteinte médullaire. Formation, sensibilisation, consultation sur la déficience motrice aux différents partenaires (consulter le fiche «Soutien à la collectivité»). Soutien psychosocial et counseling pour la personne et ses proches Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles et l’expression des émotions; o aux relations amoureuses et à la sexualité; o aux rôles parentaux; o à la gestion de l’anxiété. Information, appui et aide à la personne et aux proches, comprenant leur participation à la démarche clinique. Soutien psychologique et accompagnement de la personne et des proches dans le processus d’adaptation à l’atteinte médullaire. Collaborateurs68 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Programme-services de santé physique. Programme-services en dépendances Programme-services en santé mentale. Programme-services SAPA. Centre d’expertise en douleur chronique. Réseau scolaire secondaire régulier, professionnel et post-secondaire. Organismes communautaires afin de favoriser la participation sociale. Municipalités pour les transports et loisirs adaptés ou non. Milieux relatifs à l’emploi, SEMO, SSMO et autres. Assureurs (CSST. SAAQ, IVAC, etc.) Fondations. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Les Centres d’expertise pour blessés médullaires, notamment pour les interventions de 68 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 82 réadaptation fonctionnelle intensive en internat (consulter la fiche «URFI»). : o de l’Est du Québec : CHU de Québec – hôpital de l’Enfant-Jésus et CIUSSS de-laCapitale-Nationale – IRDPQ. o de l’Ouest du Québec : CIUSSS Nord-de-l’île-de-Montréal – hôpital Sacré-Cœurde-Montréal et CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – IRGLM – CR LucieBruneau. Tétraplégie ventilo-assistée traumatique : o Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – IRGLM – CR Lucie-Bruneau a un mandat provincial. o Le programme national pour les personnes ventilo-assistées à domicile est offert par le CUSM. La Clinique Parent-Plus du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Centre de réadaptation Lucie-Bruneau. Consortiums de l’Est de de l’Ouest pour la clientèle ayant une atteinte médullaire. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Guide d'attribution des aides techniques en déficience motrice à l'intention des intervenants AERDPQ, Mars 2005 Continuum de services en traumatologie. INESSS : http://fecst.inesss.qc.ca/fr.html 83 -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE M MO OT TR RIICCEE ATTEINTES NEURO-MUSCULO-SQUELETTIQUES (ADULTES ET AÎNÉS) CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux adultes et ainés présentant une atteinte au niveau des os, des muscles ou du système nerveux périphérique. Celle-ci entraîne, sur le plan moteur ou neurologique, des incapacités significatives et persistantes susceptibles d’affecter la réalisation des habitudes de vie et de restreindre la participation sociale. Les atteintes neuro-musculo-squelettiques peuvent être de naissance ou des suites d’une maladie ou d’un traumatisme. Elles correspondent notamment à une amputation d’origine vasculaire, traumatique ou tumorale, à une blessure orthopédique complexe (fractures multiples, lésions tendineuses, polytraumatisme, etc.), à une atteinte du plexus bracchial et à des maladies neuromusculaires (dytrophies, chrorées, etc.). Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Faciliter l’adaptation de la personne et de ses proches à l’atteinte et aux changements qui peuvent l’affecter. Permettre la récupération et la consolidation optimale des capacités motrices, proprioceptives et perceptuelles de la personne. Favoriser l’atteinte d’une condition physique et physiologique optimale. Soutenir l'apprentissage de l'autogestion de la douleur. Favoriser l’autonomie de la personne dans la réalisation de ses activités courantes à domicile et dans sa communauté. Favoriser l’autonomie et la sécurité de la personne dans ses déplacements. Permettre l’apprentissage de stratégies compensatoires ou l’utilisation optimale d’aides techniques ou technologiques pour compenser les incapacités résiduelles. Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes. Permettre la reprise ou l’exercice des rôles sociaux. Permettre l’intégration ou la réintégration en emploi et le maintien d’une vie active. Soutenir son intégration sociale par la réalisation de ses habitudes de vie à domicile, au travail, dans les loisirs et dans sa communauté. 84 Assurer le maintien des acquis de la personne dans l’ensemble des domaines de sa vie. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Aide au développement et au maintien des habiletés nécessaires à vivre chez soi de manière autonome Évaluation des capacités, des limitations et des besoins et de leurs impacts sur la qualité de vie. Interventions de réadaptation fonctionnelle intensive en internat (consulter la fiche «URFI»). Interventions visant la récupération ou la consolidation des habiletés liées : o aux capacités motrices, proprioceptives et perceptuelles; o à la nutrition; o à la communication orale et écrite; o aux activités de la vie quotidienne et domestique (préparation des repas, entretien du domicile, utilisation sécuritaire de différents équipements, etc.). Interventions visant l’autogestion de la douleur, notamment : o entrainement à des activités adaptées à la condition de santé de la personne; o traitement pharmacologique; o gestion de l’énergie. Évaluation, recommandation et enseignement de stratégies compensatoires ou d’utilisation d’aides techniques et technologiques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques») facilitant la réalisation sécuritaire des activités courantes à domicile ou dans la communauté. Services d’assistance personnelle aux activités de la vie quotidienne et domestique (consulter la fiche «Services d’aide à domicile»). Enseignement aux proches à l’utilisation optimale de certaines aides techniques. Évaluation des besoins et recommandation d’adaptation du domicile. Évaluations, recommandations et accompagnement vers un milieu résidentiel autre que le domicile (consulter la fiche «Services résidentiels»). Évaluation des besoins en lien avec l’accès à un véhicule routier (Consulter la fiche « Services visant l’utilisation sécuritaire d’un véhicule automobile ». Soutien à l’intégration professionnelle et sociale Évaluation et intervention en vue du retour au travail ou pour développer le potentiel d’employabilité de la personne (consulter la fiche « Réadaptation au travail »).»): Sensibilisation ou formation de l’entourage (familial, professionnel ou social) aux conséquences de l’atteinte neuro-musculo-squelettique. Formation, sensibilisation, consultation sur la déficience motrice aux différents partenaires (consulter le fiche «Soutien à la collectivité»). Soutien psychosocial et counseling pour la personne et ses proches 85 Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles et l’expression des émotions; o aux relations amoureuses et à la sexualité; o aux rôles parentaux; o à la gestion de l’anxiété; o à la gestion de la douleur; o à l’adaptation à l’évolution d’une maladie. Information, appui et aide à la personne et aux proches, comprenant leur participation à la démarche clinique. Soutien psychologique et accompagnement de la personne et des proches dans le processus d’adaptation à l’atteinte neuro-musculo-squelettique. Collaborateurs69 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Programme-services de santé physique. Programme-services SAPA; Programme-services en santé mentale; Programme-services en dépendance; Réseau scolaire secondaire régulier, professionnel et post-secondaire. Organismes communautaires afin de favoriser la participation sociale. Municipalités pour les transports et loisirs adaptés. Milieux relatifs à l’emploi, SEMO, SSMO et autres. Assureurs (CSST, SAAQ, IVAC, etc.). Fondations. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Centres d'expertise en douleur chronique. Des établissements sont reconnus pour offrir des services spécialisés pour la fabrication et l’utilisation d’une prothèse du membre supérieur : o CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – IRGLM (pour l’ouest) o CIUSSS de la Capitale-Nationale – IRDPQ (pour l’est) Des établissements sont reconnus pour offrir des services spécialisés pour les victimes d’amputation avec réimplantation d’urgence en collaboration avec le CEVARMU 69 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 86 (CHUM) : o o CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – IRGLM, CIUSSS de la Capitale-Nationale - IRDPQ Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Cadre structurant la programmation des services spécialisés de réadaptation pour les personnes ayant subi une lésion musculo-squelettique ou d’autres blessures graves Partie 1 Partie 1 de 2, AERDPQ, Août 2002 Cadre structurant la programmation des services spécialisés de réadaptation pour les personnes ayant subi une lésion musculo-squelettique ou d’autres blessures graves Partie 2 Partie 2 de 2, AERDPQ, Août 2002 Guide d'attribution des aides techniques en déficience motrice à l'intention des intervenants AERDPQ, Mars 2005 87 -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE M MO OT TR RIICCEE BRÛLURES GRAVES CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux s’adresse aux personnes de tous âges ayant subi des brûlures graves entrainant, sur le plan moteur, tactile et proprioceptif des incapacités significatives et persistantes pouvant entraver la réalisation des habitudes de vie et restreindre la participation sociale. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Améliorer la condition physique de la personne. Permettre la récupération ou la consolidation optimale des capacités motrices, sensorielles et celles liées à la communication Soutenir l’apprentissage de l’autogestion de la douleur Favoriser l’autonomie et la sécurité de la personne dans ses déplacements Faciliter l’adaptation de la personne et de ses proches à sa condition et aux changements qui peuvent l’affecter, notamment en ce qui a trait à son image corporelle. Favoriser son autonomie en utilisant son potentiel au maximum. Permettre l’utilisation des équipements spécialisés ou l’apprentissage de nouvelles façons de faire. Favoriser la réalisation des habitudes de vie à domicile, aux études, au travail, dans les loisirs et dans la communauté. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Développement des capacités et enseignement de stratégies permettant de réduire l’impact des incapacités et l’acquisition d’une autonomie personnelle optimale Évaluation des capacités, des limitations et des besoins et de leurs impacts sur la qualité de vie. Interventions de réadaptation fonctionnelle intensive en internat, le cas échéant (consulter la fiche « URFI ») Interventions visant le développement ou la consolidation des capacités liées : o aux activités motrices, tactiles et proprioceptives; 88 o o à la communication; aux activités de la vie quotidienne. Activités de prévention visant à diminuer les contractures et favoriser la cicatrisation de la peau Interventions visant l’autogestion de la douleur, notamment : o Entraînement à des activités adaptées à la condition de santé de la personne o Traitement pharmacologique o Gestion de l’énergie Évaluation, recommandation et enseignement de stratégies compensatoires ou d’utilisation d’aides techniques et technologiques, notamment les vêtements compressifs (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques») facilitant la réalisation sécuritaire des activités courantes à domicile ou dans la communauté. . Enseignement aux proches à l’utilisation de certaines aides techniques Services d’assistance personnelle aux activités de la vie quotidienne et domestique (consulter la fiche « Services d’aide à domicile ». Soutien à l’intégration scolaire, professionnelle et sociale Évaluation et intervention en vue de la reprise des habitudes de vie reliées aux études, au travail et au loisir (consulter les fiches « Réadaptation au travail » et « Activités socioprofessionnelles et communautaires ») Soutien à l’intégration en milieu de garde, à l’école et en emploi Soutien psychosocial et counseling pour la personne et ses proches Soutien psychologique et accompagnement de la personne et de ses proches dans leur processus d’adaptation à la condition, notamment quant au développement ou la consolidation : o de l’estime et la confiance en soi o de relations interpersonnelles et amoureuses satisfaisantes o de la gestion de l’anxiété Information, appui et aide à la personne et aux proches, comprenant leur participation au continuum de service Collaborateurs70 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Omnipraticiens et médecins spécialistes Organismes communautaires offrant des services de soutien aux personnes victimes de brûlures graves. SAAQ, CSST, IVAC Fondation des pompiers et Fondations d’établissement 70 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 89 Programme-services en santé physique Programme-services en dépendance Programme-services en santé mentale Milieu de garde, réseau scolaire et professionnel Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’est du Québec, notamment pour les interventions de soins de santé, de plastie et de réadaptation fonctionnelle intensive en internat (consulter la fiche «URFI») : Constitué du CHU de Québec – hôpital de l’Enfant-Jésus et du CIUSSS de-la-CapitaleNationale - IRDPQ Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’ouest du Québec, notamment pour les interventions de soins de santé, de plastie et de réadaptation fonctionnelle intensive en internat (consulter la fiche «URFI») : Constitué du CHUM – Hôtel-Dieu-de-Montréal et de l’Hôpital de réadaptation Villa Médica pour les adultes; du CUSM – hôpital de Montréal pour enfants, du CHU SainteJustine et du Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine pour les enfants. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Les centres d’expertise pour clientèles spécifiques http://fecst.inesss.qc.ca/fr/maillons/centres-dexpertise.html 90 en traumatologie : -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE V VIISSU UEELLLLEE DÉFICIENCE VISUELLE ENFANTS ET ADOLESCENTS CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux enfants et aux adolescents, âgés entre 0 et 17* ans, qui présentent, sur le plan de l’acuité visuelle ou du champ de vision des incapacités significatives et persistantes pouvant entraver la réalisation des habitudes de vie et restreindre la participation sociale. Ces personnes peuvent être aveugles ou présenter un problème de basse vision dès la naissance, en raison d’une maladie ou d’un traumatisme. *Ces services peuvent aussi être offerts aux jeunes âgés de 18 à 21 ans qui, suite à l’obtention d’une dérogation, poursuivent des études de niveau primaire ou secondaire jusqu’à l’âge de 21 ans. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Faciliter l’adaptation du jeune et de ses proches à la condition et à la situation engendrée par la déficience visuelle. Maximiser le potentiel visuel du jeune ayant un résidu visuel. Stimuler l’utilisation de stratégies compensatoires. Favoriser son autonomie, en tenant compte de son âge et de ses aptitudes. Favoriser la réalisation des habitudes de vie à domicile, en milieu de garde, à l’école, en emploi étudiant, dans les loisirs et dans sa communauté. Faciliter les apprentissages scolaires. Favoriser la transition de l’école vers la vie active. Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes. Assurer le maintien de ses acquis dans l’ensemble des domaines de sa vie. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Développement des capacités et enseignement de stratégies permettant de réduire l’impact des incapacités et l’acquisition d’une autonomie personnelle optimale 91 Évaluation de la vision fonctionnelle et évaluation de la santé oculaire par le biais d’examens et d’appareils d’optométrie spécialisés. Évaluation des capacités, des limitations et des besoins et de leurs impacts sur la réalisation des habitudes de vie. Développement de l’autonomie face à des responsabilités personnelles ou familiales. Apprentissage quant à l’utilisation des habiletés visuelles résiduelles. Soutien et développement des habiletés relatives à la gestion de l’information et à la communication écrite (utilisation du grossissement de caractères, du braille, de pictogrammes ou de la synthèse vocale). Évaluation et intervention visant la réalisation autonome des activités de la vie quotidienne, selon le groupe d’âge du jeune. Identification des dangers (objets et façons de faire), des facilitants (repères existants dans l’environnement, proximité et l’accessibilité des services, etc.) et incitation à y avoir recours. Conseils relatifs à l’environnement physique dans les milieux résidentiels, communautaires et urbains, recommandations pour assurer la sécurité du milieu de vie et faciliter la réalisation des habitudes de vie (ex. : améliorer les conditions d’éclairage, augmenter les contrastes de couleurs des objets, organiser l’espace utilisé pour une activité, utiliser des repères visuels, tactiles et sonores, etc.). Évaluation, recommandation, conception, fabrication et entrainement aux aides spécialisés adaptées à la personne et à son milieu de vie (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques»). Entrainement à l’utilisation des aides nécessaires aux soins de santé, lorsque pertinent selon l’âge du jeune. Soutien à l’intégration sociale (milieu de garde, scolaire, activités de loisirs, emploi étudiant) et lors de la transition de l’école vers la vie active Enseignement et entraînement des techniques de déplacement (acquisition de l’autonomie et d’une aisance), avec ou sans aides techniques (canne blanche, chienguide, etc.). Entraînement à l’acquisition des notions de sécurité lors des déplacements à l’intérieur et à l’extérieur (domicile, milieu de garde, école, milieu de travail, lieux de loisirs). Sensibilisation ou formation de l’entourage (familial, scolaire ou social) aux conséquences de la déficience visuelle. Évaluation et entrainement visant l’utilisation d’aides technologiques, d’aides informatiques et de logiciels adaptés à domicile, au travail ou à l’école. Évaluation des besoins, recommandation, enseignement et suivi de l’adaptation de l’environnement scolaire ou de travail. Développement des habiletés sociales nécessaires à l’intégration du jeune dans divers environnements (domicile, école et communauté). Soutien à l’intégration dans des activités sportives, de loisir adapté et de loisir en milieu 92 scolaire et dans la communauté (Club sportif, Camp d’été, Camp de jour, etc.). Consultation et planification de la transition de l’école aux activités socioprofessionnelles (projets d’étude et de carrière, emploi étudiant, stage, etc.) (consulter les fiches «Activités socioprofessionnelles et communautaires » et « Réadaptation au travail »). Soutien psychosocial et counseling pour le jeune et ses proches : Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles; o à la gestion de l’anxiété; o l’estime et la confiance en soi. Information, appui et aide au jeune et aux proches, comprenant leur participation au continuum de services. Soutien et accompagnement du jeune et de ses proches dans leur processus d’adaptation à la déficience visuelle : croyances, réactions, etc. Soutien aux familles favorisant notamment le développement des habiletés parentales. Collaborateurs71 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Services en déficience visuelle offerts aux adultes et ainés, particulièrement pour la desserte des adolescents et jeunes adultes. Optométristes en cliniques privées et médecins spécialistes en ophtalmologie Programme-services Jeunes en difficulté Programme-services en DITSA Milieux scolaires, de garde et relatifs à l’emploi. Municipalités pour les transports et loisirs adaptés. Organismes communautaires afin de favoriser la participation sociale. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Dans certains contextes lorsque la déficience visuelle s’accompagne d’une déficience auditive, des services en surdicécité peuvent être requis (consulter la fiche «Surdicécité»). Des établissements ont développé une expertise de pointe relativement à l’enseignement du braille abrégé, à l’évaluation, l’attribution et l’entraînement des aides informatiques sonores, au développement et à l’évaluation des capacités à 71 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 93 conduire un véhicule avec appareil télescopique bioptique. Ces établissements sont l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, du CIUSSS de la CapitaleNationale et l’Institut-Nazareth-et-Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre (consulter la fiche «Services visant l’utilisation sécuritaire d’un véhicule automobile »). Les services d’évaluation préalable à l’admission, puis d’entraînement à la mobilité avec chien-guide dans les classes de chiens-guides organisées par une école de chiens-guides sont des services de nature surspécialisée offerts par l’Institut Nazareth et Louis Braille du CISSS de la Montérégie Centre en collaboration avec la Fondation MIRA. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) La communication informatique- Le rôle des centres de réadaptation pour personnes ayant une déficience visuelle, AERDPQ (2002) Document d’application du Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés en vigueur le 2 juin 2011 Cadre de référence sur les services surspécialisés de réadaptation en déficience physique, MSSS (2007) 94 -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE V VIISSU UEELLLLEE DÉFICIENCE VISUELLE ADULTES ET AINÉS CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux adultes et aux ainés qui présentent, sur le plan de l’acuité visuelle ou du champ de vision, des incapacités significatives et persistantes pouvant entraver la réalisation des habitudes de vie et restreindre la participation sociale. Ces personnes peuvent être aveugles ou présenter un problème de basse vision dès la naissance, en raison d’une maladie, d’un traumatisme ou suite au processus de vieillissement. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Faciliter l’adaptation de la personne et de ses proches à la condition et à la situation engendrée par la déficience visuelle. Maximiser le potentiel visuel de la personne ayant un résidu visuel. Stimuler l’utilisation de stratégies compensatoires. Développer des aptitudes pour permettre à la personne de vivre à domicile. Améliorer et maintenir l’autonomie et la sécurité de la personne, notamment dans ses déplacements à domicile et dans la communauté. Favoriser la réalisation des habitudes de vie à domicile, dans des études postsecondaires, au travail, dans les loisirs et dans sa communauté. Favoriser l’intégration ou le maintien en emploi et le maintien d’une vie active. Assurer le maintien de ses acquis dans l’ensemble des domaines de sa vie. Faciliter l’exercice des rôles sociaux, notamment celui d’être parent. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Développement et maintien des habiletés nécessaires à vivre chez soi de manière autonome Évaluation de la vision fonctionnelle et évaluation de la santé oculaire par le biais d’examens et d’appareils d’optométrie spécialisés. Évaluation des capacités, des limitations et des besoins et de leurs impacts sur la 95 réalisation des habitudes de vie. Apprentissage quant à l’utilisation des habiletés visuelles résiduelles. Soutien et développement des habiletés relatives à la gestion de l’information et à la communication écrite (utilisation du grossissement de caractères, du braille, de pictogrammes ou de la synthèse vocale). Développement des habiletés pour les activités liées à la préparation et la prise de repas, aux tâches domestiques, à la connaissance et l’utilisation des services communautaires tels que les marchés d’alimentation, les institutions financières, etc. Évaluation de l’environnement physique dans les milieux résidentiels, communautaires et urbains, recommandations pour assurer la sécurité du milieu de vie et faciliter la réalisation des habitudes de vie (ex. : identification des dangers et des facilitants, améliorer les conditions d’éclairage, augmenter les contrastes de couleurs des objets, organiser l’espace utilisé pour une activité, utiliser des repères visuels, tactiles et sonores, etc.). Évaluation, recommandation, et entrainement à l’utilisation des aides techniques spécialisés adaptées à la personne et à son milieu de vie (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques»). Services d’assistance personnelle aux activités de la vie quotidienne et domestique (consulter la fiche «Services d’aide à domicile»). Entrainement à l’utilisation des aides nécessaires aux soins de santé. Soutien à l’intégration scolaire, professionnelle et sociale Enseignement et entraînement des techniques de déplacement (acquisition de l’autonomie et d’une aisance), avec ou sans aides techniques (canne blanche, chienguide, etc.). Acquisition des notions de sécurité lors des déplacements à l’intérieur et à l’extérieur (domicile, milieu scolaire, de travail, lieux de loisirs). Évaluation et intervention pour développer le potentiel d’employabilité de la personne et faciliter les apprentissages reliés à l’intégration dans un milieu scolaire postsecondaire, de travail (rémunéré, compétitif ou non) (consulter les fiches «Réadaptation au travail» et « Activités socioprofessionnelles et communautaires »): Recommandation sur les aptitudes et limites en lien avec les impacts de la déficience visuelle pour l’orientation ou la réorientation professionnelle (consulter la fiche « Réadaptation au travail »). En collaboration avec les partenaires, soutien dans le processus de recherche et d’obtention d’un emploi. Adaptation de postes d’étude et de travail ou aménagement de la tâche (outils informatiques, bruit ambiant, ergonomie, etc.). Évaluation et entrainement visant l’utilisation d’aides technologiques, d’aides informatiques et de logiciels adaptés à domicile, au travail ou à l’école. Évaluation des besoins, recommandation, enseignement et suivi de l’adaptation de l’environnement scolaire et de travail. 96 Soutien psychosocial et counseling pour la personne et ses proches Sensibilisation ou formation de l’entourage (familial, professionnel ou social) aux conséquences de la déficience visuelle et stratégies à adopter afin de diminuer les situations de handicap.. Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles; o à la sexualité et aux relations amoureuses; o à la gestion de l’anxiété; o l’estime et la confiance en soi. Information, appui et aide à la personne et aux proches, comprenant leur participation au continuum de services. Soutien psychologique et accompagnement de la personne et des proches dans le processus d’adaptation à la déficience visuelle. Soutien aux familles favorisant notamment le développement des habiletés parentales. Formation, sensibilisation, consultation sur la déficience visuelle aux différents partenaires (consulter le fiche «Soutien à la collectivité»). Collaborateurs72 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Programme-service SAPA dans le cadre des activités de repérage de la déficience visuelle chez les aînés. Optométristes en cliniques privées et médecins spécialistes en ophtalmologie Organismes communautaires afin de favoriser la participation sociale. Municipalités pour les transports et loisirs adaptés. Milieux scolaires post-secondaires Milieux relatifs à l’emploi, SEMO, SSMO et autres. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Des établissements ont développé une expertise de pointe relativement à l’enseignement du braille abrégé, à l’évaluation, l’attribution et l’entraînement des aides informatiques sonores, au développement et à l’évaluation des capacités à conduire un véhicule avec appareil télescopique bioptique. Ces établissements sont l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, du CIUSSS de la CapitaleNationale et l’Institut-Nazareth-et-Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre 72 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 97 (consulter la fiche « Services visant l’utilisation sécuritaire d’un véhicule automobile »). Les services d’évaluation préalable à l’admission, puis d’entraînement à la mobilité avec chien-guide dans les classes de chiens-guides organisées par une école de chiens-guides sont des services de nature surspécialisée offerts par l’Institut Nazareth et Louis Braille du CISSS de la Montérégie Centre en collaboration avec la Fondation MIRA. Dans certains contextes lorsque la déficience visuelle s’accompagne d’une déficience auditive, des services en surdicécité peuvent être requis (consulter la fiche «Surdicécité»). Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Continuum de services pour les aînés présentant une déficience auditive ou visuelle : Responsabilités des acteurs du programme-services en déficience physique (services spécifiques et spécialisés de réadaptation), AERDPQ/AQESSS, (2015) Cadre structurant la programmation des services pour les personnes aînées ayant une déficience visuelle, AERDPQ, Mars 2003 La communication informatique- Le rôle des centres de réadaptation pour personnes ayant une déficience visuelle, AERDPQ (2002) Document d’application du Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés en vigueur le 2 juin 2011 Cadre de référence sur les services surspécialisés de réadaptation en déficience physique, MSSS (2007) 98 D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE A AU UD DIIT TIIV VEE D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE V VIISSU UEELLLLEE SURDICÉCITÉ CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux personnes de tous âges ayant une surdicécité, résultant d’une déficience auditive et visuelle combinées, entraînant des incapacités significatives et persistantes susceptibles d’entraver la réalisation des habitudes de vie et restreindre la participation sociale.. L’une ou l’autre des déficiences, ou les deux, peut être présente depuis la naissance ou être apparue à la suite d’une maladie ou d’un traumatisme. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Faciliter l’adaptation de la personne et de sa famille à la condition et situation engendrée par la surdicécité. Développer le potentiel de la personne et maintenir son autonomie. Favoriser le développement ou la consolidation des habiletés de communication et d’accès à l’information visuelle, sonore et tactile. Favoriser le développement de relations interpersonnelles harmonieuses et satisfaisantes. Favoriser le développement ou le maintien de l’estime de soi et de la confiance en soi. Faciliter les déplacements de façon sécuritaire. Favoriser l’apprentissage des stratégies compensatoires ou l’utilisation d’aides techniques et technologiques. Favoriser la réalisation des habitudes de vie à la maison, en milieu de garde, à l’école ou en emploi, dans les loisirs et dans la communauté. Faciliter les apprentissages scolaires. Faciliter l’exercice des rôles sociaux, notamment celui d’être parent. Assurer le maintien de ses acquis dans l’ensemble des domaines de sa vie. 99 Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Développement des capacités et enseignement de stratégies permettant de réduire l’impact des incapacités et l’acquisition d’une autonomie personnelle optimale Évaluation des capacités sensorielles (visuelles, auditives et tactiles). Interventions visant l’utilisation optimale des capacités visuelles, auditives et tactiles. Intervention visant l’accès à l’informatique adaptée. Enseignement de stratégies compensatoires d’accès à l’information et de communication (langue orale, braille, langue des signes en mode tactile - LSQ73, ASL74, pidgin, signes naturels, etc. -, cartes de communication, tableau, etc.). Enseignement et soutien au développement d’une autonomie dans les déplacements en utilisant ou non une aide technique. Intervention visant le développement et le maintien de l'autonomie de la personne dans la réalisation de ses activités courantes à domicile et dans la communauté (consulter la fiche «Services d’aide à domicile»). Évaluation, recommandation, attribution et entraînement à l’utilisation des aides de suppléance visuelles et auditives ou tout autre aide technique ou technologique (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques»). Services de soutien aux familles (Consulter la fiche « Services de soutien aux familles ») Soutien à l’intégration sociale, scolaire et professionnelle Soutien à l’entourage et interventions dans tous les milieux de vie de la personne (domicile, garderie, école, travail, centre d’hébergement, loisirs, etc.) et rencontre de sensibilisation ou de formation du personnel de ces différents milieux de vie. Recommandations d’adaptation de l’environnement ou aménagement de la tâche. Enseignement de stratégies compensatoires ou d’utilisation d’aides techniques ou technologiques facilitant les apprentissages scolaires ou l’intégration en emploi (rémunéré, compétitif ou non) (consulter les fiches «Activités socioprofessionnelles et communautaires » et « Réadaptation au travail »). Soutien aux démarches d’intégration dans des activités sportives et de loisirs. Soutien à la gestion du programme d’accompagnement et encadrement des accompagnateurs. Soutien psychosocial et counseling pour la personne et ses proches Interventions visant le développement ou la consolidation des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles; o à la sexualité et aux relations amoureuses; o à la gestion de l’anxiété; o l’estime et la confiance en soi. Information, appui et aide aux parents et aux proches, comprenant leur participation à 73 74 Langue des signes Québécoise American sign language 100 la démarche clinique. Soutien psychologique et accompagnement de la personne et des proches dans le processus d’adaptation à la double déficience. Collaborateurs75 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Programme-services Jeunes en difficulté Programme-services SAPA Programme-services DITSA Audioprothésistes, optométristes en cliniques privées, médecins spécialistes en otorhino-laryngologie et en ophtalmologie Milieux de garde scolaires. Organismes communautaires afin de favoriser la participation sociale. Municipalités : repérage des personnes ayant une surdicécité afin d’intervenir dans des contextes d’urgence et d’évacuation. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Plusieurs programmes-services en déficience physique ont développé des services en surdicécité. Ils peuvent compter sur le soutien et l’expertise de deux programmes spécialisés en surdicécité(CIUSSS de la Capitale nationale – IRDPQ, CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal et CISSS de-la-Montérégie-Centre – IRD/INLB). Il est à noter que ces deux établissements ont aussi développé une expertise particulière pour les personnes présentant une surdicécité et porteuses d’un implant cochléaire. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) 75 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 101 R REET TA AR RD D SSIIG GN NIIFFIICCA AT TIIFF D DU UD DÉÉV VEELLO OPPPPEEM MEEN NT T DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux jeunes enfants présentant un retard significatif par rapport au développement des jeunes du même âge. Ce sont des enfants âgés de moins de sept ans qui accusent un retard significatif (deux écarts-types sous la moyenne établi avec un outil normalisé ou son équivalent) par rapport à leur âge chronologique dans au moins deux sphères de leur développement : motricité, cognition, développement socioémotionnel, communication et autonomie. Ce retard entraine des incapacités significatives et persistantes qui compromettent la réalisation des habitudes de vie de l’enfant. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Faciliter l’adaptation de l’enfant et de ses proches à la situation engendrée par le retard significatif de développement. Soutenir l’engagement des parents tout au long du processus d'évaluation diagnostique et d’intervention. Aider l’enfant à développer son potentiel de manière optimale en tenant compte des stades de développement Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes Faciliter son intégration en service de garde, en milieu scolaire et dans les loisirs. Aider à développer au maximum autonomie personnelle et sociale de l’enfant. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Contribution à la précision du diagnostic lorsque requis. Évaluation globale de l’enfant dans les différentes sphères du développement : motricité globale et fine, communication, cognition, développement personnel et social, activités de la vie quotidienne. Interventions auprès de l’enfant pour stimuler son développement dans différentes 102 sphères, avec la participation des proches. Interventions visant `assurer une alimentation adéquate et équilibrée. Évaluation, recommandation et enseignement de stratégies compensatoires ou d'utilisation d'aides techniques et technologiques (consulter la fiche "Attribution d'aides techniques".) facilitant la réalisation sécuritaire des activités courantes à domicile ou dans la communauté. Information, formation et soutien aux proches. Planification de la transition vers le milieu scolaire. Interventions, sensibilisation et formation dans le milieu (à domicile, au service de garde, à l’école et dans la communauté). Recommandations concernant les équipements spécialisés requis. Soutien aux familles favorisant notamment le développement des habiletés parentales et lien avec le retard de l'enfant. Collaborateurs76 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Implication des deux programmes-services DI-TSA-DP. Programme-services Jeunes en difficulté Milieu scolaire et milieux de garde. Omnipraticiens et spécialistes Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Selon les limitations présentées par le jeune, il importe de s'assurer de déployer l'expertise spécialisée dans les différentes sphères de développement touchées Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Guide de pratique L’intervention précoce auprès des enfants de 2 à 5 ans présentant un retard global de développement. Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, 2015 Protecteur du citoyen. Rapport spécial : L’accès, la continuité et la complémentarité des services pour les jeunes (0-18 ans) ayant une déficience intellectuelle ou un trouble 76 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 103 du spectre de l’autisme, mars 2015 Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport. Guide pour soutenir une première transition scolaire de qualité. 2010 104 -- T TR RO OU UB BLLEE D DEE LLA A CCO OM MM MU UN NIICCA AT TIIO ON N SSO OCCIIA ALLEE SERVICES AUX ENFANTS PRÉSENTANT UN TROUBLE DE LA COMMUNICATION SOCIALE À DÉVELOPPER 105 Services dits « transversaux » 106 TOUTES DÉFICIENCES RÉADAPTATION AU TRAVAIL CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux personnes ayant une déficience physique en âge de travailler et qui ont un projet de vie dont les objectifs visent le développement des capacités de travail, l’intégration, la réintégration ou le maintien en emploi77. Les services peuvent aussi s’adresser à des personnes de 16 ans et plus qui sont en processus de scolarisation. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Intégrer réintégrer ou maintenir la personne dans un emploi rémunéré en tenant compte des facteurs personnels et environnementaux. Déterminer le profil (habiletés, compétences, connaissances, intérêts) de la personne en lien avec son objectif d’emploi; Favoriser le développement de l’employabilité de la personne; Développer les habiletés et compétences requises pour occuper un emploi ciblé dans un milieu du travail; Collaborer à l’accomplissement de toutes les étapes menant à l’intégration en emploi (orientation scolaire, recherche d’emploi, intégration et maintien dans un emploi, etc.) Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Évaluation des capacités et limitations de la personne, de leur impact sur une intégration en emploi, et des besoins de la personne, notamment en matière de soutien requis (relatif à un emploi ciblé ou à tout emploi). Détermination du pronostic d’intégration socioprofessionnelle pour les adolescents et jeunes adultes encore aux études et faire le lien avec leur cheminement scolaire. 77 Le terme « emploi » est utilisé dans le sens de l’emploi rémunéré tel que défini par la Loi sur les normes du travail ; l’emploi peut être subventionné ou non par un programme gouvernemental. 107 Détermination du pronostic en relation avec le travail ciblé. Collaboration avec les partenaires pour préparer une réorientation scolaire, le cas échéant. Collaboration avec les partenaires au développement ou à la consolidation d’habiletés préalables à l’emploi (déplacement, gestion d’agenda, gestion du stress, résolution de problèmes, etc.) Développement ou consolidation des habiletés et compétences reliées à un emploi ciblé. Collaboration avec les partenaires pour l’intégration dans un stage en emploi permettant d’évaluer, de développer ou de consolider les habiletés et compétences reliées à un emploi ciblé. Adaptation du poste de travail (recherche, conception, fabrication, recommandations d’aides techniques ou technologiques) ou aménagement des tâches reliées à l’emploi ou à l’environnement de travail (Consulter la fiche « Attribution d’aides techniques ») Collaboration au suivi de la personne dans son milieu de travail et intervention auprès de la personne ou de l’employeur au besoin Sensibilisation et formation aux employeurs et collègues, aux partenaires et aux proches de la personne à l’égard des caractéristiques spécifiques reliées au profil de la personne. Collaborateurs78 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Milieux scolaires pour la transition de l’école à la vie active Employeurs, intervenants du réseau de l’emploi (Centre local d’emploi, services spécialisés de main-d’œuvre (SSMO), services externes de main d’œuvre (SEMO), Organismes communautaires de développement de l’employabilité. SAAQ, CSST, IVAC Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) 78 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 108 -- D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEE M MO OT TR RIICCEE UNITÉ DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE (URFI) CLIENTÈLE : Les services de réadaptation fonctionnelle intensive s’adressent aux personnes de tous âges présentant une déficience motrice pouvant entraîner, sur le plan moteur et neurologique, des incapacités significatives et persistantes à risque d’entraver la réalisation des habitudes de vie et restreindre la participation sociale. Ces services peuvent être offerts dans une unité interne de réadaptation fonctionnelle intensive lorsqu’un retour à domicile après un épisode de soins en centre hospitalier à la suite d’un traumatisme (ex : un traumatisme craniocérébral, une blessure orthopédique grave, une lésion de la moelle épinière, etc.) ou d’une maladie (ex : un Guillain-Barré, un accident vasculaire cérébral, etc.), peut s’avérer impossible pour des raisons médicales, de santé et de sécurité de la personne et de ses proches. Ainsi les services d’une unité de réadaptation fonctionnelle intensive sont une modalité permettant à une personne présentant de telles incapacités, de recevoir, pour une durée limitée dans le temps, des services médicaux et des services de réadaptation simultanément et d’une manière intensive, en étant admise dans un lit dédié à cette fin. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Permettre à la personne de récupérer de façon optimale ses capacités motrices, proprioceptives, perceptuelles et celles liées à la nutrition et aux fonctions d’élimination. Permettre la récupération optimale des capacités liées à la communication et aux activités intellectuelles. Favoriser l’atteinte d’une condition physique et de santé optimale. Permettre l’apprentissage de stratégies compensatoires ou l’utilisation optimale d’aides techniques ou technologiques pour compenser les incapacités résiduelles. Favoriser un retour dans le milieu de vie de la personne de façon sécuritaire. Favoriser l’autonomie et la sécurité de la personne dans ses déplacements et la 109 réalisation de ses activités courantes à domicile. Soutenir la personne et ses proches dans leur adaptation à la nouvelle situation. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Développement et maintien des habiletés nécessaires à vivre chez soi de manière autonome et sécuritaire Évaluation des capacités, des limitations et des besoins et de leurs impacts sur la qualité de vie de la personne. Suivi médical et pharmacologique. Évaluation, suivi et recommandations pour le maintien d’une santé optimale Interventions intensives de réadaptation visant la récupération des habiletés liées : o à la motricité, proprioception et perception; o à la nutrition et à l’élimination; o à la communication orale et écrite; o aux activités intellectuelles; o aux activités de la vie quotidienne (préparation des repas, entretien du domicile, utilisation sécuritaire de différents équipements, etc.). Évaluation, recommandation et enseignement de stratégies compensatoires ou d’utilisation d’aides techniques et technologiques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques») en prévision d’un retour à domicile et de la réalisation sécuritaire des activités courantes. Enseignement de stratégies de gestion de la douleur Préparation du retour à domicile, incluant la planification des services d’aide qui seront requis (consulter la fiche «Services d’aide à domicile»). Enseignement aux proches à l’utilisation de certaines aides techniques (lève-personne, appareil de gavage, etc.). Évaluation des besoins et recommandation d’adaptation du domicile. Évaluations, recommandations et accompagnement vers un milieu résidentiel autre que le domicile (consulter la fiche «Services résidentiels»). Soutien à l’intégration scolaire, professionnelle et sociale Évaluation et intervention pour ajuster certaines activités en vue de préparer un éventuel retour aux études ou au travail (consulter les différentes fiches en Déficience motrice adulte et aînés): Dépistage des conducteurs de véhicules automobiles à risque et identification des démarches à privilégier (consulter la fiche « Services visant l’utilisation sécuritaire d’un véhicule automobile »). Soutien psychosocial et counseling pour la personne et ses proches Interventions visant la récupération des habiletés liées : o aux relations interpersonnelles et l’expression des émotions; 110 o o o o o aux relations amoureuses et à la sexualité; aux rôles parentaux et sociaux; à la gestion du sommeil, de la douleur et de l’anxiété; à la gestion des comportements inappropriés (consulter la fiche «Troubles graves du comportement»); à l’adaptation à la nouvelle condition ou à l’évolution d’une maladie. Information, appui et aide à la personne et aux proches, comprenant leur participation à la démarche clinique. Soutien psychologique et accompagnement de la personne et des proches dans leur processus d’adaptation. Collaborateurs79 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Programme-services en santé physique. Programme-services SAPA. Organismes communautaires. SAAQ, CSST, IVAC Organismes de transport adapté Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine (pour l’ouest du Québec) et IRDPQ du CIUSSS de la Vieille-Capitale (pour l’est du Québec) pour les services de réadaptation fonctionnelle intensive en internat aux enfants et adolescents. Consortiums en traumatologie pour les adultes présentant un traumatisme craniocérébral modéré ou grave. Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’est du Québec, notamment pour les interventions de soins de santé, de plastie et de réadaptation fonctionnelle intensive en internat : o Constitué du CHU de Québec – hôpital de l’Enfant-Jésus et du CIUSSS de-laCapitale-Nationale - IRDPQ Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’ouest du Québec, notamment pour les interventions de soins de santé, de plastie et de réadaptation fonctionnelle intensive en internat : 79 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 111 o Constitué du CHUM – Hôtel-Dieu-de-Montréal et de l’Hôpital de réadaptation Villa Médica pour les adultes; du CUSM – hôpital de Montréal pour enfants, du CHU Sainte-Justine et du Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU SainteJustine pour les enfants. Les Centres d’expertise pour blessés médullaires pour les interventions de réadaptation fonctionnelle intensive en internat. : o de l’Est du Québec : CHU de Québec – hôpital de l’Enfant-Jésus et CIUSSS de-laCapitale-Nationale – IRDPQ. o de l’Ouest du Québec : CIUSSS Nord-de-l’île-de-Montréal – hôpital Sacré-Cœurde-Montréal et CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – IRGLM – CR LucieBruneau. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Cadre de référence sur l’organisation d’une unité de réadaptation fonctionnelle intensive en établissement de réadaptation en déficience physique, AERDPQ, mai 2006 Rapport du comité d'experts sur l'offre de services de réadaptation post-AVC. Trajectoires de services de réadaptation post-AVC : Un continuum centré sur le patient. Mai 2013. Guide d'attribution des aides techniques en déficience motrice à l'intention des intervenants AERDPQ, Mars 2005 Harmonisation des pratiques en centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) pour les personnes ayant de la douleur chronique, AERDPQ, août 2012 112 -- T TO OU UT TEESS D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEESS SERVICES VISANT L’UTILISATION SÉCURITAIRE D’UN VÉHICULE AUTOMOBILE CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux personnes de tous âges, passagers et conducteurs d’un véhicule, présentant une déficience physique entrainant des incapacités significatives et persistantes pouvant entraver l’utilisation d’un véhicule routier de promenade. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Rendre la personne le plus autonome possible à se déplacer ou à être déplacée de façon sécuritaire dans un véhicule adapté à ses besoins. Permettre à la personne d'accéder ou de conduire un véhicule automobile de promenade adapté à ses besoins. Contribuer à assurer la sécurité routière de tous. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Évaluation des équipements d’accessibilité au véhicule routier en tant que passager ou conducteur. Évaluation clinique des aptitudes physiques et cognitives à la conduite automobile pour les conducteurs. Recherche de solutions d’adaptation, essais et recommandations. Entrainement à la conduite sécuritaire et autonome, avec ou sans équipement spécialisé. Développement des capacités et des stratégies compensatoires en prévision de l’obtention d’un permis de conduire, incluant celles reliées au processus pour l’obtention d’un premier permis de conduire. Entrainement à l’embarquement des aides à la mobilité. Suivi de l’adaptation du véhicule. Recommandations et accompagnement en lien avec la cessation de conduire ou le report de l’apprentissage de la conduite automobile. 113 Collaborateurs80 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Les écoles de conduite permettent la réalisation d’évaluations sur route des capacités à conduire et soutiennent l’entraînement à la conduite d’un véhicule. À noter que les coûts pour payer l’école de conduite (moniteur et utilisation du véhicule-école) sont à la charge de la personne. Société de l’Assurance automobile du Québec (SAAQ) Entreprises spécialisées dans les modifications de véhicule et l’installation des adaptations de véhicule. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Des cliniques d’évaluation de la conduite automobile existent dans la majorité des programmes-services en déficience physique des CISSS. Le Centre de réadaptation Constance-Lethbridge du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-deMontréal offre des services surspécialisés à toutes les régions du Québec pour les cas complexes d’adaptation de véhicule relativement à une déficience motrice. L’évaluation et le développement des habiletés compensatoires, avec l’utilisation d’un système télescopique bioptique pour les personnes présentant une déficience visuelle, se font en étroite collaboration avec l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour l’est du Québec et l’Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) du CISSS de-la-Montérégie-Centre pour l’ouest du Québec qui sont reconnus pour leur expertise surspécialisée en la matière. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Programme d’adaptation de véhicule pour les personnes http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personnehandicapee/Pages/adapter-vehicule.aspx Dépliant « Adapter son véhicule c’est possible », Société de l’Assurance automobile du Québec (SAAQ) : http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/victime/adapter_vehicule.pdf Programme cadre d’évaluation et de développement des capacités à conduire et d’adaptations de véhicule routier, AERDPQ, Février 2001 Programme provincial de développement des habiletés compensatoires à conduire avec l’utilisation d’un système télescopique bi-optique. IRDPQ et INLB. (mars 2015) 80 handicapées : Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 114 -- T TO OU UT TEESS D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEESS ATTRIBUTION D’AIDES TECHNIQUES CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux personnes de tous âges présentant une déficience physique entrainant des incapacités significatives et persistantes pouvant entraver la réalisation des habitudes de vie, restreindre la participation sociale et qui peuvent être compensées par une aide technique81. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Compenser les incapacités que peut avoir une personne ayant une déficience physique dans la réalisation de ses principales habitudes de vie telles que les soins personnels, la communication, les activités domestiques, les déplacements, la scolarisation et le travail. Soutenir la personne dans la réalisation de ses principales habitudes de vie afin d'éviter qu'elle se retrouve en situation de handicap dans son environnement domiciliaire, scolaire, professionnel ou communautaire. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) L’évaluation des besoins de la personne, de ses proches et des composantes de l’environnement. La recherche, la conception ou la fabrication d'une aide technique. Les essais de l'aide technique avec la personne. La recommandation de l'aide technique. L'accompagnement de la personne dans les démarches nécessaires à l'octroi ou au financement de l’aide technique. L’installation et l’ajustement de certaines aides techniques, lorsque requis. L’enseignement et l'information à la personne quant aux responsabilités qui lui reviennent. 81 L’aide technique est un équipement simple ou spécialisé, voire dédié à répondre aux besoins des personnes ayant une déficience. Au sens du présent texte, sont incluses à ce grand ensemble les aides dites technologiques, de même que les orthèses et prothèses. 115 L'entraînement à l’utilisation de l'aide technique. Le suivi de l'utilisation de l'aide technique82. L’entretien et la réparation des aides techniques. La récupération, le nettoyage et la remise en état de l'aide technique, en vue d’une réattribution lorsqu'applicable. Collaborateurs83 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Les principaux programmes d'aides techniques sont administrés par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ou par le MSSS. Il s'agit de programmes donnant accès gratuitement, sous forme de prêt84, à des aides compensant les incapacités : Programmes administrés par la RAMQ : Règlement sur les aides auditives et les services afférents assurés : aides à l’audition et aides de suppléance à l’audition; Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés : aides pour lire et écrire, aides à la mobilité, aides pour réaliser les activités de la vie quotidienne et domestique, aides pour l’auto-administration des soins de santé; Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique : aides à la marche, aides à la mobilité, orthèses, prothèses. Programmes administrés par le MSSS : Programme d’attribution des tricycles et vélos adaptés; Programme d’attribution des triporteurs et quadriporteurs; Programme ministériel des aides techniques à la communication; Programme d’attribution des ambulateurs; Programme de remboursement des frais relatifs à l’utilisation d’un chien d’assistance à la motricité; Programme d’attribution de chaussures orthétiques et de l’appareillage de la chaussure; Programme d’aides matérielles pour les fonctions d’élimination; Programme sur les aides à la vie quotidienne et à la vie domestique; Responsables de programmes relevant du domaine de l’éducation Assureurs (CSST, SAAQ, Croix Bleue, IVAC, etc.) qui défraient des aides techniques; Fondations; Fournisseurs de matériaux et d’équipements spécialisés Fondation MIRA qui octroie gracieusement les chiens-guides et chiens d’assistance à la motricité. 82 Dans un esprit de saine gestion des fonds publics, l’intervenant s’assure que l’aide payée par l’État soit utilisée par l’usager. 83 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 84 À l'exception de certains types d'aides comme le matériel pour les fonctions d'élimination ou certains types d‘orthèses et de prothèses. 116 Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Les centres de réadaptation en déficience physique intégrés aux CISSS des différentes régions sont identifiés par la RAMQ comme dispensateurs de services pour l’attribution et la réparation d’aides techniques spécialisées pour les personnes présentant une déficience auditive, motrice ou visuelle. Ils ont entre autres comme responsabilité d’offrir à toutes personnes répondant aux critères d’admissibilité des programmes de la RAMQ, les services requis pour l’obtention des aides selon différentes obligations cliniques, administratives et règlementaires. L’attribution de certaines autres aides techniques est confiée à des établissements mandataires désignés pour répondre aux besoins de l’ensemble de la population québécoise. Il s’agit de : L’attribution des tricycles et vélos adaptés : Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour l’est du Québec et de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal (IRGLM) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour l’ouest du Québec; L’attribution des triporteurs et quadriporteurs : IRDPQ du CIUSSS de la CapitaleNationale pour l’est du Québec et IRGLM du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour l’ouest du Québec; L’attribution des aides à la communication : Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Ste-Justine; L’attribution des ambulateurs : IRDPQ du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour l’est du Québec et IRGLM du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour l’ouest du Québec; Le remboursement des frais relatifs à l’utilisation d’un chien d’assistance à la motricité : IRDPQ du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour l’est du Québec et IRGLM du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour l’ouest du Québec. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Liens hypertexte : http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/loisreglements.aspx http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/groupes/personnes_handicapees/index.php?docu mentation Documentation : Programme d'attribution de chaussures orthétiques et de l’appareillage de la chaussure : Guide de gestion, MSSS (2011) Programme d'attribution des ambulateurs : Guide de gestion, MSSS (2011) Programme d'attribution des tricycles et vélos adaptés : Guide de gestion, MSSS (2011) Programme d'attribution des triporteurs et des quadriporteurs - Guide de gestion, MSSS (2011) 117 Programme de remboursement de frais relatifs à l’utilisation d’un chien d’assistance à la motricité - Guide de gestion, MSSS (2011) Guide d’attribution. Programme ministériel des aides techniques à la communication (PMATCOM). Mars 2006 Le prêt d’une aide visuelle – Principes et orientations, MSSS (2011) Guide d’attribution des aides techniques en déficience motrice à l’intention des intervenants, AERDPQ (2005) Guide d’attribution des aides auditives à l’intention des intervenants, AERDPQ (2000) Document d’application du Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés, AERDPQ (2011) Guide des programmes d’aide pour les personnes handicapées et leur famille, OPHQ (2011) 118 - TOUTES DÉFICIENCES ACTIVITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES ET COMMUNAUTAIRES CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux personnes ayant une déficience physique âgées de plus de 18 ans dont les incapacités limitent significativement la possibilité d’intégrer un emploi, mais qui souhaitent se réaliser par différents types d’activités dans la communauté. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Permettre la participation sociale la plus optimale possible pour la personne, en tenant compte de ses aspirations et de son environnement. Développer et maintenir les capacités de la personne; Maximiser le développement de son autonomie; Faciliter la réalisation des habitudes de vie qui correspondent à celles d’un adulte; Faciliter sa participation sociale dans les milieux qu’elle fréquente en concordance avec son projet de vie. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Exploration des goûts et intérêts de la personne, en particulier de sa motivation à occuper un emploi non rémunéré, une activité dans la communauté, une activité de jour ou de loisir. et ses besoins notamment en matière de soutien. Évaluation des capacités et limitations de la personne à occuper l’une ou l’autre ou plusieurs des activités précédemment citées. Évaluation des habiletés sociales de la personne. Développement ou consolidation des compétences reliées à l’occupation d’une ou plusieurs activités ciblées. Intégration dans l’une ou plusieurs activités en fonction des intérêts, capacités, besoins de la personne et de son niveau de soutien requis. 119 Évaluation, recommandation et enseignement de stratégies compensatoires ou d’utilisation d’aides techniques et technologiques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques») facilitant la réalisation sécuritaire des activités ciblées. Mise en place, pour les personnes présentant des besoins complexes, de programmes et techniques spécialisés avec toute l’intensité requise pour permettre leur participation aux activités ciblées. Sensibilisation et formation des partenaires (organisme communautaire, de loisir, etc.) à l’égard des caractéristiques spécifiques reliées au profil de la personne (consulter la fiche « Soutien à la collectivité ». Services du programme transport-hébergement (Consulter la fiche « Programme transport-hébergement »). Collaborateurs85 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Organismes communautaires, entreprises d’économie sociale, organismes impliqués dans le développement durable sont des partenaires pouvant offrir des possibilités de travail dans la communauté. Intervenants de la communauté (notamment le réseau des loisirs, des clubs sociaux, des organismes culturels et sportifs, etc.), organismes communautaires pour les services d’activités de jour. Municipalités, notamment pour le transport en commun et le transport adapté. Milieux reliés à l’emploi, notamment les services spécialisés de main d’œuvre. Centres d’action bénévole Programme-services DITSA Programme-services jeunes en difficulté Programme-services en santé mentale Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Les activités socioprofessionnelles et communautaires : État de la situation et actions 85 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 120 convenues pour l’amélioration des services. MSSS, 2014 Lignes directrices ministérielles sur les activités de jour pour les personnes ayant une déficience. MSSS, 2015. Document en consultation à l’automne 2015. Cadre de référence sur la réadaptation au travail pour les personnes ayant des incapacités qui découlent d’une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle, AERDPQ (2009). 121 -- T TO OU UT TEESS D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEESS SERVICES RÉSIDENTIELS CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux personnes de tous âges présentant une déficience physique entrainant des incapacités significatives et persistantes pouvant entraver la réalisation des habitudes de vie et restreindre la participation sociale. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Offrir un milieu de vie répondant aux besoins de la personne, tenant compte de la nature et de la complexité de ceux-ci, ainsi que des capacités et incapacités de la personne et de ses choix. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Au plan individuel Évaluation des besoins de la personne. Identification et mise en place de moyens permettant à la personne de demeurer dans son milieu de vie naturel, notamment : o l’attribution d’aides techniques (consulter la fiche «Attribution d’aides techniques»); o l’adaptation et l’aménagement du domicile; o la dispensation de services d’aide à domicile (consulter la fiche «Services d’aide à domicile»), etc. Accompagnement de la personne dans la recherche d’un milieu de vie alternatif qui lui convienne le mieux, en s’assurant qu’il: o soit librement choisi; o soit le plus près possible de sa communauté; o soit le plus simple possible; o réponde à ses besoins. Pairage optimal de la personne avec une ressource et suivi de cette personne dans sa ressource résidentielle. Formation et soutien des personnes-ressources impliquées dans la formule résidentielle retenue. Au plan territorial 122 Planification et développement de milieux résidentiels substituts pouvant s’adapter aux besoins des personnes pour qui ils sont constitués. Maintien d’une organisation de services pouvant s’adapter aux besoins évolutifs d’une personne en matière de services résidentiels : o Ressource de type familial (RTF); o Ressource intermédiaire (RI); o Ressource à assistance continue (RAC). Développement ou contribution au développement de projets novateurs et de formules hybrides. Évaluation des postulants et recrutement des ressources. Formulation de recommandations d’accréditation de ressources au MSSS. Suivi, rétribution et évaluation des services rendus par les ressources. Soutien communautaire en logement social. Collaborateurs86 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Municipalités SHQ Partenaires en logement social Propriétaires de ressources privées Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Afin d’assurer un service de qualité pour répondre aux besoins de certaines personnes comme par exemple celles ayant un trouble grave du comportement, une expertise spécialisée peut être requis afin que soit mise en place un environnement adapté et sécuritaire. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Cadre de référence Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial, MSSS (2014) Site internet relatif aux options résidentielles : http://monchoixmontoit.com/ Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (LRQ. c. S-4.2, r. 3.1) 86 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 123 T TO OU UT TEESS D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEESS TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT (TGC) CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux personnes de tous âges, ayant une déficience physique et présentant ou à risque de présenter des comportements pouvant la mettre potentiellement ou réellement en danger, menacer son intégrité physique ou psychologique, celle d’autrui ou de l’environnement ou encore compromettre sa liberté, son intégration ou ses liens sociaux. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Favoriser l’adaptation de la personne, de ses proches et des personnes faisant partie de son environnement immédiat à sa condition et aux changements qui peuvent l’affecter. Réduire l’occurrence des manifestations et les conséquences du trouble grave de comportement (TGC) de façon satisfaisante pour la personne et ses proches. Contribuer à l’intégration et à la participation sociale de ces personnes. Favoriser la réalisation des habitudes de vie à domicile, en milieu de garde, à l’école, en emploi, dans les loisirs et dans la communauté. Prévenir la manifestation du TGC par des actions en amont sur les causes et l’identification des précurseurs à l’occurrence de comportements inappropriés ou dangereux. Assurer une gestion coordonnée des problématiques liées aux TGC par l’implication de la personne et de ses proches en étroite collaboration avec les intervenants autour d’objectifs communs. Favoriser le développement et le maintien de relations interpersonnelles satisfaisantes. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Déploiement d’activités de prévention (primaire, secondaire et tertiaire) et de dépistage auprès des personnes présentant ou à risque de présenter des TGC. Évaluations et interventions respectant les processus cliniques reconnus (analyse et intervention multimodales (AIMM) ou Approche de collaboration, par exemple). 124 Élaboration d’un plan d’intervention, d’un plan de transition lors de tout changement de ressource ou de service et mise en œuvre des modalités identifiées au plan. Développement de nouvelles habiletés adaptatives essentielles (communication, résolution de problèmes, affirmation de soi, gestion des émotions, etc.). Instauration de routines positives quotidiennes comportementales, fonctions exécutives). Adaptation de l’environnement pour réduire les manifestations des TGC, notamment par une stabilité du personnel et une très grande constance dans les interventions. Soutien dans le développement du potentiel d’employabilité de la personne et dans son intégration dans un milieu de travail (rémunéré, compétitif ou non) (consulter les fiches «Activités socioprofessionnelles et communautaires » et « Réadaptation au travail »). Soutien à l’intégration d’activités sportives et de loisir adaptés dans la communauté. Accompagnement de la personne et de ses proches dans leur processus d’adaptation à la condition: croyances, réactions, etc. Sensibilisation, soutien et formation de l’entourage (familial, scolaire ou social) aux conséquences des TGC. Formation, sensibilisation, consultation sur les troubles graves de comportement aux différents partenaires (consulter le fiche «Soutien à la collectivité»). (communication, cognitives, Collaborateurs87 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Programme-services en santé physique Programme-services DITSA Programme-services en santé mentale Programme-services en dépendances Programme-services Jeunes en difficulté Ressources d’hébergement spécialisées pour accueillir les personnes ayant un TGC Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Formation Équilibre en situation de TGC - Des stratégies pour s’occuper de soi... et de l’autre développée pour les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. 87 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 125 Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Guide de pratique - Le service d’adaptation et de réadaptation auprès des personnes ayant des troubles graves du comportement (TGC)(2010) Fédération des CRDITED du Québec. Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. Labbé, L., Choquette P. et Turgeon, M.‐J. (2014). Prévention des troubles du comportement et des troubles graves du comportement – Cadre de référence. Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. Pour l’approche de collaboration : Ylvisaker, M., Jacobs, H., & Feeney, T. (2003). Positive Supports for People Who Experience Behavioral and Cognitive Disability after Brain Injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 18, 7-32. 126 -- T TO OU UT TEESS D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEESS SOUTIEN À LA COLLECTIVITÉ CLIENTÈLE : Toute personne présentant une déficience physique peut bénéficier de la mise en place d’activités de soutien à la collectivité. Ces activités, en mobilisant les partenaires de la société civile, encouragent l’intégration sociale de l’ensemble des personnes, enfants, adolescents, adultes et aînés, ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Les groupes cibles de la société civile auxquels s’adressent les activités de soutien à la collectivité sont, notamment : le réseau de la santé et des services sociaux ou les organismes gouvernementaux, paragouvernementaux reliés à un autre ministère ; les milieux de garde et le réseau de l’éducation; les organismes communautaires; les municipalités (activités de loisirs, culturelles, sportives, sécurité civile, etc.) ; le milieu de l’emploi. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Favoriser l’inclusion des personnes présentant une déficience physique (auditive, du langage, motrice ou visuelle) en soutenant les partenaires dans l’exercice de leur mandat spécifique. Permettre l’identification des obstacles ou facilitateurs environnementaux de nature sociale (compris dans les systèmes politiques, économiques, sociaux et culturels) et physique (les éléments naturels et artificiels de l’environnement). Favoriser la mobilisation et l’action des partenaires vers la création des facilitateurs ou l’élimination des obstacles systémiques communautaire ou sociétal à la participation sociale des personnes présentant une déficience physique. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Activités de soutien-conseil ou de sensibilisation/formation aux groupes cibles pour permettre l’amélioration de leurs connaissances des caractéristiques, capacités et besoins des personnes présentant une déficience physique. 127 Activités contribuant à promouvoir ou améliorer l’accessibilité universelle des lieux publics ou des différentes plateformes de communication. Activités contribuant au développement ou à l’ajustement d’une offre de services, chez les groupes cibles, adaptés aux réalités des personnes présentant une déficience physique. Collaborateurs88 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Partenaires du réseau de la santé et services sociaux Organismes communautaires Partenaires de l’intersectoriel : éducation, municipal, emploi, transport Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Ces services sont dispensés par une diversité d’intervenants ayant une expertise spécialisée en déficience physique leur permettant de sensibiliser, soutenir, former et accompagner le réseau de la santé et des services sociaux et ses partenaires de l’intersectoriel en mettant à leur disponibilité l’expertise développée par le programmeservices en déficience physique. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Cadre de référence sur les activités de soutien à la collectivité, AERDPQ (2014) 88 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 128 -- T TO OU UT TEESS D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEESS PROGRAMME TRANSPORT-HÉBERGEMENT À DÉVELOPPER 129 -- T TO OU UT TEESS D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEESS SERVICES D’AIDE À DOMICILE CLIENTÈLE : Ces services s’adressent aux personnes de tous âges présentant une déficience physique entrainant des incapacités significatives et persistantes pouvant entraver la réalisation des habitudes de vie et restreindre la participation sociale. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Soutenir la personne dans la réalisation d’activités à domicile afin d’assurer le maintien dans son milieu de vie naturel. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Selon les évaluations réalisées au début du cheminement de la personne (voir fiche «Évaluation globale des besoins») ou celles réalisées au cours de son cheminement clinique, des activités d’aide à domicile peuvent répondre aux besoins identifiés et pourront prendre la forme de : o supervision; o stimulation; o assistance; o aide complète. Les services d’assistance personnelle comprennent les soins à la personne dans ses activités de la vie quotidienne (AVQ) tels que les soins d’hygiène, l’aide à l’alimentation, de même que la mobilisation, les transferts, la gestion de la médication, etc. Les services d’aide domestique comprennent l’entretien ménager, la préparation de repas, l’approvisionnement et autres courses, l’entretien des vêtements, la lessive, et toutes autres activités de la vie domestique (AVD). Les activités de soutien civique comprennent l’aide pour administrer le budget, remplir des formulaires divers, etc. 130 Collaborateurs89 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Selon les besoins, le choix de la personne et les modalités d’organisation qui prévalent, ces services peuvent être offerts par l’établissement ou encore : o o o o les entreprises d’économie sociale; les organismes communautaires; les groupes bénévoles; l’employé de l’usager rémunéré par l’allocation directe (chèque emploi service). Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Le CISSS doit mobiliser les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) et établir des ententes de services avec ceux-ci afin d’assurer la disponibilité, la variété et la qualité des services requis. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Chez soi : le premier choix, Politique de soutien à domicile, MSSS (2003) Cadre de référence sur l’allocation directe. MSSS (1996) Lignes directrices du soutien à l’autonomie, MSSS (parution à venir) 89 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 131 T TO OU UT TEESS D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEESS SERVICES DE SOUTIEN AUX FAMILLES CLIENTÈLE : Ce programme s’adresse aux familles et aux proches de toute personne admissible au programme-services. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Permettre aux membres de la famille et aux proches : o de s’adapter comme système familial à la réalité de vivre avec une personne ayant une déficience physique o d’assumer leurs différentes responsabilités o de compenser le stress et la fatigue supplémentaire occasionnés par les besoins particuliers d’un enfant ou d’un adulte ayant une déficience physique o de faire face à des situations imprévisibles ou urgentes o d’être soutenus dans leurs activités quotidiennes, lorsqu’ils prennent soin d’une personne ayant une déficience physique. Prévenir l’épuisement du réseau de soutien de la personne ayant une déficience physique Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Interventions de soutien psychosocial ou d’entraide permettent à chaque membre de la famille et aux proches de s’ajuster à leur réalité, de s’adapter aux caractéristiques des incapacités et de maintenir une vie familiale harmonieuse et cela à différentes étapes : annonce du diagnostic, adaptation à la réalité quotidienne familiale, situations de transition (entrée à l’école, passage au secondaire, fin de la scolarisation, etc.) Information sur la déficience physique, sur le potentiel de la personne et ses incapacités; Formation et soutien au développement des habiletés parentales visant à soutenir le développement optimal des capacités de la personne et de son autonomie, o Gamme de services aux familles et aux proches et programme d’allocation financière de soutien aux familles (gardiennage, répit, dépannage, appui aux tâches quotidiennes) : 132 o o o o o o Le gardiennage (dans le cas d’un enfant) ou La « présence-surveillance » (dans le cas d’un adolescent ou d’un adulte) : activité de garde lorsqu’un proche doit s’absenter de son domicile, sur une base occasionnelle ou régulière, pour réaliser divers activités de la vie courante. Ces activités peuvent se dérouler au domicile ou à l’extérieur de celui-ci. Le répit : activité de garde/prise en charge lorsqu’un proche doit s’absenter pour un moment de détente en l’absence de la personne ayant une déficience. Ces activités peuvent se dérouler au domicile ou à l’extérieur de celui-ci. Le dépannage : activité de garde/prise en charge généralement temporaire et de courte durée (quelques jours) survenant à la suite d’un événement imprévisible. Même si ces activités surviennent à la suite d’un événement imprévisible, les proches doivent savoir où et à qui s’adresser lorsque requis afin de diminuer leurs inquiétudes. L’appui aux tâches quotidiennes : activité de soutien à l’organisation matérielle, de soin des enfants, d’aide aux devoirs, etc. L’information et la référence aux autres ressources : activité permettant de connaitre les organismes offrant des services d'accompagnement, de gardiennage, de visites d’amitié, de répit, etc., de même que les programmes et services d’autres secteurs pouvant les soutenir (service de garde, crédits d’impôt, etc.) Collaborateurs90 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Une gamme variée de chaque type de services doit être rendue disponible sur le territoire Ces activités peuvent être offertes par : o Un hébergement temporaire dans un établissement ou une RI-RTF o Les organismes communautaires : maisons de répit, des camps de séjour ou des camps de jour, des banques de gardiennage y compris des banques de gardiennage spécialisé qui impliquent des étudiants de niveau collégial ou universitaire d’un programme d’études afférent à la spécialisation requise, etc. o Les entreprises d’économie sociale o Les groupes bénévoles. o Le personnel embauché de gré à gré par l’allocation directe. L’établissement a la responsabilité de prévoir et d’organiser les mesures et les types de ressources les plus appropriées pour répondre aux besoins des personnes et des proches des personnes qu’il dessert. Il se doit de mobiliser les partenaires du RTS et établir des ententes de services avec ceux-ci afin d’assurer la disponibilité, la variété et la qualité des services requis. 90 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 133 Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Afin d’assurer un service de qualité pour répondre aux besoins de certaines personnes dont celles ayant un trouble grave du comportement, une condition physique particulière ou des besoins plus complexes de soins de santé, une expertise spécialisée ainsi qu’un environnement adapté et sécuritaire peuvent être requis pour permettre la participation de la personne aux services de répit ou de gardiennage. Pour ce faire, des mesures d’adaptation des services sont identifiées et proposées. Ces services peuvent être offerts dans une ressource résidentielle gérée par l’établissement ou par le soutien spécialisé à des organismes communautaires offrant des activités de répit ou de gardiennage. Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) 134 Modalités de coordination 135 T TO OU UT TEESS D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEESS ÉVALUATION GLOBALE DES BESOINS CLIENTÈLE : Ce service s’adresse aux personnes de tous âges présentant une déficience physique entrainant ou susceptible d’entrainer des incapacités significatives et persistantes ayant un impact sur une ou plusieurs de leurs habitudes de vie. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Évaluer l’ensemble des besoins de la personne et de ses proches. Planifier et organiser les services appropriés à une réponse adaptée aux besoins de la personne et de ses proches. Outiller la personne et ses proches pour qu’elles participent activement à la réalisation du plan d’intervention. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Analyse des besoins et de la demande de services en tenant compte des évaluations antérieures. Utilisation d’outils validés, reconnus et communs aux différentes étapes du continuum. Établissement d’un bilan de santé. Évaluation des capacités, des incapacités, des facteurs environnementaux facilitateurs ou obstacles et leurs impacts sur la réalisation des habitudes de vie. Identification des services requis en fonction de la complexité des besoins, de la motivation et du choix de la personne ou de ses proches : o type de services; o type de professionnels impliqués; o intensité; o modalités; o fournisseurs, etc. Expression du projet de vie de la personne. Évaluation des besoins des proches. Identification d’un intervenant pivot qui coordonnera les services. Information à la personne et ses proches sur les sujets suivants : 136 o rôle et fonctionnement de l’établissement, du programme-service et de l’équipe; o domaines d’intervention; o programmes disponibles; o limites de la desserte pouvant être attendue; o rôle des partenaires pouvant être interpellés. Identification des collaborations nécessaires avec d’autres acteurs des programmes de l’établissement, d’autres établissements ou d’autres réseaux de services. Références aux ressources du milieu. Collaborateurs91 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) L’évaluation globale des besoins commande la collaboration de l’ensemble des expertises requises et s’effectue dans une perspective interdisciplinaire. Ainsi, les professionnels des services spécifiques, des services spécialisés et des autres programmes-services peuvent contribuer à l’évaluation globale des besoins lorsqu’il est estimé que leur contribution respective est requise. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Circulaire 2003-021, MSSS Comité aviseur sur l’adoption d’un outil d’évaluation intégré des besoins des personnes en perte d’autonomie et de détermination des services requis, notamment en institution ou à domicile, MSSS (2000) 91 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 137 -- T TO OU UT TEESS D DÉÉFFIICCIIEEN NCCEESS INTERVENANT PIVOT – INTERVENANT PIVOT-RÉSEAU92 CLIENTÈLE : Cette modalité s’adresse aux personnes de tous âges présentant une déficience physique entrainant des incapacités significatives et persistantes pouvant entraver la réalisation des habitudes de vie et restreindre la participation sociale. Objectifs: (Répond au « pourquoi » des interventions tout au long du processus, de l’adaptation-réadaptation jusqu’au maintien des acquis) Assurer la planification, coordination, la continuité et l’intégration des services. Soutenir la personne et ses proches dans le processus d’obtention des services. Activités : (Définit le « quoi? », les principales actions de l’équipe interdisciplinaire afin de répondre aux besoins de la personne) Accompagnement de la personne et ses proches dans le processus d’obtention des services. Obtention de la participation active de la personne, en tenant compte de ses capacités, de ses besoins, de ses préférences et de ses choix. Soutien de la recherche d’alternatives en cas de non-disponibilité des ressources appropriées. Maintien d’un contact avec tous les intervenants et les partenaires impliqués. Animation au besoin des rencontres entre les partenaires impliqués auprès de la personne. Transmission des informations pertinentes entre la personne, les proches et les partenaires. Supervision des échanges de renseignements requis pour la continuité des services en temps opportun. Supervision de l’élaboration, de l’application et de la révision du PII ou du PSI : o Complémentarité des services mis en place; L’intervenant pivot (IP) se distingue de l’intervenant pivot-réseau (IPR) par la coordination des services qui s’effectue au sein de l’établissement (IP) ou avec d’autres établissements ou partenaires (IPR). Il coordonne ainsi le PII (IP) ou le PSI (IPR). 92 138 o Cadence appropriée pour la dispensation des services; o Cohérence des interventions de chaque intervenant et partenaire impliqués. Participation, lorsque cela est requis, à la coordination des interventions entre divers secteurs : o Réseau de la santé et des services sociaux; o Milieux communautaires; o Transport; o Emploi; o Éducation; o Services de garde à l’enfance, etc. Collaborateurs93 : (Précise le « avec qui? », décrit les zones « intersectorielles » les plus fréquentes ou les plus susceptibles d’être impliquées pour assurer une desserte optimale) Tous les prestataires de services. Au-delà des responsabilités de l'intervenant pivot, celui-ci n'est pas responsable du volet touchant les interventions spécifiques de chaque professionnel. Ceux-ci demeurent responsables de leurs plans d'intervention, élaborés conformément aux normes de leur ordre professionnel. Toutefois, l’intervenant pivot discute avec le professionnel concerné de la révision du PI, si ce dernier va à l’encontre des objectifs convenus dans le PII ou le PSI. Expertise : (Détermine le « Considérant quoi? », en l’occurrence les conventions établies permettant d’assurer et de soutenir l’expertise nécessaire soient les centres d’expertise reconnus, les établissements ou groupes d’établissements mandatés pour une desserte surspécialisée, les trajectoires de services convenues, les consortiums formalisés, etc.) Maîtriser le PPH, l’approche écosystémique, collaboration interdisciplinaire. Maîtriser le processus d’élaboration et d’animation du PII et du PSI. Connaitre les ressources locales et régionales, de même que les processus d’accès à celles-ci. Connaître et respecter la spécificité des autres établissements du réseau de la santé ou de l’intersectoriel, des autres programme-services et des professionnels impliqués. Avoir une connaissance des clientèles et de leurs besoins. l’approche usager-partenaire et la Références : (Soutient l’organisation du « Comment » par le partage de connaissances les plus contemporaines rendues disponibles par des organisations reconnues) Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience, MSSS, (2008) Fiche descriptive : cahier d’accompagnement du Plan d’accès, Forum Web (2015) 93 Cette énumération est non exhaustive, il importe qu’en présence de co-morbidité que des ponts soient faits avec les différents partenaires pouvant soutenir la réponse au client 139 140