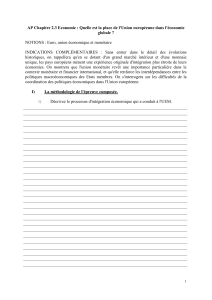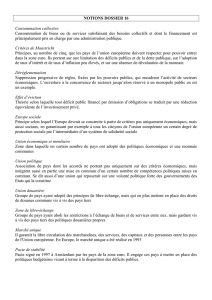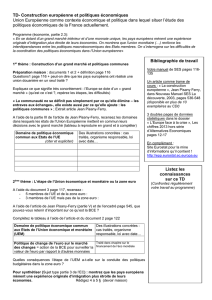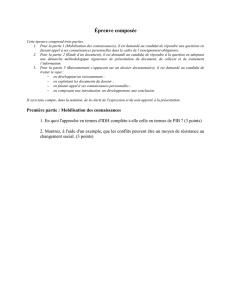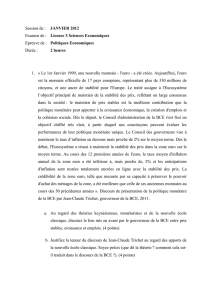Page 1. Chapitre 10 L`UNION EUROPÉENNE : UNE EXPÉRIENCE

Page 1.
Chapitre 10
L’UNION EUROPÉENNE : UNE EXPÉRIENCE
ÉCONOMIQUE ORIGINALE
Introduction. Rappels historiques et géographiques
L’Union européenne comporte 27 Etats (bientôt 28 avec la Croatie). C’est une zone d’intégration économique, c’est-
à-dire un espace géographique dans lequel des pays au départ totalement distincts fusionnent peu à peu leurs économies.
L’U.E. a aujourd’hui un poids important dans l’économie mondiale : avec plus de 500 millions d’habitants, elle
produit collectivement le ¼ du PIB mondial. C’est une zone géographique où le niveau de développement est très
élevé : tous les pays de l’U.E. ont au minimum un I.D.H égal à 0,8. En 2011, elle a réalisé près du tiers des exportations
mondiales de biens et services et aussi près du tiers des IDE. Ainsi, la taille de la population de l’U.E. lui donne une
place importante dans l’économie mondiale, d’autant que son poids économique est beaucoup plus élevé que son poids
démographique.
L’aventure « européenne », entamée avec la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier en 1950, puis
approfondie avec le Traité de Rome en 1957, est souvent l’objet de critiques. L’U.E. fonctionnerait mal, les
« Européens » auraient du mal à s’entendre… Mais les critiques oublient souvent qu’il s’agit là d’une aventure
novatrice et unique à ce degré d’approfondissement. Il est donc normal que l’Union Européenne connaisse des revers,
des difficultés.
On sait que les fondateurs de l’U.E. ont voulu rendre l’Europe plus pacifique en faisant collaborer les Européens
autour d’objectifs concrets, notamment économiques. Cet objectif semble avoir bien réussi, et c’est la raison pour
laquelle le Prix Nobel de la Paix a été attribué à l’Union Européenne en 2012. Mais on connaît souvent moins bien les
avantages que peuvent apporter aux Européens le Grand Marché Intérieur et l’Union Economique et Monétaire. Dans ce
chapitre, nous présenterons ces atouts de l’U.E. puis nous montrerons les difficultés que la construction européenne
pose parallèlement sur le plan économique.
A. L’intégration des économies européennes et ses avantages dans le contexte monétaire et
financier international
1. Le grand marché intérieur
L’une des premières étapes de la construction européenne a consisté, dès les débuts de l’Union, à construire une
zone de libre-échange spécifique. Comment a-t-on fait cela et quel était l’intérêt de cette démarche ?
a. Une zone de libre-échange spécifique
Dès 1957, les six premiers Etats-membres de l’ancêtre de l’Union Européenne (France, Italie, Allemagne, Benelux), ont
décidé de créer un Marché Commun. Cela a consisté à…
- supprimer les barrières douanières entre eux pour de nombreux produits ;
- parallèlement à instaurer un « tarif extérieur commun », c’est-à-dire des droits de douanes identiques par rapport
aux pays situés hors de la zone ;
Ce système a été approfondi par l’Acte Unique de 1986, qui a conduit à la mise en œuvre du Marché Unique en
1993. Désormais, pour tous les biens (c’est plus compliqué pour les services), il y a une circulation parfaitement libre
des produits entre les Etats-membres, sans droit de douanes ni protectionnisme non-tarifaire. Les capitaux circulent
aussi librement.
b. Les avantages du marché intérieur
Ce choix de libéraliser les échanges entre pays de la zone (faire du libre-échange plutôt que du protectionnisme dans
la zone, mais continuer à faire un peu de protectionnisme par rapport à l’extérieur de la zone) avait trois grands
objectifs :

Page 2.
- un objectif politique : rendre les Etats européens dépendant les uns des autres et supprimer les affrontements
protectionnistes pour, à terme, éviter les guerres ;
- deux objectifs économiques : (1) bénéficier de tous les avantages du libre-échange (déjà étudiés dans le chapitre 8
– à réutiliser ici), c’est-à-dire tirer parti des avantages comparatifs et des bienfaits de la concurrence entre les pays ;
(2) donner aux pays de la zone un poids dans les négociations économiques internationales : seuls face aux géants
américains, russes ou japonais, et bientôt chinois, brésiliens, indiens, les pays européens risquaient de n’avoir pas grand
poids dans les négociations commerciales ; réunis, ils devenaient plus forts (pour s’opposer à un protectionnisme
américain par exemple).
2. L’Union économique et monétaire
a. Une monnaie unique et une banque centrale commune
Les six premiers pays-membres, progressivement rejoints par d’autres, ont ensuite décidé d’instaurer une Union
Economique et Monétaire. Ce fut chose faite à partir de 2002, lorsque les premières pièces et billets en euros ont
commencé à circuler, mais la procédure avait commencé dès les Traités de Maastricht en 1992 et d’Amsterdam en 1997
(qui lancent l’UEM et fixent les conditions d’adhésion à la Zone Euro, zone privilégiée de l’UEM)
En 2002, la Zone Euro comportait douze pays (dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, mais ni la Suisse ni
le Royaume-Uni encore aujourd’hui) ; elle en comporte dix-sept aujourd’hui (dernier entrant l’Estonie en 2011). En
quoi y a-t-il union monétaire ? La réponse tient en deux idées.
Premièrement, il n’y a qu’une seule monnaie pour ces dix-sept pays : l’euro En 2002, l’euro a remplacé le franc
français, le mark allemand, la lire italienne, la peseta espagnole ou le florin néerlandais… Cette monnaie est émise par
la Banque Centrale Européenne (BCE), installée à Francfort, qui dirige désormais toutes les banques centrales
nationales
Deuxièmement, la politique monétaire n’est plus décidée par chacun des Etats de la zone, mais par la BCE : c’est le
conseil des gouverneurs de la BCE qui en a le monopole. C’est elle qui décide, en toute indépendance, s’il faut baisser
les taux d’intérêt pour relancer la croissance (mais accélérer l’inflation) ou les augmenter (pour freiner l’inflation mais
ralentir la croissance). Pour cela, elle fait baisser ou augmenter son « taux directeur », celui auquel elle prête de l’argent
aux banques commerciales. Dans les Traités européens, la BCE a pour mission de maintenir l’inflation en-dessous de
2 % par an.
L’union monétaire devient Union économique et monétaire si en plus les Etats de la zone tentent de coordonner
leurs autres politiques (politiques budgétaires, politiques structurelles), ce qui es désormais le cas au moins en partie.
b. Les avantages de l’Euro
Pourquoi passer à l’Euro ? Pour plusieurs raisons très utiles mais que l’on a tendance à oublier durant les périodes
de crise. S’il y a une seule monnaie et non plusieurs, cela permet entre autres…
1 – De mieux comparer les prix dans la zone, ce qui favorise la concurrence. Les entreprises et les consommateurs
peuvent mieux comparer les prix entre les différentes entreprises dans la zone, et cela rend la concurrence plus vive –
condition du bon fonctionnement de l’économie de marché.
2 – D’éviter des coûts liés au change entre devises. Autrefois, une entreprise qui achetait des produits dans un autre
pays de la zone devait souvent acheter de la monnaie de ce pays, et pour cela payait des commissions de change (des
frais à verser aux banquiers). En outre, en système de change plus ou moins flexible, il était fréquent que le taux de
change évolue, et donc les entreprises ne savaient jamais vraiment combien elles allaient payer leurs importations de
matières premières étrangères ou combien elles allaient gagner grâce à la vente de leurs exportations. Cela rendait les
échanges extérieurs plus instables, moins intéressants, et donc limitait les avantages du libre-échange. Ces problèmes
sont supprimés avec une seule monnaie.
3 – D’empêcher certaines formes de spéculations. En effet, beaucoup de financiers du monde entier spéculaient sur
le cours des différentes devises européennes, notamment quand un pays connaissait des difficultés et que le taux de
change de sa monnaie baissait. La lire italienne, par exemple, a connu des moments de baisse, les riches particuliers ou
les institutions financières se mettaient alors à les vendre en grande quantité de peur que son cours ne baisse encore,
tandis que d’autres les vendait en espérant les acheter plus tard à prix plus bas pour les revendre peu après un peu plus
cher. Cette spéculation plaçait l’Italie en difficulté, car même si ses produits devenaient plus attractifs pour le reste du
monde, elle avait du mal à importer car personne ne voulait de sa monnaie et lorsqu’elle la changeait, cela lui coûtait de

Page 3.
plus en plus cher car le cours de la lire baissait de jour en jour. Cela déstabilisait l’économie italienne (d’autres pays
européens ont également connu ce genre de difficultés). Lorsqu’il n’y a qu’une seule monnaie, ce type de spéculation
nuisible disparaît.
Tous ces avantages ont été profitables aux pays de la Zone Euro, on l’oublie trop souvent. Dans un contexte
monétaire et financier international où les changes sont flexibles et créent de l’incertitude pour les entreprises, où les
capitaux circulent à toutes vitesses d’un bout à l’autre de la planète pour rechercher les meilleurs taux d’intérêt, la zone
Euro a été un élément de stabilisation des activités économiques. Elément important puisque, rappelons-le, la plupart
des échanges commerciaux et financiers des pays européens se déroulent avec d’autres pays européens (on parle
d’échanges intra-communautaires) : un peu moins de 60 % des exportations et des importations françaises, par exemple,
vont dans l’Union européenne ou en sont issues.
Ceci étant dit, faire collaborer de nombreuses économies ensemble n’est pas chose aisée, et à côté des avantages
indéniables du marché intérieur et de l’union économique et monétaire, des problèmes, nombreux, sont aujourd’hui
posés aux dirigeants européens.
B. Des problèmes d’interdépendance et de coordination
Pendre des décisions collectives est en effet toujours difficile lorsque les intérêts des uns et des autres ne coïncident
pas forcément. Chaque pays de l’Union européenne à 27 ou de la Zone Euro à 17 a ses traditions politiques, ses valeurs,
ses caractéristiques économiques, et les dirigeants des 27 réunis dans le Conseil européen pour impulser les grandes
décisions européennes tentent d’imposer aux autres leurs points de vue car ils ont des comptes à rendre à leur
population – s’ils veulent être réélus. La Commission européenne, chargée de rédiger les lois sous la direction du
Conseil européen, est plus indépendante, mais elle ne peut travailler correctement que si la direction est claire.
Comment, dans ce contexte, prendre de bonnes décisions économiques ?
1. De nouveaux modes de décision utiles mais difficiles à mettre en œuvre
a. Une répartition des compétences Etats/Union européenne
La première chose importante consiste à savoir qui fait quoi dans l’Union européenne. Une des règles importantes
de l’Union, réaffirmée dans le traité de Lisbonne en 2005, consiste à partager les compétences entre les États et l’Union.
On distingue (d’après le site institutionnel Europa) :
- Les compétences exclusives de l’UE : l’UE est la seule à pouvoir légiférer et adopter des actes contraignants dans
ces domaines. Le rôle des États membres se limite donc seulement à appliquer ces actes, sauf si l’Union les autorise à
adopter eux-mêmes certains actes. Exemples : la politique monétaire ou la politique douanière.
- Les compétences partagées : l’UE et les États membres sont habilités à adopter des actes contraignants dans ces
domaines. Cependant, les États membres ne peuvent exercer leur compétence que dans la mesure où l’UE a décidé de
ne pas exercer la sienne. Exemples : l’environnement ou les transports.
- Les compétences d’appui (ou encore compétences « exclusives » des Etats) : l’UE ne peut intervenir que pour
soutenir, coordonner ou compléter l’action des États membres. Elle ne dispose donc pas de pouvoir législatif dans ces
domaines et ne peut pas interférer dans l’exercice de ces compétences réservées aux États membres. Exemples : la
culture ou le tourisme.
A ce partage s’ajoute le principe de subsidiarité : dans le domaine des compétences partagées, l’UE ne doit
intervenir que si les Etats, à leur niveau, ne parviennent pas à régler seuls les problèmes (soit par négligence, soit par
manque de moyens, soit parce que le problème est par nature un problème international – par exemple sur la pollution
atmosphérique).
b. Des politiques qui peuvent être mieux coordonnées…
Grâce au nouveau cadre européen, les pays-membres ont désormais l’habitude de travailler ensemble, de se
coordonner, de tenir compte les uns des autres. Ils peuvent peser d’un poids commun dans les décisions internationales,
ou mettre en commun leurs moyens financiers pour lancer des projets qui ne pourraient raisonnablement être financés
par un seul Etat.

Page 4.
Cela peut être le cas en matière industrielle ou de recherche (exemple de l’Agence Spatiale Européenne, créateur des
fusées Ariane, qui est un organisme financé conjointement par vingt Etats européens).
Cela peut être aussi le cas en matière de lutte contre les crises conjoncturelles : pour lutter contre la Crise de la Dette
partie de Grèce puis qui a gagné l’Espagne, le Portugal ou l’Irlande, et qui risque de se poursuivre, les membres de la
zone Euro se sont entendus pour créer un Mécanisme Européen de Stabilité (MES), basé sur un Fonds Européen de
Stabilité Financière (FESF) : si un pays de la zone Euro ne parvient pas à rembourser ses dettes, ce fonds lui prêtera
(soit sur ses fonds propres, soit en empruntant lui-même avec la garantie du sérieux de la zone Euro, donc avec des taux
d’intérêt bas)… Le Fonds dispose ou peut disposer d’environ 700 milliards d’euros. Cela limitera les crises dans les
pays trop endettés et permettra que l’Euro ne soit pas trop attaqué sur les marchés financiers.
c. … Mais des décisions souvent bloquées
Les pays européens parviennent parfois à se coordonner, mais c’est loin de toujours être le cas. Les exemples
abondent de situations où il y a des désaccords, donc aucune décision prise ; ou alors de situations où un pays impose sa
façon de voir car les autres sont dépendants de son bon vouloir. L’Allemagne, principal pays de l’UE par le nombre
d’habitants et le produit intérieur brut, et principal contributeur au budget et aux projets européens, a imposé une
politique de rigueur relativement forte en Europe au moment de la crise de la dette, alors que beaucoup de pays
proposaient un politique de rigueur plus souple (voir ci-dessous). L’Europe manque d’une vraie politique industrielle
commune, mais le financement fait défaut car les Etats ne veulent pas contribuer davantage au budget européen. De
façon générale, certains Etats ont des directions plutôt socialistes, d’autres des directions plutôt libérales… comme au
Conseil européen (qui peut être assimilé à la « présidence » de l’Union) les décisions se prennent à l’unanimité, il n’est
pas rare qu’un pays mette son veto à une décision. Ainsi, on n’avance pas aussi vite qu’il le faudrait sur le plan des
réformes, ni dans un sens ni dans l’autre.
2. Une convergence économique qui pose problème
a. L’importance d’une homogénéité des économiques de l’UEM
Avant de passer à l’Euro en 2002, il a fallu faire « converger » les économies des pays candidats à l’entrée de la
zone. Autrement dit, il a fallu leur demander de s’arranger pour que leurs « fondamentaux économiques » (taux
d’inflation, taux d’intérêt, déficit public, endettement public, etc.) se ressemblent. Pourquoi ?
Prenons l’exemple des taux d’inflation. Imaginons que deux pays appartenant à la zone euro aient des taux
d’inflation très différents : par exemple, les prix dans la plupart des pays augmentent d’environ 2 % par an dans l’un
mais de 6 % par an dans un pays particulier. Rapidement, les prix du pays à 6 % d’inflation vont « exploser » par
rapport au reste de la zone. Il va avoir un solde commercial très déficitaire et devoir emprunter en masse sur les marchés
financiers. Mais si la situation persiste, il devra réemprunter, s’endetter finalement de plus en plus jusqu’au moment où
il ne pourra plus rembourser. A ce moment, deux problèmes se poseront : (a) la zone Euro aura un Etat en difficulté à
aider, ce qui lui coûtera cher ; (b) les prêteurs voudront se débarrasser de leurs créances douteuses en euro contre des
produits financiers en une autre devise, ce qui fera baisser le cours de l’euro, fera perdre beaucoup d’argent aux
possesseurs d’euros dans les échanges financiers internationaux et déstabilisera la zone.
b. Le Traité de Maastricht : les obligations faites aux Etats de la zone Euro
Pour éviter ce genre de situations, le Traité de Maastricht puis le Traité d’Amsterdam ont imposé un Pacte de
Stabilité et de Croissance. Cela revient à dire que pour qu’un pays rentrer dans la zone, il devait être en bonne santé
financière et avoir une gestion rigoureuse de son économie. Concrètement, pour entrer dans la zone Euro (et pour ne pas
recevoir d’amende une fois entré), les Etats candidats devaient respecter plusieurs « critères de convergence » ou
critères de Maastricht :
- le taux d’inflation ne devait pas dépasser de plus de 1,5 point la moyenne des trois meilleurs pays candidats les
plus performants dans ce domaine ;
- le taux d’intérêt ne devait pas dépasser de plus de 2 points la moyenne des trois meilleurs pays candidats en
matière de stabilité des prix ;
- il était interdit d’avoir un déficit public annuel supérieur à 3 % du PIB
- et une dette publique supérieure à 60 % du PIB
- il était interdit de dévaluer sa monnaie.
Après l’ouverture de la zone euro, ces critères sont restés valables pour les nouveaux pays candidats.

Page 5.
c. Une convergence problématique et ses conséquences négatives
Jusqu’à présent, dix-sept pays respectant ces critères ont été acceptés dans la zone Euro à leur demande. Mais la
Grèce avait maquillé ses comptes publics et le pot-au-rose a été découvert trop tard. Pays gangréné par la corruption
(beaucoup de Grecs ne payaient qu’une partie de leurs impôts, encouragés par des inspecteurs complaisants moyennant
« dessous de table »), la Grèce s’était déjà beaucoup endettée et a continué à être très mal gérée. Sa dette a fini par faire
peur aux prêteurs, qui ont arrêté de prêter, ou alors à des taux d’intérêt trop élevé. La Grèce, qui empruntait à la fois
pour faire de nouvelles dépenses et pour rembourser ses anciennes dettes avec de nouvelles dettes, s’est retrouvé en
situation de faillite publique : elle ne parvenait plus à rembourser ses prêteurs et n’arrivait plus à payer ses
fonctionnaires et faire les travaux publics essentiels pour ses infrastructures. Par contamination, cela a touché les autres
pays de la zone euro, et l’euro lui-même.
Mais il peut y avoir des problèmes de convergence même en-dehors de la zone euro. Ces dix dernières années,
l’Union européenne s’est considérablement élargie, avec dix pays supplémentaires en 2004 et deux en 2007. Ces pays,
souvent des pays de l’est de l’Europe, comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie ou la Bulgarie, sont des pays au
niveau de vie nettement plus bas que celui de l’Europe de l’Ouest et même du Sud. Certains observateurs considéraient
comme urgente leur adhésion, car ils risquaient d’entrer dans la zone d’influence américaine. Mais faire entrer des pays
relativement pauvres dans une Union plutôt riche a généré un certain nombre de problèmes.
1) Par solidarité, il a fallu réorienter une partie des aides du budget européen (en grande partie financé par les pays
les plus riches) vers ces pays pauvres, ce qui a généré des tensions – d’ailleurs, les pays comme l’Allemagne ou la
France ou diminué leurs financements.
2) Mais un autre problème, plus gênant, s’est posé, celui du dumping. A la base, le dumping est un terme qui
désigne une concurrence déloyale (quant une entreprise vend son produit au-dessous de son coût de production pour
nuire à ses concurrents – elle perd provisoirement de l’argent mais va attirer tous les clients à elles en « tuant » ainsi la
concurrence). Au niveau des Etats, le dumping peut être fiscal ou social :
- Dumping fiscal : dans certains pays nouveaux entrants dans l’Union européenne, les impôts prélevés sur les
entreprises sont très faibles – cela permet aux entreprises de ces pays de pratiquer des prix très bas et donc de
concurrencer de façon « injuste » les anciens Etats de l’Union.
- Dumping social : de la même façon, dans beaucoup de ces pays, les salariés sont très mal payés, il n’y a pas
de salaire minimal ou il est très bas, tandis que les cotisations sociales sont très faibles.
Beaucoup de salariés, syndicats ou entreprises d’Europe occidentale ont ainsi souffert de cette nouvelle
concurrence dans le cadre du grand marché intérieur.
Tout ceci a généré des tensions et, au-delà, des problèmes économiques pour une partie des pays de l’Union
européenne. En France, on a ainsi beaucoup parlé du « plombier polonais », salarié de son pays, payé aux normes
polonaises, susceptibles de venir travailler en France en concurrençant les plombiers français. On a aussi beaucoup
parlé d’un pays plus ancien dans l’UE mais qui a attiré les entreprises européennes à coups d’énormes cadeaux fiscaux
et s’est ainsi considérablement enrichi en quelques années au détriment des autres : l’Irlande.
3. Des politiques macro-économiques moins libres
L’un des grands changements, enfin, qu’introduit l’UEM dans la vie des Etats européennes, c’est qu’il n’est
désormais plus possible de mener les politiques conjoncturelles de la même façon qu’auparavant. Les politiques
monétaires sont passées sous le contrôle de la BCE, tandis que les politiques budgétaires sont de plus contrôlées par le
Conseil européen et la Commission européenne. Voyons pourquoi, et quel problème cela peut poser.
a. La politique monétaire : une politique unique… qui pose problème
On a évoqué les avantages d’une monnaie et d’une politique monétaire uniques (section 2.B.). Mais une telle
situation peut aussi poser problème.
1er exemple. Avant le passage à l’euro et au contrôle de la BCE sur la politique monétaire, un pays pouvait décider
d’utiliser seul la politique de change ou la politique monétaire pour améliorer sa situation. Il trouvait que son
commerce extérieur était trop déficitaire parce que ses entreprises n’exportaient pas assez ? Il pouvait abaisser le taux
de change de base de sa monnaie ; ainsi, il devenait moins cher d’acheter de sa monnaie avec une autre ; cela diminuait
le prix des produits fabriqués dans le pays pour les acheteurs étrangers ; cela relançait donc ses exportations. Mais
désormais, un pays de la zone euro ne peut plus utiliser l’arme du taux de change par rapport à ses partenaires de la
zone, car il n’y a tout simplement plus de change (tous les pays de la zone ont la même monnaie…). Et il ne peut non
plus rien faire vis-à-vis des pays extérieurs à la zone car ce n’est pas lui qui contrôle le taux de change de l’euro : c’est
la BCE, et celle-ci le laisse flotter – régime de changes flexibles.
 6
6
1
/
6
100%