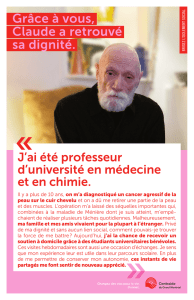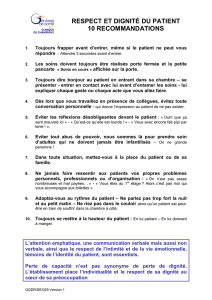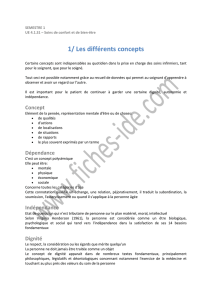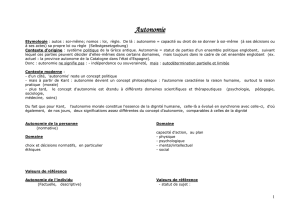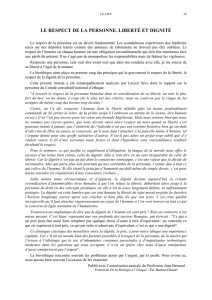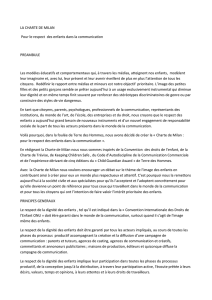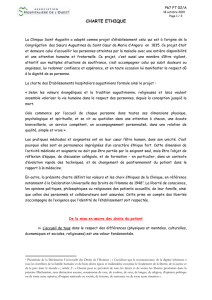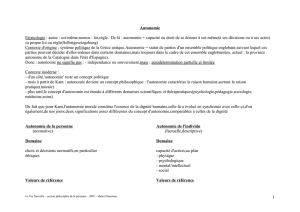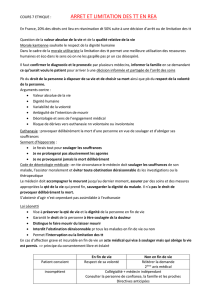Introduction - Centre d`Action pour un Personnalisme Pluraliste

1
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Institut Supérieur de Philosophie
La dignité humaine :
entre éthique et anthropologie
Dissertation présentée en vue de l’obtention
du titre de licenciée en Philosophie et Lettres
Par Aude Brochier
Sous la direction de Monsieur le professeur Michel Dupuis
Année académique 2006-2007

2
Remerciements
Nos premiers remerciements iront à mes promoteurs, à Olivier Depré, qui nous ont
orientées dans les débuts tâtonnants de ma réflexion si vaste sur la dignité humaine, ainsi
qu’à Michel Dupuis qui, en cours de route, a accueilli avec enthousiasme notre projet et qui
nous a permis, grâce à sa guidance critique et chaleureuse ainsi qu’à sa disponibilité, de
finir notre travail dans les temps.
Depuis que nous travaillons sur cet ouvrage, nous avons bénéficié de nombreuses
remarques et conseils judicieux ; nous aimerions ici exprimer notre gratitude à ceux qui
nous les ont adressés, et plus particulièrement à François, Eric Vermeer, Bon-papa, Wassim
et Christophe Rouart qui ont accepté de lire les versions précédentes de ce texte,
partiellement ou même entièrement. Leur aide nous a été fort précieuse et nous a permis de
corriger de nombreuses erreurs. Tout au long de la rédaction, nous avons pu également
rencontrer et discuter avec des personnes qui nous ont éclairées dans notre réflexion et qui
l’ont enrichie par leur avis personnel. Leur regard avisé, critique mais bienveillant sur ce
travail, a contribué pour une grande partie à son évolution. Un merci particulier à : Marc,
Olivier Bonnewijn, Emmanuel Tourpe, Vincent Triest, Pierre-Olivier Arduin, Eric de Rus,
Pierre Protot.
Nous avons également reçu une aide précieuse de la part du Père Jacobs et de
François-Xavier Putallaz, qui nous ont très aimablement fourni une source d’inspiration en
mettant à notre disposition leur documentation et leur bibliographie abondante sur le sujet.
Nous souhaitons encore témoigner notre reconnaissance chaleureuse à deux de nos
confrères philosophes, Marie-Françoise et David, ainsi qu’à nos cokotteurs, qui nous ont
encouragée et accompagnée dans ce travail difficile et délicat.
Nous ne voudrions pas oublier tous ceux et celles qui ont accepté d’être interviewés
dans le cadre de cette étude sur la dignité humaine. Merci à Clotilde Nyssens, Philippe
Mahoux, Jeanine Stiennon, Marie Frings, Sylvie Bauvois, Alain Schoonvare, Monsieur

3
Abramovick, Xavier Muller, Monsieur Marthoz, Catherine Struyve, Maître Bertrand
Matthieu, Père Piet Vandevoorde. Ils nous ont permis, grâce à leur expérience sur le terrain,
d’entrer dans le vif du sujet et de définir certaines lignes de conduites.
Mais nous ne saurions parler de gratitude, sans penser à François qui, par sa présence
constante, affectueuse et patiente, a été bien davantage que les causes occasionnelles d’un
climat propice à la vie heureuse, gage d’un travail gratifiant au moins pour l’auteur ; à son
intention il est inutile d’ajouter des mots (il y en a déjà assez dans ce volume) nous nous
bornons à lui dédier cet ouvrage.

4
Table des matières
Remerciements ................................................................................................................................. 2
Table des matières ............................................................................................................................ 4
Introduction ...................................................................................................................................... 7
Analyse systématique du concept de dignité .................................................................................. 18
I. Un sens social et politique : la dignité comme honneur ......................................................... 18
II. Un sens moral et religieux : la double genèse, stoïcienne et chrétienne, du concept de dignité
.................................................................................................................................................... 20
A. Le stoïcisme ....................................................................................................................... 20
B. La tradition judéo-chrétienne : l’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu ..... 22
1. La distinction entre « image » et « ressemblance » ........................................................ 23
2. L’âme spirituelle de l’homme ........................................................................................ 24
3. Image imparfaite mais image universelle et inaliénable ................................................ 25
4. Image statique et image dynamique ............................................................................... 25
III. Pic de La Mirandole ............................................................................................................. 28
IV. La dignité au siècle des Lumières : la dignité d’un être de raison et de liberté. .................. 29
V. Utilitarisme : dignité et qualité de vie ................................................................................... 34
Le concept de dignité aujourd’hui .................................................................................................. 38
I. Introduction : Mourir dans la dignité… Oui ! Mais quelle dignité ? ...................................... 38
II. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ................................................ 39
A. Le droit et la dignité .......................................................................................................... 39
B. La dignité, principe inaliénable d’humanité ...................................................................... 42
III. Transition : deux modèles du « bien mourir » ..................................................................... 44
IV. Définition de l’euthanasie. ................................................................................................... 46
V. L’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité .......................................................... 48
A. Présentation de l’A.D.M.D. : ce qu’elle est à partir de ce qu’elle dit d’elle-même .......... 48
B. L’A.D.M.D. et sa conception de la dignité ........................................................................ 49
1. La dignité comme forme ou la dignité dans l’image de soi ........................................... 49
a. Une dignité de l’homme liée à son intégrité physique et surtout mentale .................. 49
b. Le souci de son image ................................................................................................ 51
c. La perte de dignité ...................................................................................................... 52

5
2. Mourir : décision et action ............................................................................................. 53
a. La dignité subjective : quand la dignité égale liberté individuelle ............................. 53
b. Le regard des autres .................................................................................................... 54
c. Un homme qui revendique la maîtrise de sa mort au nom de sa liberté ..................... 56
3. La confusion entre dignité et liberté ............................................................................... 58
a. La dignité se fonde sur la liberté comprise comme autonomie .................................. 58
b. L’autonomie se fonde sur la raison humaine ............................................................. 59
c. La raison est fondée sur sa capacité d’exercice .......................................................... 61
VI. Conclusion : l’homme est à lui-même sa propre mesure ..................................................... 61
Dignité et dualisme anthropologique : l’exemple de l’A.D.M.D. .................................................. 65
I. Introduction : le problème de la relation de l’âme et du corps. .............................................. 65
II. Clarifications conceptuelles ................................................................................................... 67
A. Définition commune du dualisme ..................................................................................... 67
B. Définition de l’âme ............................................................................................................ 68
C. Définition du corps ............................................................................................................ 69
III. Les sources philosophiques du dualisme : les pensées de Platon et de Descartes. .............. 69
IV. Le dualisme anthropologique aujourd’hui ........................................................................... 73
A. L’éclipse de l’âme ou la confusion entre âme, conscience et esprit .................................. 73
B. Le dualisme corps / Sujet (esprit, âme) ............................................................................. 75
C. Corps haï, corps chéri ........................................................................................................ 76
1. Le mépris du corps humain ............................................................................................ 76
2. L’idéalisation du corps humain ...................................................................................... 77
3. Un clivage ontologique .................................................................................................. 79
V. L’A.D.M.D. et un certain dualisme anthropologique ............................................................ 80
A. « Mal à mon corps, mal à ma tête » ................................................................................... 80
B. L’adieu au corps ................................................................................................................ 81
C. L’exaltation de la raison et la réduction de l’homme à celle-ci ......................................... 82
VI. La médecine et un certain dualisme anthropologique .......................................................... 83
A. L’objectivation du corps : le rôle de la médecine.............................................................. 83
B. La médecine anatomiste .................................................................................................... 85
C. La dignité du corps-machine ou du corps-objet ................................................................ 87
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
1
/
130
100%