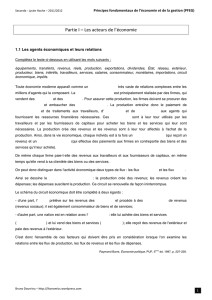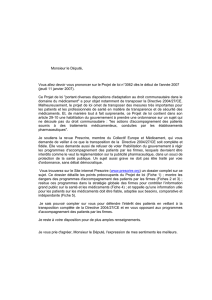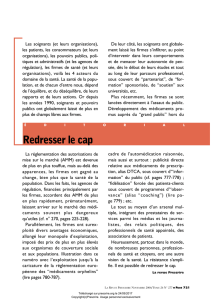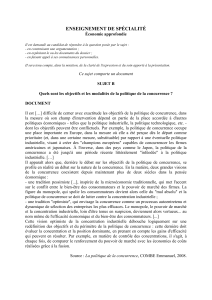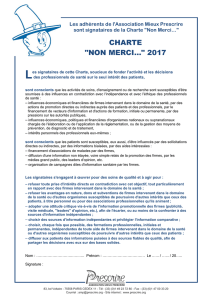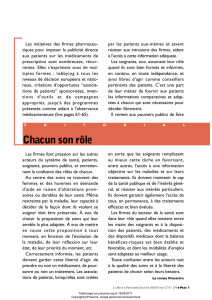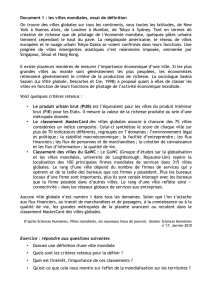integration et repartition territoriale des industries et des revenus

1
INTEGRATION ET AGGLOMERATION SPATIALE DES INDUSTRIES
ET DES REVENUS
Version provisoire
Camelia Romocea-Turcu
*
Résumé
Ce papier se propose d’analyser l’impact de la mobilité des biens et des facteurs de production
sur la répartition des revenus et des industries des pays et des régions caractérisés par une
intégration croissante. Le modèle proposé est une extension du modèle du capital baladeur de
Baldwin et alii. (2003) à deux pays - quatre régions et implique des modifications en termes
de mobilité des facteurs, coûts de transfert et dotation factorielle. Ainsi on cherche à examiner
si l’intégration économique, ayant un impact différencié selon les secteurs, accentue ou réduit
l’agglomération spatiale des industries et si cette évolution va de pair avec celle des disparités
régionales en termes de revenus.
1. INTRODUCTION
L’objectif de ce papier est d’examiner dans quelle mesure l’intégration économique accentue
ou affaiblit l’agglomération spatiale des industries et revenus si toutes les activités
industrielles sont susceptibles d’évoluer de manière similaire et si l’intégration a un impact
différencié selon les secteurs (industriels ou agricoles).
L’analyse en termes de distribution des revenus et industries sera ainsi menée au niveau
national et régional sur des pays engagés dans un processus d’intégration. Les questions
auxquelles on essaie à répondre sont : est-ce que l’intégration économique conduit à un
renforcement des disparités régionales en termes d’industries, de revenus ou de bien être? Et
est-ce que ces trois types de disparités régionales suivent la même trajectoire ?
On aborde ces questions à l’aide d’un modèle de nouvelle économie géographique car cette
théorie fournit des explications à la tendance des firmes à se regrouper et au fait que des
régions similaires au départ peuvent devenir très différentes, une fois le processus
d’intégration avancé. De plus, le modèle sera développé à l’aide d’une combinaison de
concurrence monopolistique à la Dixit et Stiglitz (1977) et des coûts de transaction en iceberg
à la Samuelson (1954). Même si ceux-ci sont des instruments assez spécifiques, ils semblent
les plus adaptés pour aborder les questions de rendements croissants, de coûts de transaction,
de mobilité de facteurs et de relations entre firmes dans un cadre d’équilibre général
analytiquement manipulable.
Ainsi, notre choix de modélisation s’est porté sur le modèle d’économie géographique de
Baldwin et alii.(2003) (le modèle du « capital baladeur » - CB) en raison de plusieurs aspects.
D’abord, dans ce modèle le capital est le seul facteur mobile tandis que la main d’œuvre reste
immobile entre pays et régions. A travers ces hypothèses, ce modèle semble être plus proche
de la réalité européenne que, par exemple, le modèle centre périphérie de Krugman (1991) qui
repose sur la mobilité géographique du travail. Ensuite, il peut être résolu analytiquement
même si on y introduit des hypothèses plus complexes.
*
Université de Poitiers, Faculté de Sciences Economiques, Laboratoire CRIEF-MOFIB –- 93, avenue du recteur Pineau, 86022 Poitiers. E-
mail : camel[email protected]

2
2. HYPOTHESES GENERALES, TECHNOLOGIES DE PRODUCTION ET
PREFERENCES
Les hypothèses sur lesquelles repose le modèle sont :
- quatre régions - deux pays (U et M), chaque pays ayant deux régions (les régions du pays
M sont 1 (Sud) et 2 (Nord)), les régions du pays U sont 3 (Sud) et 4 (Nord)). Une région est
représentée par une « unité spatiale de base, définie comme étant un espace ouvert aux
échanges extérieurs, organisée la plupart du temps autour d’un grand pôle urbain et dans
lequel se déploient en priorité les relations d’échange entre habitants » (Combes, Thisse et
Mayer (2006))
- deux secteurs : le secteur industriel (I) caractérisé par des rendements croissants, une
concurrence monopolistique et des coûts de transfert de type « iceberg » et le secteur
agricole (A) qui produit un bien homogène sous des conditions walrasiennes (rendements
constants et concurrence parfaite) et dont la production est commercialisée sans coûts. Les
deux secteurs sont présents dans toutes les régions.
- deux facteurs de production : le capital - composé des équipements productifs et/ou des
connaissances - est mobile seulement à l’intérieur de chaque région avant que la
libéralisation du capital commence pour devenir après mobile entre régions et pays ; le
travail est complètement immobile au niveau interrégional et international, mais mobile à
l’intérieur de chaque région. Les dotations en capital et en travail au niveau « mondial» sont
fixes. Les propriétaires du capital sont immobiles entre régions et pays et la localisation de
leur production dans une région suppose juste un déplacement du capital. Les revenus du
capital sont dépensés dans la région où résident leurs détenteurs. Dans cette situation, on
n’aura plus de causalité circulaire de demande et de coûts comme dans le modèle centre-
périphérie de Krugman (1991), les mouvements de capital conduisant à une modification de
la structure de la production sans déplacement des dépenses. Le coût de la vie n’est pas pris
en considération dans la localisation du capital car le revenu du capital est utilisé dans la
région de son propriétaire sans tenir compte de la région où il est employé. Dans ces
conditions le capital physique se déplace en cherchant la rémunération nominale la plus
importante plutôt que la rémunération réelle la plus élevée. Par ailleurs, à long terme il faut
faire la différence entre la part du capital détenue par les résidents d’une région et la part du
capital mondial utilisée dans la région alors qu’à court terme, les deux sont identiques.
L’équilibre de court terme correspondrait à une situation où le capital est immobile, étant
utilisé seulement sur place, dans la région de ses propriétaires. Autrement dit à court terme
on se place dans une situation d’absence de toute formes d’intégration des marchés de
capitaux, la répartition internationale du capital étant donnée. Ces hypothèses liées à la
mobilité des facteurs sont restrictives mais si les deux facteurs deviennent mobiles, alors ils
s’agglomèreront dans une des régions afin d’éviter les coûts de transactions.
Ce modèle sera caractérisé par l’agglomération si on définit, dans l’esprit de Baldwin et alii.
(2003), l'agglomération comme la tendance de l'activité économique à produire des forces qui
encouragent encore plus la concentration de l'activité économique. L'agglomération provient,
dans ce cas, de l'effet “home market” - qui suppose que la concentration de l’activité
économique et par conséquent du revenu et des dépenses crée des forces qui conduisent une
part plus que proportionnelle de l'industrie à se placer sur le plus grand marché. Toutefois
dans ce modèle l'agglomération n'est pas auto entretenue.
Une autre caractéristique du modèle est que ses principales équations d’équilibre sont
linéaires (celles liées à la dimension relative du marché et à l’allocation spatiale de
l’industrie), de façon à ce qu’on obtienne des solutions pour toutes les variables endogènes.

3
Néanmoins, la possibilité de résoudre analytiquement le modèle s’accompagne de certaines
limites concernant sa richesse…ainsi on reprendra la plupart des hypothèses simplificatrices
retenues par Baldwin et alii. (2003) en insistant plus sur les asymétries régionales/nationales.
Quant à l’hypothèse de deux pays - quatre régions, celle-ci est nécessaire pour étudier la
convergence /divergence (agglomération) nationale et régionale.
La technologie de production du secteur agricole (A) est très simple. Pour produire des
biens A on utilise seulement du travail – il faut aa unités de travail pour obtenir une unité du
bien A. Par conséquent la fonction de coût des biens agricoles est la suivante : CA=aawLY où
Y est la production du secteur concerné et wL est le revenu du travail. De plus pour simplifier
l’analyse on supposera qu’il faut juste une unité de travail pour produire une unité du bien A,
donc aa=1.
La technologie de production du secteur industriel (I) à rendements croissants suppose
des coûts fixes qui impliquent uniquement du capital et des coûts variables qui font référence
seulement au travail. Ainsi, chaque firme industrielle a besoin d’une unité de capital et de am
unités de travail pour une unité de production. La fonction de coût de chaque variété qui en
résulte est la suivante: CI= amwLx, où π et wL sont les revenus du capital et du travail, x
est le niveau de production de la firme et am représente le nombre d’unités de travail utilisées.
Par ailleurs, ces hypothèses extrêmes en ce qui concerne l’intensité factorielle des deux
secteurs ont été faites pour que le facteur mobile soit utilisé seulement dans le secteur à
rendements croissants et pour que les deux secteurs soient relativement indépendants afin de
faciliter les calculs des variables endogènes.
Comme chaque variété industrielle demande juste une unité de capital, la part du stock de
capital mondial utilisée dans une région est égale à sa part dans l’industrie mondiale et au
nombre de variétés produites dans la région. La mobilité du capital est associée à une
concentration de l’industrie (car le secteur ayant des rendements croissants est intensif en
facteur mobile).
Le consommateur représentatif de chaque région a les préférences suivantes:Uc=D
1
AI DDD
DI=
)1/(
1
/)1(
w
n
ii
d
0<μ<1, σ>1 où DI et DA représentent la demande (la
consommation) de bien industriel composite défini par un indice de type CES, respectivement
la demande (la consommation) de bien traditionnel du secteur A. L’indice CES incorpore la
préférence pour la variété. Toutefois à la place du paramètre habituel ρ mesurant inversement
le degré de différenciation entre les variétés industrielles, on met σ - l’élasticité constante de
substitution entre deux variétés industrielles. nw est la masse (le nombre) de variétés
industrielles disponibles dans le monde (la totalité des variétés domestiques et étrangères) et μ
représente la part des dépenses qui se dirige vers les biens industriels.
3. L’EQUILIBRE AVEC SEUL ECHANGE DES BIENS, SANS MOBILITE DES
FACTEURS (EQUILIBRE DE COURT TERME)
Dans ce cas, la localisation spatiale du capital est donnée, avec une stricte coïncidence entre
localisation du capital employé et localisation de son propriétaire. Les travailleurs cherchent à
maximiser leur utilité tandis que les firmes cherchent à maximiser leur profit. Dans le cadre
de la concurrence monopolistique à la Dixit-Stiglitz, l’entrée libre et instantanée sur le marché

4
conduit à des profits purs nuls, donc Ei inclura juste les revenus des facteurs :
Ei=
iLiki LwK i
où Ei est la dépense/le revenu spécifique de la région i, est la rente
d’une unité du capital (Ki) détenu par la région i, wLi et Li sont le salaire, respectivement la
quantité de main d’œuvre de la région i. Le revenu d’une région est entièrement consommé
(on suppose qu’il n’y a pas d’épargne). En conséquence, tant au niveau régional que national,
il y a égalité entre dépenses et revenu.
Par la suite on pourrait déterminer la fonction d’utilité indirecte pour les préférences calculées
antérieurement :
PEEPv ii /),(
Ei/(
1
AI PP
)
1
AI PPP
où Ei est la dépense de la
région i, P est l’indice de prix « parfait », PI est un indice de prix du bien industriel et PA (=pa)
est le prix du bien agricole.
3.1. Les résultats obtenus pour le secteur A
La fonction de demande de la région i pour un bien traditionnel est: DAi=
A
i
PE)1(
, (1-μ)Ei
étant la part du revenu de la région i dépensée sur le bien agricole. De plus, dans ce secteur,
comme le commerce est libre et il n’y a pas de coûts de transfert, les prix du bien agricole
s’égalisent entre régions et pays, à condition que le secteur A soit présent dans toutes les
régions à tout moment. Il s’agit de la « condition de non spécialisation complète » mise en
évidence par Baldwin et alii. (2003).
De plus, la concurrence parfaite conduit à une tarification au coût marginal, donc:
Liaai wap
,
i =1..4 et comme le libre échange implique pa1= pa2= pa3= pa4, on aura également wL1= wL2=
wL3= wL4. Par ailleurs, on admet qu’un travailleur produit une unité de bien agricole, cela
signifie que aa=1. En conséquence il y a égalité entre prix et salaires des régions dans le
secteur agricole si ce dernier est présent dans toutes les régions:
Liai wp
. Par la suite le bien
agricole est choisi comme étant le numéraire de sorte que son prix soit normalisé à l’unité
d’où :
Liai wp
=wL=pa= 1, i =1..4.
3.2. Les résultats obtenus pour le secteur I
Chaque firme produit une seule variété en utilisant une unité de capital par variété. Par
conséquent, le nombre de firmes est égal au nombre de variétés existant dans le monde et au
stock de capital mondial (nw=Kw). Comme le nombre de firmes est très grand, il est considéré
que chacune d’entre elles possède une part de marché très réduite, voire nulle. Dans ces
conditions, lorsqu’une firme choisit son prix, cette action n’aura pas d’impact significatif sur
le marché. De plus, le prix d’équilibre est identique pour toutes les variétés, en vertu de
l’hypothèse de symétrie des variétés industrielles.
La consommation du bien industriel est donnée par la relation suivante : DIi=
Ii
i
P
E
, μEi étant la
part du revenu de la région i dépensée sur le bien industriel et repartie entre les nw variétés
industrielles. PIi, l’indice de prix qui caractérise la région i, est formé à partir des prix des
variétés.
PI1=
1
1
1
43
1
2
1
1)))(()(( INIR pnnpnpn
PI2=
1
1
1
43
1
1
1
2)))(()(( INIR pnnpnpn
PI3=
1
1
1
21
1
4
1
3)))(()(( INIR pnnpnpn
PI4=
1
1
1
21
1
3
1
4)))(()(( INIR pnnpnpn

5
Dans les préférences des consommateurs, les variétés ne sont pas distinguées en fonction de
leur lieu d’origine. Toutefois leur consommation impose un coût de transfert lorsqu’elle ne se
fait pas dans la région de production. Les coûts de transfert sont définis en suivant Combes,
Mayer et Thissse (2003) comme étant tous les coûts engendrés par la distance et les frontières
(coûts de transport, barrières tarifaires et non tarifaires, normes de production, difficultés de
communication, différences culturelles). On suppose que ce coût est de type iceberg, qu’il a
généralement des valeurs supérieures à 1 et qu’il y a égalité des coûts de transaction dans le
monde (τIR = τIN). Ceci peut être considéré comme le résultat d’une intégration économique
approfondie entre pays et d’une politique régionale active qui, en améliorant par exemple,
l’infrastructure, facilite le transfert entre régions.
En utilisant des coûts de transfert de type iceberg on évite des questions plus délicates
comme celles de savoir qui recevra les rentes liées aux coûts de transaction ou celles du prix
des services de transport. En outre, l’hypothèse des coûts de transfert présents seulement dans
un secteur est aussi simplificatrice. Si on introduit des coûts de transaction dans l’autre
secteur, on ne peut pas y maintenir l’hypothèse simplificatrice de type walrasian. Pourtant,
Baldwin et alii. (2003) soulignent qu’on pourrait avoir le même type de résultats en
introduisant des coûts de transaction dans les deux secteurs si on suppose qu’il y a des
variétés différenciées (cette hypothèse permet le commerce intra-branche dans les deux
secteurs).
La fonction d’utilité indirecte correspondante peut être déterminée à partir de la fonction de
coût et de dépenses (qui ont la même forme que la fonction CES de base) et dans notre cas,
elle est égale à:
),( i
Epv
μEi/PIi. En appliquant l’identité de Roy, on peut déterminer la
fonction de demande CES des consommateurs de la région i pour une variété industrielle k
produite dans la région j:
1
Ii
ik
kP
Ep
dij
ij
où pkij=pk*
ij
;
ij
=1 si i=j ;
ij
=
IN
=
IR
si i≠j .
Les firmes étant en concurrence monopolistique ne s’engagent pas dans une interaction
stratégique, elles réagissent juste à des changements des variables agrégées. La demande
d’une variété industrielle est donc fonction des prix de toutes les variétés. Si un producteur
fixe un prix supérieur à ses concurrents, les consommateurs réduisent leur consommation de
la variété concernée mais la demande pour cette variété reste positive grâce à la préférence
des consommateurs pour la variété. De plus, l’introduction d’une nouvelle variété conduit à
une augmentation de la valeur du dénominateur et par conséquent à une réduction de la
demande des autres variétés si leurs prix restent inchangés. Ainsi, l’apparition de nouvelles
variétés provoque une amplification de la fragmentation de la demande.
En concurrence monopolistique, le coût d’usine est considéré comme étant optimal pour les
firmes industrielles. Donc, le prix de pré-vente est le même : on ne tient pas compte du lieu où
on vendra le produit car on passera tous les coûts de transfert sur les consommateurs. Ainsi le
prix d’une variété d’une région sur les marchés d’exportation (dans les autres régions) est égal
à son prix local multiplié par le coût de transaction τIN. Par la suite on appliquera une
transformation des coûts de transaction habituelle dans la nouvelle économie géographique
1
INin
.
in
a des valeurs comprises entre 0 et 1 et reflète le libre échange. Si
in
=1 le
commerce se fait sans coûts (on a une intégration totale au niveau de pays et régions) et si
in
=0 les pays sont en autarcie. Donc une augmentation de
in
traduit une diminution des
coûts de transfert.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%