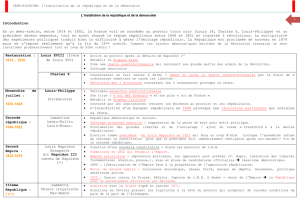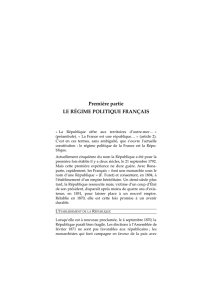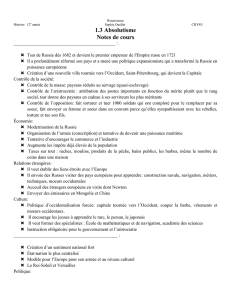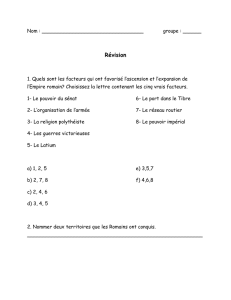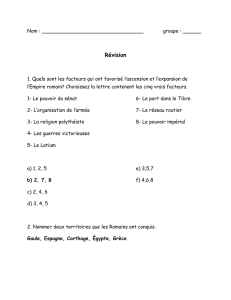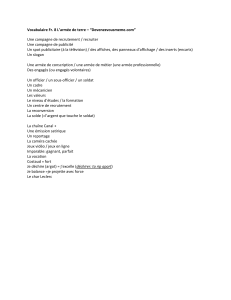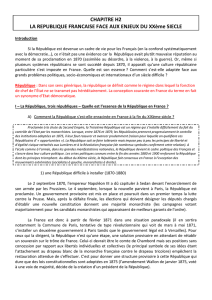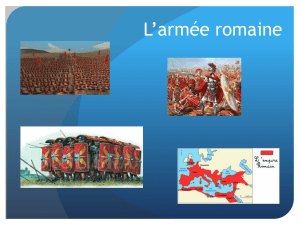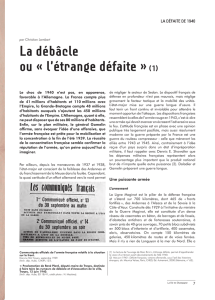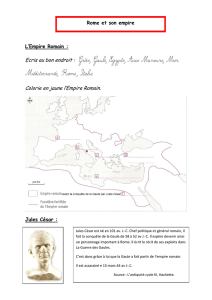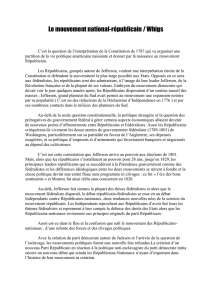LA FRANCE DU MILIEU DU XIXème SIECLE A 1914

LA FRANCE DU MILIEU DU XIXème SIECLE
A 1914
Rappel :
Un pays en profonde mutation sur tous les plans mais qui ne suit pas forcément les
mêmes évolutions que ses voisins :
-sur le plan démographique ralentissement de la croissance de la population avec
une politique malthusienne précoce.
-sur le plan économique un pays qui s’industrialise plus lentement que l’Allemagne
ou le Royaume-Uni, et qui reste fortement marqué par la ruralité.
-sur le plan culturel, un pays qui se considère comme un modèle à exporter et
cherche à répandre ce modèle par la colonisation, l’école, l’armée.
-sur le plan politique, un pays à la recherche d’une stabilité depuis la Révolution
française, faisant alterner des régimes soucieux de conserver les acquis
révolutionnaires et démocratiques (1ère République entre 1792 et 1799, 2nde
République entre 1848 et 1851), des régimes désireux de rétablir un ordre ancien
(Restauration jusqu’en 1830 avec les légitimistes) et des régimes autoritaires
recherchant un compromis (monarchie orléaniste bourgeoise de Louis Philippe ou
deux empires de Napoléon I et III).
Comment les Français font-il face aux changements de toute nature qui
affectent leur pays à l’heure de l’industrialisation, et se forgent un destin
politique commun en adhérant peu à peu à la culture républicaine ?
I- LE CADRE TERRITORIAL, DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE DE LA FRANCE EN
1914.
Etude de cas : quels changements affectent le territoire et la population de la
France sur cette période ?
1) Le territoire et l’identité de la France sont alors en pleine (re)construction mais
ne sont en aucun cas achevés. La frontière orientale de la France évolue. Elle
glisse vers l’est au sud, en intégrant le comté de Nice et la Savoie en 1860,
mais recule vers l’ouest au nord avec la perte de l’Alsace et de la Moselle
consécutive à la guerre perdue par Napoléon III contre les Prussiens en 1870.
De même qu’elle est inachevée sur le plan territorial, elle n’a pas encore d’unité
linguistique. Une large frange au nord d’une ligne Nancy / Bayonne est
pratiquement totalement francophone, mais l’est, le sud-est et la partie sud du
Massif central sont encore dominés par des patois locaux (auvergnant, catalan,
languedocien et provençal, pensez à Mistral).
2) Il faut distinguer des migrations externes et internes. Les flux migratoires,
essentiellement belges et italiens, se portent sur le nord-est et le sud-est, mais
aussi avec une prédilection pour les villes qui offrent du travail (Marseille, Lyon,
Paris, Lille).
Les migrations internes traduisent l’exode rural, les flux partant des petites
villes de l’est ou de l’ouest, essentiellement des campagnes du Massif central, et
se dirigeant vers la capitale à une écrasante majorité. Ils reflètent et ils suivent les

tracés des lignes ferroviaires. Quelques flux existent à l’échelle régionale, de
l’Espagne et du pays basque vers Bordeaux, du Massif central vers Lyon, du
Toulousain vers le Perpignanais.
Externes ou internes, ces flux sont attirés par les pôles urbains de plus de
100 000 habitants.
3)Les régions les plus attractives sont les grandes métropoles ( plus de travail en
usines, plus de logements en construction, accès facilité par de nouveaux
transports) et les régions récemment attachées au territoire français. Plus de
400 000 Italiens se fixent dans le SE, 130 000 Luxembourgeois, Allemands et
Belges se fixent prioritairement autour du Rhin, Espagnols sur le piémont
pyrénéen. Donc il existe un désir de proximité. Dans ces régions ces arrivées
posent de gros problèmes et nourrissent le racisme et de véritables pogroms
comme à Aigues Mortes ou à Lyon en 1893.
4)Un recul de la natalité peut être observé continument, avec une baisse de 35%°
à 25%° entre 1800 et 1910, soit une baisse de presque 30%. Cela se traduit
aussi par une baisse de l’excédent naturel, donc une croissance modérée de la
population à peine compensée par les flux migratoires. Les causes sont multiples :
nuptialité en recul (liée à une hausse du célibat pour des raisons salariales
surtout) de 5 points, peur de voir mourir ses enfants à la guerre dans le cadre des
guerres coloniales ou impériales, changements sociaux avec une modification
des structures familiales et une moindre solidarité entre les générations.

II- A LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU REGIME POLITIQUE (1789-1870)
2nde République
2nd Empire
3ème République
Aspects politiques :
-qui a le pouvoir
exécutif ?
-le pouvoir
législatif ?
-le suffrage
universel apparaît-
il comme
nécessaire à la
démocratie ?
2 et 5 p 121
le Président et son gouvernement élu
au SUD
l’Assemblée législative élue au SUD
pas pour les Républicains modérés
comme J.Grévy qui y voit des dérives
monarchiques et la tentation, par le
plébiscite, de reconduire son mandat
plus longtemps que prévu.
2 p 125
l’empereur héréditaire et ses ministres
le Conseil d’tat et le Sénat, dont les
membres sont choisis par l’empereur.
Le conseil législatif élu n’a que le
pouvoir d’accepter les lois et le budget
sans les modifier.
Faux SUD, le plébiscite, aucune
obligation pour l’empereur d’y recourir
3 p129
le Président du Conseil plus que
le Président de la République
après 1877, responsable devant
le Parlement. Peut dissoudre la
Chb
La Chb des députés élue au
SUD et le Sénat au SUI
Pas d’élection du Président au
SUD
Quels sont les
principes du
régime, ses
objectifs ?
-séparation des pouvoirs et principe
admis du suffrage universel direct
-création des ateliers nationaux pour
remettre les chômeurs au travail
-abolition de la peine de mort pour les
délits politiques
-liberté de la presse
-esclavage aboli.
-fondé sur le progrès, les Lumières, la
raison, la préservation des héritages
de la révolution française
2 p 126, 6 p 127 :
-un programme profondément libéral,
volonté de réduire les barrières
douanières (notamment avec les
Anglais)
-redonner un projet collectif tourné
vers la sécurité et la grandeur du
pays, avec néanmoins un idéal de
paix.
-Etat et Eglise catholique
indissociable, il parle d’évangéliser les
Français
-mise en valeur et aménagement du
territoire : canaux, ports, voies de
chemin de fer
-la lutte contre la misère
1 p 122 : antiparlementarisme, la
responsabilité des chambres dans
l’échec du régime est engagée.
7 p 123 : la violence militaire et
judiciaire (2000 morts pendant les
5 p 141, 4 p 153, 2 et 3 p 142
-une politique de paix (rejet de la
violence), de conciliation des
différents groupes sociaux, de
compromis chez les
« opportunistes » dès 1881. Le
but est de rassembler et de
fédérer.
-une politique de laïcisation
forcée et de rejet du cléricalisme
chez les « radicaux » après
1901. Une pensée libérale
attachée à la propriété
individuelle héritée de 1789.
-des symboles unanimement
acceptés, la Marseillaise
redevenu hymne national en
1879, le 14 juillet redevenu Fête
nationale
-les deux piliers : l’école (lois de
1881) et l’armée

insurrections, 980 expulsions, 5200
mises en résidence surveillée)
-un régime libéral (liberté de la
presse, liberté syndicale
acceptée en 1884)
Quels sont les
hommes forts du
régime ?
Lamartine, Ledru Rollin, Arago, Blanc
1 p 122 : l’empereur, ancien Président
de la République, uni au peuple dans
une sorte de communion liée au
plébiscite
Emile Ollivier, Villèle, Guizot
3 p 153 Gambetta pour les
« opportunistes », Waldeck-
Rousseau, Clemenceau,
Combes pour les « radicaux »,
Poincaré
Quels sont les
principaux
adversaires du
régime ?
Ils ont tous été exilés après le 2
décembre donc ce sont des émigrés.
Victor Hugo par exemple
Les républicains d’une manière
générale
3 p 153, 5 p129 : les
monarchistes à travers l’hériter
au trône, le comte de Chambord,
qui refuse le drapeau tricolore ;
les nationalistes (monarchistes)
d’Action française comme
Maurras ou Barrès. Quelques
socialistes révolutionnaires aussi
et surtout les anarchistes qui
commettent des attentats.

2nde République
2nd Empire
3ème République
Aspects politiques :
-qui a le pouvoir
exécutif ?
-le pouvoir
législatif ?
-le suffrage
universel apparaît-
il comme
nécessaire à la
démocratie ?
2 et 5 p 121
2 p 125
3 p129
Quels sont les
principes du
régime, ses
objectifs ?
2 p 126, 6 p 127 :
1 p 122 :
7 p 123 :
5 p 141, 4 p 153, 2 et 3 p 142
Quels sont les
hommes forts du
régime ?
Lamartine, Ledru Rollin, Arago, Blanc
1 p 122 :
3 p 153
Quels sont les
principaux
adversaires du
régime ?
3 p 153, 5 p129 :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%