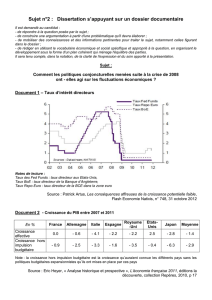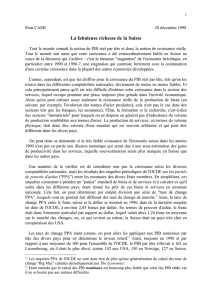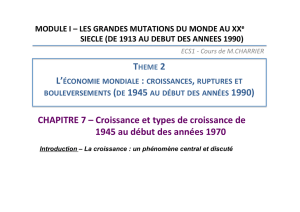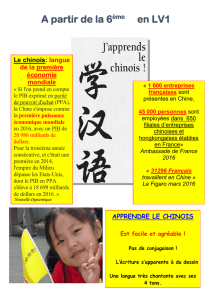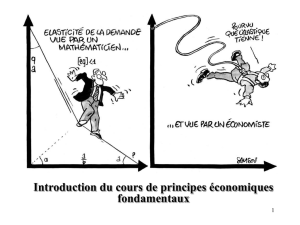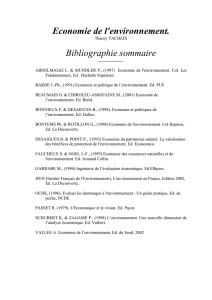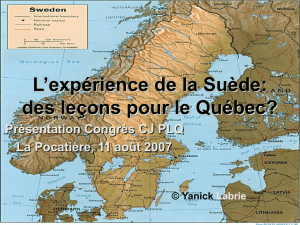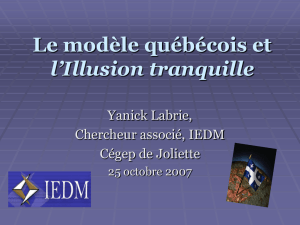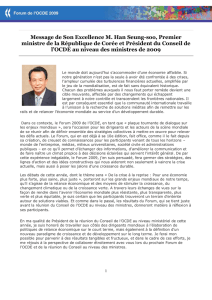Le déclin de l`économie suisse

Le déclin de l’économie suisse
Jean-Christian Lambelet
1
Tout le monde ou presque sait que l’économie suisse a traversé une phase de stagnation pro-
longée dans les années 1990 et qu’elle a perdu du terrain par rapport à pratiquement tous les
autres pays industrialisés. En règle générale, ce constat se fonde sur une comparaison des taux
de croissance réelle tels que donnés, pour chaque pays, par ses statistiques nationales. On
trouve ainsi que la Suisse est bonne dernière parmi les pays de l’OCDE. Cette comparaison a
cependant été contestée, entre autres par Ulrich Kohli de la BNS, parce que la statistique
suisse sous-estimerait, pour diverses raisons, la croissance nationale plus que ce n’est le cas
dans les autres pays. Examen fait,
2
l’objection s’avère valable dans son principe, mais il appa-
raît aussi que si l’on corrige la croissance réelle en Suisse pour la rendre mieux comparable
avec les autres pays, l’écart ne diminue que modérément : selon ces statistiques nationales
corrigées, la Suisse reste dans la queue du peloton.
Il existe cependant une autre manière d’aborder la question, une manière qui pourrait être
meilleure et qui donne en tout cas des résultats frappants. Elle consiste à prendre non pas les
statistiques nationales, mais l’évolution dans le temps des PIB par tête tels que calculés par
l’OCDE dans le cadre de ses enquêtes sur le « parités de pouvoir d’achat » (PPA). Ces en-
quêtes déterminent des « taux de change PPA » qui égalisent le pouvoir d’achat des diffé-
rentes monnaies, des taux souvent fort différents de ceux du marché : ainsi, le dollar améri-
cain valait en 2001 environ 1,90 francs en termes de PPA alors que le taux annuel moyen sur
le marché des changes s’établissait à 1,69 francs. Une fois calculés, ces taux de change PPA
permettent de déterminer, pour les divers pays de l’OCDE, des PIB par tête qui sont pleine-
ment comparables entre eux.
3
Sur la base de OCDE=100, on obtient ainsi des indices natio-
naux qui indiquent, pour chaque année, la position relative des différents pays par rapport à la
moyenne de l’OCDE.
4
Ce faisant, on applique la même méthodologie à tous les pays, une
méthodologie au demeurant solide et largement fiable. En outre, cette approche a l’avantage
d’éliminer les effets sur la croissance des mouvements conjoncturels communs aux divers
pays. Elle ne dit cependant rien sur la croissance absolue des différentes économies : ce
qu’elle montre est l’évolution dans le temps de la position relative de chaque pays – c’est-à-
dire ce qui nous intéresse dans le présent contexte.
Les comparaisons ci-dessous couvrent la période 1990-2001 parce que la première enquête
PPA à laquelle la Suisse a participé a été celle de 1990. Il existe bien des chiffres suisses pour
les années avant 1990, mais ce sont des estimations indirectes et apparemment peu fiables.
Dans le graphique 1,
5
l’Irlande et la Suisse sont les deux cas extrêmes dans l’OCDE : l’Irlande
1
Professeur d’économie à l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne, vice-président de la Commission fédé-
rale des questions conjoncturelles, membre de la Commission fédérale de la concurrence, président désigné du
Conseil consultatif (scientifique) de la Fondation Avenir Suisse.
2
Cf. une étude à paraître du Seco.
3
Pour les années 1990-2000, les données qui sous-tendent les graphiques sont extraites de : OCDE, Comptes
nationaux des pays de l’OCDE 1989-2000, Vol. 1, p. 343. Les chiffres pour 2001 ont été calculés par interpola-
tion à partir de : OCDE, Principaux indicateurs économiques, 2002/10, p. 277.
4
Cette moyenne s’entend pour les 30 pays actuellement membres de l’OCDE, à l’exclusion toutefois de la Ré-
publique tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la République slovaque.
5
Pour les années 1990-2000, les indices portent sur les PIB par tête selon les prix et les PPA de 1995. Pour 2001,
il s’agit des PIB par tête aux prix et PPA de 2000. Les courbes dans les différents graphiques ne changent que
peu si l’on prend les PIB par tête selon les prix et les PPA courants. Le constat pour la Suisse est un peu moins
défavorable si l’on considère la consommation finale par tête.

2
est le pays qui a le mieux réussi à améliorer sa position relative dans la période 1990-2001
alors que la Suisse est celui qui a connu le plus fort déclin relatif. On remarque que si la
Suisse avait en début de période un PIB par tête légèrement plus élevé que celui des USA, elle
se retrouve aujourd’hui bien au-dessous des USA. On remarque aussi – chose presque in-
croyable – que l’économie irlandaise, partie pourtant d’une position très basse, a progressé au
point de rejoindre et même de dépasser l’économie helvétique…
6
Les Pays-Bas et l’Australie
ont également réussi à améliorer leur position relative, quoique plus modestement. La faible
progression apparente des USA peut étonner. Elle s’explique en partie par le fait que
l’économie américaine représente (en 2000) environ 42% de l’ensemble de l’OCDE : si l’on
compare les USA non pas avec la moyenne pour l’OCDE, mais avec celle pour le reste de
l’OCDE, leur performance relative s’améliore nettement plus.
60
80
100
120
140
160
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
USA
Suisse
Australie
Pays-Bas Irlande
PAYS EN ESSOR RELATIF (plus la Suisse)
PIB par tête, OCDE=100 dans chaque année
Graphique 1
Le graphique 1 montre aussi que le recul relatif de l’économie suisse a été quasiment linéaire
de 1990 à 1996. Cela signifie qu’on ne peut guère en rendre responsable la forte surévaluation
du franc en 1994-1996 (jusqu’à 20% en termes réels) : quelque chose de plus profond était
manifestement à l’œuvre. Certes, les années 1996 à 1998, où le franc est redescendu de ses
hauteurs, ont été marquées par un plateau et donc par un redressement temporaire. Après cela,
c’est-à-dire – nota bene – en pleine période de reprise conjoncturelle, le recul relatif a cepen-
dant repris, quoique plus faiblement.
La Suisse n’est pas le seul pays industrialisé à avoir connu un déclin relatif dans la période
considérée. Le graphique 2 montre que cela a aussi été le cas de nos grands voisins, à savoir
l’Allemagne, la France et l’Italie, bien que leur recul ait été beaucoup moins marqué que celui
de la Suisse. La faible progression de l’Allemagne au début de la décennie est à mettre en
rapport avec le coup de fouet temporaire de la réunification, après quoi on constate une ten-
6
Si l’on prend les autres séries mentionnées dans la note précédente, la conclusion est que l’Irlande a rejoint la
Suisse, mais ne l’a pas (encore ?) dépassée. A noter encore que ces chiffres, dont ceux pour l’Irlande, concernent
le produit intérieur brut (PIB) et non le produit national brut (PNB). Les PNB selon les PPA ne sont pas calculés
par l’OCDE. Dans le cas de l’Irlande, dont la balance des revenus est fortement déficitaire, le PIB est significati-
vement plus grand que le PNB alors que c’est le contraire pour la Suisse. La comparaison selon les PIB avantage
donc l’Irlande, en ce sens qu’elle concerne la production en Irlande plutôt que la production de l’Irlande. Si l’on
compare la consommation finale par tête selon les PPA, comparaison peut-être plus significative en terme de
bien-être matériel, l’Irlande est encore assez loin derrière la Suisse. Ce qui compte, cependant, c’est la dyna-
mique : à cet égard, aucun doute que l’économie irlandaise est beaucoup dynamique que l’économie suisse.

3
dance au déclin, faible mais régulière, qui reflète parfaitement l’image qu’on se fait au-
jourd’hui de l’économie de notre voisin du nord. Il en va de même pour la France, encore que
sa situation semble s’être stabilisée en fin de période. Quant à l’Italie (y compris le Mezzo-
giorno…), elle a réussi à rejoindre la France vers 1995, après quoi elle s’en est de nouveau
écartée. Enfin, le Japon a aussi connu un déclin relatif, mais concentré dans la seconde moitié
des années 1990 et nettement moins marqué que celui de la Suisse.
90
100
110
120
130
140
150
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
PAYS EN DECLIN RELATIF
PIB par tête, OCDE=100 dans chaque année
Graphique 2
Suisse
Allemagne
Japon
France
Italie Italie
90
100
110
120
130
140
150
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Suède
Suisse
Finlande
PAYS D'ABORD EN DECLIN, PUIS SE REDRESSANT
(plus la Suisse)
PIB par tête, OCDE=100 dans chaque année Graphique 3
La Finlande et la Suède (graphique 3) sont des cas particulièrement intéressants. Tous deux
ont été durement frappés au début des années 1990. Pour la Suède, le choc a été en partie in-
terne : l’écroulement du « modèle suédois » traditionnel. Pour la Finlande, il a été externe :
l’effondrement de l’Union Soviétique, alors son principal débouché extérieur. Le graphique 3
montre que ces deux pays ont cependant réussi à surmonter leur choc respectif. Si la Suède
n’a pu ou su reconquérir le terrain perdu que partiellement, la Finlande y est arrivée intégra-
lement. On sait que ce dernier pays figure actuellement très haut dans les différents indices
qui entendent mesurer la compétitivité économique internationale. Combien de temps encore
jusqu’à ce que l’économie finnoise rattrape et dépasse l’économie suisse ? Quoi qu’il en soit,
le cas de la Finlande et, dans une moindre mesure, celui de la Suède montrent qu’il est parfai-

4
tement possible à un pays en déclin relatif de redresser la situation pour autant, toutefois, que
les nécessaires mesures de politique économique (au sens le plus large du mot) soient prises et
appliquées avec toute l’efficacité et la rigueur voulues. – Pour ce qui est des pays autres que
ceux compris dans les graphiques, leur position relative a fluctué de manière stationnaire dans
la période considérée.
7
La chose est donc parfaitement claire : l’économie suisse n’est pas menacée par le déclin, elle
est en déclin. La question est donc de savoir si ce déclin pourra être arrêté ou, mieux, rattrapé.
Certes, on peut peut-être se consoler en constatant que le PIB par tête de la Suisse reste, au-
jourd’hui, supérieur de 20% à la moyenne de l’OCDE – mais pour combien de temps encore ?
Cette évolution préoccupante soulève évidemment la double question de ses raisons et des
moyens d’y remédier.
Pour ce qui est du diagnostic, une chose semble certaine : le problème n’est pas du côté des
industries d’exportation prises globalement, les services y compris.
8
La meilleure indication
qu’elles continuent d’être performantes et concurrentielles est que, jusqu’ici, les termes de
l’échange de la Suisse se sont améliorés de façon marquée et constante – en fait, la Suisse est
l’un des pays de l’OCDE où ces termes se sont améliorés le plus. C’est sans doute aussi en
bonne partie à cause de ses industries d’exportation que la Suisse continue d’occuper une po-
sition relativement élevée dans les divers indices qui entendent mesurer la compétitivité des
économies nationales. Le problème est donc bien plutôt du côté des marchés intérieurs, des
branches travaillant pour ces marchés, ainsi que du côté d’une bonne partie du secteur public.
Structures inefficaces et sclérosées, absence ou insuffisance de concurrence, rentes de situa-
tion, fiscalité mal conçue et toujours plus lourde, appareil éducatif qui « ne suit pas » ou qui
suit mal, Etat social toujours plus généreux et plus onéreux, rigidité du cadre réglementaire –
voilà quelques-uns des mots-clés. Pour plus de détails, on peut consulter la récente étude du
Seco sur la croissance
9
ou les différents rapports de l’OCDE sur l’économie suisse, en particu-
lier le dernier (mai 2002). Mais si la liste des marchés, branches et secteurs à problèmes est
connue, ce qui manque est une identification de leur importance relative dans la genèse du
« mal suisse » : quelles sont les principales sources de la sous-performance de l’économie
suisse et, partant, où faut-il porter l’effort en priorité ? Comme souvent en économie, il n’y a
pas manque, mais pléthore d’hypothèses. C’est donc, nous semble-t-il, sur cette question que
le diagnostic devrait être affiné en priorité, en particulier de la part des économistes suisses.
Une fois que ce diagnostic affiné aura été élaboré, se posera la question de la thérapie ou, plus
vraisemblablement, des thérapies. A cet égard, nous nous limiterons ici à deux remarques.
Premièrement, il est certain que les remèdes, quels qu’ils soient, seront pour la plupart dou-
loureux dans le court terme et qu’ils ne porteront leurs fruits qu’après un temps plus vraisem-
blablement long que court. Deuxièmement, il nous paraît tout aussi certain qu’ils déclenche-
ront des affrontements idéologiques qui rendront difficile la prise des décisions politiques qui
seront nécessaires. Vu l’état actuel de l’opinion publique, le climat général et « l’air du
temps » qui prévaut aujourd’hui, on peut ne pas être très optimiste sur ce point. La première
bataille à livrer est donc celle pour les esprits.
7
C’est-à-dire (en laissant de côté les « économies en transition » ainsi que la Corée) : l’Autriche, la Belgique, le
Canada, le Danemark, la Grèce, l’Islande, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Portugal et
l’Espagne ainsi que les 15 pays de l’Union Européenne considérés dans leur ensemble. La Norvège est un cas à
part : ses importantes ressources énergétiques ne sont sûrement pas étrangères à sa forte progression relative. Il
en va de même pour le Luxembourg, également en forte progression : il s’agit d’un Etat-ville qu’il conviendrait
plutôt de comparer avec la City de Londres, Manhattan ou Zurich.
8
Avec des exceptions : ainsi, le tourisme étranger en Suisse, qui est une industrie d’exportation, se porte plutôt
mal.
9
Département fédéral de l’économie, Le rapport sur la croissance, Berne, 2002.
1
/
4
100%