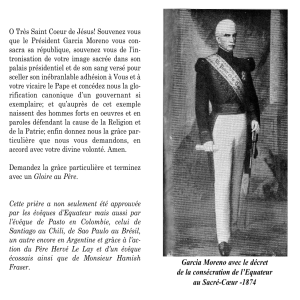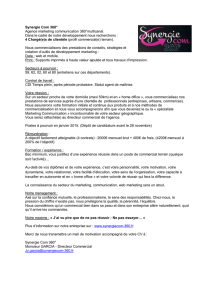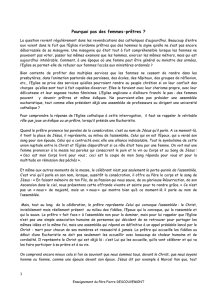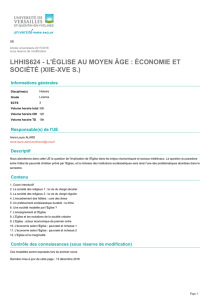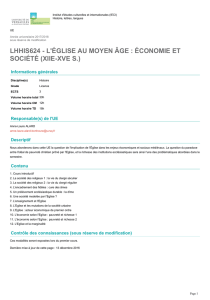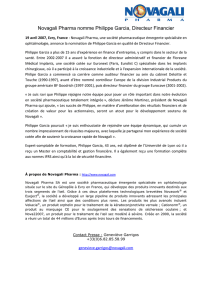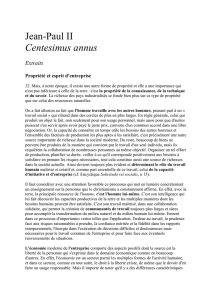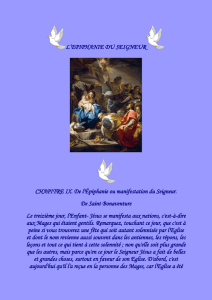Le cercle des curés disparus

Le cercle des curés disparus
Avec le film El Club, qui sort sur les écrans français ce mercredi, Pablo Larraín ouvre un
nouveau cycle. Dans ses trois films précédents, le cinéaste chilien explorait l'histoire de la
dictature militaire, du glaçant Tony Manero en passant par Santiago post-mortem (racontant
l'autopsie des corps des suppliciés de la dictature et celui de l'ancien président Salvador
Allende) et la chute formelle du régime de Pinochet scellée par le « No » au référendum de
1988, qui ouvrit la voie à la transition démocratique. Avec ce nouveau film, Pablo Larraín gratte
toujours sous le vernis de la société chilienne et brosse les portraits des membres d'un club très
fermé de religieux en rupture de ban, dans un village de pêcheurs isolé de la côte Pacifique.
«Mon père, ici nous menons une vie sainte» répond d'une voix tellement égale et douce qu'elle
finit par en être inquiétante, la seule femme du film aux questions de l'inquisiteur, le père
Garcia. Ce « beau » prêtre, c'est ainsi qu'il est présenté à nos personnages, arrive dans une
maison où vivent quatre hommes, une femme et un lévrier de course, pour faire la lumière sur
la mort brutale de l'un des occupants de la maison.
Le film, récompensé par l'Ours d'argent au dernier festival de Berlin, avance à mesure de
l'enquête du père Garcia, comme un thriller. On découvre avec le jeune prêtre le passé trouble
de chacun des occupants de la maison : homosexualité, trafic de bébés voire avortements
clandestins, crimes de la dictature pour l'aumônier militaire, pédophilie, etc. Le père Garcia, qui
représente l'Eglise moderne et «propre», est chargé par sa hiérarchie d'enquêter sur la mort
d'un pensionnaire mais surtout de liquider, au sens figuré, cette maison de pénitence ou retraite
pour prêtres déviants.
Au début du film, le père Garcia a le visage sévère et sans état d'âme du liquidateur. Peu à peu
le flou et le trouble qui caractérisent les autres personnages le gagnent lui aussi. Quand ils
n'apparaissent pas à contre-jour voire dans une demi-pénombre, les personnages semblent
filmés derrière un léger voile. Troubles comme leur passé. L'image du père Garcia perd de sa
netteté, comme s'il succombait à l'atmosphère de la maison.
Le film est tourné dans un petit village de pêcheurs dans le centre du Chili, La Boca, sorte de
«bouche» d'un enfer glacé : mer rageuse et grise, sable noir, paysages noyés dans la brume ou
dans la poussière d'eau. La palette des couleurs est froide : des gris et beige, le jaune sale de
la maison, sable mouillé. « On a tourné tôt le matin ou en fin de journée, au crépuscule,
uniquement en lumières naturelles » explique le réalisateur. Une atmosphère glaçante que
renforce la musique, airs sacrés de Bach ou Arvo Pärt.
Châtiment et rédemption
«Agneaux de Dieu» égarés, les personnages sont interprétés par des acteurs remarquables
dont deux au moins travaillent surtout au théâtre : Alfredo Castro, complice de tous les films de
Pablo Larraín, et Roberto Farías. L'irruption du personnage de ce dernier, Sandokan , mi-

homme, mi-enfant, fait voler en éclat le bel agencement du « club » des petits prêtres, « los
curitas » comme les appellent les gens extérieurs à la communauté, à la routine bien établie.
C'est lui, Sandokan, qui par ses incantations sur les sévices sexuels qu'il a subis, exprimés très
crûment, provoque le dénouement du drame.
Entre innocence et perversité, il apparaît presque comme une figure christique et c'est lui qui
portera le châtiment et (donc ?) la rédemption. Etrange personnage aussi que celui de la
femme, grande prêtresse de l'ordre de la maison, qui change les ampoules grillées, les couches
du vieux prêtre, console les peines, mais également ordonnatrice du chaos destiné à assurer
leur salut : pouvoir rester dans la maison.
Car dans cette maison jaune vivent ceux que l'Eglise catholique chilienne veut cacher. Une
Eglise qui craint par-dessus tout le scandale médiatique et donc isole, pour qu'ils échappent à
la justice et à la presse, ceux qui ont failli, « ceux qui, au regard de l'Eglise, ont commis un
péché, mais au regard de la justice civile ont commis un délit », explique Pablo Larraín. Le point
de départ du film a été, raconte le réalisateur, une photo du chalet alpin dans lequel avait trouvé
refuge un archevêque chilien en Allemagne alors qu'il était poursuivi pour abus sexuel dans son
pays.
C'est la menace de révéler à la presse ce qui s'est passé dans la maison et le passé de ses
occupants qui fera vaciller le liquidateur. La nouvelle Eglise chilienne transige avec les mêmes
démons que l'ancienne, la peur du scandale. Les plaies des petits Sandokan devenus grands
auront du mal à guérir.. Par Isabelle Le Gonidec
© RFI.fr
18 novembre 2015
1
/
2
100%