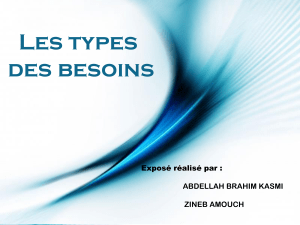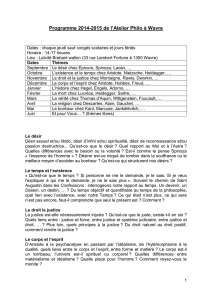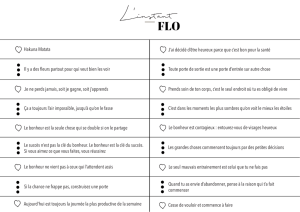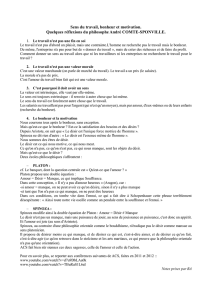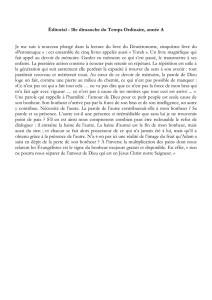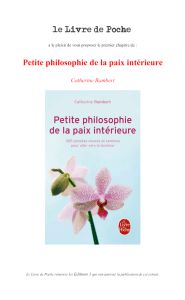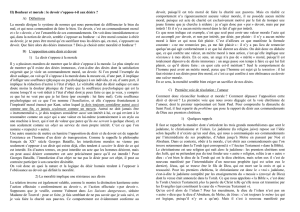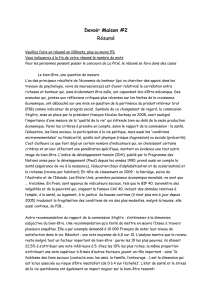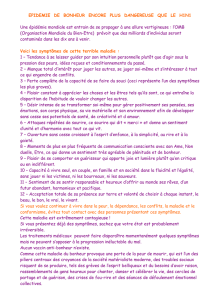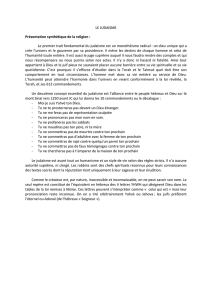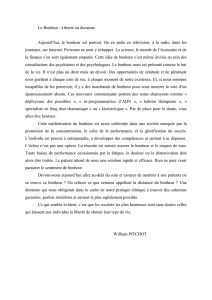La raison et le réel (première partie)

II) Bonheur et morale : le devoir s’oppose-t-il aux désirs ?
A) Définitions
La morale désigne le système de normes qui nous permettent de différencier le bien du
mal, et qui nous commandent de faire le bien. Un devoir, c’est un commandement moral
et « le » devoir, c’est l’ensemble de ces commandements. On voit donc immédiatement ce
qui, dans la notion de devoir, semble s’opposer au bonheur : si être moral consiste à obéir
au devoir, je ne peux être moral qu’en sacrifiant tous les désirs qui, en moi, s’opposent au
devoir. Que faire alors des désirs immoraux ? Dois-je choisir entre moralité et bonheur ?
B) L’opposition entre désir et devoir
1) Le désir s’oppose à la morale
Il y a plusieurs manières de montrer que le désir s’oppose à la morale. Le plus simple est
de montrer qu’il existe des désirs immoraux, c'est-à-dire des désirs dont la satisfaction
exigerait que je viole un commandement moral, un devoir. Si l’on prend l’exemple du
désir sadique, on voit qu’il s’oppose à la morale dans la mesure où, d’une part, il implique
d’infliger une souffrance (physique ou psychologique) à un individu, et où, d’autre part, il
implique la réduction d’autrui à l’état d’objet. Le véritable objet du désir sadique est sans
doute moins la douleur physique de l’autre que la souffrance psychologique qui est la
sienne lorsqu’il se voit réduit à l’état d’objet dont je peux faire ce que je veux, y compris
ce que lui ne veut pas que je lui fasse (par exemple : lui faire mal). Cette souffrance
psychologique est ce que l’on nomme l’humiliation, et elle s’oppose frontalement à
l’impératif moral énoncé par Kant, selon lequel je dois toujours considérer autrui aussi
comme une fin, et jamais seulement comme un moyen. Autrui ne doit jamais être
« instrumentalisé », je dois toujours considérer aussi son intérêt à lui, ce qui revient à le
reconnaître comme un sujet qui a une valeur en lui-même (contrairement à un stylo ou
une machine à laver, qui n’ont de valeur que parce qu’ils me servent à quelque chose), et
non seulement comme un objet au service de mon propre intérêt. C’est ce que l’on
nomme « respecter » autrui.
Mais on peut remarquer une opposition plus générale entre bonheur et morale : dans la
mesure où « la recherche du bonheur » désigne la recherche par chacun de son bonheur,
elle tend naturellement à s’opposer à l’impératif kantien. Car si le but visé est mon
bonheur, dans le cadre de cette recherche je ne rencontre autrui que comme un moyen,
pour moi, d’être heureux. Rechercher « le » bonheur, c’est toujours rechercher le bonheur
de quelqu’un ; et dans ce cas soit je recherche le bonheur de l’autre (et dans ce cadre c’est
moi qui suis un moyen pour le bonheur de l’autre, et je ne recherche plus mon bonheur),
soit je recherche mon bonheur, et dans cette recherche je ne rencontre l’autre que comme
moyen au service de ce bonheur personnel.
Une dernière manière de mettre en lumière l’opposition du désir et du devoir est de
rappeler l’existence en l’homme d’un désir de transgression. Comme le rappelle le
philosophe français du XX° siècle Georges Bataille, les interdictions morales ne viennent
pas seulement s’opposer à un désir qui existe déjà, elles tendent à susciter le désir de ce
qui est interdit. En d’autres termes, on peut interdite un acte que les hommes désirent,
mais on peut aussi désirer commettre cet acte précisément parce qu’il est interdit ! Pour
Georges Bataille, l’interdiction d’un objet ne tue pas le désir pour cet objet, il peut au
contraire participer à son caractère… désirable.
On voit donc en quoi la nature et la logique du désir humain tendent à l’opposer à
l’obéissance au devoir qui définit la moralité.
2) La moralité implique une résistance aux désirs
La relation inverse est également valable, comme le montre la distinction kantienne entre
l’action effectuée « conformément au devoir », et l’action effectuée « par devoir ».
Supposons que je veuille, comme Valmont dans Les liaisons dangereuses, séduire
Madame de Tourvel : pour ce faire, je fais semblant de ne pas savoir que je suis suivi, et
je vais faire la charité aux pauvres. Ce comportement est évidemment conforme au
devoir, puisqu’il est très moral de faire la charité aux pauvres. Mais en réalité ce
comportement n’a rigoureusement aucune valeur morale, il ne possède aucun mérite
moral, puisque cet acte de charité est exclusivement motivé par le fait de tromper une
jeune femme que je cherche à séduire : je n’agis donc pas « par » devoir, mais par pur
intérêt ! Et il n’y a aucun mérite moral dans le fait d’agir par intérêt.
Ce que nous indique cet exemple, c’est que seul peut avoir une valeur morale l’acte qui
est accompli par devoir, et non par intérêt, par désir, par plaisir : il n’y a aucun mérite
moral à faire ce qui nous fait plaisir. C’est d’ailleurs ce que manifeste la formule
courante : « ne me remerciez pas, ça me fait plaisir » : il n’y a pas lieu de remercier
quelqu’un qui agit conformément à ce que lui dictent ses désirs. On doit donc en déduire
que, ce qui confère une valeur, un mérite moral à mon action, c’est qu’elle implique une
résistance à mes désirs. En ce sens, un ange n’a pas de « mérite » moral, puisqu’il est
totalement dépourvu de désirs immoraux : un ange passe son temps à faire ce qui lui fait
plaisir, ce qu’il désire faire : en quoi cela est-il méritant ? Seul le comportement de
l’homme peut avoir un mérite moral, parce que l’homme est sujet çà la tentation : il lui
faut résister à ses désirs pour être moral, et c’est ce qui confère à son obéissance au devoir
une valeur morale.
En ce sens, la moralité semble bien exiger un sacrifice de nos désirs.
C) Première voie de résolution : la sublimation
[Je vous renvoie ici au cours sur l’inconscient]
D) Première voie de résolution : l’amour
Comment donc réconcilier bonheur et morale ? Comment dépasser l’opposition entre
désir et devoir ? La première voie que nous avons dégagée est la voie chrétienne de
l’amour, dont le premier représentant est Saint Paul. Pour comprendre la démarche de
Saint Paul, il faut repartir du problème que pose le rapport du désir aux commandements
de Dieu aux premiers chrétiens.
1) Quelques rappels
Il faut se rappeler la manière dont s’articulent les trois grands monothéismes que sont le
judaïsme, le christianisme et l’islam. Le judaïsme (la religion juive) repose sur l’idée
selon laquelle il n’existe qu’un seul dieu, qui nous a communiqués ses commandements
par l’intermédiaire de ses prophètes, d’Adam jusqu’à Moïse en passant par Noé et
Abraham. Dans ce contexte, obéir à la morale, c’est obéir aux commandements que l’on
trouve notamment dans la Torah (qui correspond à « l’Ancien Testament » dans la Bible).

Le christianisme est une religion qui naît dans le judaïsme : les premiers chrétiens sont
des Juifs, qui ne prétendent pas du tout fonder une « autre » religion, reliée à un « autre »
dieu : c’est bien le dieu de la Torah qui est le dieu chrétien, mais selon eux il s’est de
nouveau manifesté par l’intermédiaire d’un nouveau prophète (qui est selon eux le
dernier), Jésus, qui se trouve être le fils de Dieu, qui est mort sur la croix et qui a
ressuscité. Pour les premiers chrétiens, le christianisme est donc le « vrai » judaïsme,
c'est-à-dire le judaïsme complété par les enseignements du « messie » (envoyé de Dieu)
dont la venue était annoncée dans la Torah. Ce que nous appelons « la Bible », c’est donc
la Torah (Ancien Testament) plus la parole du Christ telle qu’elle nous est transmise par
les Evangiles (qui constituent le cœur du « Nouveau Testament »).
Qu’en est-il alors de l’islam ? Pour les musulmans, le dieu de l’islam n’est pas un
« autre » dieu que le dieu d’Abraham, de Moïse, de Jésus : c’est toujours le même (ce qui
est logique, puisqu’il n’y en a qu’un). Mais il s’est à nouveau manifesté par
l’intermédiaire d’un dernier prophète : Muhammad (ou Mahomet). On pourrait donc dire
que les musulmans sont aux chrétiens ce que les chrétiens sont aux Juifs : chacun ajoute
une nouvelle prophétie aux précédentes. Mais il y a néanmoins une différence : si les
musulmans reconnaissent donc Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus comme des
prophètes (qui nous transmettent la parole de Dieu), le statut de Mahomet est particulier.
Il n’est pas seulement le dernier des prophètes (le « sceau » de la prophétie) : les écrits qui
sont constitués à partir de sa parole, qui forment le Coran, récapitulent l’histoire de
l’humanité depuis la création du monde. En ce sens, le Coran ne « s’ajoute » pas à la
Bible, comme les Evangiles « s’ajoutaient » à la Torah : il les « contient » dans la mesure
où le récit de la création du monde, d’Adam, le récit de la faute originelle, la venue du
Christ, etc. sont contenus dans le Coran, qui se substitue à la Bible (il existe évidemment
des différences entre les différents récits ; ainsi, pour les musulmans, le Christ ne peut pas
être considéré comme le « fils » de Dieu — pas plus d’ailleurs que Mahomet.)
On voit donc qu’il ne faut surtout pas opposer les trois monothéismes comme des
religions séparées, rattachées à des dieux différents : il s’agit toujours du même dieu, et
chaque « nouvelle » religion reprend l’essentiel du patrimoine des précédentes.
2) Le problème de l’obéissance chrétienne aux commandements divins
Le problème qui se pose donc aux premiers chrétiens est assez simple : si le dieu du
christianisme est bien le même dieu que celui de la Torah, il va de soi que les
commandements de la Torah (et notamment les 10 commandements révélés à Moïse sur
le Mont Sinaï) sont valides : il faut donc les respecter. Mais d’un autre côté, il faut aussi
obéir aux injonctions du Christ, ce qui pose problème dans la mesure où : (a) soit Jésus ne
dit pas la même chose que la Loi juive, et dans ce cas il faut, pour lui obéir, désobéir à la
Loi juive, or cette Loi nous a été communiquée par Dieu ; (b) soit Jésus dit exactement la
même chose que la Loi juive, et dans ce cas on ne voit pas bien en quoi réside le contenu
de son enseignement.
Ce problème est présent dans tous les Evangiles, notamment dans le comportement des
« Pharisiens » : ces derniers ne cessent de venir placer Jésus face à des situations au sein
de laquelle ce qu’il dit semble contredire ce que la Loi juive commande. L’exemple le
plus connu est celui de la femme adultère, que la Loi juive commande de lapider (sous
conditions) : soit Jésus suit la Loi, et dans ce cas il doit commander la lapidation ; soit il
redit ce qu’il a l’air de dire habituellement, et il s’oppose à la Loi juive. Comment le
Christ se sort-il de cette situation ? Il ne dit pas : « lapidez » ; mais il ne dit pas non plus
« ne lapidez pas » ; il dit « que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre », ce
qui conduit les Pharisiens à rentrer chez eux. En d’autres termes, le Christ n’a pas
contredit la Loi juive, il nous a indiqué une manière de la comprendre, et donc de
l’appliquer. Dire que l’adultère mérite la lapidation peut se comprendre de deux
manières : soit on interprète cette phrase comme une invitation à lapider toutes les
femmes (et tous les hommes, rappelons-le) adultères ; soit on l’interprète comme un
énoncé qui affirme que l’adultère est une faute capitale, extrêmement grave (dont nous
devrons rendre compte à Dieu lors du Jugement dernier), mais qu’il ne nous revient pas à
nous de châtier (puisque nous sommes nous-mêmes pécheurs, et que seul a le droit de
châtier celui qui est lui-même « immaculé »). Ce qu’indique Jésus, c’est que le véritable
sens de la Loi, c’est le second. La véritable signification de la Loi, ce n’est pas « châtiez
les adultères, puisque leur faite est grave », mais « ne commettez pas l’adultère, car c’est
une faute grave » : ce qui est cohérent avec la prise de position finale de Jésus, qui dit à la
femme : « va, et ne pèche plus ».
Dans cette optique, Jésus n’est pas venu nous apporter une « nouvelle » Loi, il est venu
rappeler la véritable interprétation de la Loi, celle qui en délivre le sens véritable.
3) De la Loi juive à l’amour chrétien : la pensée de Saint Paul
Mais on peut aller plus loin. Car la question se pose de savoir comment le christianisme
conçoit l’accès au véritable sens de la loi. Quelle est l’attitude d’esprit que nous devons
avoir pour comprendre le véritable sens des commandements divins ? Et plus encore, une
fois cette attitude adoptée, a-t-on encore besoin des commandements ?
a) le paradoxe de la Loi
Pour Saint Paul, il faut repartir du caractère assez paradoxal de la Loi juive. Ainsi, la
formulation de cette Loi par Dieu n’a de sens que si l’homme n’est pas spontanément
enclin à la respecter : si Dieu a eu besoin de nous communiquer ses commandements,
c’est que nous sommes des individus pécheurs, qui spontanément agissent de façon
contraire à Sa Loi.
Or la Loi nous donne-t-elle la force de lui obéir ? Non : elle nous dit ce qu’il faut faire,
mais elle ne nous rend pas meilleurs pour autant : nous sommes tout autant pécheurs
qu’auparavant. Ce qui implique que nous allons transgresser les commandements divins !
Plus encore, les commandements nous ont indiqué ce qu’il ne fallait pas faire : or dire
« tu ne dois pas faire cela » à un individu perverti, vicieux, risque fort de le conduire à
désirer ce que, précisément, on vient de lui interdire (la femme du voisin devient d’autant
plus désirable lorsque l’on rappelle à l’individu qu’il ne doit pas la convoiter.) Quel est
alors l’intérêt de la Loi ? Pourquoi Dieu nous l’a-t-il communiquée ?
b) la loi et l’humiliation : la destruction de l’orgueil
Le premier effet de la Loi, c’est que, même si elle ne nous donne pas la force de lui obéir,
elle nous confronte néanmoins au fait que nous ne faisons pas ce que nous devrions faire.
J’agis mal, mais je le sais : la contradiction entre mes actes et les commandements de
Dieu ne peut plus être occultée. Comme le dit Saint Paul : « je vois le meilleur et je fais le
pire », et je vois que je fais le pire. Ce constat amer nous confronte donc à notre nature
fautive, perverse, pécheresse : elle nous conduit vers l’humiliation.

Il faut donc se demander à quoi sert l’humiliation. or le premier effet de l’humiliation,
c’est la destruction de notre orgueil, de cet « amour de nous-mêmes » que traduisent
l’égoïsme, la cupidité, l’ambition, le désir de domination, etc. L’aboutissement du mépris
de soi, ce n’est pas la culpabilité, c’est la destruction de l’orgueil… or l’orgueil est
précisément ce qui nous éloigne de Dieu et nous oppose aux autres hommes ! C’est
l’orgueil qui a conduit le premier des Anges, l’Ange de Lumière (Lucifer), à devenir
l’Ange des ténèbres (Satan), lui qui « s’est épris de sa propre lumière » et qui, par orgueil,
a refusé de se subordonner à l’homme. [On trouve une idée semblable dans le paganisme
grec : l’orgueil, c’est ce qui conduit à ce mélange de folie et de méchanceté que traduit le
terme d’hybris]. La formulation de la Loi ne nous conduit donc pas directement à obéir à
Dieu : mais elle brise ce qui nous éloigne de Lui et nous oppose aux autres êtres humains.
c) de l’humiliation à la contemplation
Cette destruction de l’orgueil ne nous détache pas seulement de nous-mêmes : elle nous
détache aussi du monde et, en un sens, des autres. Le mépris de soi va avec le mépris du
monde, et les choses matérielles du monde cessent d’avoir de la valeur au moment où
l’égoïsme se brise : car les biens, la richesse, la puissance n’ont de valeur que pour
l’individu orgueilleux, animé par la cupidité, l’ambition etc. Vers quoi se tourne alors le
désir de l’homme ?
Pour Saint Paul, lorsque le désir de l’homme se détourne du monde et de soi, il retourne
naturellement vers Dieu. En ce sens, le premier aboutissement « positif » de l’humiliation
induite par la Loi, c’est le retour de l’homme vers Dieu, le retour du désir humain vers
Dieu : le retour à l’amour de Dieu, qui est amour de la créature pour son Créateur. Celui
qui se détache du monde, de soi-même et des autres revient naturellement à la
contemplation de Dieu qui ne peut être qu’amour.
d) de l’amour de Dieu à l’amour des hommes
Mais aimer Dieu, se tourner vers Dieu, c’est apprendre à regarder les hommes comme lui
les regarde : comme ses créatures, comme ses enfants. C’est donc apprendre à les aimer
comme Dieu les aime, non plus d’un amour charnel, qui vise le plaisir par la séduction,
etc. mais d’un amour que l’on pourrait dire « paternel », l’amour qu’un père porte à ses
enfants.
Cet amour est très particulier : il ne s’agit plus de « l’eros », amour sensuel, mais de
« l’agapè », ce que Saint Augustin appelle l’amour de charité. A qui s’adresse cet
amour ? Il s’adresse aux êtres humains en tant qu’ils sont des enfants de Dieu ; or de ce
point de vue, tous les hommes sont absolument semblables : certains ne sont pas « plus »
créatures de dieu que d’autres. Et de même qu’un père aime tous ses enfants du même
amour, et non parce que celui-là est beau, l’autre intelligent, l’autre obéissant, etc., Dieu
aime tous les hommes du même amour, quelles que soient leurs caractéristiques
particulières. C’est cet amour qu’apprend celui qui se tourne vers Dieu. Par conséquent,
on voit que cet amour s’adresse nécessairement à tous les hommes, et de façon identique,
puisqu’il est l’amour des hommes en tant que créatures de Dieu. L’amour chrétien est
donc nécessairement amour de tous les hommes, amour de n’importe quel homme : ce
que désigne l’amour du prochain. Le prochain, c’est tout être humain en tant que créature
de Dieu. Comme le dit Kierkegaard, le prochain, c’est l’homme mis à nu, l’acteur sans
rôle qui demeure sur la scène lorsque l’on fait tomber le « costume » qu’il nous est donné
de revêtir durant notre existence terrestre. Devant le regard de Dieu, il n’y a plus ni rois ni
mendiants : il n’y a que des hommes, et c’est lorsque nous saisissons l’homme en tant
qu’homme, l’homme en tant que créature de Dieu, l’homme par-delà toutes les
différenciations qui s’effectuent en ce monde que nous apercevons — le prochain.
Et l’on peut remarquer que je suis moi aussi un « prochain », en tant que créature de
Dieu : la destruction de l’orgueil en tant que « mauvais » amour de soi-même n’aboutit
donc pas au mépris de soi, mais à une autre forme d’amour de soi, qui ne m’éloigne pas
de Dieu mais vient de lui, qui ne m’oppose pas aux autres mais m’en rapproche.
e) l’amour comme accomplissement de la Loi
Que devient alors l’obéissance à la Loi ? Saint Paul dit que l’amour chrétien « abolit » la
Loi, tandis que Kierkegaard (philosophe danois du XIX° siècle) nous dit que l’amour
« accomplit » la Loi ; en réalité, tous deux disent la même chose.
L’amour abolit la Loi dans la mesure où celui qui aime son prochain n’a plus besoin de la
Loi, il n’a plus besoin de la formulation explicite des commandements. Celui qui aime
son prochain ne veut pas le tuer, il ne veut pas lui prendre sa femme, il ne veut pas en
médire, etc. Bref : celui qui aime son prochain agit spontanément envers lui d’une façon
conforme aux différents impératifs divins. En ce sens, l’amour « périme » la Loi, il la
rend superflue.
Comme le montre Kierkegaard, face à la Loi l’homme est nécessairement angoissé : car
toute loi reste nécessairement indéterminée [nous recroiserons cette idée lorsque nous
traiterons du rapport de la loi à la justice]. Elle l’est d’abord en tant qu’elle est une règle
générale, qui doit s’appliquer à une infinité de cas particuliers, singuliers, tous différents
et dont chacun demande que l’on établisse ce qui constitue la « bonne » application de la
Loi face à ce cas particulier. On aura beau rajouter des appendices, des annexes, des notes
de bas de page pour préciser la manière dont la Loi doit être appliquée dans tel, tel ou tel
cas, jamais nous ne pourrons préciser dans la Loi la manière dont il convient de
l’appliquer face à chaque cas, chaque circonstance particulière. Car il y a une infinité de
cas particuliers, et chacun d’eux se caractérisé par une infinité de caractéristiques. Pour
que l’on puisse inscrire dans la loi la manière dont on doit l’appliquer dans tous les cas, il
faudrait rédiger une loi… infiniment longue.
La solution serait alors de connaître le « sens » de la Loi, « l’esprit » de la Loi ; celui qui
comprend parfaitement l’esprit de la loi, sa raison d’être, l’intention qu’elle sert, le but
poursuivi par le législateur, etc. pourra tenter de déterminer la manière dont il faut
l’appliquer face à un cas particulier, même si ce cas n’a pas été explicitement prévu par la
loi. Mais pour cela, il faudrait connaître avec certitude ce « sens » de la Loi. Or là encore,
nous faisons face à une pluralité irréductible d’interprétations possibles ; toute loi peut
être comprise, interprétée d’une multitude de façons, sans que le débat puisse être tranché
par la loi elle-même. Comment appliquer la Loi ? Comment interpréter la loi ? Tel est le
double questionnement auquel tout individu confronté à une Loi doit faire face… et qui le
plonge dans un débat que nul ne peut jamais clore.
En quoi l’amour permet-il de dépasser cette double indétermination de la loi ?
Mais plus encore, l’amour est précisément cette « attitude d’esprit » que nous
recherchions tout à l’heure : pour comprendre le véritable sens de la loi, pour en découvrir
la véritable interprétation, c’est bien l’amour du prochain qui doit nous habiter. Celui qui
aime son prochain sait ce que signifie le véritable sens de la Loi, il sait ce qui en constitue

la bonne application (celui qui aime son prochain sait qu’il s’agit moins de le lapider que
de l’inviter à ne plus pécher…) En ce sens, l’amour est bien l’accomplissement de la Loi,
puisqu’il est la clé qui nous permet d’accéder au véritable sens de la Loi, il est ce qui nous
conduit à toutes les applications correctes de la Loi.
[Même s’il faut faire attention à ne pas confondre l’amour inspiré par Dieu et les autres
types d’amour, on peut ici songer à ce que Donald Winnicott (un pédiatre-psychanalyste
britannique du XX° siècle) disait à propos de l’éducation des enfants en bas âge : la mère
qui aime son enfant n’a pas besoin qu’on l’étouffe sous une multitude de « consignes » et
de « règles » à respecter : elle les trouvera toute seule, spontanément. Inversement, on
peut donner à des parents qui n’aiment pas leur enfant une multitude de consignes, de
règles, etc. : sans l’amour, ils sont voués à les appliquer de travers.]
On comprend alors que l’amour de Dieu et (donc) l’amour du prochain (lequel implique
l’amour de moi-même en tant que créature de Dieu) deviennent les seuls commandements
de Dieu selon saint Paul (qui suit ici les Evangiles) ; aime Dieu, aime ton prochain
comme toi-même : tels sont les seuls « devoirs » fondamentaux, dont découle toute la
moralité.
4) l’amour comme dépassement de l’opposition entre désir et devoir
Revenons maintenant à notre question initiale : qu’en est-il du rapport désir / devoir dans
l’optique de l’amour chrétien ?
Il n’est pas difficile de voir que cette opposition est dépassée : d’une part, le désir et le
devoir disent ici la même chose : l’amour du prochain me pousse à vouloir son bien, et
vouloir le bien de l’autre est un devoir. Ce que je fais « par amour » est donc à la fois
conforme à mon désir et à mon devoir. Mais d’autre part, la question de savoir si mon
comportement est adopté « par désir/plaisir » ou « par devoir » n’a plus de sens.
Même en raisonnant hors du cadre de l’amour chrétien, on peut voir que ce qui est
effectué par amour n’est effectué ni par intérêt, par satisfaction personnelle, pour le
plaisir que j’en tire (etc.), ni par devoir, mais… « par amour ». Celui qui offre quelque
chose par amour ne le fait ni pour sa satisfaction personnelle (l’autre va m’en être
reconnaissant et du coup je pourrai lui demander ceci ou cela), ni par devoir (« puisque
c’est la Saint Valentin, je suis bien obligé de t’offrir des fleurs ») : il agit par amour, ce
qui est une troisième forme d’action.
En ce qui concerne l’amour chrétien, il faut souligner qu’il permet de synthétiser les deux
autres : ce que je fais par amour est bel et bien fait par désir (puisque l’amour de Dieu et
du prochain est le désir fondamental du chrétien), mais également par devoir (puisque
aimer son prochain est le devoir fondamental du chrétien). L’amour chrétien permet donc
de résoudre le conflit entre désir et devoir, bonheur et moralité : aimer son prochain, c’est
mener une vie qui est à la fois morale, dictée par le devoir fondamental, et heureuse dans
la mesure où le désir fondamental qui est le mien est précisément cet amour par lequel
j’aime Dieu, mon prochain, et moi-même.
En quel sens peut-on alors parler d’un dépassement de l’opposition entre bonheur et
moralité par la voie de l’amour ?
Il faut ici faire attention ; si l’on suit (comme nous venons de le faire) le raisonnement de
Kierkegaard, il ne faut surtout pas affirmer sans précisions que « celui qui aime le
prochain sera heureux ». Car la dualité que nous avons marquée concernant l’amour
(amour-orgueil, amour-charité) se retrouve dans le bonheur. Il y a le bonheur « selon le
monde », le bonheur fondé sur la possession et la jouissance des choses (et des hommes
ou des femmes) du monde, bref le bonheur tel que le conçoit celui qui se trouve encore
pris dans l’amour-orgueil. Et, par opposition, il y a le bonheur tel que le conçoit celui
qu’anime l’amour du prochain, c'est-à-dire le bonheur proprement chrétien (pour
Kierkegaard). Or ces deux types de bonheur s’excluent absolument (toujours selon
Kierkegaard) ; le chrétien véritable ne pourra éviter d’être rejeté, raillé, exploité, etc. Il
n’a aucune chance de devenir « riche et célèbre » ; en d’autres termes, le véritable
chrétien ne peut faire autrement que de sacrifier toutes les choses qui répondent au
bonheur « selon le monde » pour vivre pleinement son amour du prochain. Cela signifie-t-
il que le chrétien sera nécessairement malheureux ?
Si l’on prend comme référence le bonheur « selon le monde », il n’y a aucun doute (pour
Kierkegaard, l’un des signes les plus évidents du fait que les hauts membres de l’Eglise
ne sont en rien des « exemples » de christianisme vécu sont… qu’ils sont riches et
reconnus.) Mais justement, à ce bonheur « selon le monde » répond le bonheur selon
l’amour que Kierkegaard nomme : la félicité.
Je n’ai peut-être pas assez insisté sur cette idée dans le cours. Pour Kierkegaard, le
véritable chrétien, celui qui est pénétré de l’amour de Dieu et (donc) du prochain, est à la
fois « malheureux selon le monde » (il est pauvre, persécuté, etc.) mais heureux selon la
foi chrétienne. La « félicité », c’est la Joie que ressent celui qui vit en plein accord avec sa
foi, celui que rien ne peut atteindre ou faire chanceler car rien ne peut venir le faire douter
de ce qu’il doit faire (aimer son prochain), ou l’empêcher de le faire (il n’est nul besoin
d’être aimé par le prochain pour l’aimer). La félicité est l’état de communion avec Dieu,
avec soi et avec autrui dans l’amour. On pourrait donc dire que la félicité est à la
jouissance et à la possession des biens et des femmes (ou des hommes) ce que l’amour du
prochain est au désir charnel, ou à l’amour-orgueil auquel il se rattache. Mais, tandis que
le bonheur « selon le monde » accule l’homme à une perpétuelle opposition entre le désir
et le devoir, entre le bonheur et la morale, la félicité chrétienne réunit en son sein la Joie
d’aimer et l’accomplissement du commandement de Dieu, qui communiquent et
communient dans un Amour universel.
1
1
: Pour ceux qui auraient profité de leurs vacances pour aller au cinéma voir Anna Karénine, il y a une très belle
illustration de cet état de « félicité » kierkegaardienne dans la Joie dont témoigne l’époux d’Anna alors qu’il
vient à la pardonner, elle et son amant. A la colère et à la haine, qui étaient suggérées par l’humiliation subi par
l’amour-orgueil, succèdent la sérénité inaccessible de la félicité chrétienne.
1
/
4
100%