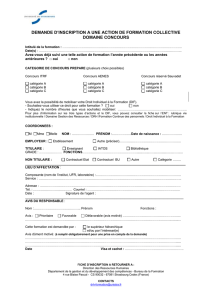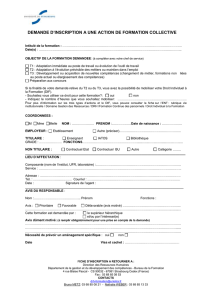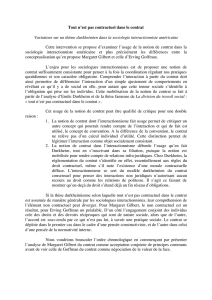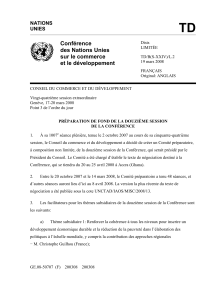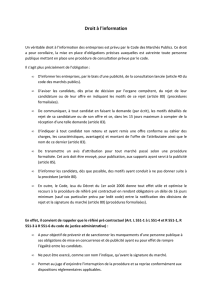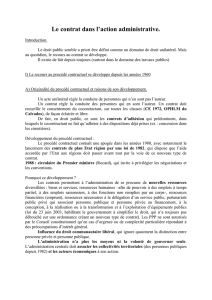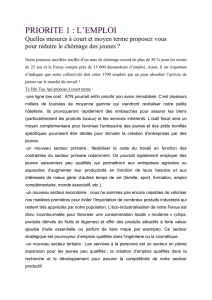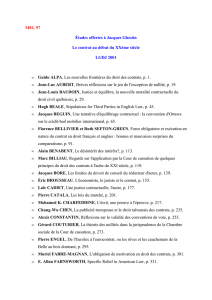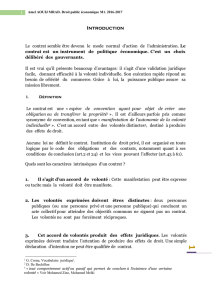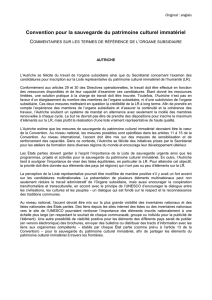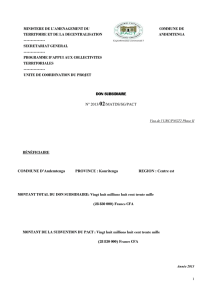Téléchargez le cours

1
UNIVERSITE LYON 2
FACULTE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
JOURNEE DE RENCONTRE ENTRE LES PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION, UNIVERSITE LYON2.
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES, ECONOMIE ET GESTION.
Mercredi 2 février 2005
INTERVENTION DE PIERRE DOCKES, PROFESSEUR D’ECONOMIE A
L’UNIVERSITE LYON2
Avertissement : il s’agit ici de notes prises à partir d’un exposé, ce qui n’est pas comparable
à un article rédigé par l’auteur. Notes prises par Jean FLEURY.
Le propos que je vais tenir aujourd’hui se place dans l’idée qu’il serait intéressant de
construire une théorie générale historique de l’Etat. Il faut faire attention aux fresques… mais
je pense qu’une telle théorie doit reposer sur une prise en compte de l’histoire longue.
Ce genre de travaux essaie de lier ensemble des disciplines diverses, comme l’histoire de la
pensée, la sociologie, l’économie, la politique… alors que, dans le discours scientifique
officiel, rien n’est plus mal vu que ces unions de disciplines.
Quand on étudie un objet aussi important que l’Etat aujourd’hui, on peut le prendre de
plusieurs façons. La question que je poserais est la suivante : « Comment les fonctions de
l’Etat se sont elles construites progressivement, par des a coup, des retours et des avancées »
Je voudrais réfléchir, à partir de l’histoire longue, sur ce qui se passe aujourd’hui dans la
construction de l’Etat.
A quoi sert l’Etat ? Comment comprendre ses formes et fonctions ?
Je vais partir de la plus ancienne métaphore utilisée à propos de l’Etat. La comparaison entre
l’Etat et le cerveau.
Les fonctions de l’état se sont surajoutées les unes sur les autres, comme un ensemble de
couches, depuis le « cerveau reptilien » jusqu’au cortex.
Dans cette métaphore, les différentes couches travaillent sous la direction d’une des couches.
Le cerveau humain joue le rôle de direction, mais il y a des inter-relations entre les différents
éléments.
J’aborderai deux parties :
1. La construction des fonctions de l’état (jusqu’au retournement de l’ordre productif
dans les années 1975-80)
2. La question de l’éventuel recul de l’Etat et ses fonctions actuelles.
On peut expliquer l’évolution présente à partir de l’évolution passée.
Pour commencer, on peut évoquer l’économiste R.A. Musgrave, qui définit les fonctions
économiques de l’Etat comme relevant de trois domaines : la redistribution, l’allocation, et la
régulation (The Theory of Public Finance, 1959). Il s’agit ici de le compléter par une
approche génétique permettant de découvrir d’autres fonctions. D’autre part, il serait

2
souhaitable de partir de l’Etat avant l’Etat, d’un paléo-État au sens où J.M. Servet parle de
paléo-monnaies. On constate une grande diversité des formes d’apparition de ce paléo-état,
son évolution vers la constitution des tribus, cités, royaumes et empires dans l’Antiquité.
Notons que cette notion de paléo-État peut aider à comprendre ce qui se construit aujourd’hui,
ce que nous nommerons ultérieurement un « néo-État ».
Je vais réfléchir sur la réémergence de l’Etat, à partir de l’aube des temps modernes.
I. L’ETAT S’EST CONSTITUE EN 4 STRATES SUCCESSIVES.
1. l’Etat garant de l’ordre public
Cela concerne les économies et sociétés d’ancien régime, jusqu’au milieu du 18° siècle.
Cet ordre public correspond immédiatement au courant économique « mercantiliste ». La
réflexion sur l’Etat est tout à fait centrale dans ce courant.
Il ne s’agit pas seulement d’un ordre sécuritaire, mais de l’idée qu’il s’agit de préserver ou de
consolider un lien social. « L’ordre public » apparaît comme la consolidation de ce lien social.
Ce lien social est pensé fondamentalement comme vertical : les relations entre les individus
sont médiatisées par la relation à l’Etat. Il en va de même des relations à la monnaie. Ce n’est
pas par hasard si la monnaie est pensée alors par rapport à l’Etat, tout comme l’échange, le
circuit économique, qui sont pensés en référence à l’Etat.
On parle des fonctions régaliennes de l’Etat, de l’« Etat-gendarme »… Mais cela ne peut se
résumer à cela ! La défense de l’ordre public recouvre des domaines beaucoup plus larges.
Par exemple, l’administration de la Justice : elle est pensée en termes d’ordre public. L’ordre
public, c’est dire que l’administration de la justice est pensée d’abord dans un but d’arbitrage
entre les parties, de façon à éviter les vendettas, les troubles à l’ordre public. L’Etat se
présente aussi comme l’institution qui doit veiller à l’ordre public, indépendamment à l’intérêt
des parties.
Cette perception tolère aisément l’arbitraire, dans la mesure où l’arbitraire ne crée par un
désordre de l’ordre public. L’Etat, le Prince a la possibilité de confisquer les biens et les vies :
cela apparaît comme dans l’ordre des choses. L’Etat intervient dans l’économie mais ces
interventions ne sont pas du tout du même ordre que celles que l’on connaîtra à la fin du XIX°
et au XX° siècle. Lorsque l’’Etat, intervient dans la vie économique, c’est dans l’objectif de
garantir l’ordre public. Ainsi, par exemple, les jurandes sont organisées sous la houlette du
Roi. L’objectif est bien l’ordre public et pas le bien-être. De même la « police des grains » :
nourrir les peuple, c’est bien l’objectif de l’Etat mais cela doit être compris dans la
perspective de l’ordre public (contrôler les « classes dangereuses » - expression qui ne viendra
que plus tard - ). De même les salaires tarifés, qui ne constituent pas une régulation
économique comme nous l’entendons aujourd’hui. Toute l’assistance aux pauvres est
également pensée en fonction de l’ordre public. L’Etat n’est pas là pour maximiser le
« welfare » des populations, mais pour garantir l’ordre public.
Dans cette perspective, le risque que présente l’Etat, c’est l’ « Etat-prédateur ». Dans la
mesure où il monopolise la « violence légitime » (cf Weber) il peut y avoir une oppression du
peuple. Cette oppression passe d’abord par la pression fiscale. La pensée de l’ancien régime
autour de la gabelle manifeste bien cela… et les revendications d’aujourd’hui (quant à la
baisse de la pression fiscale) n’ont rien à voir avec cela.
2. l’Etat garant de l’ordre contractuel.

3
Il s’agit d’une véritable révolution qui constitue un prélude à l’ordre libéral, à partir du
moment où l’Etat protège les droits de propriété privée, y compris contre lui-même, et donne
force aux contrats (« enforcement of contracts »). Il ne peut y avoir de transfert de propriété
privée autrement que par contrat et L’Etat garantit que les obligations souscrites ainsi seront
honorées.
A partir de là, l’Etat doit laisser faire, dans la mesure où le lien social, établi par le contrat
tient de lui-même. La seule division du travail et le commerce suffisent à établir le lien social
(liens horizontaux) ; cela définit un ordre contractuel qui débouchera sur la loi du marché. Et
l’on entre ainsi de plain-pied dans le XIX° siècle.
Le premier penseur de cet ordre contractuel, c’est Thomas Hobbes.
Hobbes raisonne encore dans le monde de l’ordre public. Il veut sortir de l’ « état de nature »
qui s’est réinstallé dans l’Angleterre de son temps et, pour cela, il est prêt à mettre en place un
ordre durement absolutiste. Mais , cet ordre établi, il suffit de laisser jouer les contrats : L’Etat
peut garantir la propriété privée et les contrats, dans la mesure où il garantit l’ordre public. Il
est ainsi le penseur de cette « nouvelle couche » que constitue « l’ordre contractuel ».
Cela limite considérablement l’intervention de l’Etat dans la vie économique. On en arrive à
l’idée du marché autorégulateur. Le marché étant sensé permettre un vrai développement. On
a ainsi affaire au véritable Etat-gendarme, avec le démantèlement de tous les organes de l’état
consacré à la fonction d’établir l’ordre public.
Le risque principal, n’est plus alors l’ « Etat prédateur », mais l’ « Etat opportuniste ». Dans
sa position d’arbitre, garant des contrats, il peut se placer dans une position favorable à une
partie contre les autres parties. On peut se référer ici aux affirmations de Karl Marx (l’Etat
gérant des intérêts du capital).
Sur cette couche, va se constituer la troisième strate.
3. L’Etat- subsidiaire, dans les failles de l’Etat contractuel
Lorsqu’il y a des carences au niveau microéconomique de l’allocation, au niveau macro
économique ou social, une nouvelle « couche » s’installe dans les failles de l’Etat contractuel.
Lorsque le marché ne fonctionne pas ou mal, on peut aborder le problème sous trois grandes
questions :
- l’ allocation
- la régulation macro-économique
- la régulation sociale
Quant au premier point, l’allocation, il s’agit, chaque fois que le marché ne réussit pas à
réaliser l’allocation optimale des différents individus et des différentes activités, de faire
intervenir l’Etat. On retiendra les cas où on est en présence biens collectifs, de monopoles
naturels, de rendements d’échelle croissants, d’effet de réseaux, ou d’externalités positives ou
négatives, chaque fois que l’État estime que les individus sont incapables de discerner ce qui
est bon ou mauvais pour eux, etc…Tout ce qui va correspondre aux welfare economics, à
l’économie publique.
Le penseur de cette transition est Léon Walras.
Cet homme va se trouver à un moment exceptionnel. Il est le penseur qui aboutit la pensée de
l’ordre contractuel, avec sa théorie de l’équilibre général et, en amont, avec son idée
fondamentale qu’ « il faudrait prouver que la libre concurrence permet d’atteindre au
maximum de l’intérêt individuel. » Et en chemin, il arrive à la conclusion que la libre

4
concurrence cela ne marche pas toujours, qu’il y a des failles. Par exemple, les monopoles
naturels, les rendements croissants, les services publics (« les monopoles moraux »).
Walras est en cela, le fondateur de l’économie publique. Celui qui fait aboutir la pensée néo-
classique est celui qui amorce la question de l’état subsidiaire. L’économie publique va faire
apparaître des exceptions. Lorsqu’on est en présence d’externalités positives (éducation,
santé) ou négatives (pollution), on va se retrouver dans la théorie néo-classique de l’état
optimal dans le cadre de l’Etat subsidiaire.
Cela amorce également la question de la régulation économique, de la politique économique,
destinée à lutter contre les crises et les dépressions, surtout les conséquences systémiques des
crises financières.
On reste ici dans le cadre de l’ « l’Etat infirmier ». Politique monétaire, financière, de
change…C’est vrai aussi pour des interventions meso-économiques, pour protéger des
secteurs en danger. L’appel à l’Etat se fait entendre pour toutes les catégories d’acteurs, et
surtout les plus puissantes (le capital).
Il faudrait encore parler des interventions en matière sociale, des intervention qui restent
exceptionnelle au niveau cette « couche » de l’État subsidiaire, c’est à dire lorsque le marché
s’avère incapable de maintenir les salaires au niveau de la productivité marginale du travail,
lorsqu’il exacerbe les inégalités par son mauvais fonctionnement ou lorsque l’offre de travail
ne peut s’adapter à la demande, finalement surtout lutter pour contre le paupérisme.
4. l’Etat et sa rationalité supérieure ou l’Etat organisateur.
Du fait de l’évolution socio-économique qui transforme les exceptions en normes (crises,
failles, etc.), émerge et s’impose une logique de l’ « Etat organisateur », qui se substitue peu à
peu à l’ « Etat subsidaire ».
L’idée qui se développe alors est que la rationalité de l’Etat est supérieure à la rationalité
privée. La coordination par l’Etat est supérieure à la coordination privée, décentralisée par le
marché.
C’est bien le balancement mis évidence par HAYEK : il va décocher ses flèches contre l’Etat
qui vise à l’organisation de la société. « Taxis » contre « cosmos » : organisation centralisée
contre organisation spontanée qui fait jaillir un ordre.
Selon la métaphore du cerveau, cela correspondrait au cortex : rationalité supérieure de
l’action de l’Etat (cf. l’idée qui serait propagée par le planisme d’un Henri de Man, les
courants dirigistes, certains newdealers, Keynes, le « marxisme occidental »). On a deux
versants très tranchés de cette idée de la rationalité de l’Etat : les démocraties occidentales
versus le fascisme et communisme. L’aboutissement logique en serait l’économie soviétique
avec les plan autoritaires, et l’idée de la supériorité rationnelle de l’Etat.
Ce qui est intéressant, c’est que cette idée est largement partagée par tout le monde occidental,
à un degré plus ou moins absolu, mais tout le monde admet la nécessité d’une intervention
dirigiste de l’Etat.
Le penseur de ce basculement vers une nouvelle conception est John Maynard KEYNES
C’est là encore l’auteur qui se situe dans la strate précédente mais qui, à partir de là, construit
la nouvelle strate. Il a largement une pensée de l’ « Etat subsidiaire », et pas de l’ « Etat
organisateur ». C’est un penseur très prudent. Mais, lui et les post-keynésiens vont être
amenés à être les penseurs de la rationalité supérieure de l’Etat.
II. LA SITUATION ACTUELLE
Que se passe-t-il aujourd’hui ?

5
La 4° strate s’est effondrée. La rationalité de l’état organisateur de la vie économique et
sociale est considérée comme inférieure à la coordination par le marché.
Que reste-t-il des idées correspondant à cette strate ? Par exemple de l’économie mixte ? Cette
couche fondamentale s’est effondrée. Il nous reste à nous interroger sur le « pourquoi ? ». Est-
ce que c’est un phénomène temporaire ? Quel est le rythme de l’histoire ?
L’effondrement du régime soviétique a été un moment crucial de l’effondrement de l’ « Etat
organisateur ». Mais ce n’est pas la cause.
La cause, c’est la transformation de l’ordre productif, l’apparition d’un méta capitalisme
productif : la globalisation, la transnationalisation, la mondialisation.
L’idée que l’Etat est capable d’organiser la vie économique et sociale perd tout son sens, dans
la mesure où la pensée de l’ « Etat organisateur » est intimement liée à la Nation (Etat-nation).
Comment l’Etat peut-il organiser des activités qui se développent hors de l’Etat nation ? On
assiste à une sorte de « dérive des continents » qui correspond à l’émergence et au
développement d’un nouvel ordre productif, un néo-capitalisme libéral, global, financier…
Il faudrait revenir sur les raisons profondes de l’effondrement de cette quatrième strate et
élaborer une pensée du futur.
Si l’on peut dire que la quatrième strate s’est effondrée, c’est plus complexe pour ce qui
concerne la troisième strate. Si l’on prend deux éléments de l’intervention de l’ « Etat
subsidiaire », celle de l’allocation et de la régulation économique, on voit que l’action de
l’Etat a évolué de façon différente dans les deux cas.
En ce qui concerne les externalités positives (santé, éducation, etc.), on assiste à un recul de
l’Etat. Mais, on constate une réelle présence réglementaire de l’Etat, lorsqu’il s’agit des
relations entre les entreprises, de la finance, dès que c’est nécessaire. Il faudrait regarder de
près l’ensemble des systèmes qui se substituent aux services publics ( à la française). Ce n’est
pas la loi du marché qui s’impose partout ou, du moins, l’Etat reste souvent à l’arrière plan, en
instance de surveillance en dernière instance.
Sur le plan de la régulation macroéconomique, aux Etats-Unis d’Amérique, dans les situations
de crise, on voit l’Etat remonter au créneau avec une puissance et une efficacité très
importante dans la régulation. Observons la politique financière, monétaire, de change des
USA lors des cracks précédents. 300 milliards de dollars sont immédiatement injectés dans
l’économie après le 11 septembre 2001 ; avec 500 milliards de déficit contre 236 milliards de
dollars en 2000 : on est passé de +2,5 du Pib à – 5% du PIB, ce qui a une énorme incidence !
On obtient 7,5% de différentiel en deux ans. De plus, on constate une baisse des impôts,
qu’on pourrait appeler « de classe ». Surtout, l’État-infirmier s’est porté s’est porté au secours
des assurances, des compagnies d’aviation, de l’agriculture… la sidérurgie, l’automobile… Il
y a une coopération organisée entre l’Etat, les services techniques des ministères américains,
les grandes entreprises, les universités… Ils ont constitué des institutions visant à
l’innovation, à la recherche, mobilisant des moyens colossaux, dans lesquels l’Etat est
présent.
Qu’en est-il de l’Europe ? En ce qui concerne l’Euroland, on a un ensemble où il n’y a pas de
gouvernement économique ! Pire, il n’y a pas de gouvernement économique global tandis que
l’Europe a mis en place de grandes contraintes sur les gouvernements économiques
nationaux. La banque centrale européenne, du fait des contradictions entre pays, est
condamnée à la non-intervention. On est actuellement dans une situation intermédiaire dans
laquelle il n’y a pas de possibilité d’intervention puissante ni au niveau industriel, ni au
niveau financier, et que ce soit par des politiques nationales ou au niveau européen. Une
impuissance donc qui tient à cette situation « au milieu du gué ». Si l’on prend la politique de
change, il y eu 40% de dévalorisation du dollar par rapport à l’euro et la banque centrale
 6
6
 7
7
1
/
7
100%