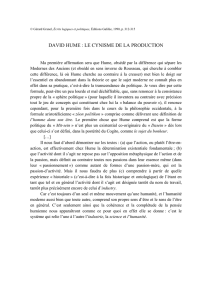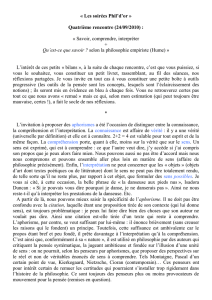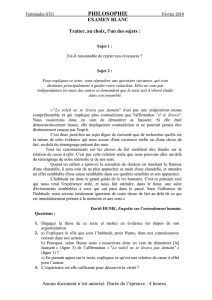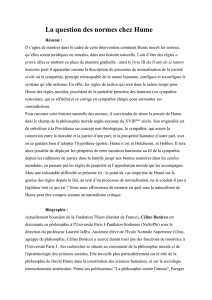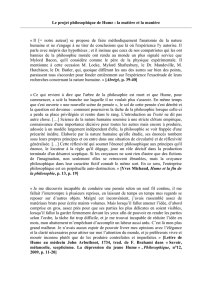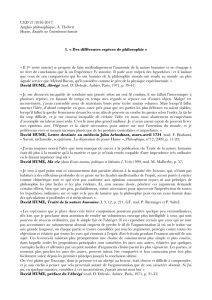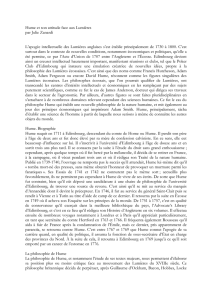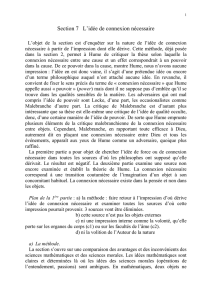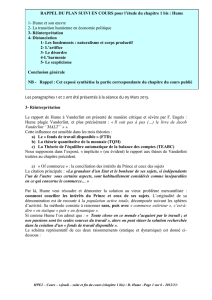Deux observations préalables :

1
La réception des Philosophical Essays en France :
Métaphysique, science et méthode
(draft)
___________________
Michel MALHERBE
(Université de Nantes)
Introduction.
Permettez-moi de commencer, à la manière de Hume dans ses essais, par deux observations
préalables dont, je crois, il aurait été content :
1) Les voies de la réception et de la tradition d’une œuvre sont toujours singulières. Qui
peut prévoir le destin d’une idée, d’une thèse, d’un argument, même fondateur ? Il suffit parfois
d’une rencontre, d’une conversation, d’un échange épistolaire, d’une bonne traduction, d’une
demande institutionnelle, pour en détourner le cours. Comme le dit Hume lui-même, il est plus
difficile de distinguer des régularités dans l’histoire des Lettres et des Sciences que dans
l’histoire civile et politique ; et toute explication historique doit laisser sa place au hasard.
2) La diffusion des œuvres au XVIII° siècle était publique, je veux dire : elle n’était
aucunement réservée à une élite universitaire soucieuse d’exactitude historique ou de rigueur
argumentative. Nous avons aujourd’hui rangé les livres des philosophes dans le musée de
l’histoire ou leurs arguments dans cet autre musée qu’est celui des paradigmes. Or, nous
pouvons envisager un tout autre mode de réception et de conservation d’une œuvre : outre le
plaisir de la lire quand elle est bien écrite, et de s’instruire, quand elle est informée et avisée,
l’on peut en faire un usage, la changer en un instrument.
Et c’est dans cet esprit de l’usage d’une œuvre que je voudrais développer mon propos. Je
voudrais m’arrêter à cette idée de l’instrumentalisation d’une œuvre.
Mais il me faut d’abord écarter une objection, celle qui consiste à dire que l’usage fait par
un autre de l’œuvre d’un philosophe ne nous instruit que de l’histoire de l’œuvre et non de son
contenu philosophique. En effet, dira-t-on, les intentions de ceux qui font usage sont étrangères

2
à l’œuvre du philosophe ; le rapport de l’œuvre à son usage n’est que de simple causalité, et un
tel rapport est soumis aux circonstances.
A cette objection, je puis répondre deux choses :
1) à tout le moins faut-il que l’œuvre présente un certain intérêt pour celui qui se propose
d’en faire usage, cet intérêt fût-il d’opportunité dans le contexte philosophique ou idéologique
donné.
2) cet intérêt doit être motivé par une certaine qualité de l’œuvre, qualité assez reçue pour
être considérée comme manifeste. Cette qualité n’est pas un objet d’interprétation ou ce qu’un
commentaire strict permettrait d’exhumer ; elle est apparente ; de même qu’un outil est employé
pour sa propriété manifeste, qu’on ne discute pas.
Ceci posé, j’en viens à mon objet :
L’œuvre de Hume à considérer : les Philosophical Essays (An Enquiry concerning Human
Understanding).
La qualité retenue de l’œuvre : le scepticisme attaché à la doctrine humienne de la
causalité
1
.
L’usage : à titre exemplaire, je retiendrai deux emplois qui sont faits de cette doctrine
sceptique et critique de la causalité, l’un par G. J. Holland et le Père Bergier pour appuyer leurs
réfutations du Système de la nature de d’Holbach ; l’autre, par Paul-Joseph Barthez, dans ses
Nouveaux éléments de la science de l’homme (Montepellier 1778 ; 2ème édition en 1806). Je
justifierai progressivement ce double choix.
Pour mieux marquer cette réception utilitaire, j’évoquerai d’abord la seule réception
proprement critique qui ait été faite des Philosophical Essays, non pas à Paris, mais à Berlin, au
sein de l’Académie de Prusse. Mais au préalable il me faut procéder à un bref rappel historique.
En conclusion, je reviendrai sur le point plus général de savoir si une réception
instrumentalisante peut être considérée comme une réception philosophique et si, en
conséquence, l’auteur d’une œuvre peut être considéré comme étant responsable de l’usage qui
est ensuite fait par d’autres de cette œuvre.
1
Il est très certain que depuis toujours les arguments du scepticisme ont été employés à des fins diverses.
En ce sens, le scepticisme de Hume ne déroge pas à la règle. Mais étant attaché à la doctrine de la
causalité, il offre des ressources nouvelles qui dépassent le simple jeu de la critique ou de la dialectique.

3
I. Quelques données historiques
2
.
1739-1741 : réception remarquable, mais sans lendemain, du Treatise of Human Nature,
dans trois journaux publiés en Hollande et principalement animés par des émigrés français
appartenant à l’Eglise Réformée.
1741-1752 : si l’on met de côté l’échange de Hume avec Montesquieu, entre la première
réception du Treatise et la parution des Political Discourses, aucune recension d’importance (à
ma connaissance !) n’est donnée des ouvrages de Hume parus entre temps. Les Essays Moral
and Political sont ignorés (L. Bongie a montré que la censure royale avait refusé une traduction
des Essays présentée par le libraire Lambert en 1751). Le premier texte de Hume traduit
apparaît en 1751 dans un petit journal qui ne vécut pas longtemps, Le petit réservoir : il s’agit
de l’essai « Of Polygamy and Divorce ». Quant aux Philosophical Essays, ils sont annoncés
dans les ‘nouvelles littéraires’ de la Bibliothèque raisonnée, qui vit encore, mais avec un très
bref commentaire, il est vrai intéressant pour la suite de notre propos : « Est-ce badinage ou
enthousiasme ? Peut-être l’un et l’autre ; et quiconque examine de près un déiste, découvre qu’il
a commencé ou du moins qu’il finira par être fanatique »
3
.
En 1752 : le même journal donne un bref résumé de l’Enquiry concerning the Principles of
Morals ((Bibliothèque raisonnée, XLVII, 1752, 229-32).
Toutefois, à partir de 1751, le Journal Britannique, nouvellement créé, qui s’est donné pour
mission d’informer les lecteurs français sur toutes les publications nouvelles qui paraissent en
Angleterre, annonce très rapidement la parution des Political Discourses et de l’Enquiry
concerning the principles of Morals
4
. Le journal fait référence à la réputation de scepticisme
déjà établie de notre philosophe, lequel se montrerait plus positif dans ses essais sur l’économie.
Des extraits sont donnés, dans des numéros suivants.
En 1754, dès son premier numéro, le Journal étranger, annonce la seconde (la troisième ?)
édition des Political Discourses.
En 1754 apparaissent, presque simultanément, deux traductions des Political Discourses,
l’une par Eleazar de Mauvillon dont Hume n’a pas de connaissance immédiate, et l’autre par
l’abbé Le Blanc qui lui en envoie une copie. Une correspondance s’ensuit entre les deux
hommes. Ce sont ces traductions qui vont faire la célébrité de Hume en France, avant que cette
célébrité ne prenne une dimension exceptionnelle avec la traduction de L’histoire d’Angleterre.
2
Ces données historiques sont extraites d’une étude assez longue que j’ai faite, ‘Hume’s reception in
France’, à paraître dans un collectif consacré à la réception de Hume en Europe, sous la direction de Peter
Jones. Je me borne ici aux informations utiles à mon propos.
3
Bibliothèque raisonnée, XL, 1748, 474.
4
Journal britannique, VII, 1752, 225-31.

4
Le Blanc déprécie la traduction de Mauvillon auprès de Hume (alors que Grimm dans sa
Correspondance littéraire
5
fait l’inverse) et tente de s’instituer traducteur ‘officiel’ du
philosophe écossais.
Mais la traduction de Mauvillon est recensée dans la Nouvelle bibliothèque germanique par
Samuel Formey avec assez de détail
6
, tandis que l’Année littéraire, recensant la traduction de Le
Blanc, donne un sommaire assez objectif des douze discours et confirme la réputation de
Hume : « Monsieur Hume est sans contredit un homme de génie, mais un peu sceptique »
7
. Etc.
Il n’est pas nécessaire de poursuivre ici le détail du considérable succès des Political
Discourses.
On notera que dans les années 1755 les Philosophical Essays sont encore quasi inconnus.
Nous avons dit que la Bibliothèque raisonnée en avait annoncé la parution dans son numéro
d’avril-juin 1748. La mention suivante qui en est faite est indirecte : en 1752 le Journal
britannique recense le livre de William Adams sur les miracles, An Essay on Mr. Hume’s Essay
on Miracles, et à l’occasion résume rapidement cet essai. La Bibliothèque des Sciences et des
Beaux Arts fait de même, en recensant le livre de John Leland, a View of the principal deisticcal
Writers that have appeared in England, dont les quatre premières lettres étaient consacrées à la
critique des essais 4 et 5, 11 et 10 des Philosophical Essays. Le journal, animé par des
protestants à la Haye, se livre à une critique virulente de la doctrine humienne, laquelle est
censée mettre en danger la religion.
Cette discrétion peut se comprendre pour deux raisons : il n’en existe pas encore de
traduction et peu de libraires sont prêts à affronter la censure sur un texte aussi explosif. Hume,
pour sa part, avait répondu très favorablement au projet de Le Blanc de traduire l’ensemble de
ses œuvres. Mais la chose ne se fit pas pour diverses raisons et il faut attendre les années 1758-
1760 pour qu’une traduction des Œuvres philosophiques de Mr. David Hume paraisse enfin à
Amsterdam, les Essais philosophiques occupant les deux premiers volumes de la collection
(1758).
La chose s’est faite de la manière suivante. Le Blanc avait envoyé un exemplaire de sa
traduction à Maupertuis, qui était alors le président de l’Académie de Berlin ; lequel Maupertuis
accuse réception de l’ouvrage avec enthousiasme
8
. Sans doute à son initiative, le jeune Jean-
Bernard Mérian écrit un précis des Philosophical Essays, précis qui fut publié par Formey, sous
forme d’extraits, dans les deux volumes des Mélanges littéraires et philosophiques
9
. Le même
Formey au début du premier extrait mentionne la traduction allemande (1755) préfacée par
5
Grimm, août 1754, ( ed. Tourneux II) 478.
6
Nouvelle bibliothèque germanique, XV, 1754, 410-435.
7
L’Année littéraire, 1754, V, 73-97.
8
Cf. Letters of David Hume, I, 225-7.
9
Voir volume I, (1755), article VI, 49-78 et article XVI, 180-203.

5
Sulzer et dont il fait ensuite la recension dans la Nouvelle bibliothèque germanique. C’est
d’ailleurs plus qu’une recension, puisque les numéros suivants du journal donneront extraits
après extraits (près de 120 pages au total !)
10
. Lorsque, enfin, la traduction, excellente (Formey a
revu le français de Mérian), paraît en 1758 (elle avait été annoncée prudemment quelques mois
auparavant), elle est précédée d’une longue introduction, incorporant, à titre de précaution, des
passages tirés de l’ouvrage de John Leland
11
et elle est annotée par Formey..
Récapitulons quelques traits de ce bref exposé :
1) Les Philosophical Essays ne furent guère connus avant d’être traduits ; et cette
traduction fut faite assez tardivement, c’est-à-dire dix ans après l’édition originale, alors
que la réputation de Hume en France était déjà établie, sans être encore à son apogée ;
2) La réputation de Hume comme étant un philosophe sceptique (le Treatise
restant ignoré et les Political Discourses ne pouvant prêter par eux-mêmes à une telle
appréciation) a précédé la connaissance des textes ;
3) Cette réputation n’empêche pas une excellente réception (que j’ai analysée
ailleurs) des contenus positifs des Political Discourses, qui entraîneront dans leur
sillage le succès après coup des Essays Moral and Political ; avant que la traduction de
L’Histoire d’Angleterre ne consacre le philosophe écossais comme philosophe
impartial.
II. La réception du scepticisme humien par les philosophes
Ainsi, la traduction des Philosophical Essays est-elle tardive et elle est faite à un moment où
la notoriété de Hume en France est assez grande pour que, avec quelques précautions, l’ouvrage
puisse passer la barrière de la censure. On pourrait attendre que, ayant passé ce cap, le texte ait
attiré l’attention des philosophes, de ces philosophes qui allaient devenir les plus proches amis
du bon David, lors de son séjour à Paris, à partir de 1763. Or il n’en est rien.
Laurence Bongie
12
avait attiré l’attention sur ce paradoxe qu’on ne peut que confirmer.
Quelques observations suffiront sur ce point.
10
Nouvelle bibliothèque germanique, XIX, 1756, 78-109, 311-333; XX, 1757, 57-87, 268-298; XXI, 1757, 65-81.
11
Malgré toutes ces précautions, et la démarche du libraire Schneider auprès de Malesherbes, l’ouvrage
n’obtint pas la permission et fut mis au catalogue des livres prohibés ; il obtint même d’être mis au pilon
de la Bastille, ce qui fut une excellente publicité.
12
L. Bongie, “Hume, ‘Philosophe’ and Philosopher in Eighteenth-Century France”, French Studies, XV, 1961, 213-
22.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%