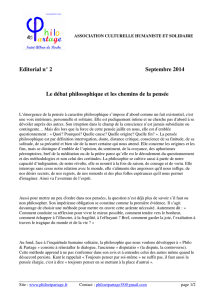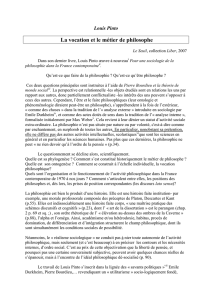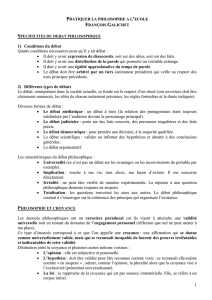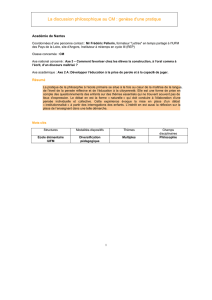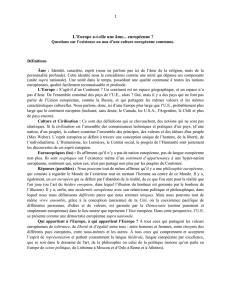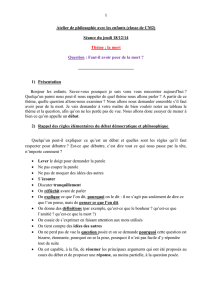La connaissance philosophique

LA CONNAISSANCE PHILOSOPHIQUE
I. L’INTELLIGIBILITE PHILOSOPHIQUE
A. LA QUESTION PHILOSOPHIQUE ET SA SPECIFICITE
TRANSCENDANTALE.
1. La « surgénéralité » comme caractère propre de la
question philosophique.
Questionner, c’est chercher une intelligibilité selon l’une ou
l’autre des méthodes fondamentales. Il n’y a pas d’intelligibilité
unique et uniforme de la réalité. Son idéal réside au contraire
dans sa différenciation, conformément à la nature structurée de
l’esprit humain. En conséquence, c’est selon cette originalité
différenciée que chaque forme d’intelligibilité fondamentale
s’accorde avec les autres, conformément aussi à la nature
structurée de l’esprit humain. On ne peut pas dire qu’en
recherchant une intelligibilité générale de la réalité, on englobe
les intelligibilités particulières et on en fait l’unité, les ramenant
ainsi à l’unicité, car une intelligibilité générale en ce sens
n’existe pas. Une intelligibilité formulée en un haut niveau de
généralité, ultime et insurpassable, comme l’intelligibilité philo-
sophique, est elle-même une intelligibilité particulière à côté des
autres formes d’intelligibilité. Il n’est pas possible de poser « la »
question la plus générale, la question qui par sa généralité
engloberait toutes les autres questions particulières qui
achèveraient de la déterminer, et de lui trouver une réponse qui
engloberait toutes les réponses.
Mais il est possible de poser la question qui concernera toutes
les questions et d’étudier la question en tant que telle, c’est-à-
dire de poser la question la plus générale qui soit en son ordre :
« Qu’est-ce que questionner ? » et de lui chercher une réponse.
« Qu’est-ce que je fais quand je pose une question ? » L’acte
de questionner traduit l’initiative de l’esprit. Aussi peut-il être
mis en question par celui qui le pose. Cette interrogation valable
de toutes les questions ne porte cependant pas sur le sens de telle

LA CONNAISSANCE PHILOSOPHIQUE
2
question particulière si générale soit-elle dans sa formulation.
Aussi la question : « Qu’est-ce que questionner ? » est-elle diffé-
rente de cette autre question : « Que signifie telle question ? » ;
par exemple cette question : « Qu’est-ce que l’être ? »
Bien que d’une généralité ultime l’une et l’autre, elles sont
des questions particulières parmi les autres. La « généralité »
insurpassable de la question : « Qu’est-ce que questionner ? »
n’est pas une généralité obtenue par une « abstraction », c’est-à-
dire par élimination de qualités particulières et par extension de
plus en plus vaste des propriétés considérées comme communes,
mais une généralité due à la considération de l’exercice même de
questionner quels que soient le contenu ou l’objet de la question,
c’est-à-dire de son questionnaire. Qu’en est-il, en revanche, de la
généralité de la question : « Qu’est-ce que l’être ? » Cela a déjà
fait l’objet d’innombrables discussions entre philosophes. Nous
lui consacrerons un chapitre à la fin de notre deuxième partie,
lorsque notre pensée sera mieux outillée pour prendre position
dans ce problème, c’est-à-dire lorsqu’elle se comprendra mieux
elle-même comme capable de poser cette question : « Qu’est-ce
que l’être ? » et donc d’y répondre.
Cependant, comme la question : « Qu’est-ce que l’être ? »
est philosophique, et même une question majeure de la philo-
sophie, il convient de savoir d’abord ce que c’est que s’interroger
philosophiquement. Nous répondrons que c’est s’interroger
« réflexivement » ; c’est s’interroger comme nous venons de le
faire, par exemple sur notre acte même de questionner, et cher-
cher une réponse à ce genre de question, c’est comprendre ce que
je fais en posant cet acte même de questionner. La réponse est
donc enveloppée dans l’exercice même de la question et il ne
m’est pas possible de ne pas l’apercevoir — ce qui ne veut pas
dire qu’on l’aperçoit instantanément et d’emblée — ou de la
refuser sans tomber dans le ridicule de dire ne pas comprendre ce
que je prétends faire en pleine connaissance et conscience. Ainsi
je sais réflexivement que poser une question, c’est non seulement
reprendre le questionnaire de ma question en une succession de
questions qui l’explicitent et le précisent, ainsi que nous l’avons
vu en étudiant le processus général de recherche, mais c’est, au
moment même où je pose ma question comprendre ce que je fais
quand je questionne et c’est poser en conscience le jugement que
je suis en acte de questionner. Lorsque je pose une question, je

LA CONNAISSANCE PHILOSOPHIQUE
3
me saisis sans intermédiaire en activité de questionnant, c’est-à-
dire en exercice de « questionnement ».
Si donc je m’interroge sur cet exercice, et pas seulement sur
son questionnaire, je pose vraiment une question philosophique.
Ce n’est sans doute pas la première que l’homme se pose en
progressant dans la vie, mais telle est bien la première des ques-
tions philosophiques dans l’ordre méthodologique, celle qui
prend pour objet, en son questionnaire, l’acte même de question-
ner et le jugement de conscience qui y est impliqué, est bien le
premier jugement. Celui-ci atteste que les « vraies » questions
philosophiques, celles qui sont posées vraiment philosophique-
ment, ce sont celles dont le questionnaire porte sur l’exercice
même de ces activités dont nous avons une conscience
immédiate et qui sont en elles-mêmes activité de conscience.
Nous pouvons même les dire « conscientes » d’elles-mêmes, en
tant qu’elles sont des manières d’être du sujet conscient. Aussi
c’est parce que nous avons une conscience immédiate et exercée
de notre activité questionnante que nous avons pu, au chapitre
précédent, affirmer qu’en questionnant nous obéissions à une
double exigence d’intelligibilité et de fidélité.
Nous pouvons maintenant compléter notre réponse. Nous
comprenons en effet que nous ferons de la philosophie si nous
inventons, à de vraies questions philosophiques, c’est-à-dire à
des questions réflexives, une réponse selon cette voie réflexive
de la connaissance. Cela signifie que nous devons poursuivre une
intelligibilité appropriée : évidence réflexive, complétude ou
intégralité réflexive, unité réflexive, universalité réflexive et que
nous devons nous exprimer en un langage également approprié,
c’est-à-dire sans nous laisser piéger par les schémas objectifs des
symboles que nous employons. Dans le discours philosophique,
ils sont la médiation de la prise de conscience progressive de nos
activités, c’est-à-dire de leur accomplissement de plus en plus
conscient, car nous en exprimons la signification en l’associant à
certaines de nos perceptions dont le donné est d’abord matériel.
La conscience humaine tandis qu’elle s’actualise en ses rela-
tions s’exprime à elle-même par le truchement de symboles. Ce
faisant, elle se révèle en cet acte à elle-même comme conscience
incarnée, comme conscience d’autant plus conscience qu’elle
s’incarne, c’est-à-dire qu’en symbolisant, elle se rend comme
être spirituel présent dans la matière, sans se matérialiser, et se
sert de la matière pour se dire et se bâtir comme esprit. Comme

LA CONNAISSANCE PHILOSOPHIQUE
4
nous le verrons par la suite, cette conscience de soi est aussi
inséparable de la conscience d’autrui, et c’est par rapport à autrui
que le symbole est chargé, de la façon la plus significative, de
notre propre présence.
2. L’aspect d’exercice et l’aspect de détermination.
Si nous avons pu répondre comme nous l’avons fait aux
questions : « Qu’est-ce que questionner ? » et « Qu’est-ce que
questionner philosophiquement ? » c’est parce que nous avons en
fait déjà « réfléchi » en notre activité : celle de questionner et que
nous avons exprimé notre réflexion.
Nous pouvons aussi remarquer qu’en faisant cela nous
avons, par la démarche même de notre pensée, distingué dans la
question, d’une part le « questionnaire » de la question, c’est-à-
dire l’action d’interroger à propos de quelque chose et d’autre
part le « questionnement » lui-même, c’est-à-dire l’action
d’interroger à propos d’un sujet donné quel qu’il soit.
Ainsi dans l’analyse de l’activité questionnante nous décou-
vrons déjà qu’il existe un point de vue fondamental d’où le
philosophe, considérant la réalité, y découvre dans l’unité une
dualité d’aspects, chaque aspect renvoyant à l’autre, et n’étant
possible que dans l’unité qu’il forme avec l’autre.
Ainsi, il n’y a pas de question réelle qui ne soit comprise
comme une synthèse de deux aspects analytiques. Tout ques-
tionnement est questionnement d’un questionnaire et tout
questionnaire est questionnaire d’un questionnement. Il n’existe
pas de questionnaire sans questionnement ni de questionnement
sans questionnaire. L’un de ces aspects, exprimé dans un langage
caractérisé par la « généralité » est l’aspect d’exercice : tel le
questionnement ; l’autre exprimé dans un langage caractérisé par
sa particularisation est l’aspect de « détermination » de l’activité.
Comme les rapports de généralité et de particularité sont
spécifiques de la détermination de nos concepts, il ne faudrait
pas ramener l’aspect d’exercice à un niveau de simple généralité
déterminative.
Pour parler d’une activité en la distinguant sous son aspect
d’exercice, on emploiera aussi souvent, avec une dimension
symbolique, le singulier du nom qui la désigne, par exemple : la
parole. Il ne s’agit pas d’un singulier numérique qui implique la
considération d’un pluriel. Le pluriel quant à lui selon un emploi

LA CONNAISSANCE PHILOSOPHIQUE
5
symbolique permettra également une considération de l’activité
sous l’angle de ses déterminations, par exemple : les paroles. Par
de tels artifices de langage (généralité du terme selon un emploi
grammatical singulier) qu’il ne faut pas comprendre comme s’ils
exprimaient une classification objective ou un dénombrement
sommaire, la distinction, rencontrée entre le « questionnement »
et le « questionnaire » dans l’unité concrète de la question,
trouvera une formulation parallèle pour toutes les autres formes
d’activité humaine. Elle aura ainsi sa place en toute analyse
réflexive de la réalité.
Ce discernement entre l’aspect d’exercice et l’aspect de dé-
termination de nos activités est essentiel à la démarche
réflexive. Cette distinction ne doit pas être comprise — ainsi que
le firent les aristotéliciens — comme un rapport de généralité
entre des termes plus ou moins généraux et plus ou moins
particuliers, ni comme un rapport d’unité et de multiplicité.
Même si, sur le plan du discours conceptuel, cette distinction se
formule au travers d’un rapport de généralité et par l’apparition
du singulier et du pluriel grammatical, et même si l’exercice, en
ce qu’il a de plus fondamental, se laisse comprendre comme une
réalité unique et se laisse décrire en ces termes que la
philosophie classique appelle « transcendantaux », parce qu’ils
sont du degré de généralité suprême ; la détermination de
l’exercice n’est pas une « particularisation » limitative de
l’exercice, ni la cause de sa multiplication. Inversement celui-ci
ne peut être pensé comme infini ou unique, au cas où il n’aurait
pas de détermination.
Réciproquement, nous dirons que les significations de for-
mules générales, telle la classique expression aristotélicienne de
« l’être en tant qu’être », ne peuvent trouver leur intelligibilité
que dans l’intuition de notre exercice d’être, perçu à des niveaux
de réflexion plus ou moins profond, sous peine de rester un
artifice purement verbal, produit d’un automatisme linguistique.
Le transcendantal philosophique — le plus haut niveau de géné-
ralité de la pensée philosophique — n’est pas un transcendantal
objectivé et abstrait. La généralité ultime et insurpassable de la
pensée n’est pas une généralité d’absolue indétermination.
3. Le transcendantal d’exercice relationnel et
l’indéfini de généralité discursive.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
1
/
55
100%