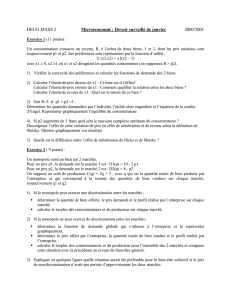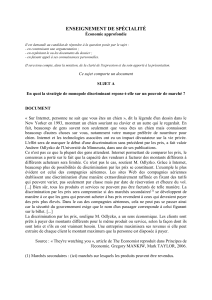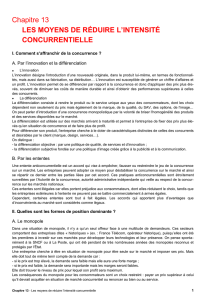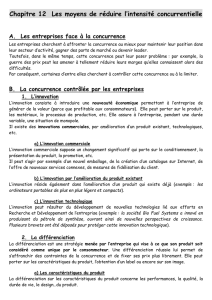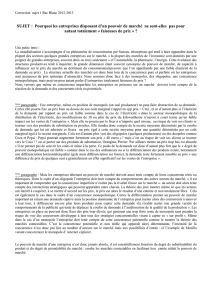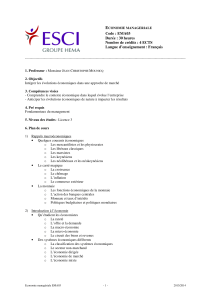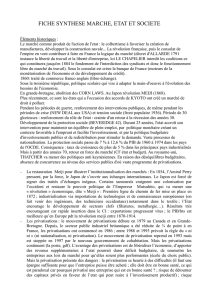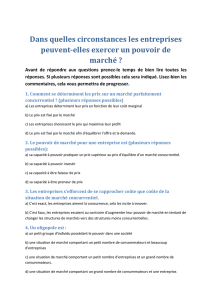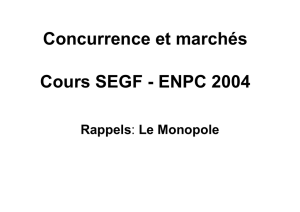ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ Économie approfondie Il est

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
Économie approfondie
Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet :
- en construisant une argumentation ;
- en exploitant le ou les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles.
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.
Ce sujet comporte un document
SUJET B
En quoi la stratégie de monopole discriminant repose-t-elle sur un pouvoir de marché ?
DOCUMENT
« Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien », dit la légende d'un dessin dans le
New Yorker en 1993, montrant un chien souriant au clavier et un autre qui le regardait. En
fait, beaucoup de gens savent non seulement que vous êtes un chien mais connaissent
beaucoup d'autres choses sur vous, notamment votre marque préférée de nourriture pour
chien. Internet et les technologies associées ont eu un impact dévastateur sur la vie privée.
L'effet sera de marquer le début d'une discrimination sans précédent par les prix, a fait valoir
Andrew Odlyzko de l'Université du Minnesota, dans une de ses publications.
Ce n'est pas ce que la plupart des gens attendent. Internet permettant de comparer les prix, le
consensus a porté sur le fait que la capacité des vendeurs à facturer des montants différents à
différents acheteurs sera limitée. Ce n'est pas le cas, soutient M. Odlyzko. Grâce à Internet,
beaucoup plus de possibilités de discrimination par les prix se constituent. L'exemple le plus
évident est celui des compagnies aériennes. Les sites Web des compagnies aériennes
établissent une discrimination d'une manière extraordinairement raffinée en fixant des tarifs
qui peuvent varier, pas seulement par classe mais par date de réservation et d'heure du vol.
[...] Bien sûr, tous les produits et services ne peuvent pas être facturés de telle manière. La
discrimination par les prix sera compromise si des marchés secondaires(1) se développent de
manière à ce que les gens qui peuvent acheter à bas prix revendent à ceux qui devraient payer
des prix plus élevés. Dans le cas des compagnies aériennes, cela ne peut pas se passer ainsi
car la sécurité du gouvernement exige que le nom d'un passager corresponde à celui figurant
sur le billet. [...]
La discrimination par les prix, souligne M. Odlyzko, a un sens économique. Les clients sont
prêts à payer des montants différents pour le même produit ou service, selon la façon dont ils
sont lotis et s'ils en ont vraiment besoin. Une entreprise maximisera ses revenus si elle peut
extraire de chaque client le montant maximum que la personne est disposée à payer.
Source : « They're watching you », article de The Economist reproduit dans Principes de
l'économie. Gregory MANKIW, Mark TAYLOR, 2006.
(1) Marchés secondaires : (ici) marchés sur lesquels les produits peuvent être revendus.

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
Correction sujet B - En quoi la stratégie de monopole discriminant repose-t-elle sur un
pouvoir de marché ?
En 2008, un rapport parlementaire portant sur la tarification des billets de train par la SNCF notait que peu de
voyageurs payent le même prix pour un trajet donné. Ce rapport, réalisé au nom de la commission des Finances de
l'Assemblée, et intitulé "Le consommateur a le droit de comprendre", ne conteste pas la différenciation des prix opérée par
l’entreprise, mais revendique une plus grande transparence tarifaire pour les consommateurs.
Cette différenciation des tarifs pour un même bien correspond à une pratique de monopole discriminant. Nous
étudierons dans un premier temps comment cette stratégie est mise en œuvre afin de montrer qu’elle repose nécessairement
sur un pouvoir de marché.
Une stratégie de monopole discriminant vise à capter la totalité de la disposition à payer de chaque consommateur
afin d’accaparer la totalité du surplus du consommateur au profit de l’entreprise. Les services vendus doivent être alors
différenciés pour justifier les différences de prix entre le service vendu le plus cher aux consommateurs qui ont la plus forte
disposition à payer et le service vendu le moins cher à ceux dont la disposition à payer est la plus faible.
Cette pratique est fréquente dans l’hôtellerie ou le transport. Dans le secteur aérien, elle est connue aussi sous le
nom du « yield management ». Il s’agit de proposer, pour un même trajet Paris-New York par exemple, des services différents
en termes de confort (classe affaire, 1ère classe, classe économique), de services annexes (priorités d’enregistrement, qualité
des repas à bord, …), de possibilités d’échanges de billets ou de remboursement, … Pour des chambres d’hôtel, les tarifs
peuvent aussi être différenciés en fonction de la qualité de la chambre, de son orientation, des services optionnels (wi-fi, mini-
bar, accès aux salles de sport, …), des dates de réservation, … Pour le train, les tarifs varieront en fonction de la date d’achat
(à l’avance ou en dernière minute), du taux de remplissage des trains, de la possibilité d’échanger ou non le billet, de la date de
départ (vacances, week-ends ou semaine), des cartes de fidélité achetées (selon l’âge ou la fréquence des trajets), …
Cette discrimination par les prix fonctionne bien lorsque les consommateurs peuvent assez difficilement différer leur
consommation dans le temps (c’est souvent au moins partiellement le cas pour les voyages, qu’il s’agisse de voyages d’affaires
ou de tourisme) et lorsque les consommateurs potentiels ont des caractéristiques différentes et donc des attentes différentes
(comme pour les voyageurs d’affaires ou de loisirs).
Cette discrimination par les prix suppose néanmoins que l’entreprise dispose d’un pouvoir de marché (c’est-à-dire
d’une capacité à accroître ses prix sans perdre de clients) relativement important. En d’autres termes, cette stratégie nécessite
que la concurrence soit limitée sur le marché. D’ailleurs, si l’on observe ces stratégies de différenciation des prix dans d’autres
structures que les monopoles (par exemple dans certaines situations d’oligopole ou de concurrence monopolistique), elle n’est
pas possible en situation de concurrence.
En effet, plus l’élasticité de la demande par rapport au prix est faible, plus le monopole peut fixer un prix élevé. Au
contraire, plus elle est forte, plus le monopole a intérêt à fixer un prix bas. Or, cette élasticité-prix de la demande dépend en
partie du niveau de la concurrence. Par exemple, on constate que si le prix des vols pour les hommes d’affaire sont
relativement élevés, cela s’explique par le fait qu’il leur est plus difficile d’arbitrer entre un nombre limité de concurrents sur un
long-courrier sans escale sur des dates fixes. Au contraire, dans le cas des voyages de tourisme pour des destinations plus
proches, la concurrence est plus vive avec le rail ou la voiture et il y a davantage de trajets low-costs, car l’élasticité-prix de la
demande est alors plus élevée.
Cette discrimination par les prix est aussi d’autant plus efficace qu’il est difficile pour le consommateur de repérer le
meilleur rapport qualité-prix. Or, la multiplication des services proposés par les monopoles discriminants limite cette capacité du
consommateur à choisir entre les différents concurrents éventuels lequel propose ce meilleur rapport qualité-prix. Par sa
stratégie de différenciation des services, l’entreprise acquiert ainsi un pouvoir de marché basé sur l’absence d’homogénéité du
produit vendu. Ce pouvoir du monopole discriminant s’accompagne aussi souvent de politiques de fidélisation (Smile’s par
exemple dans le transport aérien ou vente de cartes de réduction spécifiques par la SNCF) qui accroissent son pouvoir de
marché. Enfin, on peut faire remarquer que cette stratégie de différenciation des prix ne pourrait pas être mise en place dans
un marché où les acheteurs qui ont bénéficié du prix d’achat le plus faible pourraient revendre le service acheté à un prix un
peu plus élevé aux consommateurs dont la disposition à payer est la plus forte (mais à un prix plus faible que celui proposé par
le monopole discriminant). C’est pour cela que cette stratégie de différenciation des prix ne peut s’opérer que sur des marchés
où la concurrence est limitée. Par exemple, dans le cas du transport aérien, la concurrence est limitée par le fait que les billets
sont nominatifs et ne peuvent pas être revendus, comme le soulignent Grégory Mankiw et Mark Taylor dans leur ouvrage
Principes de l’économie.
Au final, si la SNCF peut réaliser une tarification aussi différenciée selon les caractéristiques de ses voyageurs, c’est
bien parce qu’elle bénéficie d’un réel pouvoir de marché pour les trafics ferroviaires basée sur l’absence de concurrent direct et
une élasticité-prix de la demande relativement faible pour de nombreux voyageurs. L’ouverture à la concurrence des trajets
voyageurs imposée par la Commission européenne tendra peut-être à améliorer la transparence de l’information tarifaire
réclamée par de nombreuses associations de consommateurs.
1
/
2
100%