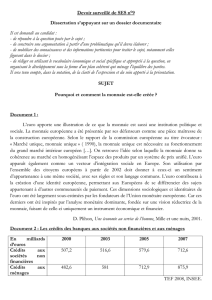La_monnaie_et_financement_de_l

La monnaie et financement de l’économie
LA plus part des économies sont qualifiées de monétaires. La monnaie intervient dans tous les
échanges.
L’introduction de la monnaie puis les innovations successives en matière de moyens de paiement
(CB, lettre de change), ont permis le développement des échanges, et donc l’émergence de véritable
économie de marché. La monnaie n’a pas seulement un rôle de stimulant des échanges, elle
conditionne la création de richesses. On ne peut dissocier la création de richesses de ses possibilités
de financements.
I- Fonctions et composantes de la monnaie.
A) Les 3 fonctions de la monnaie :
1) La monnaie comme moyen de paiement et d’intermédiaire d’échange :
Elle est un bien particulier, puisque c’est le seul bien qui peut s’échanger contre tous les
autres biens. D’où son intervention quasi systématique dans les échanges, même si une
petite parti y échange et relève de système de troc.
2) La monnaie comme réserve de valeurs :
Elle peut conservée dans le temps, sans qu’on perde en valeur nominale, contrairement à
d’autres actifs. Par exemple 100 euros aujourd’hui restent 100 euros dans 1 an (si on les
laissent) alors qu’une action qui vaut 100 euros aujourd’hui n’aura pas en théorie la même
valeur dans 1 an (+ faible ou + forte). La monnaie peut donc être mise en réserve sans crainte
en vu d’une utilisation futur, elle permet de déconnecter dans le temps les actes d’achat et
de vente, contrairement au système de troc où l’achat et la vente son simultanés.
La monnaie représente un pouvoir d’achat, ce pouvoir d’achat se détériore un peu chaque
année à cause de l’inflation. Avec un même montant nominal, la quantité de biens et services
que l’on pouvoir acheter dans un an diminuera. Donc si la monnaie n’est pas placée, on
conservera sa valeur nominale, mais pas sa valeur réelle, c'est-à-dire en termes de pouvoir
d’achat.
3) La monnaie comme unité de compte :
Dans un système de troc, les prix sont relatifs, c'est-à-dire exprimés pour un bien par rapport
à un autre. La monnaie permet précisément de passer d’un système de prix relatif à un
système de prix absolu où la valeur de chaque bien est exprimée indépendamment des
autres biens en un certains nombre d’unité monétaires.
L’introduction de la monnaie dans l’économie a entrainée une augmentation exponentielle
des échanges par rapport au troc. En particulier la vente d’un bien ne suppose pas, l’achat
d’un autre bien en contre partie.
B) les composantes de la masse monétaire :
La masse monétaire d’un pays donnée désigne les différentes formes de monnaies, détenue
par les agents économiques non financiers résidents au prêt des agents économiques

financiers résidents. En exclu ainsi de la masse monétaire les billets qui remplissent les
caisses des banques= (agents financiers), ou encore l’argent détenu par des français au prêt
de banques étrangères (Lichtenchten), car cette argent ne peut servir directement de
moyens de paiement en France. Les différentes formes de monnaies sont classées par
agrégats, du plus liquide au moins liquide, du moins risqué au plus risqué.
1) Les notions de liquidité et de risque :
Un actif est liquide, lorsqu’il peut être converti instantanément et sans coût en moyen
de paiement, exemple : le compte courant que l’on peut mobiliser instantanément avec
une carte bleue ou un chèque. Un plan épargne logement est moins liquide, car si on le
casse avant l’échange car on peut des avantages en termes d’emprunt.
Le risque : un acte est dit risqué lorsque sa valeur, est susceptible de variée aussi bien à
la hausse qu’à la baisse. Exemple les actions : le cours boursier. La masse monétaire va
inclure un ensemble d’actifs, qui en théorie présente une forte liquidité et un faible
risque.
2) Les agrégats monétaires :
1er agrégat : l’agrégat M1 : il correspond à la monnaie au sens stricte. Il comprend les
billets, les pièces et les dépôts à vu, c'est-à-dire les sommes placées sur les comptes
courants.
Monnaie Fiduciaire : c'est-à-dire monnaie dans laquelle on a confiance = billets et pièce
Dépôt à vu = monnaie scripturale
Donc ça comprend actif les + liquides et les moins risqués.
Agrégat M2 : chaque agrégat inclus le précédent, donc M2 inclus M1 : mais dans M2 il y a
en plus de M1, les comptes sur livrets comme par exemple le livret A, le livret de
développement durable qui a remplacé le CODEVI, ces derniers sont considérés comme
de la monnaie car ils ont une forte liquidité et un faible risque.
On peut retirer à tout monnaie sans être pénalisé sauf avec le fait que les intérêts qui
forcement vont diminuer. Mais les livrets sont un peu moins liquides que M1 on ne peut
pas payer directement avec.
Agrégat M3 : il comprend M1 et M2. M3 est retenu comme indicateur de la masse
monétaire. Il comporte en plus, et comporte en plus un certain nombre de titres
considérés comme liquides et peu risqués. Il s’agit de titres de créances, de courtes
échéances émis par les banques. On considère que ces titres sont peu risqués car ils sont
émis par des agents financiers (plus valables !!) et à cour terme.
Donc la masse monétaire intègre des actifs qui n’ont pas un risque nul, ont considère que
les agents économiques peuvent convertir rapidement et à moindre frais ce genre de
titre en moyen de paiement. Au-delà de l’agrégat M3, on trouve des actifs financiers qui
sont moins liquides et + risqués comme les actions ou encore les obligations qui sont des
titres de créances à long terme. Comme le PEL.

II- La demande de monnaie :
Les besoins de monnaie des agents économiques, s’explique à l’évidence par leurs niveau
de revenu, mais aussi par leurs comportements face aux risques, et par d’autres variables
comme la qualité des moyens de paiements à leurs dispositions.
A) La relation entre richesse et masse monnaie :
La théorie quantitative de la monnaie (TQM) : Irving Fisher 1928, elle a été
réhabilitée dans les années 50 et 60 par les économistes monétaristes : Milton
Friedman, école de Chicago.
Au niveau d’un pays, la quantité de monnaie utilisée sur une année dépend de
l’intensité de son activité économique, donc de son PIB.
1ère l’équation des échanges :
Soit Q le PIB, mesuré à monnaie constante, c'est-à-dire le PIB en volume ou encore la
richesse réelle sur 1 an. Soit P le niveau général des prix, c’est un indice des prix de
l’ensemble des prix des biens et services existant dans l’économie.
Q x P = la richesse en valeur donc le PIB comme il nous est donné.
Soit M la quantité de monnaie en circulation dans le pays sur 1 an, c'est-à-dire c’est
la masse monétaire (M3 pour être précis). Soit V la vitesse de circulation de la
monnaie qui représente le nombre de transactions réalisées, en moyenne et sur 1
an et par une unité monétaire. Il traduit de nombre fois qu’une unité monétaire en
moyenne change de mains, sur l’année. V dépend de l’organisation de l’économie,
de la modernisation des moyens de paiements (virement, prélèvement
automatique), et des habitudes de paiement. V est donc une monnaie stable qui
évolue assez lentement.
M x V = Q x P
(PIB)
Pour une vitesse V donnée, + le PIB à atteindre est grand plus la quantité de monnaie
nécessaire M est grande.
Pour atteindre un certains niveau de richesses, c'est-à-dire de PIB, la quantité de
monnaie M nécessaire, sera d’autant plus faible que sa vitesse de circulation V est
grande.
Autant dit des pays qui crées la même richesse n’auront pas besoin de la même
quantité de monnaie, cela dépend de V.
L’interprétation monétariste, les économistes monétaristes ont utilisés la TQM, pour
montrer qu’une augmentation de la masse monétaire entraine principalement de
l’inflation et ne crée pas durablement de la richesse, ils se sont donc opposés aux
politiques de relance par la monnaie, c'est-à-dire par le crédit bancaire.
L’équation des échangent peut en effet s’écrire différemment.
P = M x V/Q

Si le rapport V/Q est stable on voit qu’une augmentation de M, agit directement sur
P. Pour les monétaristes le rapport V/Q est stable. Même lorsque M augmente.
En effet on sait que V est stable) cour, moyen terme, mais en plus les monétaristes
disent qu’une augmentation de M ne fait pas augmenter la richesse réelle c'est-à-
dire Q. Donc V/Q n’est pas affectée par une augmentation de M, et donc une
politique consistant à augmenter la masse monétaire ne fait que créer de l’inflation
et n’agit pas sur le PIB réel.
L’interprétation monétariste sera contestée par Keynes, pour lequel la masse
monétaire agit sur la richesse réelle, dans l’équation sur M et Q augmentent P
augmentera pas forcement. Néanmoins i lest reconnue que la quantité de monnaie,
en circulation dans un pays est un facteur d’inflation on parle d’inflation monétaire,
en effet lorsque la monnaie est excessive par rapport aux quantités de biens et
services disponibles, le prix de ces derniers ne peut augmenter.
3) Masse monétaire et BCE :
La BCE, chargée de la politique monétaire au niveau de la zone euro à pour principale
mission de veiller à la stabilité des prix. Pour limiter l’inflation, la croissance de la masse
monétaire, doit être en rapport avec l’évolution d l’activité économique. Ainsi chaque
année la BCE a pour objectif de limité la progression de la masse monétaire, en fonction
du taux de croissance du PIB.
B) Les 3 motifs de la demande de monnaie :
1- Le motif de transactions, les agents ont besoins de monnaie pour faire face à
leurs dépenses.
2- Le motif de précaution, les agents veulent conserver de la monnaie en cas
d’imprévus ou simplement sortir de l’argent du compte courant.
3- Motif de spéculation mis en évidence par Keynes : les agents veulent détenir de
la monnaie, plus tôt que placer dans d’autres actifs, par préférence pour la
liquidité, et aussi parce que la monnaie est moins risquée que les autres actifs.
Selon ce motif, les agents fond un arbitrage entre différents actifs, pour
composer leurs épargne. Et donc Keynes montre que la monnaie peut être
détenue pour elle-même comme n’importe quel autre bien, alors que pour les
économistes classiques la monnaie est un simple intermédiaire des échanges,
c'est-à-dire neutre pour l’économie.
-En période de forte croissance économique, le volume d’activité à financer et
plus élevé, la demande de monnaie sera donc plus forte.
-En période de récession, la demande de monnaie est globalement plus faible,
malgré le besoin de précaution.
- En résumé la demande de monnaie pour les motifs de transaction et de
précaution est fortement liée au revenu des agents. Et donc elle est relativement
prévisible. En revanche, la demande de monnaie spéculative est beaucoup plus
imprévisible, car elle dépend en plus du revenu de variables purement financière
comme le taux d’intérêt. Hors cette demande spéculative est de plus en plus
importante au niveau mondial, en raison de la mobilité des capitaux. A cause de
ce troisième motif de spéculation, la relation entre le niveau d’activité d’un pays
(PIB), et la quantité de monnaie demandée par ces agents économiques, est de
moins en moins stables et prévisibles.

III- l’offre de monnaie :
Nous avons vu que la monnaie correspond au moyen de paiement émit par les agents financiers et
qui sont à la disposition des agents non financiers résidents. L’offre de monnaie est donc effectuée
par les agents financiers. A savoir la banque centrale dite banque de 1er rang. Et l’ensemble des
banques commerciales dites banque de second rang. On parle d’offre de monnaie ou encore de
création monétaire.
A)- la notion de création monétaire :
Historiquement les banques émettaient des billets correspondant strictement à la valeur de leurs
stocks d’Or. Les agents déposés leurs Or à la banque et obtenaient en contre parti la valeur
correspondante en billet. Mais les banques on constatées que les déposant ne convertissaient pas
tous leurs billet en Or. Les banques ont alors pris le risque d’émettre de la monnaie au-delà de la
valeur de leur stock d’Or. C’est la différence entre les montants qui constitue la création monétaire.
Ex : bilan d’une banque
actif
passif
Stock d’or = 2000
Billets émis 3000
Crédit = 1000
Commentaire :
La création monétaire est égale à 1000, elle correspond à la valeur des billets émis qui n’a
pas de contre parti physique. C’est l’opération de crédit qui a crée la monnaie. Aujourd’hui,
la monnaie mise en circulation dans l’économie, n’a plus de contre partie physique. Mais se
sont toujours les opérations de crédit bancaire qui assurent l’essentiel de la création
monétaire.
B- le crédit bancaire principale source de création monétaire :
Exemple : une banque accorde un crédit de 10 000 euros à un client, le crédit va donc
alimenter le compte courant du client, et donc la masse monétaire M3 augmente du même
montant, il y a donc création monétaire.
Exemplounet :
Actif
passif
Crédit = 10 000 euros
Compte courant client= 10 000 euros
Appartient à M3
Commentaire :
La quantité de monnaie des ANF (agent non financier) a ici augmenté de 10 000 euros. Donc
la création monétaire, d’où une création monétaire de 10 000 euros. Supposons qu’un an
après le client rembourse 1000 euros à la banque, ces 1000 euros passent d’un ANF à 1 agent
financier, il y a donc destruction de monnaie pour 1000 euros. Pour qu’il est création
monétaire il faut que la quantité de monnaie c'est-à-dire l’agrégat M3 augmente.
Si un ménage achète une action émise par une entreprise, il y a n’y création/destruction de
monnaie puis qu’il s’agit d’un simple transfert d’argent entre 2 ANF, donc globalement
l’argent à la disposition des ANF est inchangé. Seuls les agents financiers, peuvent créer de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%