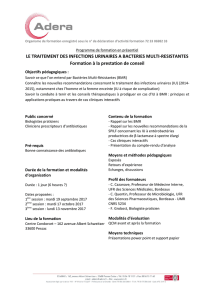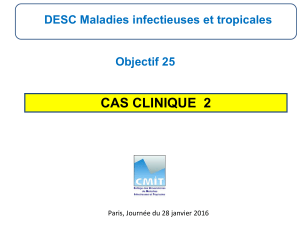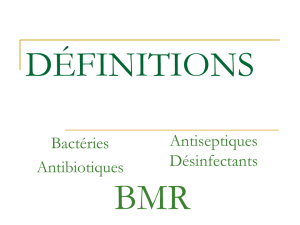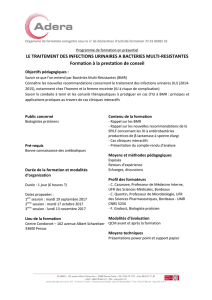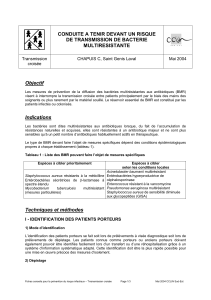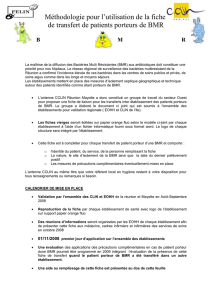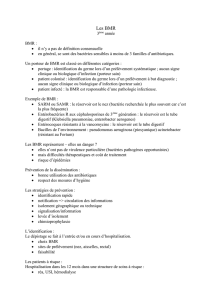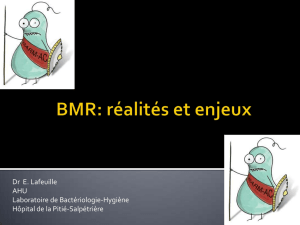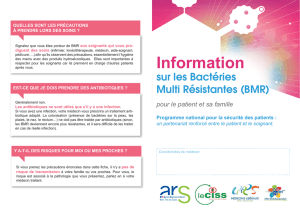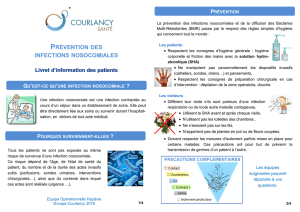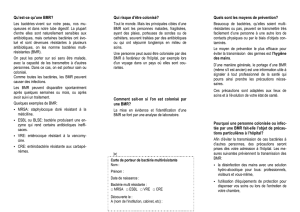Conduite à tenir devant des bactéries multirésistantes en réanimation

Conduite à tenir devant des bactéries
multirésistantes en réanimation
AM Korinek
Département d'anesthésie-réanimation, hôpital Pitié-Salpêtrière,
47-83 boulevard de l'Hôpital, 75651 Paris cedex 13
POINTS ESSENTIELS
· La lutte contre les bactéries multirésistantes en réanimation doit devenir une priorité des
services.
· Elle doit commencer par la lutte contre les staphylocoques dorés méticilline résistants et les
entérobactéries porteuses d'une bêtalactamase à spectre étendu.
· Elle repose sur des protocoles de soins écrits, adaptés à chaque service.
· La transmission croisée des germes est principalement manuportée.
· Les principales mesures recommandées sont : 1) le dépistage des porteurs sains ; 2) leur
signalisation ; 3) l'isolement géographique en chambre individuelle ; 4) l'isolement technique ;
5) la chimiodécontamination des porteurs qui n'est qu'une mesure de complément.
· Le lavage des mains est une des principales mesures à instaurer lors de tout contact avec le
patient ou son environnement.
· Le retour d'information est essentiel pour entretenir la motivation des personnels.
· Les protocoles doivent être facilement applicables et consensuels, ce qui améliore
l'observance.
Ce n'est que depuis une dizaine d'années que s'est manifestée une réelle prise de conscience en
France de l'importance de la lutte contre les infections nosocomiales. Cette prise de
conscience a été favorisée par l'apparition dans les hôpitaux français d'une épidémie
d'infections à Klebsiella pneumoniae , multirésistante aux antibiotiques. Parallèlement, des
enquêtes de prévalence européennes et françaises ont permis d'avoir une idée des taux
d'infections nosocomiales et de réaliser que la France était bien mal placée ! [1] . Les
différentes enquêtes de prévalence françaises [2] [3] font apparaître un taux d'infections
nosocomiales entre 8 et 9 % ; ce taux est bien sûr beaucoup plus élevé dans les unités de
réanimation, avec un taux d'infectés de 31 % et d'infections de 43,4 % [3] .
En outre, les services de réanimation sont le réservoir des bactéries multirésistantes (BMR) et
l'enquête récente « Hôpital Propre II », consacrée aux BMR, a trouvé un taux d'incidence de
41 pour 1 000 admissions en réanimation ; un quart de l'ensemble des patients porteurs de
BMR dans les CHU était hospitalisé en réanimation [4] . C'est donc d'abord dans les services
de réanimation que la prise de conscience s'est faite, rapidement élargie à l'ensemble de
l'hôpital dans certains cas.

Avant d'envisager la conduite à tenir vis-à-vis de ces BMR en réanimation, il convient de
définir ce qu'est une BMR et quels sont les enjeux.
DÉFINITIONS
Selon le rapport des experts du jury de la XVIe Conférence de consensus en réanimation et
médecine d'urgence [5] , « une bactérie est multirésistante lorsque, du fait de résistances
naturelles et/ou acquises, elle n'est sensible qu'à un petit nombre de familles ou de sous-
familles d'antibiotiques ». Cette définition regroupe toutefois de nombreuses entités : certes,
les germes les plus fréquemment rencontrés en réanimation, comme le staphylocoque doré
résistant à la méticilline (SDMR), les entérobactéries sécrétrices de bêtalactamases à spectre
étendu (EBLSE), Acinetobacter , Pseudomonas aeruginosa , mais aussi les pneumocoques
résistants à la pénicilline, problème majeur en pathologie communautaire, les entérocoques
résistants à la vancomycine qui sévissent aux États-Unis, les Enterobacter , Serratia ,
Citrobacter , sécréteurs d'une céphalosporinase, voire les Stenotrophomonas maltophilia . Il
est impossible de prévoir des mesures spécifiques pour chacun de ces germes, et des choix
doivent être faits. La majorité des études publiées porte sur deux germes : le SDMR et les
EBLSE, plus particulièrement Klebsiella pneumoniae multirésistante (KMR). Il paraît licite
de s'intéresser en priorité à ces 2 germes. En effet, ils ont en commun :
- un pouvoir pathogène important, avec une virulence comparable à celle des souches
sauvages, c'est-à-dire qu'ils sont capables de provoquer des infections chez des sujets sains,
non débilités ;
- d'être des hôtes habituels de l'homme qui, une fois implantés dans l'organisme, vont persister
de nombreuses années, avec donc la possibilité de créer des infections en dehors des
réanimations, voire en dehors de l'hôpital ;
- d'être enfin particulièrement résistants à la majorité des antibiotiques disponibles
actuellement, avec des possibilités thérapeutiques souvent restreintes à une seule molécule.
Ces caractéristiques sont bien différentes de celles des autres germes multirésistants
rencontrés en réanimation : Acinetobacter , Ps aeruginosa , Enterobacter , Serratia ... ne sont
pas des hôtes habituels de l'homme. Dès que le patient quitte la réanimation et la pression de
sélection qu'exercent les antibiotiques, il s'en débarrasse rapidement ; en outre, le pouvoir
pathogène de ces espèces bactériennes est plus faible et leur virulence ne s'exprime que chez
des patients aux défenses naturelles amoindries et porteurs de nombreux dispositifs invasifs.
Ces bactéries ne sont donc qu'un problème limité au contexte de la réanimation et nécessitent,
certes, la mise en oeuvre de mesures spécifiques en cas d'épidémie au sein d'un service, mais
ne représentent pas actuellement un problème de santé publique.
ENJEUX DE LA LUTTE
CONTRE LES BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES
Les enjeux de la lutte contre les bactéries multirésistantes sont multiples.
Marqueur potentiel de la qualité des soins

Il semble que l'isolement de BMR dans une institution soit un marqueur du taux des infections
nosocomiales en général. La diminution de leur incidence au sein d'une unité pourrait ainsi
être un indicateur simple de la qualité des soins prodigués aux patients.
Morbidité et mortalité
Du fait d'une virulence équivalente à celle des souches sauvages, les BMR sont responsables
d'infections graves. Toutefois, les problèmes thérapeutiques posés par les BMR créent un
biais évident lorsqu'on veut comparer les infections dues aux deux types de bactéries. En
outre, le terrain sur lequel surviennent les infections à BMR est souvent plus débilité que celui
sur lequel surviennent les infections à souches sauvages, ce qui induit un nouveau biais
majeur dans l'étude de la mortalité et même de la morbidité [6] . Quelques études ont tenté de
comparer la mortalité due à des septicémies à S aureus résistant ou non à la méticilline, en
ajustant les résultats sur les scores de gravité [7] [8] [9] [10] . Il apparaît alors que le
risque de décès n'est pas significativement différent dans les deux groupes. En revanche, une
étude cas-témoins a mis en évidence une surmortalité au cours des pneumopathies à Ps
aeruginosa ou Acinetobacter , comparées aux pneumopathies à autres germes,
indépendamment de la gravité des patients à l'admission [11] .
Au total, il est clair que les infections à BMR sont responsables d'une mortalité et d'une
morbidité au moins équivalente à celles des infections à bactéries sauvages. On peut penser
intuitivement, bien que les études actuelles ne soient pas formelles, qu'elles induisent une
surmortalité du fait, d'une part des problèmes thérapeutiques engendrés (et donc du retard
thérapeutique dans certains cas), et d'autre part du terrain sur lequel elles surviennent en
réanimation.
Coût
Les infections à BMR provoquent un surcoût médical [12] . Celui-ci est lié à l'augmentation
des durées de séjour, à l'augmentation considérable de la charge de soins, au prix des
antibiotiques nécessaires pour traiter ces infections. De plus, les surcoûts sociaux
(prolongation d'arrêt de travail, invalidité...) ne sont jamais pris en compte.
Rôle des prescriptions antibiotiques empiriques
La connaissance dans une unité de cas d'infections à BMR conduit les cliniciens à des
prescriptions empiriques d'antibiotiques « de réserve », actifs sur ces BMR, pour la majorité
des patients, dans le but de donner toutes ses chances au patient, en évitant tout retard
thérapeutique. Cette pratique est illustrée par l'enquête sur la consommation des antibiotiques
effectuée dans le cadre d'« Hôpital Propre II [14] » : globalement, moins de 20 % des
antibiotiques de réserve (vancomycine, téicoplanine, imipénème, ceftazidime) dispensés dans
les services sont utilisés pour traiter les infections à BMR ; ces chiffres atteignent cependant
30 % en réanimation en raison de la prévalence des patients porteurs de BMR dans ces unités.
Le reste des prescriptions s'adresse à des patients non porteurs de BMR, pour lesquels un
traitement empirique a été instauré dans l'hypothèse d'une infection à BMR !
Cette pratique, compréhensible du point de vue du clinicien qui souhaite traiter au mieux ses
patients, induit une surconsommation des quelques antibiotiques encore actifs sur les BMR et
pourrait à terme favoriser l'émergence de nouvelles souches qui, elles, seraient résistantes à
l'ensemble des antibiotiques. La diminution des infections à BMR dans une unité devrait

conduire à casser ce cercle vicieux, en changeant les habitudes thérapeutiques et en diminuant
le nombre de ces prescriptions empiriques [13] .
Problème médico-légal
Il est sous-tendu par ce qui précède : les infections à BMR s'accompagnent d'une mortalité et
d'une morbidité élevées, d'un surcoût non médical difficile à chiffrer mais réel ; elles sont les
marqueurs de l'infection hospitalière et peut-être de la qualité des soins. Elles représentent
donc un préjudice majeur pour les patients et pourraient à l'avenir avoir des conséquences
médico-légales pour les services qui n'auraient mis en place aucune politique de lutte et de
prévention.
PHYSIOPATHOLOGIE DE L'ACQUISITION
ET DE LA TRANSMISSION DES BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES
Dans la grande majorité des cas, les patients s'infectent à partir de leur propre flore (infections
endogènes). Cette flore va se modifier au cours de l'hospitalisation avec :
- l'acquisition de bactéries de l'environnement, le plus souvent bactéries à Gram négatif à
métabolisme oxydatif ( Pseudomonas , Acinetobacter , Stenotrophomonas ) ; ces bactéries
sont naturellement résistantes à de nombreux antibiotiques et ont une grande capacité
d'acquisition de nouveaux mécanismes de résistance ; elles survivent et se multiplient en
milieu hospitalier, où elles sont favorisées par la pression de sélection qu'exercent les
nombreux antibiotiques prescrits, surtout en réanimation ; à partir de l'environnement, elles
vont coloniser les patients, apportées le plus souvent par les mains du personnel ;
- la sélection au sein de la flore du patient, de souches multirésistantes ; c'est le cas des
entérobactéries porteuses d'une céphalosporinase induite ou déréprimée ; une fois
sélectionnées chez un malade, ces souches pourront là aussi se transmettre de patient à patient
par transmission manuportée ( Enterobacter , Serratia , Citrobacter ) ;
- enfin, l'acquisition au niveau de la flore de bactéries multirésistantes présentes à l'état
endémique (SDMR) ou épidémique (KMR) chez de nombreux patients de l'unité, et
transmises par manuportage quasi-exclusif.
Ainsi, deux facteurs majeurs vont influer sur la présence de BMR dans un service : a) la
quantité d'antibiotiques prescrite qui favorise la sélection des germes les plus résistants, qui,
seuls, vont pouvoir survivre ; b) la transmission croisée qui augmente le nombre de porteurs.
En réanimation, ces deux facteurs sont très intriqués et aussi importants l'un que l'autre,
puisque c'est l'endroit de l'hôpital où le plus d'antibiotiques sont prescrits d'une part, et où les
malades sont le plus dépendants du personnel et le plus « techniqués » d'autre part.
Actuellement, la maîtrise des prescriptions d'antibiotiques en France en est à ses
balbutiements, malgré une prise de conscience récente du problème [15] [16] . La lutte
contre les infections à BMR repose donc principalement sur des recommandations visant à
interrompre la transmission croisée manuportée.
CONDUITE À TENIR DEVANT DES BACTÉRIES
MULTIRÉSISTANTES EN RÉANIMATION

La prise en compte du problème, première étape pour la mise en route d'une stratégie de
prévention, peut venir soit d'une épidémie dans une unité, ce qui incite le personnel à se
mobiliser, soit plus souvent d'une incitation extérieure, locale (Commission locale de lutte
contre l'infection nosocomiale), voire régionale ou nationale (création de réseaux de
surveillance).
Deux grands types d'approche sont à considérer quant aux mesures préventives à adopter,
aucun des deux n'ayant fait, à l'heure actuelle, la preuve de sa supériorité [17] .
Stratégie horizontale
Elle est surtout développée aux États-Unis [18] et repose sur des mesures systématiques,
applicables pour tout patient, et visant à protéger les mains du personnel contre la
contamination par des bactéries pathogènes et contre le risque de transmission virale d'origine
sanguine ou humorale. Cette approche repose sur le lavage des mains et le port de gants. Elle
a l'avantage de la simplicité et évite les coûts du dépistage, puisque tout patient est considéré à
risque. Ses inconvénients sont la charge de travail induite, les coûts et une observance très
partielle.
Stratégie verticale
Elle est beaucoup plus européenne et définit une stratégie de prévention adaptée à un germe
particulier, en fonction de son mode de transmission et de ses réservoirs naturels. En France,
c'est le type d'approche qui est actuellement privilégié.
Quel que soit le choix effectué, la mise en place de mesures préventives dans une unité
nécessite :
- une information de l'ensemble du personnel qui doit prendre conscience du problème et
comprendre les enjeux ;
- la rédaction de protocoles de soins écrits, spécifiques au service, rédigés et discutés en
commun, où chaque catégorie professionnelle doit pouvoir intervenir ; ces protocoles sont
ensuite testés dans l'unité et modifiés éventuellement, pour en améliorer l'observance ;
- une surveillance des résultats sur les taux d'infections à BMR, avec retour rapide des
informations pour soutenir la motivation de chacun ;
- un soutien des autorités financières et administratives pour obtenir le matériel et les
conditions de travail indispensables au respect du protocole [19] .
Nous détaillerons ici les mesures recommandées dans une stratégie verticale, celles
préconisées pour une stratégie horizontale étant très détaillées par l' Hospital infection control
advisory committee du CDC [18] .
Le principe général repose sur la détection des patients porteurs, leur signalisation, l'isolement
géographique quand il est possible, l'isolement technique et la chimiodécontamination des
porteurs.
Détection des patients porteurs
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%