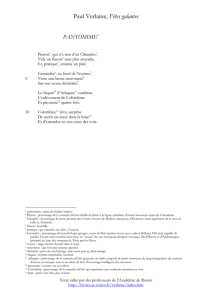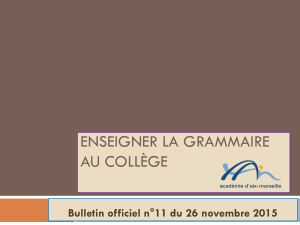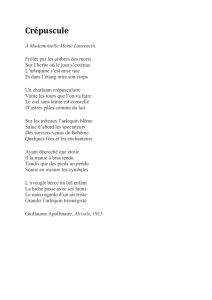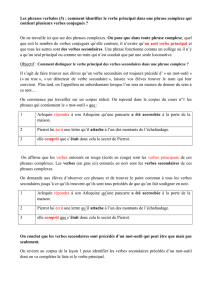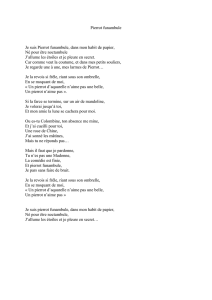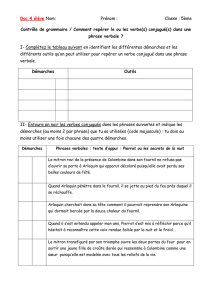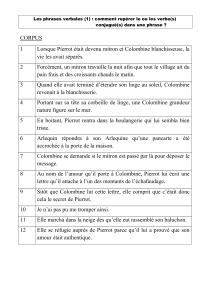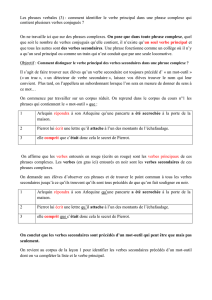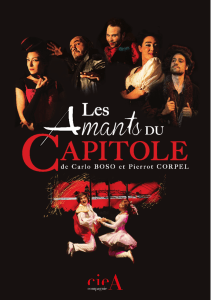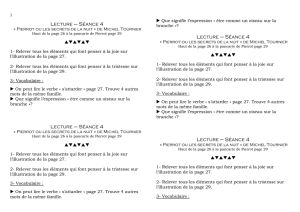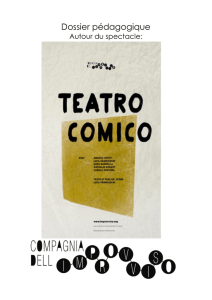La Pantomime

La Pantomime
1- DEFINITION ET ORIGINE
La pantomime est un spectacle d'origine sicilienne typiquement romain. C'est
un ballet à sujet mythologique, de tonalité tragique. Il comporte un acteur, un
orchestre et le chœur.
2- QU'EST CE QU'UNE PANTOMIME?
La pantomime est une pièce de théâtre mimée et muette, c'est à dire sans
parole, uniquement des gestes. Sur scène, une seule personne joue la comédie.
Elle incarne tous les personnages. Ils sont accompagnés par un chœur de
danseurs et un petit orchestre. L'acteur porte un beau costume de soie et un
masque aux lèvres fermées. Souvent, ce spectacle est irrespectueux et grossier,
voir obscène. Dans le théâtre latin, exceptionnellement, il y avait des actrices. A
la fin du spectacle, elle se dévêtaient. Souvent les acteurs sont de grandes
vedettes ou aristocrates, ne jouant plus de rôle politique en raison du régime
impérial et préférant la gloire au statut social. Leur représentation est soit privée
soit publique. La pantomime est accessible à tous, y compris à un barbare qui
ignore le latin et le grec. Elle est l'un des véhicules simples de la romanisation
dans les provinces.
3- SOURCES
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_romain
http://users.skynet.be/honore/theatre.htm
http://college.belrem.free.fr/loisirom/theatre/theatre.htm
Page écrite en 2005 par Ophélie Godard en quatrième latiniste

Pantomime
Le poème dont nous allons faire la lecture est la deuxième pièce de Fêtes galantes, un
recueil de poésies de Verlaine édité en 1869, chez Lemerre à Paris. Notre poète est alors âgé
de 25 ans ; quand il a 4 ans, son père démissionne de l’armée pour se consacrer entièrement à
son enfant et ainsi lui assurer un brillant avenir (saint-cyrien ou polytechnicien) ; la famille se
retrouve dans le quartier des Batignolles à Paris ; Verlaine assiste aux matinées, le dimanche,
du théâtre des Batignolles, d’où son rêve d’être auteur dramatique. En avons-nous une trace
avec son intérêt pour la commedia dell’arte dans ce recueil et dans notre texte ? Quoi qu’il en
soit, les efforts parentaux sont récompensés par son succès au baccalauréat ès lettres en 62 ; il
ne poursuit pas pour autant ses études de droit ni une carrière, d’abord de rond-de-cuir,
ensuite de fonctionnaire subalterne : deux choses comptent pour lui, la poésie avec l’école du
Parnasse, dont le dogme est l’impassibilité… et les cafés du Quartier latin, ce qui n’est pas
contradictoire. Et il tombe amoureux de sa cousine, Elisa Moncomble, maintenant mariée
sous le nom de Dujardin, avec deux enfants. Le frémissement contenu de cette passion
affleure dans les Poèmes saturniens dont la tendre Elisa a financé la publication. Mais
Verlaine ne trouve que dans l’alcool de quoi soigner son désespoir suite à la mort brutale de
sa Muse. Désespoir préfiguré par sa Chanson d’automne, in Poèmes saturniens, en1867, cf. la
dernière strophe. C’est dans l’étourdissement des fêtes qu’il cherche à oublier, dans le salon
de Nina de Villars. Au reste, on éloigne de lui les couteaux pointus : son ivresse est agressive,
cf. ses deux coups de feu sur Rimbaud, en Belgique. Il participe tous les mois au dîner des
Vilains Bonshommes au début de 1869; c’est à cette époque que paraît Fêtes galantes, œuvre
marquée par la même insouciance, l’avidité dans les plaisirs, qu’à la fin de l’Ancien
Régime… En point d’orgue, il rencontre cette même année 69 sa future femme,
Mathilde Mauté, une jeune fille de 16 ans, ce qui amènera la création du recueil : La Bonne
Chanson ; mais il a déjà éprouvé le paradis artificiel de l’alcool, comme l’atteste son
poème l’Auberge de 1865 et comme le prouvera sa tentative de meurtre contre sa mère quatre
ans plus tard; notons qu’il s’est épris, l’année précédente de Lucien Viotti, un ancien
condisciple du musicien Charles de Sivry, le demi-frère de Mathilde… Ces multiples
contrastes se retrouvent dans ce poème…
Une première publication de ce poème est parue dans L’Artiste, le 1er janvier 1968, avec dans
le manuscrit un ancien titre : En a-parte, lui-même barré de manière différente. Est-ce pour
surligner l’autonomie de chacun des protagonistes ? De toute façon, ce poème est loin d’être à
part dans le recueil… (cf. Fantoche, avec Pulcinella/ Colombine puis Colombine en titre) et la
thématique théâtrale est prégnante dans l’œuvre peint de Watteau…
Ce poème prend comme thème central la commedia dell’arte ; il s’ingénie à jouer sur
les contrastes, voire les contradictions. N’est-ce pas là le propre de toute fête réussie, avec
l’obsession verlainienne de pousser la galanterie à l’extrême… de sa tension ?
A) la commedia dell’arte
l’ancien titre, a-parte, renvoie à ce que dit un personnage à part, pour les spectateurs, qui
est censé ne pas être entendu par les autres intervenants sur scène, ceci montre que le
monde du théâtre est bien là, ce que corrobore le titre conservé : de fait, la pantomime est
une représentation théâtrale où ce dernier terme retrouve son sens étymologique en grec
ancien : «voir» ; le pantomime, l’acteur qui s’y exprime, n’intervient que par ses gestes,

ses attitudes, voire ses mimiques, qui peuvent être soulignés par de la musique mais
aucunement par des paroles. Et c’est bien de mutisme dont fait preuve Pierrot dans la
première strophe, pour souligner sa voracité ? Avec la rapidité induite par les termes
utilisés : «vide un flacon sans plus attendre», comme une urgence, avec ensuite la
satisfaction, après la soif, de la faim : «entame un pâté», ce qui se fait souvent avec un
couteau à grande lame. Le second comparse semble moins vif, plus détaché des
contingences physiologiques de ce bas monde : «au fond de l’avenue», assagi : «verse une
larme» ; mais le fait qu’elle soit «méconnue» renvoie-t-elle à sa solitude (=le fait que sa
tristesse échappe complètement au rustaud Pierrot), ou à son objet : d’où sort ce «neveu
déshérité» ? Cassandre, le vieux barbon de la Commedia dell’arte ne pense qu’à sa fille,
en vieillard libidineux dont l’obsession est rendue encore plus honteuse par l’inceste ainsi
hautement réclamé. Le troisième reprend le devant de la scène, avec l’attaque : Ce,
l’homéotéleute -quin, l’allitération en gutturales sourdes [ k ]. Le lecteur, ne sachant trop
quel comportement envisager («combine l’enlèvement»), le voit pirouetter 4 fois. Pour
marquer sa joie ? Et Colombine de rêver… On la sent penchée sur elle-même, avec
l’accumulation des nasales et le ronronnement apaisé des liquides [r].
Après la pantomime, reprenons les pantomimes :
Pierrot n’est pas fidèle à son image traditionnelle si l’on pense au tableau de
Watteau, Gilles, car il est ici, comme l’on dit, nature : son peu de surface sociale s’incarne
dans les deux synérèses et les voyelles fermées ; sa gloutonnerie s’exprime par le rythme
ascendant du vers : 1/3/4 avec une césure centrale peu fréquente dans un octosyllabe dont
le rythme rapide, avec ses variations multiples chez Verlaine est bien en accord avec la
vivacité, l’inventivité et l’improvisation dont doivent faire preuve les acteurs dans ce type
de création artistique… Ici, Pierrot, comme attendu, ne fait pas de manière : sans plus
attendre, alors que la politesse exige que dans un groupe on boive de concert. Pour lui, peu
importe le flacon pourvu que l’on ait l’ivresse, et son manque de tenue s’oppose à celle du
raffiné, voire sophistiqué Clitandre. Il passe au repas, comme de juste, en accord avec le
rythme équilibré du v. 4: 3/2/3. L’indifférenciation des articles indéfinis participe aussi au
côté fruste du personnage ici, aux antipodes d’ailleurs d’une dimension tragique, voire
d’un fantastique morbide auquel il arrivera dans Jadis et Naguère :
Pierrot
Ce n'est plus le rêveur lunaire du vieil air
Qui riait aux jeux dans les dessus de porte ;
Sa gaîté, comme sa chandelle, hélas ! est morte,
Et son spectre aujourd'hui nous hante, mince et clair.
Et voici que parmi l'effroi d'un long éclair
Sa pâle blouse a l'air, au vent froid qui l'emporte,
D'un linceul, et sa bouche est béante, de sorte
Qu'il semble hurler sous les morsures du ver.
Avec le bruit d'un vol d'oiseaux de nuit qui passe,
Ses manches blanches font vaguement par l'espace
Des signes fous auxquels personne ne répond.
Ses yeux sont deux grands trous où rampe du phosphore
Et la farine rend plus effroyable encore
Sa face exsangue au nez pointu de moribond

Ce qui le concerne est commun : «flacon, pâté», avec l’adjectif «pratique» qui renvoie
prosaïquement, en toute simplicité quotidienne, à l’entame d’un pâté dont personne ne
veut car trop gras ; mais Pierrot est là pour que personne n’ait à attendre qu’un convive se
sacrifie : il faut bien commencer…
Cassandre, lui, semble fini, ce vieillard libidineux que son obsession sexuelle
incite au désir incestueux à l’égard de sa fille Colombine, sans égard pour elle ; ici,
à l’écart, en piètre estime, car sa mise en exergue en début de tercet est
contrebalancée par l’endroit où il est relégué, renforcée par les 3 fricatives ; il
s’avère passif comme sa fille : un seul verbe pour évoquer sa prostration, «Verse»,
en début de vers, cf. Colombine qui «rêve» (au rebours des deux jeunes gens,
Pierrot : «vide, entame», comme Arlequin : «combine, pirouette»), le tout incarné
par les voyelles fermées qui abondent aux v. 5 et 6. Il est méprisable et ne mérite
pas notre pitié : larme méconnue, pour terminer sur une interrogation
énigmatique : le neveu déshérité n’a pas d’avatar avéré dans la commedia dell’arte
Arlequin est loin d’être poli par l’amour ; il est présenté sans aménité, comme
indigne avec le démonstratif, les trois gutturales sourdes, le mépris qui effleure
dans la virulence de l’insulte (avec un effet de balancement sonore propre aux
comptines : e a in a e in, quin étant en rime interne, pour ne pas dire
homéotéleute) : «faquin», donc un portefaix (amusant pour évoquer un
enlèvement ! un homme de peu de valeur, mal élevé et méprisable (d’après le
dictionnaire de l’Académie) ou plat et impertinent (dans le Robert) (vieux ou
littéraire) avec la césure de l’octosyllabe régulière : 3/8, les nasales abondent
comme illustrant l’intensité du désir ; il s’agit pour lui de s’assurer de la
possession physique : l’enlèvement, en toute fausse pudeur ; à peine ce forfait est-
il mentionné que le succès en est fêté, sans retenue : 4 syllabes pour pi-rou-et-te, ce
qui alourdit singulièrement cette figure empreinte habituellement de souplesse.
Oui, Arlequin est loin d’être un parangon de la discrétion, comme l’atteste sa tenue
en losange, qui évoque les multiples facettes de ce personnage. Mais ses qualités
sont discutables : il ne brille pas par son intelligence, il est bête, famélique, crédule
et paresseux. Il cherche partout de quoi se sustenter et pour ce faire, il s’adonne à
tous les stratagèmes, pirouettes ou acrobaties imaginables ; sinon, son but est la
méridienne, en respectant la loi du moindre effort.
Il s’oppose ici à sa chérie Colombine qui incarne, ce qui est assez inhabituel chez
elle, la spiritualité : «rêve», avec les 3 e finaux qui nous font effleurer son
évanescence. Habituellement vêtue de blanc, communément amoureuse de Pierrot,
taquinant Arlequin, elle semble ici s’ouvrir avec surprise, ce que marquent les
liquides, aux subtilités de la cour amoureuse, avec l’écho des «cœursۚ» en accord,
comme le veut la répétition, le souffle de la brise étant à l’instar des battements du
cœur de l’amoureux, qui devient amant (mais lequel ? Pierrot ou Arlequin ?)
puisqu’il éveille un écho chez l’autre; elle-même semble s’ouvrir à l’amour, non
pas comme quelque chose de nouveau chez une vierge qu’elle n’est pas dans la
commedia dell’arte, mais comme une renaissance des sentiments amoureux
(Pierrot, Arlequin ? Entre les deux son cœur balancerait-il ?), pluriel auquel nous
contraint le terme final : «des voixۚ», en une mise en abyme pour évoquer les
sonorités de ce poème…

B) les contrastes : Notons que la cohérence de cette pantomime n’existe que par la
grâce du texte, la volonté du poète : quelle logique narrative, quel déroulement
significatif attribuer à ces quatre tableaux successifs ? L’un mange et boit tandis qu’un
autre pleure dans le fond, un troisième prévoit un enlèvement pour satisfaire ses pulsions,
dont il semble fêter par ailleurs les multiples réalisations par une pirouette… et la femme
de se montrer romantique, à son étonnement apparemment. Là ne s’arrêtent pas les
contradictions de ce poème : le premier vers affiche d’emblée une opposition nette entre
les deux noms propres qui l’encadrent, en un rapprochement qui paraît d’autant plus
gratuit qu’il est présenté comme tel : «n’a rien de» ne peut être plus négatif et que vient
faire «Clitandre» dans la commedia dell’arte, sinon par le hasard d’un rangement dans une
bibliothèque ? Ce nom propre étant lui-même rendu commun par l’article indéfini, comme
pour déprécier cette figure classique du soupirant rencontré chez Molière puisque c’est
l’amant de Lucinde dans L’Amour médecin, celui d’Angélique dans George Dandin,
d’Henriette dans Les Femmes savantes… «Et c’est l’éternel Clitandre» mis en exergue
dans Mandoline, par le présentatif et la polysyndète… Pourquoi ensuite évoquer «sans
plus attendre», en une tournure affectée, car l’objet de l’attente échappe complètement,
absence renforcée par le suspens de la rime… procédé rhétorique que conseillera Art
poétique… L’ordre même des actions semble peu cohérent : la consommation d’un pâté se
fait habituellement au rythme de la baisse du liquide dans le flacon afférent… alors que ce
dernier sert ici d’apéritif. Après cet en-cas, Cassandre se trouve reclus au fond de
l’avenue, comme en vieux rebut, et cette mise à l’écart est confirmée par le mépris à
l’égard de sa larme (sic !), alors que l’on attend plutôt des larmes. Cette impression
d’évanescence est confirmée par les préfixes mé- et dés- et corroborée par la déshérence
du neveu, dont le rapport familial est ainsi dénié. Plus vif, Arlequin, car actif
intellectuellement («combine») et physiquement («pirouette»), au rebours du passif et
déplorant Cassandre,
Colombine tranche ainsi nettement dans le dernier tercet sur les trois personnages
précédents ; elle seule incarne la beauté, le raffinement, toute en spiritualité : «rêve».
C’est que ces personnages semblent tous à contre-emploi : nous avons évoqué plus haut
la gloutonnerie évidente de Pierrot : cela ne fait pas partie de ses traits de caractère
traditionnels, et ce défaut est plutôt réservé à Arlequin. Certes ce dernier pirouette comme
attendu, mais c’est plutôt à Pierrot de combiner l’enlèvement de son amour, au détriment
de Cassandre. Cassandre, avez-vous dit ? Autre rupture ! Certes, il est au ban de la société
et subit la moquerie vengeresse de la populace vu son désir pour sa fille, mais il y a
ambiguïté sur son identité réelle, car il partage ce nom avec la célèbre Cassandre de Troie
qui, récupérée par Agamemnon, ne peut que verser une larme en secret, pour ne pas subir
la raillerie de ses ennemis, sur son neveu, le petit Astyanax, de fait déshérité puisque son
père Hector, le fils de Priam, et donc futur roi de Troie a perdu la vie sous les coups
d’Achille. D’ailleurs, il est vivant et sert au chantage de Pyrrhus dans Andromaque de
racine, mais chez Homère, il a été précipité du haut des murailles de Troie en flamme.
Verlaine, encore une fois, s’amuse et nous perd ici dans les méandres mêlés du mythe et
théâtre, un bon exercice de redistribution des cartes pour les cuistres… Ce que confirme la
présentation inhabituelle de Colombine, accorte jeune fille, délurée, maîtresse de ses
sentiments, à l’abri des surprises de l’amour, car elle est coutumière du fait, vu sa beauté.
Elle se montre pourtant ici d’une délicatesse extrême, on n’ose dire : romantique, vu
l’anachronisme, ou alors c’est avant la lettre ! Les nasales en écho (sen- un dans) , ensuite
soulignées par les dentales : «[d’]en[|t]en[d]r(e) en son» n’entrent pas pour peu dans la
douceur de ce point d’orgue affectif, en deux très belles images où le souffle de la brise se
mêle intimement aux battements du cœur d’un autre. Etant entendu (sic !) que le terme
 6
6
 7
7
1
/
7
100%