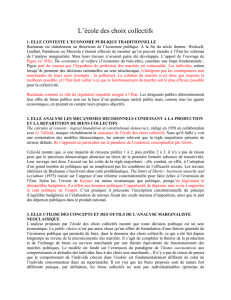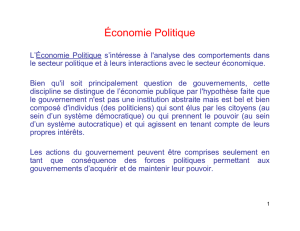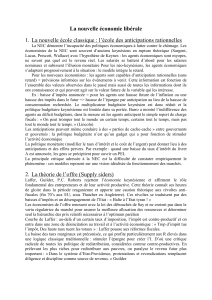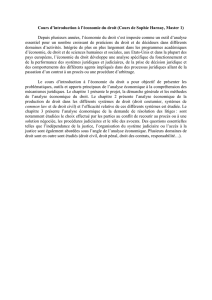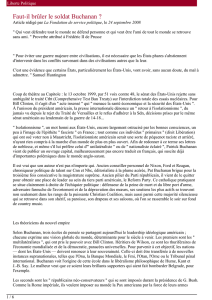La théorie des choix publics

MASSART Conférence d’économie de Sophie Harnay
TRISTAN
1
La théorie des choix publics
I. Origine de la théorie des choix publics
1. Historique
Les économistes classiques ont surtout concentré leur attention sur le fonctionnement
du marché et non sur le rôle à jouer de l’Etat (d’autant plus qu’ils considéraient que
l’Etat n’a peu voire pas de rôle à tenir dans un marché parfait). « L’école du choix
publics est fondée au début des années 1960 par deux économistes de l’université de
Virginie, J. Buchanan (prix Nobel en 1986) et G. Tullock, elle étend la notion de
marché à l’analyse des systèmes politiques. Ses thèses sont présentées dans The
Calculus of Consent (=le calcul du consentement, Buchanan/Tullock, 1962), La
demande et l’offre de biens publics (Buchanan, 1968), Théorie du choix public :
applications à la politique de l’analyse économique (Buchanan/Tollison, 1972). »
1
Joseph Schumpeter a devancé cette école avec ses travaux dans Capitalism, Socialism,
and Democracy (1942) qui furent mathématiquement complétés par Arrow (prix
Nobel) puis par l’étude d’Anthony Downs dans Economic Theory of Democracy
(1957) qui développe une théorie selon laquelle la politique économique des élus se
résume à mettre tout en œuvre pour être réélu. Mais la théorie des choix publics a
surtout été d’actualité dans les années 1980 avec les travaux de Buchanan.
« En poursuivant son propre intérêt, l’individu concourt fréquemment à celui de la
société, plus efficacement que s’il désirait vraiment le bien public. » Adam Smith, La
richesse des nations, (1776)
2
. En effet les économistes classiques ne pensent pas
qu’une intervention de l’Etat dans l’économie aurait un intérêt pour le marché et donc
pour le peuple. Mais les générations suivantes pensent différemment et de nombreuses
justifications voient le jour pour une intervention de l’Etat dans l’économie.
2. Le rôle de l’Etat
L’Etat tend à corriger principalement :
- l’imperfection du marché (monopole, oligopole avec lois antitrust…)
- les externalités (comme la pollution…)
- l’information imparfaite (obligation d’information…)
Quelles sont les buts de l’Etat ?2et
3
Elles sont multiples et non définies de manière
stricte, on peut cependant recenser :
1
Jean Boncoeur et Hervé Thouément (2000) : Histoire des idées économiques, Nathan, 2° édition, p.205.
2
Extrait de Christophe Marchand (1999) : Economie des interventions de l’Etat, Que sais-je ?
3
Samuelson et Nordhaus (2004) : Economie, Economica, 16 ° édition.

MASSART Conférence d’économie de Sophie Harnay
TRISTAN
2
- l’amélioration de l’efficacité économique
- assurer une répartition équitable des revenus
- assurer une économie stable
- conduire une politique économique internationale
-assurer une cohésion sociale
Cela peut se résumer à affecter des ressources à des secteurs que le marché ne peut financer
(=pallier les carences) ; stabiliser en réduisant l’ampleur des variations cycliques de
l’économie et enfin redistribuer pour corriger les inégalités dues au carences du marché.
Partant, le rôle de l’Etat ne peut se limiter à une action strictement de court terme, ne prenant
en compte que les coûts et les bénéfices.
Quels sont les principaux outils à la disposition de l’Etat ?
- l’impôt
- le contrôle des dépenses et des transferts d’argent
- les réglementations
Cependant, l’intervention de l’Etat elle-même n’est pas sans défaut et carence, c’est à
cela que s’intéresse la théorie des choix publics qui rappelle qu’aux défaillances du marché
répondent les défaillances de l’intervention publique (« government failure »).
« Le principe même du gouvernement constitutionnel exige de présumer qu’on abusera du
pouvoir politique dans le sens des intérêts particuliers de son titulaire ; non parce qu’il en est
toujours ainsi, mais parce que c’est la tendance naturelle des choses, et parce que les
institutions libres ont précisément pour objet de la prévenir. » John Stuart Mill
4
(n.b. : La théorie des choix publics relève de l’économie normative, c’est-à-dire qu’elle ne
ressort pas strictement que de la science économique mais fait aussi appel à des notions
éthiques et politiques.). Tâchons maintenant de voir quelles sont les carences relevées par la
théorie des choix publics.
II. La théorie des choix publics
1. Les principales hypothèses
La théorie des choix publics suppose que les agents des décisions de la politique
économique se comportent de la même façon que les agents du marché, c’est-à-dire avec
comme motivation principale de maximiser leur bien-être (cf. les hypothèses de la
maximisation de l’utilité ou du profit). Ceci nuancé bien sûr par le fait que certaines actions
sont prises en prenant compte de l’intérêt commun mais avec néanmoins pour principe majeur
(et lucide) que la majorité des agents vise avant tout la maximisation de son bien-être. Cette
théorie met alors en place une vision assez sceptique de l’action des gouvernants (the theory
« replaces…romantic and illusory...notions about the working of governments [with] notions
that embody more skepticism, Buchanan
5
»).
Une autre hypothèse de la théorie des choix publics est l’ignorance rationnelle des
électeurs dont le vote n’a quasiment aucune chance d’avoir de réelles conséquences sur l’issue
4
Extrait de Christophe Marchand (1999) : Economie des interventions de l’Etat, Que sais-je ?
5
Extrait de Jane S. Shaw: Public Choice Theory, in the Concise Encylopedia of Economics, site
www.econlib.org

MASSART Conférence d’économie de Sophie Harnay
TRISTAN
3
du vote. De plus, les citoyens n’investissent pas leur temps dans la recherche d’informations
post-électorales sur les élus ou leurs actions, n’en voyant pas l’intérêt étant donné le coût
d’opportunité d’une telle entreprise. Cette ignorance rationnelle et donc volontaire est rare
dans le secteur privé qui est souvent marqué par une asymétrie d’information (involontaire).
La théorie s’intéresse également au comportement des élus et des gouvernants. En
effet elle étudie le comportement des législateurs qui sont tenus d’agir dans l’intérêt du bien
commun, mais ce comportement ne conduit à aucune compensation puisque le législateur ne
récupère pas une partie du budget économisé ou un quelconque bénéfice d’une bonne gestion
des ressources publiques…Il n’y a donc pas d’intérêt direct à agir dans l’intérêt de la
communauté, ce qui n’influence pas les politiques à agir dans ce sens. Les politiques sont en
outre influencés par des groupes de pression (lobbies aux USA par exemple). Tout cela
conduit les agents de la politique économique à se comporter d’une manière qui ne maximise
pas l’intérêt de la communauté mais le leur, c’est-à-dire leur maintien au pouvoir.
Une autre théorie des choix publics a été développée par George Stigler et s’intéresse
au comportement des fonctionnaires : « the theory of capture ». G. Stigler montre que les
fonctionnaires employés par l’Etat ne sont pas motivés par une maximisation de leur revenu
ou profit mais agissent parce qu’ils ont un but fixé, une mission. Ils ont pour cela besoin des
fonds alloués par le Congrès (l’étude de Stigler se base sur la société américaine) et les
personnes ou groupes de personnes qui doivent bénéficier de leur mission sont justement
souvent en mesure d’influencer le Congrès. Dès lors cette dépendance des fonctionnaires
envers les groupes de pression peut leur valoir d’être « capturés » par les groupes d’intérêt
influents (qui sont de natures très diverses).
Toutes ces théories sont autant d’exemple de l’échec des gouvernements selon les
théoriciens des choix publics. Ils proposent alors des moyens de remédier à ces échecs.
Ils suggèrent pour cela l’application du principe de subsidiarité (ce qui pour un Etat
non fédéral revient à la décentralisation).
George Tullock et William Niskanen proposent également de mettre en concurrence
plusieurs services publics pour augmenter les performances et l’efficacité. L’idée est en fait
de rémunérer les services publics selon leurs performances, leurs succès, idée reprise par
Rodney Fort et John Baden qui suggèrent la création d’un « predatory bureau » chargé de
réguler les budgets des différents services selon leur réussite.
Une idée plus controversée par les différents économistes des choix publics est
d’établir une législation limitant les dépenses des services publics.
Mais Buchanan et Tullock analysent aussi le processus des prises de décision
collective. Ainsi ils cherchent à montrer qu’unedécision collective ne suit l’intérêt public que
si elle est prise à l’unanimité, rejetant alors la prise de décision à la majorité.
2. Critiques et évolution
La théorie des choix publics a souvent été critiquée comme une théorie conservatrice
et opposée à toute intervention de l’Etat dans l’économie puisqu’elle met en exergue les
carences de l’Etat et son inefficacité à corriger les imperfections du marché. Ils s’opposent
alors à une vue plus interventionniste, prônée notamment par les kéneysiens. Mais certains
théoriciens des choix publics prônent une intervention du gouvernement et tous ne font pas de
« l’économie idéologique ». Certains se basent sur des modèles objectifs, construisant par
exemple des modèles mathématiques sur les stratégies de votes (qui rappellent un peu la
théorie des jeux). L’Institut de Technologie de Californie a ainsi mis en évidence l’importance
de mettre en place des calendriers pour les élections ou de faire des référendums de manière à
influencer le comportement des politiques et les forcer à prendre en compte toutes les options.
De cette mathématisation de la théorie des choix publics est née la théorie des choix sociaux

MASSART Conférence d’économie de Sophie Harnay
TRISTAN
4
(avec le livre notamment de Arrow en 1951 : Social Choice and Individual Values). Le livre
de Buchanan et Tullock The Calculus of Consent (1962) et notamment sa réflexion sur les
processus de prise de décision ont conduits à la création d’une sous discipline de la théorie
des choix publics : «constitutional economics » (=l’économie constitutionnelle) qui
s’interroge sur les règles qui précèdent les prises de décisions au niveau parlementaire.
Sources bibliographiques :
Samuelson et Nordhaus (2004) : Economie, Economica, 16 ° édition.
Jean Boncoeur et Hervé Thouément (2000) : Histoire des idées économiques, Nathan, 2° édition.
Christophe Marchand (1999) : Economie des interventions de l’Etat, Que sais-je ?
Jane S. Shaw: Public Choice Theory, in the Concise Encylopedia of Economics, site www.econlib.org
1
/
4
100%