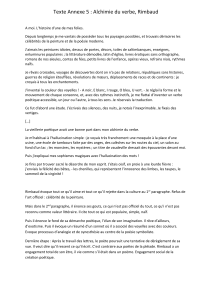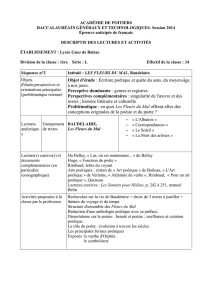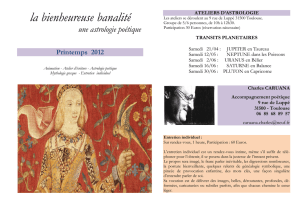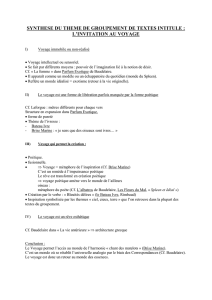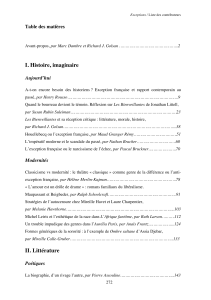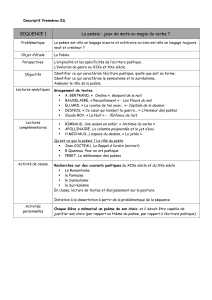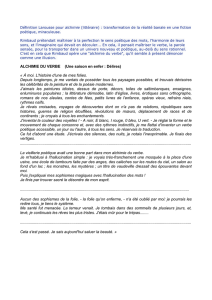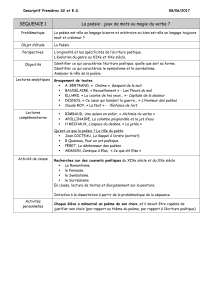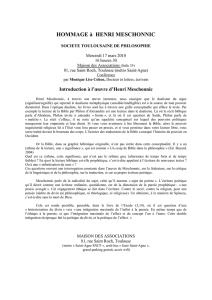Marko Pajević : La Pensée poétique et la question de l`être humain

Marko Pajević : La Pensée poétique et la question de l’être humain.
Fondements d’une anthropologie poétologique.
HDR soutenue le vendredi 19 octobre 2012 à l’Université de Rouen devant un jury
composé de Madame et Messieurs les Professeurs :
Prof. Roland Berbig, Humboldt Universität Berlin
Prof. Gérard Raulet, Université de Paris IV – Sorbonne (rapporteur/ Président du
jury)
Prof. Françoise Rétif, Université de Rouen (directrice de recherches)
Prof. Jürgen Trabant, Freie Universität Berlin/ Jacobs University Bremen
(rapporteur)
Prof. Ralf Zschachlitz, Université Lumière Lyon 2 (rapporteur)
Le dossier d’HDR comprend :
- le nouveau travail intitulé « Poetisches Denken und die Frage nach dem
Menschen. Grundzüge einer poetologischen Anthropologie » publié en
juillet 2012 au Karl Alber Verlag, Freiburg /München (ISBN 978-3-495-
48532-3, 358 pages).
- le document de synthèse « La pensée poétique et la question de l’être
humain. Fondements d’une anthropologie poétologique » de 102 pages.
- Le recueil d’articles (386 pages)
Et quatre autres ouvrages publiés :
- La thèse : Zur Poetik Paul Celans : Gedicht und Mensch — die Arbeit am
Sinn, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 2000, 310 pages.
- Un ouvrage collectif publié sous la direction de M. Pajević : Poésie et
musicalité. Liens, croisement, mutations, L’Harmattan, Paris, 2007, 158
pages.
- Kafka lesen. Acht Textanalysen, Bernstein, Bonn, 2009, 106 pages.
- German and European Poetics after the Holocaust, Camden House,
Rochester and New York, 2011, 310 pages, publié sous la direction de
Gert Hoffmann, Rachel MagShamhrain, Marko Pajević et Michael Shields.
Résumé
Le point de départ des réflexions de ce dossier est la crise de la pensée
occidentale. Elle est causée par un complexe de problèmes créé par ces modes de
fonction justement qui font le succès de l’Occident, à savoir le rôle dominant de

la pensée du signe et de la pensée sujet-objet. Ces attitudes envers la réalité, par
leurs distanciation, rendent possible d’un côté d’exercer une dominance sur le
monde et de le maîtriser jusqu’à un certain point, d’un autre côté, elles privent
l’être humain d’être en congruité avec soi-même. Cela se manifeste dans une
désorientation générale. Dans le contexte de la question anthropologique, qu’est-
ce que l’être humain ?, il faudrait prendre en considération des modèles
alternatives de pensée qui permettront une conception plus large de la raison.
Mes recherches antérieures, portant en grande partie sur la poétique de Paul
Celan, m’ont sensibilisé pour la manière comment le mouvement de la parole
dans le langage crée le sens, comment le sens est constitué dans le langage. J’ai
étudié ces processus dans un bon nombre de textes – de Celan, mais également
de Franz Kafka, d’Ilse Aichinger, d’Ingeborg Bachmann, de l’avant-garde entre les
deux guerres, et de Michael Donhauser et Hans Ulrich Treichel. Ces études
analysent en même temps entre autres le rapport de la littérature à la musicalité,
à la nature, au mémoire, à l’espace et à l’abîme. Ces questionnements avaient
déjà entamé le travail sur le rapport entre la pensée poétique et la question
anthropologique.
Les théories de Peter Sloterdijk et de Giorgio Agamben présentent une entrée
stimulante dans les réflexions sur ce rapport. Sloterdijk thématise les problèmes
de légitimation de l’Humanisme aujourd’hui, dans des conditions médiatiques
changées. Il propose une anthropologie ascétique, où l’être humain est présenté
comme étant constitué par ses systèmes d’exercices, d’ascèses. Il évoque aussi la
constitution dyadique de l’être humain, les atmosphères et les résonances ; or, ces
éléments ne sont pas suffisamment élaborés et motivés chez lui. Ils sont pourtant
des approches importantes dans l’autoréflexion de l’être humain ; le travail
présenté dans ce dossier les poursuit dans la perspective de la pensée poétique
en établissant des soubassements plus solides.
Agamben étudie la question anthropologique dans des conditions
contemporaines en vue des mises en question historiques et technologiques de
l’Humanisme. Il oppose sa notion de forme de vie à celle de biopolitique ; cette
dernière est pour lui la conception de l’être humain qui est privé de son
humanité, considéré comme élément stratégique dans des enjeux politiques. La
forme de vie, en revanche, implique que l’être humain est toujours considéré

dans le contexte de ses formes de vie concrètes. Cela se veut comme une
résistance contre l’anthropologie technologique contemporaine.
Dans ce contexte, j’analyse aussi le rôle des sciences culturelles
(Kulturwissenschaften) que je propose d’appeler disciplines du sens
(Sinnwissenschaften ou (Be)Deutungswissenschaften). La dimension spirituelle et
l’historicité doivent être prises en comptes dans nos idées sur l’être humain,
contre les définitions purement biologiques et universalistes. La dimension du
sens dépasse toujours le factuel et est développée dans un processus culturel
langagier. Pour comprendre la vie humain, il est par conséquent indispensable
de développer des théories sur ces processus.
C’est l’arrière-plan devant lequel mon travail poétologique poursuit la question
anthropologique. Après une présentation de la situation de l’anthropologie
philosophique, j’analyse le rôle de l’art et de la littérature dans les sciences de la
vie, en me référant à la notion d’Ottmar Ette, donc à l’opposé des life sciences
dominantes. Je base mon argument sur la critique des technologies hominales par
Günter Seubold et surtout sur la notion atmosphère et la pensée du corps que l’on
est (Leib), developpées par Gernot Böhme. Ces réflexions résultent dans la
nécessité d’intégrer le concept d’une transcendance immanente (Tugendhat)
dans notre vision du monde.
Sur cette base d’un autre de la raison (Böhme), le chapitre suivant présente la
tradition de Sprachdenken (pensée du langage) et sa poétique inhérente, pour
l’opposer à la pensée du signe. Je procède d’abord à l’aide de l’anthropologie
historique du langage de Jürgen Trabant et de son histoire de la pensée
européenne sur le langage, basée sur Wilhelm von Humboldt. La tradition
européenne, philosophique et religieuse, est hostile envers le langage. Ce n’est
qu’avec Leibniz, et ensuite avec Hamann, Herder et Humboldt, qu’une autre
tradition se forme : celle de Sprachdenken qui considère justement que c’est
l’infinie et merveilleuse variété des opérations langagières (Leibniz) qui forme la
base et la richesse de la pensée humaine, et sans laquelle l’être humain n’aurait
jamais pu développer son esprit et ses exploits. Je considère aussi les
conséquences pour la politique de langues.
C’est ensuite à l’aide de la poétique du continu d’Henri Meschonnic que j’élabore
la dimension du langage que Humboldt appelle rednerisches Sprechen et qui

s’oppose à la pensée du signe. Penser sur la base d’une conception du signe ne
permet pas de penser le phénomène de la littérature et présente une réduction
de la vie humaine. La théorie du rythme de Meschonnic est une tentative de
dépasser cette pensée limitée dans l’entreprise paradoxale de développer des
concepts pour ce qui dépasse la pensée conceptuelle, afin de s’approcher de
l’intelligibilité de la présence.
Cette pensée du langage est soutenue par la pensée dialogique pour établir des
fondements plus solides pour la pensée poétique. Après une introduction
historique rapide dans le dialogisme et des sous-chapitres sur les théories du
langage des approches dialogiques par Ferdinand Ebner et Franz Rosenzweig, je
focalise sur le principe dialogique développé par Martin Buber. Buber parle, à
côté de notre mode d’être quotidien, la relation je-il, d’une relation je-tu.
Contrairement au je-il, où les choses sont considérées comme objets, le je de la
relation je-tu entre dans une sphère entre-deux (Zwischen) avec l’Autre, où la
pensée sujet-objet est dispensée. J’analyse également les rapports
problématiques entre la philosophie et la pensée dialogique, ainsi qu’entre
Emmanuel Lévinas et Buber.
Ces deux approches, pensée du langage et pensée dialogique, avec leur diverses
parallèles, forment la base pour la notion de pensée poétique. Celle-ci est clarifiée
à l’aide d’exemples pour mettre en avant certains de ses aspects. C’est d’abord un
poème de Paul Celan qui éclaire le caractère transformateur du poétique, déjà
évoqué dans la théorie de Meschonnic. Un petit texte en prose de Peter Handke
sert à présenter sa poétique de la perception : lorsqu’on les abordent
attentivement, les choses sont reconnaissables et reconnaissantes (das Sich-
erkenntlich-Zeigen der Dinge). La pensée poétique implique une attitude
dialogique au monde. Cet aspect langagier et les forces interrelationnelles entre
langage et monde sont soulignés par la poétique de la nomination de Michael
Donhauser. La manière particulière de filmer de Werner Herzog met en avant
l’exigence d’une poétique de l’ek-stase qui fait partie de la pensée poétique.
En prenant en compte cette conscience du langage et le dialogique, nous pouvons
thématiser des idées de présence, devenues impossibles dans notre épistémè. La
pensée poétique renvoie à ces angles morts de notre épistémè pour développer
une anthropologie poétologique. Elle n’est pas saisissable par la pensée du signe,

mais elle démontre les limites des life sciences et présente une culture plus riche,
comprenant l’imagination et la création.
1
/
5
100%