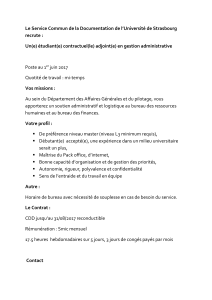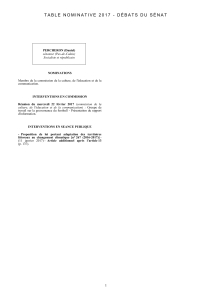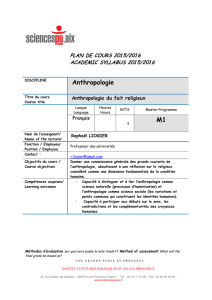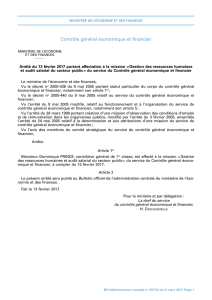du 21 AU 30 DECEMBRE 2016

Gerard CLEMENT Page 1 du 21 AU 30 DECEMBRE 2016 84090517816/04/2017
1
CENTRE RHONE –ALPES D’INGENERIE SOCIALE SOLIDAIRE & TERRITORIALE
REVUE DE PRESSE
Du 21 AU 30 DECEMBRE 2016

Gerard CLEMENT Page 2 du 21 AU 30 DECEMBRE 2016 84090517816/04/2017
2
Femmes exclues des cafés : l'inquiétante léthargie de l’Occident face au péril islamique
Primaire à gauche : pour atteindre Valls, c'est la laïcité que Peillon attaque !
Des précisions utiles sur la gauche et la substitution des prolétariats
CGT, effritement d’un bastion
Les emplois d’avenir mènent à la qualification
« À qui la faute ? », ou les erreurs économiques dans la gestion de la crise
« Réinventer le progrès », ou comment concevoir les transitions de l’économie numérique et de l’écologie
La théorie du sans emploi : un pas dans la sociologie néolibérale
En ces périodes de primaire (s) , le conflit est-il primaire ?
L'anthropologie managériale réinterroge le sens donné au travail humain
Malgoverno à la française
Front populaire: un octogénaire sans anniversaire
L'article 66 ou Le Vengeur masqué
Syndicalisme : comment font les autres ?
La rhétorique politique entre conviction et intoxication
Politique et Internet : une citoyenneté renouvelée ?
Comment la "déconnomie" guide le monde, par Jacques Généreux
Femmes exclues des cafés : l'inquiétante léthargie de l’Occident face au péril islamique
Lundi 12 Décembre 2016 à 11:55
Lydia Guirous
Essayiste, auteure de Je suis Marianne et de Allah est grand la République aussi. Ancienne porte-parole de Les Républicains.
Lydia Guirous en appelle au "réveil du citoyen de l'Occident" face à "l'obscurantisme islamique qui progresse rapidement". Un citoyen
"anesthésié par l'individualisme narcissique et le matérialisme".
Mercredi 7 décembre, un reportage salutaire est diffusé dans le journal de David Pujadas sur la ségrégation sexuelle qui règne dans certains
quartiers de France. Il n'est jamais trop tard pour voir le triste état de la France. Dans mon premier livre Allah est grand, la République aussi,
j’avais dénoncé cette réalité dans une description sans fards, ni détours, de la terrifiante évolution d’une ville populaire où le
communautarisme islamique met petit-à-petit fin au vivre-ensemble. J'avais rapporté l'anecdote de ma tante qui arrivant d'Algérie pour un
court séjour nous avez déclaré, taquine et désolée : "Je n'ai pas fait deux heures d'avion pour me retrouver à Bab-el-Oued! "...
À Roubaix, à Sevran, à Villeurbanne... le communautarisme va toujours de pair avec l’islamisme qui diffuse dans les esprits un machisme
honteux qui piétine des années de lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, en rendant, entre autres, l’accès aux cafés et terrasses
inaccessible aux femmes. Défier cette règle tacite de non-mixité c’est s’exposer au harcèlement, aux brimades, et parfois à la violence
physique. Finalement, dans ces quartiers, une femme n’est tolérée dans l’espace public que dans le cadre exclusif de l’accomplissement de ses
tâches domestiques : faire les courses, aller chercher les enfants, promener les enfants, les emmener chez le médecin… Le tout dans une tenue
« décente », à savoir tête couverte pour ne pas heurter la sensibilité exacerbée de ces hommes qui semblent avoir développé un certain
fétichisme pour la chevelure.
"DÉFIER CETTE RÈGLE TACITE DE NON-MIXITÉ C’EST S’EXPOSER AU HARCÈLEMENT"
La bien-pensance avait bien sûr accueilli cette réalité crue avec mépris. Ils étaient de ceux qui désignaient comme « islamosphobe »
,« intégriste de la laïcité », « colonialiste »... ceux qui dénonçaient courageusement le recul de la laïcité face à la montée de l'islamisme en
France. Ils préféraient se vautrer dans le confort de leurs certitudes, la facilité du déni et caricaturer ceux qui osent dénoncer ces assauts
continus contre la République. Les bien-pensants et les islamistes ont en commun une forme de tyrannie de la pensée : imposer leur vision de
la société aux autres et jeter l'opprobre sur ceux qui refusent de renoncer à leur esprit critique.
Oublions. La réalité rattrape toujours celui qui tente de lui échapper. Tout déni finit pas prendre fin. Il vous met face à votre situation comme
un verdict sans appel. Aujourd'hui, le voile des aveugles volontaires semble se lever pour découvrir ce que les Français vivent et observent avec
désespoir chaque jour depuis des années : la lente agonie de la République sacrifiée sur l'autel d’un relativisme culturel qui dévoie la tolérance.
"SANS UN RÉVEIL DU CITOYEN, LA VICTOIRE DE L’ISLAMISME SERA INÉLUCTABLE"
"C'est culturel, c’est leur tradition, il faut respecter". Ne nous trompons pas, la générosité et la tolérance qui se dégagent de prime abord de ce
comportement n'ont pour seule ambition que de rassurer la personne sur ses propres qualités de cœur. Appartenir au "camp du bien" est
l’obsession. De ces raisonnements individualistes, à la lisière de l'auto-médication psychologique, nait un éloignement effrayant avec l'intérêt
général et les grands principes fondateurs de notre pays qui cimentent encore le peu de cohésion nationale qu'il nous reste.
Individualisme, narcissisme et consumérisme se substituent à l'engagement, l’intérêt général et aux idéaux. La léthargie de l’Occident face au
péril islamique est des plus inquiétantes au moment où les communautaro-islamistes avancent intransigeants et sûrs d'eux.
Ils sont déterminés à servir le projet d’une religion dévoyée devenue idéologie politique de conquête. Ils affichent tout le mépris qu'ils nous
portent en imposant leur mode de vie, leur vision de la société et en piétinant nos principes fondamentaux. Egalité hommes-femmes, laïcité,
libre-circulation, liberté vestimentaire, mixité, métissage... seront-ils bientôt que de vagues souvenirs en France ?
L'individualisme narcissique et le matérialisme ont anesthésié le citoyen. Face à l’obscurantisme islamique qui progresse rapidement, un
réarmement moral, culturel et une détermination à faire triompher nos valeurs doivent être mis en œuvre par chacun et à chaque instant. Une
guerre, même culturelle, ne se gagne jamais sans patriotisme, sacrifice et engagement pour des idéaux. Sans ce réveil du citoyen, la victoire de
l’islamisme sera inéluctable.
Primaire à gauche : pour atteindre Valls, c'est la laïcité que Peillon attaque !
Lundi 19 Décembre 2016 à 10:42
Fatiha Boudjahlat
Céline Pina

Gerard CLEMENT Page 3 du 21 AU 30 DECEMBRE 2016 84090517816/04/2017
3
Vincent Peillon, qui quand il était ministre de l’Education Nationale fut à l’origine de la charte de la laïcité en 2013,
se place désormais sur le terrain des accommodements tous azimuts.
Un jour nous irons vivre en théorie parce qu’en théorie tout se passe bien
» et nous y retrouverons Vincent Peillon qui
manifestement y vit depuis un temps certain. En effet, le énième candidat à la Primaire du PS était l’invité de Ruth Elkrieff,
vendredi 16 décembre sur BFMTV et il a réussi l’exploit de parler de sa candidature à la présidence de la république, de laïcité, de
Syrie et d’islamisme sans faire une seule fois référence aux attentats et assassinats qui ont ponctué les années 2015 et 2016. Sans
montrer une seule fois qu’il a conscience des attaques qui ont frappé notre pays et de la menace qui continue de peser sur nous à
la fois en tant que peuple constitué et individus libres. Hors sol, voilà comment est apparu l’homme dont la candidature n’a été
pensée que pour obéir à un mot d’ordre : Tout Sauf Valls.
Quand servir ses querelles personnelles conduit à attaquer un principe universel
Il faut dire que l’horizon pour Vincent Peillon n’est ni la France ni la République mais le PS et ses querelles de personnes. Hélas,
quand on cherche à servir ses querelles sans s’interroger sur leur importance réelle, on peut finir par oublier la réalité dans laquelle
on s’inscrit. Cet oubli n’est pas seulement un calcul, mais le fruit de la situation fausse dans laquelle il s’est placé : puisque Valls est
le seul à être lucide et clair sur l’offensive islamiste, puisqu’il est le seul à être limpide et cohérent sur la laïcité, il faut en faire un
suppôt de l’intolérance et un semeur de discrimination, un homme qui fait monter le Front national et qui détruit l’esprit de nos lois
et de nos principes universels. Mais pour atteindre Valls, c’est à la laïcité que Peillon va porter l’essentiel de ses coups.
Mesurons d’abord le ridicule et l’ampleur du virage : Vincent Peillon, ancien chantre de la laïcité, se place désormais sur le terrain
des accommodements tous azimuts.
Dans cette interview télévisée il reprend, et donc valide, la fausse alternative imposée par les islamistes et leurs idiots utiles, entre
la gentille laïcité douce comme une lotion de bébé et celle relevant de «
l’orthodoxie à rebours
», de «
l’intolérance
» et qui
«
désignerait certaines populations
». En cela, cet échange avec Ruth Elkrief est emblématique : il met en scène tout ce qui rend
les hommes politiques méprisables : l’abandon de valeurs pour gagner des voix. Au bingo des mots à caser pour s’assurer le vote
communautariste et gauchiste, Vincent Peillon a réalisé un carton plein, se dépêchant de noyer la critique des islamistes sous la
mise en accusation des juifs ultra-orthodoxes et des catholiques ultras de la Manif pour Tous. On aurait aimé que les islamistes se
contentent de manifester avec des T-shirt bleus et roses. Avons-nous recensé par ailleurs une victime du judaïsme ultra-orthodoxe
en France ces dernières années ? Vincent Peillon n’a jamais évoqué les vraies victimes, celles du terrorisme, or jusqu’à
maintenant, c’est l’islamisme qui a tué et ce sont les Français le rejetant, par leurs fonctions ou par leurs occupations, qui ont été
tués.
En évacuant la dimension politique de conquête du pouvoir et de conquête territoriale des islamistes et en faisant semblant de
mettre au même niveau de dangerosité et de capacité d’action les fanatiques de toutes les religions, Vincent Peillon, pour mettre
Manuel Valls dans sa ligne de mire, mitraille tous les républicains et n’hésite pas à faire passer les tenants d’une laïcité sans
adjectif, pour de dangereux boutes-feux. Au mieux ils sont accusés de faire dans «
l’amalgame
» et la «
brutalité
», au pire
d’attaquer
« un certain nombre d’identités historiques et culturelles
». La référence laïque ne cacherait ici que xénophobie et
racisme. Et M. Peillon, par cet élément de langage, remporte le pompon des indigénistes : il s’agit «
d’identités historiques
et
culturelles
», pas de religion ni de politique, juste du folklore, donc. M. Peillon, place-t-il le voilement du côté du folklore ? Celui
des petites filles aussi ? Il s’est en tout cas empressé de prendre l’exemple du burkini, débat rendu de nouveau très actuel par la
saison et la météo…
C’est qu’il faut se distinguer du méchant Valls. Au prix d’un lapsus non relevé mais terriblement révélateur du mépris d’une certaine
gauche. Evoquant les musulmans qu’il convient de distinguer des «
islamistes radicaux
» (vous et nous y verrions une redondance,
pas le député européen philosophe), M. Peillon déclare : «
Ils ne pratiquent plus, ils aiment cette République, ils cherchent du
travail, ils défendent nos valeurs
». Quel étrange méli-mélo ! Faut-il ne plus pratiquer sa religion pour montrer son attachement à
la République ? M. Peillon s’emmêle dans les fils qui dirigent la marionnette qu’il est.
Un opportunisme qui alimente le rejet par les Français de leur classe politique
C’est pourtant lui qui, ministre de l’Education Nationale, fut à l’origine de la charte de la laïcité en 2013, charte à l’époque critiquée
par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dahlil Boubakeur et par d’autres comme
« stigmatisante »
pour les musulmans. C’est
lui qui avait maintenu la circulaire Châtel et l’obligation de neutralité faite aux parents accompagnateurs de sorties scolaires dans
un communiqué[2] daté du 22 Décembre 2013. Il y déclarait : «
Le milieu scolaire est un cadre qui doit être particulièrement
préservé. Ainsi s'agissant des parents d'élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, ils doivent faire preuve
de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. C'est ce qu'indique la circulaire du 27 mars 2012 (…)
Cette circulaire reste donc valable.
» Mais ça, c’était avant.
Comment ne pas avoir le tournis ? Najat Vallaud-Belkacem a rendu cette circulaire caduque[3], dans une déclaration faite devant
l’Observatoire de la laïcité et a incité les directeurs d’école à accepter ces parents dans l’ostentation religieuse. La Ministre évoquait
dans son allocution l’écueil de «
la laïcité dite de combat, qui stigmatise le fait religieux et constitue parfois le masque de
l’islamophobie.
» Qui donc fait dans l’amalgame ? Et à la fin de tout ce cirque, c’est Vincent Peillon, candidat-lige catapulté dans la
primaire du PS, qui se place dorénavant dans le sillon accommodant de Najat Vallaud-Belkacem. Laquelle a finalement rejoint
Manuel Valls, son opposé dans ce domaine. Comment se garder de ressentir du dégoût face à ces girouettes dont la seule
constance se trouve concentrée dans la construction de leur propre carrière ?
Un déni de réalité indigne d’un homme d’Etat
Aspirer à diriger la France et les Français et réussir à ramener le déni sur le devant de la scène dès le début de sa campagne, voilà
l’exploit qu’a su réaliser Vincent Peillon. Rappelons-lui tout de même que si les questions liées à la laïcité et à l’islamisme prennent
dans notre pays une résonnance particulière, c’est en raison d’un contexte exceptionnel : il y eut d’abord Mohamed Merah en 2012,
l’attaque du commissariat de Joué-Les-Tours en 2014, puis les attentats de
Charlie
, de l’hyper-casher, des attaques au couteau
devant un centre communautaire juif, l’agression d’un militaire à Orly, la décapitation d’Hervé Cornara en Isère, l’attentat déjoué
du Thalys, les attentats de Paris, les meurtres des deux policiers de Magnanville, puis la tuerie de Nice, l’assassinat du père
Hamel… Et aujourd’hui il ne se passe guère de semaine sans que l’on apprenne qu’un attentat a été déjoué…
Il faut atteindre un niveau de déconnexion stratosphérique pour se porter candidat à la présidence de la République et oublier que
si nous sommes en état d’urgence c’est que nous sommes attaqués, que le sang a coulé sur notre sol, que plus de 230 des nôtres
sont morts, que nous nous préparons à affronter d’autres meurtrissures. Il faut être particulièrement loin des préoccupations de
nos concitoyens pour ne pas comprendre qu’ils n’ont rien contre les musulmans mais n’acceptent plus que l’on impose des règles
d’un autre siècle et d’une autre culture sur notre sol, à quelques kilomètres de la Tour Eiffel. Il faut être particulièrement aveugle

Gerard CLEMENT Page 4 du 21 AU 30 DECEMBRE 2016 84090517816/04/2017
4
pour ne pas voir qu’un nouveau totalitarisme se lève et qu’il est nourri par une idéologie islamiste que répandent dans certains
quartiers frères musulmans et salafistes.
Dans un tel contexte, Vincent Peillon n’a pas eu un mot pour les victimes des djihadistes, encore moins pour celles du
fondamentalisme islamiste, pas un mot pour les femmes interdites de café et chassées de l’espace public, tant il était occupé à
entonner l’air du « padamalgame »… Oubliant qu’à force de parler de respect des musulmans quand il se trouve face à des
revendications et discours islamistes, le politique provoque les amalgames là où il pourrait les éviter. Oubliant que c’est le refus
d’une grande partie de la gauche de prendre ses responsabilités, de faire respecter nos lois et nos idéaux, qui a fait monter la peur
dans la population et alimenté le vote extrémiste. Que pour tenter d’abattre un adversaire de son propre parti, cet homme, au
demeurant plutôt intelligent et expérimenté, en vienne à oublier ce qu’il doit à son pays dit tout du péril qui nous guette : trop de
politiciens sans envergure se disputent une fonction où l’on a plus que jamais besoin d’hommes d’Etat. A voir les attaques qu’il
subit tant des islamistes que des bien-pensants islamo-compatibles, Manuel Valls gagnerait à choisir la voie du courage et de la
responsabilité dès la primaire socialiste, car l’appareil ayant refusé la présence du candidat du MRC, Bastien Faudot, également
impeccable sur ces questions-là, il est aujourd’hui le seul à pouvoir ramener vers la primaire du PS, les républicains de gauche.
Céline Pina, ex-élue socialiste, est essayiste et militante, elle est l’auteur de
Silence coupable
, paru aux Editons
Kero. Fatiha Boudjahlat est professeure et secrétaire nationale du MRC en charge de l’education. Toutes deux sont
les co-fondatrices de « Viv(r)e la République » mouvement laïque féministe et républicain appelant à lutter contre
tous les totalitarismes et pour la promotion de l’indispensable universalité de nos valeurs républicaines
[2] http://www.education.gouv.fr/cid76045/etude-du-conseil-d-etat-realisee-a-la-demande-du-defenseur-des-
droits.html
[3] http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/09/01/31001-20160901ARTFIG00123-sorties-scolaires-et-signes-
religieux-la-lachete-de-najat-vallaud-belkacem.php
Des précisions utiles sur la gauche et la substitution des prolétariats
Mardi 13 Décembre 2016 à 13:00
Laurent Bouvet
Laurent Bouvet apporte ici des précisions sur son concept de "substitution d’un prolétariat à un autre" évoqué lors d'un entretien à
"Marianne" la semaine passée.
Dans un entretien à Marianne le 9 décembre, nous expliquions que :
“Les gauches, qu’il s’agisse de la social-démocratie ou de la gauche radicale, ont progressivement donné la priorité aux catégories populaires
venant de l’extérieur du pays dans leurs projets respectifs. Pour la gauche social-démocrate, dite « moderne », avec la mondialisation des
échanges, l’ouverture des frontières et les délocalisations, ces prolétaires venus d’ailleurs apparaissent comme le meilleur moyen de baisser le
coût du travail. Pour la gauche radicale, ils sont le prolongement de l’internationalisme et de la lutte anticoloniale.
C’est ce qui explique que dans tous les grands pays industriels, la gauche radicale elle aussi (Jérémy Corbyn, Bernie Sanders ou Jean-Luc
Mélenchon…), séduit d’abord des gens diplômés, des jeunes, des catégories dites « ouvertes » à la mondialisation mais finalement assez peu les
catégories populaires. Il y a eu en quelque sorte substitution d’un prolétariat à un autre.”
Le caractère concis et sans doute elliptique de ces quelques lignes a pu conduire certains lecteurs non familiers des réflexions et des travaux
de leur auteur à des interprétations aussi rapides que fausses sur le fond du propos. Dès lors, quelques précisions s’imposent. Le fait pour la
gauche (quasiment toute la gauche donc) d'avoir intégré la mondialisation dans son “logiciel” (que ce soit par la libéralisation ou par
l’altermondialisme) à partir du début des années 1990 a produit en son sein une préférence de fait pour des catégories populaires extérieures
à celles qui sont installées en France : soit en favorisant dans la division internationale du travail les travailleurs pauvres des pays émergents au
détriment des travailleurs en France (délocalisations, stagnation du pouvoir d'achat, prévarication des emplois...) ; soit en favorisant la
pression sur la “modération” salariale en instaurant davantage de concurrence entre travailleurs non qualifiés récemment arrivés en France et
travailleurs déjà présents.
Côté gauche radicale, l'idée étant davantage culturelle qu’économique, conduisant à repérer et privilégier dans le discours de plus en plus les
catégories populaires étrangères ou issues de l'immigration afin de “compenser” en quelque sorte le colonialisme et les responsabilités des
pays colonisateurs en la matière, et plus largement de maintenir un lien historique avec un internationalisme mis en porte-à-faux par la
mondialisation. Les thématiques qui se sont déployées à gauche de droit à la différence, de diversité, d'intersectionnalité, etc. depuis 30 ans
témoignent de ce grand virage.
Au regard de quoi, l'éloignement des catégories populaires déjà présentes sur le territoire national (qu’elles soient d'origine étrangère ou non
d'ailleurs) d'un vote systématiquement de gauche (gauche de gouvernement ou gauche radicale) étant peu à peu venu confirmer ce tournant.
La fameuse note de Terra Nova de mai 2011 ne faisant qu’acter au grand jour une telle évolution de long terme. Une note que nous avons
suffisamment dénoncée et combattue dès 2011 pour ne pas avoir, une fois de plus, à le faire ici.
CGT, effritement d’un bastion
mercredi 21 décembre 2016
Résultats des élections professionnelles de novembre 2016 à l’EDF et dans les industries électriques et gazières
Les élections professionnelles se sont déroulées à l’EDF en novembre 2016. Des résultats sont publiés.
Comme le montrent les tableaux ci-dessous, les résultats de ces dernières élections à EDF poursuivent une évolution déjà
commencée. Tout en gardant sa première place, depuis 2007 la CGT a perdu plus de 12 points, en 9 ans, au niveau de la société
EDF SA (2007 : 47 %) au profit de la CGC surtout, en lien avec la progression du nombre de cadres. La CFDT rétablit son score de
2010, FO continue une progression modérée, la CFTC et Sud en restent à des scores très faibles.
2016
2013
2010
CGT
34,76 %
37,5 %
41,97 %
CGC - Unsa
25,41 %
23,25 %
18,02 %

Gerard CLEMENT Page 5 du 21 AU 30 DECEMBRE 2016 84090517816/04/2017
5
2016
2013
2010
CFDT
21,38 %
20,66 %
21,44 %
FO
13,86 %
13,31 %
12,45 %
EDF SA
Au RTE (réseau de transport d’électricité), entre 2010 et 2016 la CGT a perdu presque 8 points en 6 ans (2010 : 46,75 %).
Profitent de cette baisse la CFDT, la CGC et un peu FO. La CFTC reste complètement marginale.
2016
2013
CGT
38,98 %
44,23 %
CFDT
28,09 %
26,6 %
CGC
20,6 %
17,63 %
FO
11,8 %
11,07 %
Sud
2,6 %
-
CFTC
0,3 %
0,48 %
RTE
Ces résultats confirment une tendance qui se développe dans les grands bastions historiques de forte adhésion syndicale à la
CGT : SNCF… Tant les positions de la centrale que l’évolution des salariés, de leurs qualifications et de leurs attentes sont des
facteurs qui interviennent dans ce mouvement.
Ils sont ensuite agglomérés aux résultats des autres entreprises pour déterminer la représentativité générale dans la branche des
IEG, puis au niveau de la représentativité générale… Dans la branche (163 entreprises, 148 000 salariés), si le recul de la CGT est
plus limité cette fois-ci, il succède à de très fortes baisses (2010 : 46,23 %, 2007 : 50,15 %). La tendance va donc dans le même
sens.
2016
2013
CGT
40,11 %
41,95 %
CGC
23,88 %
20,48 %
CFDT
19,32 %
19,36 %
FO
13,74 %
14,09 %
Branche IEG (industries électriques et gazières)
Les emplois d’avenir mènent à la qualification
mercredi 21 décembre 2016
Dans un récent rapport, la DARES se penche sur les caractéristiques de la formation des jeunes en emploi d’avenir. Ce dispositif a été créé
en 2012 et depuis 300 000 jeunes, environ, y ont eu accès. L’étude du ministère du travail précise que, « un an après la signature de leur
contrat, trois jeunes sur quatre en emploi d’avenir ont bénéficié d’une formation et un jeune sur deux d’une formation certifiante ». Cette
vision positive contraste avec un récent rapport de la Cour des comptes beaucoup plus sévère quant au coût et aux résultats.
Ce que sont les emplois d’avenir ?
Les emplois d’avenir ont pour objectif de faciliter l’insertion sur le marché du travail des jeunes peu ou pas qualifiés en leur proposant un
emploi à temps plein de longue durée incluant un projet de formation. Il s’agit d’une obligation légale. La formation est suivie par un tuteur au
sein de l’entreprise. Principalement destiné aux employeurs du secteur non marchand (secteur associatif, collectivités territoriales, etc.), le
dispositif est également ouvert à certains secteurs d’activité du secteur marchand.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%