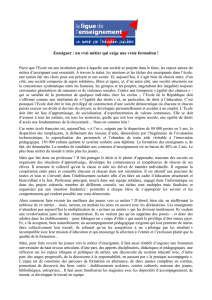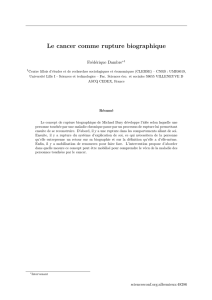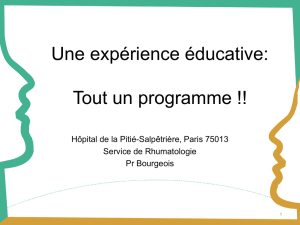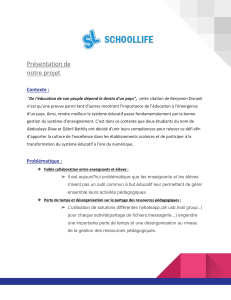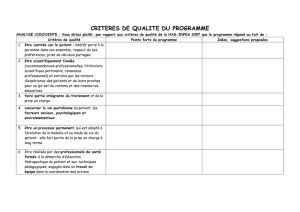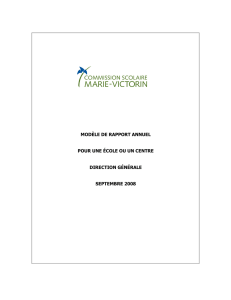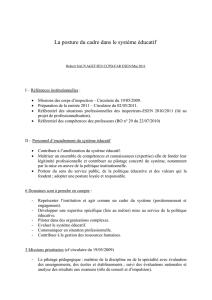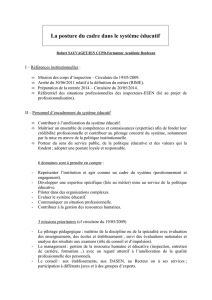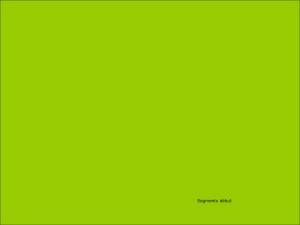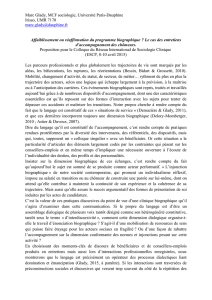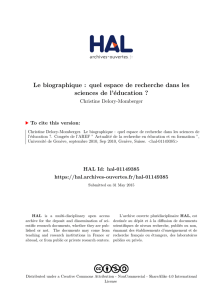MiseEnMots - Word - 25 ko

Séminaires thématiques CIREL- Proféor 2009-2010
Mises en mots du travail éducatif
Lundi 25 janvier 2010
Organisation : Christophe Niewiadomski
Après avoir abordé le travail éducatif par la question des frontières dans le
précédent séminaire, nous tenterons, le 25 janvier, d’aborder quelques éléments relatifs
aux conditions de sa mise en mots. Au cours de cette journée, nous nous centrerons, entre
autres aspects, sur l'exploration des liens entre l'individu et le monde social et culturel et
sur la dialectique objectivité-subjectivité dans la mise en mots du travail éducatif,
questions auxquelles nous sommes confrontés de manière récurrente dans la conduite de
nos travaux en sciences de l'éducation et de la formation.
A ce titre, et puisqu'il s'agit bien de « mise en mots » du travail éducatif, nous
pourrons nous intéresser tout particulièrement aux processus de « biographisation » tels
que l’envisage par exemple le domaine de la recherche biographique. Celle-ci se donne
en effet pour objectif d'explorer les processus de construction du sujet au sein de l’espace
social en tentant de comprendre comment les individus donnent forme à leurs
expériences, comment ils font signifier les situations et les événements de leur existence,
comment ils agissent et se construisent dans leurs environnements historiques, sociaux,
culturels, politiques. Christine Delory Momberger précise à ce propos: « Nous n'arrêtons
pas de nous biographier, c'est-à-dire d'inscrire notre expérience dans des schémas
temporels orientés qui organisent mentalement nos gestes, nos comportements, nos
actions, selon une logique de configuration narrative. Cette activité de biographisation
pourrait être définie comme une dimension du penser et de l'agir humain qui, sous la
forme d'une herméneutique pratique, permet aux individus, dans les conditions de leur
inscriptions socio-historiques, d'intégrer, de structurer, d'interpréter les situations et les
événements de leur vécu. »
1
Dans le domaine de l’éducation, entendu ici au sens large du terme, la recherche
biographique s’interesse à la relation étroite entre formation, apprentissage et biographie.
Celle-ci ne vise pas tant à produire un savoir « objectivé » qu’à comprendre la manière
dont les acteurs font signifier leurs expériences de formation et d’apprentissage et le rôle
que jouent les institutions éducatives et formatives dans les constructions biographiques
1
Delory Momberger C. (2009) La condition biographique. Essai sur le récit de soi dans la modernité
avancée. Paris, Téraèdre

individuelles et dans les processus de socialisation. Ceci n'est, à l'évidence, pas sans
conséquences sur l'épineuse question de la dialectique objectivité-subjectivité dans les
sciences sociales et sur le débat entre explication et compréhension introduit il y a plus
d'un siècle par Dilthey.
2
La mise en mots est ici à questionner comme écriture ou parole
sur soi et ouvre donc le débat sur la parole du sujet et son statut dans les recherches en
sciences humaines
En outre, ces préoccupations rejoignent bien entendu les travaux qui se penchent
aujourd’hui sur l’étude des articulations entre processus de socialisation, de
subjectivation et d’individuation et pour lesquelles l’usage du biographique et de la
« mise en mots de l'expérience » joue désormais un rôle déterminant. Ainsi, pour Vincent
de Gaulejac : « On ne peut plus séparer l’étude de la société de celle de l’individu. Nous
n’avons plus là deux entités dissociées, mais un ensemble de processus complexes qui
relient en permanence le registre individuel et le registre social. » L'auteur souligne:
Certes, l'étude de la fabrication sociale des individus reste l'un des objets privilégiés de
la sociologie. Mais le sujet n'est pas inerte quant à l'agencement des différents éléments
qui contribuent à sa constitution. Dans ce contexte, les notions de subjectivité, d'identité,
d'individu et de sujet deviennent incontournables.»
En d'autres termes, si les situations éducatives confrontent les acteurs sociaux à
des environnements communs, la manière dont ils vivent ces expériences renvoie aussi à
des disparités de représentations que la mise en mots du travail éducatif permet sans
doute d'approcher avec une granularité descriptive que l’on devine potentiellement
heuristique.
Si nous lançons le débat à partir de l’approche biographique, ce n’est pas sans
ignorer d’autres formes et d’autres approches de la mise en mots qui coexistent dans la
recherche en éducation. L’analyse à partir d’entretiens constitue également une mise en
mots du travail éducatif, du point de vue de différents acteurs.
Globalement, nous pourrons nous interroger sur les formes de traduction,
d’expression de cette expérience qui est celle du travail éducatif. A quelles conditions est-
elle possible, dans quels buts, à partir des mots de quels acteurs ?
Il s'agira donc ici, à partir des travaux menés par les membres du laboratoire, de
dialoguer et de débattre autour de ces questions liées aux formes et aux conditions de la
« mise en mots » du travail éducatif et de leurs apports pour la recherche en éducation et
en formation.
2
Dilthey W. (1883) Introduction aux sciences de l’esprit. Par ailleurs, voir à ce propos : Critique de la
raison historique. Introduction aux sciences de l’esprit et autres textes. Présentation, traduction et notes
par Mesure S. Paris, Cerf, 1992
1
/
2
100%