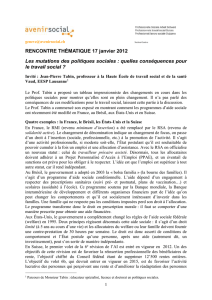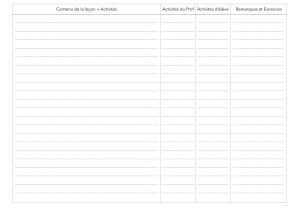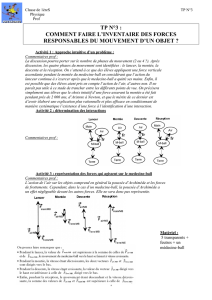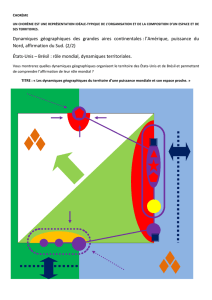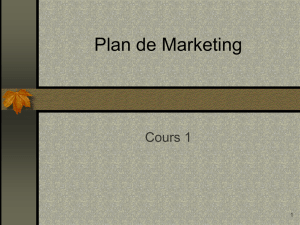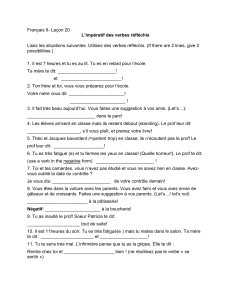compte_rendu_jeanpierre_tabin_12janvier2012 (137 Ko)

1
geneve@avenirsocial.ch Section Genève
RENCONTRE THÉMATIQUE 17 janvier 2012
Les mutations des politiques sociales : quelles conséquences pour
le travail social ?
Invité : Jean-Pierre Tabin, professeur à la Haute École de travail social et de la santé
Vaud, EESP Lausanne
1
Le Prof. Tabin a proposé un tableau impressionniste des changements en cours dans les
politiques sociales pour montrer qu’elles sont en plein changement. Il n’a pas parlé des
conséquences de ces modifications pour le travail social, laissant cette partie à la discussion.
Le Prof. Tabin a commencé son exposé en montrant comment les programmes d’aide sociale
ont récemment été modifié en France, au Brésil, aux États-Unis et en Suisse.
Quatre exemples : la France, le Brésil, les États-Unis et la Suisse
En France, le RMI (revenu minimum d’insertion) a été remplacé par le RSA (revenu de
solidarité active). Le changement de dénomination indique un changement de focus, on passe
d’un droit à l’insertion (sociale, professionnelle, etc.) à la promotion de l’activité. Il s’agit
d’une activité professionnelle, si modeste soit-elle, l’État postulant qu’il est souhaitable de
pouvoir cumuler à la fois un emploi et une allocation d’assistance. Avec le RSA on officialise
un nouveau statut : celui de travailleur précaire assisté. Désormais, tous les allocataires
doivent adhérer à un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE), et un éventail de
sanctions est prévu pour les obliger à le respecter. L’idée est que l’emploi est supérieur à tout
autre statut, car il rend indépendant.
Au Brésil, le gouvernement a adopté en 2003 la « bolsa familia » (la bourse des familles). Il
s’agit d’un programme d’aide sociale conditionnelle. L’aide dépend d’un engagement à
respecter des prescriptions sanitaires (suivi pré- et postnatal, plans de vaccination…) et
scolaires (assiduité à l’école). Ce programme soutenu par la Banque mondiale, la Banque
interaméricaine de développement et différents organismes financiers part de l’idée qu’on
peut changer les comportements et qu’il est socialement intéressant d’investir dans les
familles. Une famille qui ne respecte pas les conditions imposées perd son droit à l’allocation.
Le programme transforme donc le droit en prescription morale : il faut se comporter d’une
manière prescrite pour obtenir une aide financière.
Aux États-Unis, le gouvernement a complètement changé les règles de l’aide sociale fédérale
(welfare) en 1995. Deux principes régissent désormais cette aide sociale : il s’agit d’un droit
limité (à 5 ans au cours d’une vie) et les allocataires du welfare ou leur famille doivent fournir
une contre-prestation de 30 heures par semaine. Le droit est donc assorti de conditions de
comportement et l’État postule qu’une personne, après une aide (autrement dit, un
investissement), peut s’en sortir de manière indépendante.
En Suisse, le premier volet de la 6e révision de l’AI est entré en vigueur en 2012. Un des
objectifs de cette révision est de favoriser la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de
rente, l’objectif chiffré du Conseil fédéral étant de supprimer 12’500 rentes entières.
L’objectif du volet 6b, qui devrait entrer en vigueur en 2015, est de favoriser l’activité
lucrative des personnes qui perçoivent une rente et d’améliorer la réadaptation des personnes
1
Parcours de Monsieur Tabin : éducateur spécialisé, licence et doctorat en politiques sociales.

2
souffrant de troubles psychiques. Il s’agit de développer le potentiel sous-exploité des
personnes invalides. Ces révisions partent du principe que l’emploi est supérieur à la rente,
diagnostiquent que le système actuel engendre des incitations négatives à l’emploi et que
nombre de personnes, si elles reçoivent les bonnes mesures (vus comme de bons
investissements), pourront vivre de manière indépendante.
À partir de ces 4 exemples, le Prof. Tabin propose de réfléchir à la notion d’« indépendance »
et à celle d’« investissement ».
L’indépendance
Une des idées sous-jacentes est que la dépendance (de l’aide sociale ou de l’assurance) est
négative et qu’il s’agirait d’un état à la fois transitoire et dépassable. On trouve l’idée d’une
frontière entre personnes indépendantes et les autres. Or, l’indépendance est une fiction,
personne n’est indépendant. La dépendance est même éminemment positive car elle incarne la
profondeur des relations sociales. Nous dépendons les uns des autres dans une société
marquée par la division du travail, c’est ce qu’a montré déjà à la fin du XIXe siècle le
sociologue Émile Durkheim.
Aujourd’hui, tout se passe comme si la dépendance était synonyme d’exclusion. Autour de la
connotation négative de la dépendance, c’est la figure du salarié qui est valorisée comme
modèle de l’autonomie et de l’utilité sociale. Or, cette situation concerne en Suisse moins de
la moitié de la population. Les personnes âgées, les enfants, les jeunes en formation, les
personnes qui s’occupent à plein-temps de leur ménage, les invalides, les personnes au
chômage ne sont pas indépendantes financièrement. Et même parmi les salariés, et encore
davantage parmi les salariées, nombre de personnes n’ont pas un salaire suffisant pour
s’entretenir et doivent recourir à l’aide sociale.
Est-ce donc opportun de valoriser l’emploi quelle que soit sa qualité ou son sens ? N’importe
quel emploi n’est pas un bon emploi et l’univers des possibles ne se résume pas à l’emploi.
L’investissement
Les choix en matière de politiques sociales sont désormais guidés par l’idée de
l’investissement social. Qui dit investissement dit également retour sur investissement. Ce
discours sur l’investissement social se généralise depuis les années 2000, un de ses grands
inspirateurs est Tony Blair. Son idée est qu’il vaut mieux vaut donner de l’argent à quelqu’un
pour qu’il devienne indépendant que de le laisser dans une situation de dépendance. Ce
discours s’accompagne d’une critique des politiques sociales actuelles dont la fonction est
principalement d’assurer un droit de vivre à toutes les personnes appartenant à la société.
Aujourd’hui, c’est la logique économique qui est de mise. Cette logique envisage les
politiques sociales en termes financiers uniquement (le chômage, la vieillesse, l’invalidité, la
maladie… coûtent) et fait l’impasse sur les raisons sociales qui expliquent que l’on ait
aujourd’hui un État social. L’assurance chômage a été mise en place pour stabiliser les
salariés en cas de crise, l’assurance accident pour socialiser les conséquences des accidents du
travail, etc.
Les promoteurs de l’investissement social préconisent des dépenses dans l’enfance (pour
former les futurs salarié·e·s), dans les mères (pour leur permettre de concilier emploi et vie
familiale) et dans les familles (comme lieu de socialisation à l’emploi). Il s’agit également de
favoriser l’augmentation de la natalité, car le vieillissement de la population va générer des
problèmes de financement des retraites. On peut selon eux au contraire diminuer les dépenses
qui ne sont pas intéressantes du point de vue de l’investissement, par exemple on peut retarder
l’âge de la retraite, diminuer les allocations d’aide sociale pour rendre l’emploi plus attractif
(ou du moins l’emploi non attractif plus attractif), couper dans les budgets de la santé.

3
Conclusion
Les logiques économiques deviennent dominantes dans les politiques sociales sans que cela
ne suscite pour l’instant beaucoup d’oppositions. Les effets sociaux de ces changements ne
sont pas connus, et il faudra les mesurer.
La question posée en conclusion par le Prof Tabin est : « N’est-ce pas une des tâches du
travail social que de les documenter, voire de s’y opposer ? »
1
/
3
100%