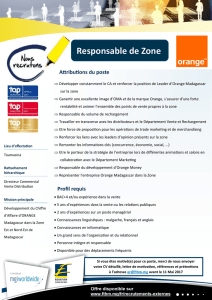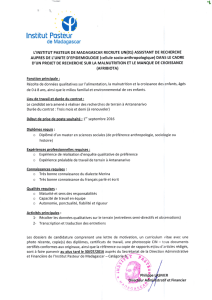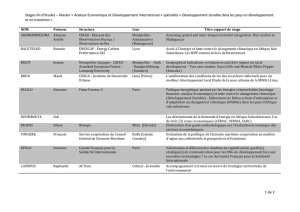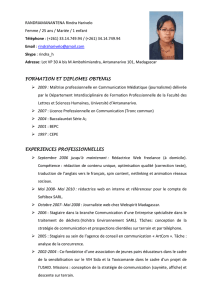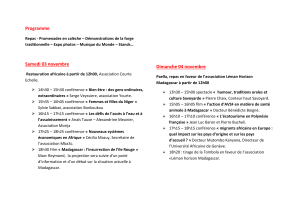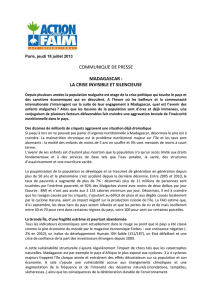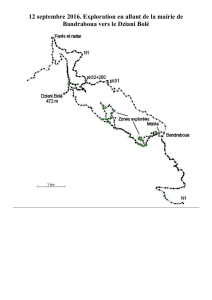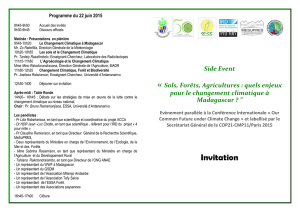M - Sud Expert Plantes

M.A.E., F.S.P. « Sud-Expert-Plantes »
Composante 3 : « Projets de recherche »
FICHE RESUME
Réservé au Secrétariat exécutif
Numéro
Recevable
Signature
Avis CR
SCAC
Avis
Expert 1
Avis
Final
K€
Avis CS
K€
Rapporteur
Avis
Expert 2
Avis
N° Dossier
381
Titre court
ECOSYSTEME FORESTIER MADAGASCAR
Titre
Approche de la dynamique des écosystèmes forestiers de Madagascar et des
Comores : application de la dendrochronologie aux espèces et aux forêts du domaine
occidental malgache et comoriennes
Thème
Ecosystèmes forestiers
Mots clés
dynamique des écosystèmes, âge des arbres, dendrochronologie, dendroécologie, gestion durable
des écosystèmes, Madagascar, Comores
Région(s)
Océan indien
Pays
Madagascar, Comores
Coordinateur
Edmond ROGER / Pascal DANTHU
Institution
Université Antananarivo/Cirad/ URP Forêts et Biodiversité
Courriel
rogeredmond1@yahoo.fr
Téléphone
032-07-411-10
% temps
cumulé
35
Equipes
Pays
Nb chercheurs
& enseignants
Total
chercheurs &
enseig. cherch.
en équivalent
temps plein
Nb étudiants
en Master
Nb étudiants
en Thèse
URP Forêts et
Biodiversité (Université
d’Antananrivo, Fofifa et
Cirad)
Madagascar
10
1.5
2
4
Université des Comores
Comores
2
0.2
1
Budget total (€)
Contribution SEP
Autres financements
150 000
50 000
Projet Corus en phase
d’acceptation
Utilisation de la contribution SEP (€)
Total
Salaires
temporaires
Bourses
Equipement
Missions
terrain
Autres
missions
Fonctionnement
hors missions
50 000
10 000
5 000
6 000
12 000
10 000
7 000
Durée (années)
3

PARTENARIAT
Liste des chercheurs impliqués dans le projet
Nom
Prénom
Laboratoire (nom complet)
Adresse et E mail
% temps
Madagascar
Mr
ROGER
Edmond
Université d’Antananarivo
Faculté des Sciences
rogeredmond1@yahoo.fr
20
Mme
RAKOUTH
Bakolimalala
Université d’Antananarivo
Faculté des Sciences
ba.rakouth@simicro.mg
10
Mme
ANDRIANOELISOA
Hanitra
Fofifa
DRFP
hanitrashn@hotmail.com
15
Mme
RALAMBOFETRA
Eliane
Université d’Antananarivo
Faculté des Sciences
ralambofetra@yahoo.fr
10
Mr
RABEVOHITRA
Raymond
Fofifa
DRFP
rabevohitra_raymond@yahoo.fr
15
Mr
RAKOTOVAO
Georges
Fofifa
DRFP
cdrfp_fofifa@yahoo.fr
20
Mr
RAKOTONDRAOELINA
Hery
Fofifa
DRFP
rakotondraoelina@hotmail.com
10
Mr
RANDRIANJAFY
Honoré
Fofifa
DRFP
cdrfp_fofifa@yahoo.fr
10
Comores
Mr
SOULÉ
Hamidou
Université des Comores
Faculté des Sciences
soulehamidou@yahoo.fr
20
Mr
DAROUSSI
Mohamed
Université des Comores
Faculté des Sciences
appui
Madagascar/France
Mr
COLLAS
Philippe
URP Forêts et Biodiversité
Antananarivo, Madagascar
10
Mr
DANTHU
Pascal
URP Forêts et Biodiversité
Antananarivo, Madagascar
15

Noms des autres personnes impliquées dans ce projet
Mr,
Mme
Nom
Prénom
Institution & Laboratoire
Courriel
% temps
Mr
GERARD
Jean
UPR Valorisation des bois
Cirad, Montpellier
appui
Mr
CHAIX
Gilles
UPR Génétique forestière
Cirad, Montpellier
appui
Mr
CARCAILLET
Christopher
Centre de BioArchéologie et d'Ecologie,
Montpellier
christopher.carcaillet@univ-montp2.fr
appui
Mr
BARTHELAT
Fabien
DAF-SEF Station de Coconi
Mamoudzou, Mayotte
fabien.barthelat@agriculture.gouv.fr
appui
Mr
URBINATI
Carlo
Università Politecnica delle Marche,
Padoue, Italie
c.urbinati@univpm.it
appui
Mr
CARRER
Marco
Università degli Studi, Pdoue, Italie
Padova
marco.carrer@unipd.it
appui
- Noms des Ingénieurs et techniciens participant :
RAHAJANIRINA Voninavoko, botaniste
RAKOTOARISOA Emilson, technicien forestier
RAMAHAFALY Wilfred, pépiniériste
BENJA Rakotonirina, pépiniériste
MOHAMED Andyliat, botaniste
- Nom des Post-doctorants participant :
LEONG POCK TSY Jean Michel
GANDOLFI Nicola
- Noms des étudiants en Master participant :
trois stages pratiques pour des étudiants de master seront proposés dans la durée du projetUniversité des Comores
Faculté des Sciences
- Nom des doctorants participant :
RAZAFIMAMONJY Nivo (Université d’Antananarivo), thèse en cours
RAZANAMEHARIZAKA Juvet (Université d’Antananarivo), thèse en cours
SOULE Hamidou (Université des Comores), thèse débutant
RAKOTOBE Miarantsoa (Université d’Antananarivo), thèse débutant

4/15
DESCRIPTION
1. Contexte et justification
Les Mascareignes sont classées parmi les principaux centres de biodiversité de la planète. Au cours des derniers
siècles, la forêt malgache et comorienne a été l’objet de nombreuses altérations essentiellement d’origine humaine :
feux de pâturage et feux de brousse, défrichement pour culture sur brûlis (tavy), production de charbon de bois et
récolte de bois d'œuvre. Aujourd’hui, on estime que la végétation primaire ne couvre plus que 9.9% du territoire
malgache (Kull, 2000 ; Myers et al. 2000).
Ce constat est connu depuis plus d'un siècle (Perrier de la Bâthie, 1921). Très tôt le discours des naturalistes a incité
l’administration à prendre des mesures afin d’enrayer la destruction des écosystèmes. A Madagascar, la réponse a
tenu en deux points majeurs : la promulgation d’un corpus législatif très répressif (codes forestiers de 1900, 1913 et
1930) et dès 1927 la création d’un réseau d’aires protégées dont le but était de créer « de véritables sanctuaires où
la flore et la faune seraient respectées en tout intégrité, où se conserveraient des milliers d’espèces végétales non
encore décrites, des bois précieux, des essences d’utilités diverses pour l’industrie, la pharmacie », ces réserves
étant « affranchies de tous droits d’usage, fermées à la chasse, la pêche, l’exploitation minière, la récolte des
produits naturels » (Petit, 1928 ; Lavauden 1934).
Selon la FAO (2001) 20% du territoire malgache sont couverts de forêts. Aux Comores, seuls 4% du territoire sont
forestiers, avec un taux de régression annuel record de -4,3%. Le réseau actuel des aires protégées à Madagascar
représente environ 3% de la surface du pays (1,7 millions de km²) et le Président de la République malgache s’est
engagé en 2003, au Congrès mondial des Aires protégées à Durban de porter cette surface à 6 millions d’hectare
avant 2008. (Angap, 2003 ; Ingram et al. 2005). Plus récemment, l'octroi de tout nouveau permis d'exploiter est
suspendu depuis le 18 octobre 2004 sur 45 % de la surface forestière, tandis que 12% de cette surface est déjà
incluse dans les aires protégées.Aux Comores, le système d’aires protégées forestières n’existe pas encore
Bien que les feux de végétation continuent à parcourir l'île, malgré les chiffres de la déforestation avancés (200 à
300 mille hectares annuellement) (Kull, 2000) et malgré la très forte réduction des autorisations d'exploiter,
l'Observatoire du Secteur Forestier note en juillet 2006 que " [...] les différents entrepôts des commerces de bois,
observés au niveau des principales villes du pays, se trouvent néanmoins bien approvisionnés". Cette persistance
de produits forestiers sur les marchés intérieurs en dépit de toutes les mesures de rétorsion des activités humaines
en forêt amène donc objectivement à poser les termes d’un paradoxe qui pourrait s’expliquer par différentes
hypothèses dont :
- les aires protégées sont encore le siège de prélèvements qui seraient dans ce cas illicites,
- il reste encore suffisamment de formations forestières en dehors de ces aires protégées pouvant répondre à
la demande et les accroissements naturels de ces formations forestières plus ou moins anthropisées
couvrent pour l’instant (durablement ou pas) les prélèvements en produits ligneux.
La première hypothèse est envisagée dans différentes études en cours, aussi la présente proposition est elle centrée
sur l'examen de la seconde hypothèse. Elle a donc pour finalité d’apporter des éléments objectifs concernant les
dynamiques des écosystèmes forestiers malgaches et comoriens.
.
2. Objectifs
Les objectifs généraux de la proposition en terme de contribution au développement et à la recherche sont les
suivants :
- L'objectif de développement est d’évaluer les niveaux de production ligneuse tant au niveau de
l’écosystème que pour quelques espèces ligneuses utiles et/ou menacées,
- L'objectif de recherche est de mettre en évidence des marqueurs de l’histoire environnementale
malgache et des indicateurs des changements naturels et/ou d’origine anthropique sur la dynamique des
écosystèmes.

5/15
Plus spécifiquement, en utilisant la dendrochronologie comme descripteur de l'histoire individuelle et collective des
arbres d'un écosystème, la proposition apportera des moyens d'exploration des dynamiques forestières naturelles ou
anthropisées. Ces données manquent effectivement fortement au point que se développent des discours
idéologiques quant à la croissance des espèces ou à l'histoire des forêts. La recherche a pour objectif de fournir des
données objectives au service de politiques fondées.
Se basant sur le raisonnement selon lequel pour prévoir l'évolution des écosystèmes il est impératif d'en connaître
l'histoire, les données qui seront acquises permettront de dégager les potentiels de développement des ressources
utiles et d'en déduire des modalités de gestion durable des prélèvements
3. Résumé
Quel âge a un palissandre ayant atteint le diamètre minimum d’exploitabilité ? Quel est l’accroissement moyen
annuel de la forêt caducifoliée de l’ouest de Madagascar ? Quels âges ont les baobabs de Morondava ? Quelle est la
dynamique de croissance des Dalbergia et des Ocotea malgaches et comoriens ? Peut-on utiliser ces arbres
longévifs comme des témoins de l’histoire environnementale des Mascareignes ? Ces questions, certaines très
appliquées, d’autres plus fondamentales, n’ont à l’heure actuelle aucune réponse fiable.
Notre projet se propose d’apporter des éléments d’informations objectives et plus généralement proposer une
évaluation raisonnable des dynamiques des écosystèmes forestiers malgaches et comoriens.
Afin d’approcher les dynamiques forestières, nous nous proposons de développer nos investigations à deux
niveaux : écosystémique et générique en focalisant sur les forêts sèches de l’Ouest malgache et quelques espèces
comoriennes du domaine des forêts humides sempervirentes.
Ce projet adaptera les outils et méthodes de la dendrochronologie (analyse des séquences de cernes annuels de
croissance) et de la dendroécologie aux espèces tropicales afin d’évaluer les dynamiques de production ligneuses
des écosystèmes et espèces étudiés et envisager une utilisation des ces espèces (et en particulier des espèces
longévives comme les baoabs) comme témoins de l’histoire de la dynamique forestière des Mascareignes.
.
4. Méthodologie
Afin d’approcher les dynamiques forestières, nous nous proposons de développer nos investigations à deux
niveaux : écosystémique et générique. Pour que le programme soit compatible avec les trois ans impartis au projet
et les moyens humains disponibles, nous proposons d’effectuer les choix simplificateurs suivants :
- disposer notre étude dans un seul des écosystèmes forestiers à Madagascar : les forêts sèches de l’ouest
et dans deux sites représentatifs de ces formations : la Forêt de Kirindy sur laquelle un grand nombre de
données floristiques et faunistiques ont déjà été capitalisées et le parc national d'Ankarafantsika où des
inventaires et des suivis écologiques sont disponibles. Le domaine occidental, de par une saison sèche
marquée, est plus propice à la possibilité de lecture de cernes.
- évaluer la capacité de transfert des outils mis au point pour le domaine occidental en focalisant sur
quelques espèces comoriennes du domaine des forêts humides sempervirentes.
- focaliser l’approche générique sur quatre genres choisis pour leur représentativité et/ou pour leur
implication dans des filières d’exploitation à Madagascar et aux Comores. En première approche le choix
se portera sur Dalbergia, Adansonia, Commiphora et Ocotea pour les motifs suivants :
actuellement, personne ne connaît avec certitude l’âge d’exploitabilité d’espèces nobles et à croissance
lente comme les palissandres. Il a bien été constaté la présence de cernes dans le bois, mais sans
qu’il ait été possible de définir leur origine, et en particulier sans savoir s’ils représentent des
cernes de croissance annuels,
les baobabs, espèces forestières par nature sont souvent les derniers vestiges de zones anciennement
forestières. Ils présentent dans de nombreux sites des déficits de régénération puisque les plus petits
diamètres présents sont de un mètre, mais on ignore encore quels ages ont ces plus petits individus. La
flore malgache contient sept espèces de baobabs et un travail récent d’inventaire vient de montrer que
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%